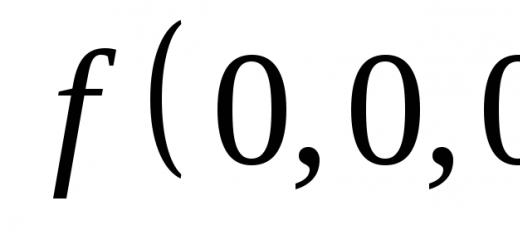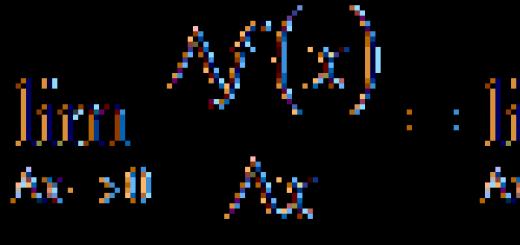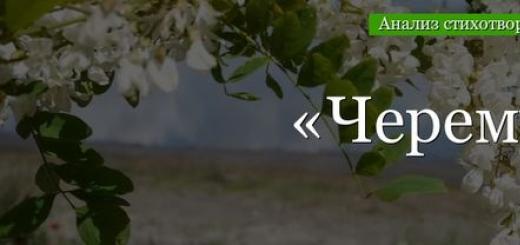Chemins : La comparaison est une expression figurative dans laquelle un phénomène, un objet ou une personne est comparé à un autre. Les comparaisons s'expriment de différentes manières : étui instrumental(« s'en va en fumée ») ; diverses conjonctions (comme si, exactement, comme si, etc.) lexicalement (en utilisant les mots similaire, similaire)




La périphrase est une expression descriptive. Une expression qui transmet de manière descriptive le sens d’une autre expression ou d’un autre mot. Ville sur la Neva (au lieu de Saint-Pétersbourg) Un oxymore est un trope qui consiste à combiner des mots qui nomment des concepts mutuellement exclusifs. Âmes mortes (N.V. Gogol) ; regarde, c'est amusant pour elle d'être triste (A.A. Akhmatova)


Épithète Une définition artistique qui dresse un tableau ou transmet une attitude envers ce qui est décrit est appelée une épithète (du grec épiton - application) : surface miroir. Les épithètes sont le plus souvent des adjectifs, mais souvent les noms font également office d'épithètes (« sorcière-hiver ») ; adverbes (« est seul »). Dans la poésie populaire, il y a des épithètes constantes : le soleil est rouge, le vent est violent.

N.V. Gogol
Diapositive 2
Les sentiers:
La comparaison est une expression figurative dans laquelle un phénomène, un objet, une personne est comparé à un autre.
Les comparaisons s'expriment de différentes manières :
- cas instrumental (« s'en va en fumée ») ;
- diverses conjonctions (comme si, exactement, comme si, etc.)
- lexicalement (en utilisant les mots similaire, similaire)
Diapositive 3
La métaphore et la personnification se construisent sur la base de la comparaison.
- Métaphore - (transfert grec) - transférer le nom d'un objet à un autre en fonction de leur similitude. Livre de vie, branches de mains, cercle d'amour
Diapositive 4
La personnification est un type de métaphore. Transférer les sentiments, les pensées et la parole d'une personne à des objets et des phénomènes inanimés, ainsi que lors de la description d'animaux.
Une goutte de pluie glissa sur une feuille de cassis rugueuse.
Diapositive 5
Métonymie - (du grec - renommer) - transfert d'un nom d'un objet à un autre, adjacent à celui-ci, c'est-à-dire proche de lui.
Tout le camp dort (A.S. Pouchkine)
Diapositive 6
La périphrase est une expression descriptive. Une expression qui transmet de manière descriptive le sens d’une autre expression ou d’un autre mot.
- Ville sur la Neva (au lieu de Saint-Pétersbourg)
Un oxymore est un trope qui consiste à combiner des mots qui nomment des concepts mutuellement exclusifs.
- Âmes mortes (N.V. Gogol) ; regarde, c'est amusant pour elle d'être triste (A.A. Akhmatova)
Diapositive 7
Hyperbole et litotes
- Des chemins à l'aide desquels un signe, une propriété, une qualité est soit renforcé, soit affaibli.
- Hyperbole : et le pin atteint l'étoile (O. Mandelstam)
- Litota : un petit homme (A. Nekrasov)
Diapositive 8
Épithète
- Une définition artistique qui dresse un tableau ou transmet une attitude envers ce qui est décrit est appelée une épithète (du grec épiton - application) : surface miroir.
- Les épithètes sont le plus souvent des adjectifs, mais souvent les noms font également office d'épithètes (« sorcière de l'hiver ») ; adverbes (« est seul »).
- Dans la poésie populaire, il y a des épithètes constantes : le soleil est rouge, le vent est violent.
Afficher toutes les diapositives
En 2016/17 année académique dans "l'Atelier Créatif Alcora", nous étudierons les moyens d'expression artistique utilisés dans la poésie, et nous organiserons même une nouvelle série de concours pédagogiques sur ce sujet sous Nom commun LES SENTIERS.
TROP est un mot ou une expression utilisé dans sens figuratif pour créer image artistique et atteindre une plus grande expressivité.
Les tropes incluent des dispositifs artistiques tels que l'épithète, la comparaison, la personnification, la métaphore, la métonymie, ils incluent parfois l'hyperbole et les litotes et un certain nombre d'autres. moyens expressifs. Aucune œuvre d’art n’est complète sans tropes. Un mot poétique est polysémantique ; le poète crée des images, jouant avec les sens et les combinaisons de mots, utilisant l'environnement du mot dans le texte et sa sonorité - tout cela constitue les possibilités artistiques du mot, qui est le seul outil du poète ou de l'écrivain.
Lors de la création de TROP, le mot est TOUJOURS UTILISÉ DANS UN SENS FIGURABLE.
Faisons connaissance avec les types de sentiers les plus connus.
1. ÉPITHÈTE
Une épithète est l'un des tropes, qui est une DÉFINITION artistique et figurative.
Une épithète peut être :
Adjectifs:
visage doux (S. Yesenin);
ces villages pauvres, cette nature maigre... (F. Tioutchev) ;
jeune fille transparente (A. Blok);
Participes :
terres abandonnées (S. Yesenin) ;
dragon frénétique (A. Blok) ;
décollage brillant (M. Tsvetaeva) ;
Noms, parfois accompagnés de leur contexte environnant :
Le voici, un chef sans escouades (M. Tsvetaeva) ;
Ma jeunesse! Ma petite colombe est sombre ! (M. Tsvetaeva).
Toute épithète reflète le caractère unique de la perception du monde de l'auteur, elle exprime donc nécessairement une sorte d'appréciation et a un sens subjectif : une étagère en bois n'est pas une épithète, puisqu'il n'y a pas de définition artistique ici, un visage en bois est une épithète exprimant l'impression du locuteur de l'expression du visage de l'interlocuteur, c'est-à-dire la création d'une image .
DANS oeuvre d'art une épithète peut remplir diverses fonctions :
- caractériser au sens figuré l'objet : yeux brillants, yeux en diamant ;
- créer une ambiance, une ambiance : matinée maussade ;
- transmettre l'attitude de l'auteur (conteur, héros lyrique) au sujet étant caractérisé : « Où ira notre farceur ? (A. Pouchkine) ;
- combiner toutes les fonctions précédentes (comme cela arrive dans la plupart des cas d'utilisation d'une épithète).
2. COMPARAISON
La comparaison est technique artistique(trope), dans lequel une image est créée en comparant un objet avec un autre.
La comparaison diffère des autres comparaisons artistiques, par exemple les comparaisons, en ce qu'elle a toujours un signe formel strict : une construction ou un chiffre d'affaires comparatif avec des conjonctions comparatives COMME, COMME, MOT, EXACTEMENT, COMME COMME SI et ainsi de suite. Des expressions comme IL ÉTAIT COMME... ne peuvent pas être considérées comme une comparaison comme un trope.
"Et les faucheuses élancées aux ourlets courts, COMME DES DRAPEAUX EN VACANCES, volent avec le vent" (A. Akhmatova)
"Ainsi, les images de fantasmes changeants, courant COMME DES NUAGES DANS LE CIEL, pétrifiées, vivent pendant des siècles dans une phrase aiguisée et complète." (V. Brioussov)
3. PERSONNALISATION
La personnification est une technique artistique (trope) dans laquelle des PROPRIÉTÉS HUMAINES sont attribuées à un objet, un phénomène ou un concept inanimé.
La personnification peut être utilisée de manière étroite, sur une seule ligne, dans un petit fragment, mais elle peut être une technique sur laquelle toute l'œuvre est construite (« Tu es ma terre abandonnée » de S. Yesenin, « Mère et le soir tués par les Allemands », « Le violon et un peu nerveusement » de V. Mayakovsky, etc.). La personnification est considérée comme l'un des types de métaphore (voir ci-dessous).
La tâche de la personnification est de corréler l'objet représenté avec une personne, de le rapprocher du lecteur, de comprendre au sens figuré l'essence intérieure de l'objet, cachée de la vie quotidienne. La personnification est l'un des moyens d'art figuratifs les plus anciens.
4. HYPERBOLE
L'hyperbole (exagération) est une technique dans laquelle une image est créée par exagération artistique. L'hyperbole n'est pas toujours incluse dans l'ensemble des tropes, mais de par la nature de l'utilisation du mot au sens figuré pour créer une image, l'hyperbole est très proche des tropes.
"Mon amour, comme un apôtre du temps, je détruirai les routes sur des MILLIERS DE MILLIERS..." (V. Maïakovski)
"Et le pin atteint les ÉTOILES." (O. Mandelstam)
La technique opposée à l'hyperbole dans le contenu est LITOTA (simplicité) - euphémisme artistique. Litota, c'est aussi la définition d'un concept ou d'un objet en niant l'inverse : « il n'est pas stupide » au lieu de « il est intelligent », « c'est bien écrit » au lieu de « c'est bien écrit »
"Votre Poméranien est un adorable Poméranien, PAS PLUS QU'UN DÉ à coudre ! Je l'ai caressé partout ; comme une fourrure soyeuse !" (A. Griboïedov)
"Et en marchant surtout, dans un calme convenable, le cheval est conduit par la bride par un homme en grosses bottes, en manteau court en basane, en grosses mitaines... ET LUI-MÊME !" (A. Nekrassov)
L'hyperbole et les litotes permettent à l'auteur de montrer au lecteur sous une forme exagérée le plus traits de caractère objet représenté. L’hyperbole et les litotes sont souvent utilisés par l’auteur de manière ironique, révélant non seulement des aspects caractéristiques, mais également négatifs, du point de vue de l’auteur, du sujet.
5. MÉTAPHORE
La métaphore (transfert) est un type de trope dit complexe, un tour de parole dans lequel les propriétés d'un phénomène (objet, concept) sont transférées à un autre. Une métaphore contient une comparaison cachée, une comparaison figurative de phénomènes utilisant le sens figuré des mots ; ce à quoi l'objet est comparé n'est que sous-entendu par l'auteur. Il n’est pas étonnant qu’Aristote ait dit que « composer de bonnes métaphores signifie remarquer des similitudes ».
"Je ne me sens pas désolé pour les années perdues en vain, je ne me sens pas désolé pour l'ÂME DE LA FLEUR DE LILAS. UN BIRE ROWAN ROUGE BRÛLE DANS LE JARDIN, mais il ne peut réchauffer personne." (S. Yesenin)
"(...) Le firmament endormi a disparu, et à nouveau TOUT LE MONDE GELÉ ÉTAIT HABILLÉ DE LA SOIE BLEUE DU CIEL, RÉALISÉE PAR LE COFFRE NOIR ET DESTRUCTEUR DE L'ARME." (M. Boulgakov)
6. MÉTONYMIE
Métonymie (renommer) - un type de trope : une désignation figurative d'un objet selon l'une de ses caractéristiques, par exemple : boire deux tasses de café ; murmure joyeux; le seau s'est renversé.
"Ici la seigneurie est sauvage, sans sentiment, sans loi, APPROCHÉE d'elle-même par une vigne violente
Et le travail, et la propriété, et le temps du AGRICULTEUR..." (A. Pouchkine)
"Ici vous RENCONTREZ DES BARDODS SIDE, les seuls, portés avec un art extraordinaire et étonnant sous une cravate (...) Ici VOUS RENCONTREZ une merveilleuse MOUSTACHE, représentée par aucun stylo, aucun pinceau (...) Ici vous rencontrerez RENCONTREZ DES MANCHES DE DAMES sur la perspective Nevski ! (. ..) Ici vous rencontrerez le seul SOURIRE, un sourire au sommet de l'art, parfois tel qu'on peut fondre de plaisir (...)" (N. Gogol)
"J'ai lu volontiers APULEY (au lieu du livre d'Apulée "L'Âne d'or"), mais je n'ai pas lu Cicéron. " (A. Pouchkine)
" Giray était assis les yeux baissés, AMBRE fumait dans la bouche (au lieu de « pipe d'ambre ») (A. Pouchkine)
7. SYNECDOCHE
La SynEcdoche (corrélation, littéralement « co-compréhension ») est un trope, une sorte de métonymie, un dispositif stylistique dans lequel le nom du général est transféré au particulier. Moins souvent, au contraire, du particulier au général.
« Toute l'école s'est déversée dans la rue » ; "La Russie a perdu contre le Pays de Galles : 0-3",
L'expressivité de la parole dans un extrait du poème « Vasily Terkin » d'A.T. Tvardovsky est construite sur l'utilisation de la synecdoque : « À l'est, à travers la vie quotidienne et la suie // D'une prison sourde // L'Europe rentre chez elle // Le duvet d'un un lit de plumes dessus comme un blizzard // Et le soldat russe // Frère français, frère britannique // Frère polonais et tout à la suite // Avec amitié comme coupable // Mais ils regardent avec cœur..." - ici le nom généralisé d'Europe est utilisé à la place du nom des peuples habitant les pays européens ; Le singulier des noms « soldat », « frère français » et autres remplace leur pluriel. La synecdoque améliore l'expression de la parole et lui donne un sens généralisateur profond.
"Et on a entendu jusqu'à l'aube à quel point le Français se réjouissait" (M. Lermontov) - le mot "Français" est utilisé comme nom de l'ensemble - "Français" (un nom en singulier utilisé à la place d'un nom dans pluriel)
"Tous les drapeaux nous rendront visite (au lieu des "navires" (A. Pouchkine).
Les définitions de certains tropes sont controversées parmi les spécialistes de la littérature car les frontières entre elles sont floues. Ainsi, la métaphore, par essence, est presque impossible à distinguer de l'hyperbole (exagération), de la synecdoque, de la simple comparaison ou de la personnification et de l'assimilation. Dans tous les cas, il y a transfert de sens d’un mot à un autre.
Il n'existe pas de classification généralement acceptée des tropes. Un ensemble approximatif des tropes les plus célèbres comprend des techniques de création de moyens d'expression telles que :
Épithète
Comparaison
Personnification
Métaphore
Métonymie
Synecdoque
Hyperbole
Litote
Allégorie
Ironie
Calembour
Pathétique
Sarcasme
Périphrase
Dysphémisme
Euphémisme
Nous parlerons de certains d'entre eux plus en détail au cours du processus de participation aux concours individuels de la série pédagogique « Parcours », mais pour l'instant rappelons-nous simplement le nouveau terme :
TROP (chiffre d'affaires) est une figure rhétorique, un mot ou une expression utilisé dans un sens figuré afin de renforcer le caractère figuré de la langue, expressivité artistique discours. Les tropes, en plus de la poésie, sont largement utilisés dans les œuvres littéraires en prose, dans art oratoire et dans le discours de tous les jours.
Poétique Mandelstam C'est beau dans le sens où les mots et les phrases figés, sous l'influence de sa plume, se transforment en images visuelles vivantes et enchanteresses remplies de musique. On disait de lui que dans sa poésie les « descentes concertées des mazurkas de Chopin » et les « parcs à rideaux de Mozart », « le vignoble musical de Schubert » et les « buissons bas des sonates de Beethoven », les « tortues » de Haendel et les « pages militantes de Bach » ont pris vie, et les violonistes de l'orchestre se sont enchevêtrés dans « des branches, des racines et des archets ».
Des combinaisons gracieuses de sons et de consonances sont tissées dans une mélodie élégante et subtile qui scintille de manière invisible dans l'air. Mandelstam se caractérise par un culte de l'impulsion créatrice et un style d'écriture étonnant. « Moi seul, j'écris avec ma voix », disait le poète de lui-même. Ce sont les images visuelles qui sont apparues initialement dans la tête de Mandelstam, et il a commencé à les prononcer silencieusement. Le mouvement des lèvres donne naissance à une métrique spontanée, envahie de grappes de mots. De nombreux poèmes de Mandelstam ont été écrits « avec la voix ».
Joseph Emilievich Mandelstam est né le 15 janvier 1891 à Varsovie dans une famille juive composée d'une marchande et gantiere, Emilia Mandelstam, et d'une musicienne, Flora Werblowska. En 1897, la famille Mandelstam s'installe à Saint-Pétersbourg, où le petit Osip est envoyé à la forge russe du « personnel culturel » du début du XXe siècle - l'école Tenishev. Après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1908, le jeune homme part étudier à la Sorbonne, où il étudie activement la poésie française - Villon, Baudelaire, Verlaine. Là, il rencontre et se lie d'amitié avec Nikolai Gumilyov. Parallèlement, Osip suit des cours à l'Université de Heidelberg. En arrivant à Saint-Pétersbourg, il assiste à des conférences sur la versification dans la célèbre « tour » de Viatcheslav Ivanov. Cependant, la famille Mandelstam commença progressivement à faire faillite et, en 1911, ils durent abandonner leurs études en Europe et entrer à l'Université de Saint-Pétersbourg. À cette époque, il y avait un quota d’admission pour les Juifs, ils devaient donc être baptisés par un pasteur méthodiste. Le 10 septembre 1911, Osip Mandelstam devient étudiant au département roman-germanique de la Faculté d'histoire et de philologie de l'Université de Saint-Pétersbourg. Cependant, il n'était pas un étudiant assidu : il manquait beaucoup, faisait des pauses dans ses études et, sans terminer ses cours, il quitta l'université en 1917.
À cette époque, Mandelstam s’intéressait à autre chose que l’étude de l’histoire, et son nom était Poésie. Gumilyov, de retour à Saint-Pétersbourg, invitait constamment le jeune homme à lui rendre visite, où il rencontra en 1911 Anna Akhmatova. L'amitié avec le couple poétique est devenue « l'une des principales réussites » de la vie du jeune poète, selon ses mémoires. Plus tard, il rencontra d'autres poètes : Marina Tsvetaeva. En 1912, Mandelstam rejoint le groupe Acmeist et assiste régulièrement aux réunions de l'Atelier des poètes.
La première publication connue a eu lieu en 1910 dans la revue Apollo, alors que le poète en herbe avait 19 ans. Plus tard, il a été publié dans les magazines "Hyperborea", "New Satyricon" et autres. Le premier recueil de poèmes de Mandelstam a été publié en 1913. "Pierre", puis réimprimé en 1916 et 1922. Mandelstam était au centre de la vie culturelle et poétique de ces années-là, visitant régulièrement le refuge de la bohème créative de ces années-là, le café d'art." chien sans abri", a communiqué avec de nombreux poètes et écrivains. Cependant, le charme beau et mystérieux de cette époque "intemporelle" allait bientôt se dissiper, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, puis avec l'avènement de la Révolution d'Octobre. Après cela, La vie de Mandelstam était imprévisible : il ne se sentait plus en sécurité. Il y eut des périodes où il vécut en pleine ascension : au début de la période révolutionnaire, il travailla dans les journaux, au Commissariat du peuple à l'éducation, voyagea à travers le pays, publia, parlait avec poésie. En 1919, au café "H.L.A.M" de Kiev, il rencontre sa future épouse, une jeune artiste, Nadezhda Yakovlevna Khazina, avec qui il se marie en 1922. Parallèlement, un deuxième recueil de poèmes est publié "Tristia"(« Élégies douloureuses ») (1922), qui comprenait des œuvres de l'époque de la Première Guerre mondiale et de la Révolution. En 1923 - "Le Deuxième Livre", dédié à sa femme. Ces versets reflètent l'angoisse de cette époque troublée et instable où Guerre civile, et le poète et sa femme ont erré dans les villes de Russie, d'Ukraine, de Géorgie, et ses succès ont été remplacés par des échecs : faim, pauvreté, arrestations.
Pour gagner sa vie, Mandelstam se livrait à des traductions littéraires. Il n'abandonna pas non plus la poésie et commença d'ailleurs à s'essayer à la prose. « Le bruit du temps » a été publié en 1923, « Le timbre égyptien » en 1927 et un recueil d'articles « De la poésie » en 1928. Au même moment, en 1928, paraît le recueil « Poèmes », qui devient le dernier recueil de poésie à vie. Des années difficiles attendent l'écrivain. Au début, Mandelstam fut sauvé grâce à l'intercession de Nicolas Boukharine. L’homme politique a préconisé le voyage d’affaires de Mandelstam dans le Caucase (Arménie, Soukhoum, Tiflis), mais « Voyage en Arménie », publié en 1933 sur la base de ce voyage, a suscité des articles dévastateurs dans la Gazette littéraire, la Pravda et Zvezda.
"Le début de la fin" commence après que Mandelstam, désespéré, ait écrit en 1933 l'épigramme anti-stalinienne "Nous vivons sans sentir le pays au-dessous de nous...", qu'il lit au public. Parmi eux se trouve quelqu’un qui dénonce le poète. L'acte, qualifié de « suicide » par B. Pasternak, conduit à l'arrestation et à l'exil du poète et de son épouse à Cherdyn (région de Perm), où Mandelstam, amené à un extrême épuisement émotionnel, est jeté par la fenêtre, mais est sauvé à temps. Ce n’est que grâce aux tentatives désespérées de Nadejda Mandelstam pour obtenir justice et à ses nombreuses lettres adressées à diverses autorités que les époux sont autorisés à choisir un endroit où s’installer. Les Mandelstam choisissent Voronej.
Les années de Voronej du couple sont sans joie : la pauvreté est leur amie constante, Osip Emilievich ne trouve pas de travail et se sent inutile dans un nouveau monde hostile. Des gains rares dans le journal local, le théâtre et l'aide possible d'amis fidèles, dont Akhmatova, lui permettent de supporter les difficultés d'une manière ou d'une autre. Mandelstam écrit beaucoup à Voronej, mais personne n'a l'intention de le publier. Les "Cahiers de Voronej", publiés après sa mort, constituent l'un des sommets de sa créativité poétique.
Cependant, les représentants Union soviétique les écrivains avaient une opinion différente sur cette question. Dans l’une des déclarations, les poèmes du grand poète ont été qualifiés d’« obscènes et calomnieux ». Mandelstam, qui fut inopinément libéré à Moscou en 1937, fut de nouveau arrêté et envoyé travailler dur dans un camp le Extrême Orient. Là, la santé du poète, ébranlée par un traumatisme mental, se détériore finalement et le 27 décembre 1938, il meurt du typhus dans le camp de Second River à Vladivostok.
Enterré dans une fosse commune, oublié et privé de tout mérite littéraire, il semble avoir prévu son sort dès 1921 :
Quand je tombe pour mourir sous une clôture dans un trou,
Et l'âme n'aura nulle part où échapper au froid de la fonte -
Je partirai poliment et tranquillement. Je me fondrai imperceptiblement dans les ombres.
Et les chiens auront pitié de moi en m'embrassant sous la clôture délabrée.
Il n'y aura pas de cortège. Les violettes ne me décoreront pas,
Et les jeunes filles ne répandront pas de fleurs sur la tombe noire...
Dans son testament, Nadezhda Yakovlevna Mandelstam a effectivement refusé Russie soviétique aucun droit de publier les poèmes de Mandelstam. Ce refus sonnait comme une malédiction contre l’État soviétique. Ce n’est qu’avec le début de la perestroïka que Mandelstam commença progressivement à être publié.
"Soirée Moscou" propose une sélection de beaux poèmes d'un merveilleux poète :
***
On m'a donné un corps, que dois-je en faire ?
Alors un et donc le mien ?
Pour la joie de respirer et de vivre tranquillement
Qui, dis-moi, dois-je remercier ?
Je suis jardinier, je suis aussi fleur,
Dans le donjon du monde, je ne suis pas seul.
L'éternité est déjà tombée sur le verre
Mon souffle, ma chaleur.
Un motif y sera imprimé,
Méconnaissable récemment.
Laisse couler la lie du moment -
Le joli motif ne peut pas être barré.
<1909>
***
La carie mince s'amincit -
tapisserie violette,
A nous - aux eaux et aux forêts -
Le ciel tombe.
Main hésitante
Ceux-ci ont fait ressortir les nuages.
Et le triste croise le regard
Leur motif est flou.
Insatisfait, je me lève et reste silencieux,
Moi, le créateur de mes mondes, -
Où les cieux sont artificiels
Et la rosée cristalline dort.
<1909>
***
Sur émail bleu pâle,
Ce qui est envisageable en avril,
Les bouleaux dressaient leurs branches
Et il commençait à faire nuit sans que l'on s'en aperçoive.
Le motif est net et petit,
Une fine maille s'est figée,
Comme sur une assiette en porcelaine
Le dessin, dessiné avec précision, -
Quand son artiste est mignon
S'affiche sur le solide vitreux,
Dans la conscience d'un pouvoir momentané,
Dans l'oubli d'une triste mort.
<1909>
***
Une tristesse indescriptible
Elle a ouvert deux grands yeux,
Vase fleur réveillé
Et elle a jeté son cristal.
Toute la pièce est ivre
L'épuisement est un médicament doux !
Un si petit royaume
Tant de choses ont été consommées par le sommeil.
Un peu de vin rouge
Un mois de mai un peu ensoleillé -
Et, cassant un fin biscuit,
Les doigts les plus fins sont blancs.
<1909>
***
Silentium
Elle n'est pas encore née
Elle est à la fois musique et paroles.
Et donc tous les êtres vivants
Connexion incassable.
Des mers de seins respirent calmement,
Mais la journée est lumineuse comme une folle.
Et de la mousse lilas pâle
Dans un vaisseau azur nuageux.
Que mes lèvres trouvent
Mutisme initial -
Comme une note de cristal
Qu'elle était pure de naissance !
Reste de l'écume, Aphrodite,
Et rends la parole à la musique,
Et ayez honte de votre cœur,
Fusionné du principe fondamental de la vie !
< 1910>
***
Ne demande pas : tu sais
Cette tendresse est inexplicable,
Et comment appelles-tu
Mon appréhension est toujours la même ;
Et pourquoi se confesser ?
Quand irrévocablement
Mon existence
As-tu décidé?
Donne-moi ta main. Que sont les passions ?
Des serpents qui dansent !
Et le mystère de leur pouvoir -
Aimant tueur!
Et la danse inquiétante du serpent
Je n'ose pas m'arrêter
Je contemple le gloss
Les joues de la jeune fille.
<1911>
***
Je frissonne de froid -
Je veux m'engourdir !
Et l'or danse dans le ciel -
M'ordonne de chanter.
Tomish, musicien anxieux,
Aime, souviens-toi et pleure,
Et, jeté d'une sombre planète,
Ramassez la balle facile !
Donc elle est réelle
Connexion avec le monde mystérieux !
Quelle mélancolie douloureuse,
Quel désastre!
Et si, après avoir bronché à tort,
Toujours scintillant
Avec ta goupille rouillée
La star m'aura-t-elle ?
<1912>
***
Non, pas la lune, mais un cadran lumineux
Brille sur moi - et quelle est ma faute,
De quelles étoiles faibles je ressens le lait ?
Et l’arrogance de Batyushkova me dégoûte :
Quelle heure est-il, lui a-t-on demandé ici,
Et il répondit aux curieux : l'éternité !
<1912>
***
Bach
Ici les paroissiens sont des enfants de la poussière
Et des tableaux au lieu d'images,
Où est la craie - Sebastian Bach
Seuls des nombres apparaissent dans les psaumes.
Un grand débatteur, vraiment ?
Je joue mon choral à mes petits-enfants,
Soutien de l'esprit en effet
Avez-vous cherché une preuve ?
Quel est le son ? Seizièmes,
Cri d'organa polysyllabique -
Juste ta grogne, rien de plus,
Oh, vieil homme intraitable !
Et un prédicateur luthérien
Sur sa chaire noire
Avec le vôtre, interlocuteur en colère,
Le son de vos discours interfère.
<1913>
***
"Glace!" Soleil. Génoise aérée.
Un verre transparent avec de l'eau glacée.
Et dans le monde du chocolat avec une aube vermeille,
Les rêves s'envolent vers les Alpes laiteuses.
Mais en faisant tinter la cuillère, c'est touchant de regarder -
Et dans un belvédère exigu, parmi les acacias poussiéreux,
Acceptez favorablement les grâces de la boulangerie
Dans une tasse complexe se trouvent des aliments fragiles...
L'ami de l'orgue de Barbarie apparaîtra soudainement
La couverture hétéroclite du glacier errant -
Et le garçon regarde avec une attention gourmande
La poitrine est pleine dans le froid merveilleux.
Et les dieux ne savent pas ce qu'il prendra :
Crème diamant ou gaufre farcie ?
Mais il disparaîtra vite sous un mince éclat,
Étincelante au soleil, glace divine.
<1914>
***
Insomnie. Homère. Voiles serrées.
J'ai lu la liste des navires au milieu :
Cette longue couvée, ce train de grues,
Cela s'élevait autrefois au-dessus de l'Hellas.
Comme le coin d'une grue dans les frontières étrangères, -
Sur la tête des rois il y a une écume divine, -
Où vas-tu? Chaque fois qu'Elena
Qu'est-ce que Troie seule pour vous, Achéens ?
La mer et Homère, tout bouge avec amour.
Qui dois-je écouter ? Et maintenant Homer se tait,
Et la mer noire, tourbillonnante, fait du bruit
Et avec un gros rugissement, il s'approche de la tête de lit.
<1915>
***
Je ne sais pas depuis quand
Cette chanson a commencé -
N'y a-t-il pas un voleur qui s'y cache ?
Le prince des moustiques sonne-t-il ?
je ne voudrais de rien
Parle encore
Bruisser avec une allumette, avec ton épaule
Remuer la nuit, se réveiller ;
Dispersez une botte de foin à table,
Un bonnet d'air qui languit ;
Déchirez, déchirez le sac,
Dans lequel le cumin est cousu.
À la connexion du sang rose,
Ces herbes sèches sonnent,
L'objet volé a été retrouvé
Un siècle plus tard, une grange à foin, un rêve.
<1922>
***
Je suis retourné dans ma ville, familier aux larmes,
Aux veines, aux glandes enflées des enfants.
Tu es de retour ici, alors avale-le vite
Huile de poisson des lanternes de la rivière Léningrad,
Découvrez bientôt le jour de décembre,
Où le jaune est mélangé au goudron menaçant.
Pétersbourg ! Je ne veux pas encore mourir !
Vous avez mes numéros de téléphone.
Pétersbourg ! j'ai encore des adresses
Par lequel je retrouverai les voix des morts.
J'habite dans les escaliers noirs, et à mon temple
Une cloche arrachée avec de la viande me frappe,
Et toute la nuit j'attends mes chers invités,
Déplacer les manilles des chaînes de porte.
<декабрь 1930>
***
Pour la valeur explosive des siècles à venir,
Pour la haute tribu du peuple
J'ai perdu même la coupe à la fête de mes pères,
Et amusant, et votre honneur.
Le siècle du chien-loup se précipite sur mes épaules,
Mais je ne suis pas un loup de sang,
Tu ferais mieux de me mettre comme un chapeau dans ta manche
Manteaux de fourrure chauds des steppes sibériennes.
Pour ne pas voir un lâche ou une saleté fragile,
Pas de sang dans la roue,
Pour que les renards bleus brillent toute la nuit
Pour moi dans sa beauté primitive,
Emmène-moi dans la nuit où coule le Yenisei
Et le pin atteint l'étoile,
Parce que je ne suis pas un loup de sang
Et seul mon égal me tuera.
<март 1931>
***
Oh comme nous aimons être des hypocrites
Et on oublie facilement
Le fait que nous soyons plus proches de la mort dans l'enfance,
Que dans nos années de maturité.
D'autres insultes sont tirées de la soucoupe
Enfant endormi
Et je n'ai personne à qui bouder
Et je suis seul sur tous les chemins.
Mais je ne veux pas m'endormir comme un poisson
Dans le profond évanouissement des eaux,
Et le libre choix m'est cher
Mes souffrances et mes soucis.
<февраль 1932>
SENTIERS (basés sur le sens lexical du mot)
Allégorie
- trope basé sur le remplacement concept abstrait ou un phénomène avec une image spécifique d'un objet ou un phénomène de réalité : médecine - un serpent enlaçant un bol, ruse - un renard, etc.
Hyperbole
- un trope basé sur une exagération excessive de certaines propriétés de l'objet ou du phénomène représenté :
Et le pin atteint les étoiles. (O. Mandelstam)
Métaphore
- un trope dans lequel des mots et des expressions sont utilisés dans un sens figuré basé sur l'analogie, la similitude, la comparaison :
Et mon âme fatiguée est enveloppée d'obscurité et de froid (M. Yu. Lermontov).
Comparaison
- un trope dans lequel un phénomène ou un concept est expliqué en le comparant à un autre. Des conjonctions comparatives sont généralement utilisées : Anchar, comme une redoutable sentinelle, est seul - dans l'univers entier (A.S. Pouchkine).
Métonymie
- un trope basé sur le remplacement d'un mot par un autre de sens similaire. Dans la métonymie, un phénomène ou un objet est désigné par d'autres mots ou concepts, tandis que leurs connexions et caractéristiques sont préservées : Le sifflement de verres mousseux et de punch, une flamme bleue (A. S. Pouchkine).
Synecdoque
- un des types de métonymie, qui repose sur le transfert de sens d'un objet à un autre en fonction de la relation quantitative entre eux : Et on entendit jusqu'à l'aube comment le Français se réjouissait (c'est-à-dire tout le armée française) (M. Yu. Lermontov).
Litote
- un trope opposé à l'hyperbole, un euphémisme artistique : Votre Spitz, votre adorable Spitz, n'est qu'un dé à coudre (A. Griboïedov).
Personnification
- un trope basé sur le transfert des propriétés des objets animés à des objets inanimés : la tristesse silencieuse sera consolé et la joie se reflétera de manière ludique (A.S. Pouchkine).
Épithète
- un mot qui définit un objet ou un phénomène et met l'accent sur l'une de ses propriétés, qualités, caractéristiques. Habituellement, l'épithète est utilisée pour décrire une définition colorée : Le crépuscule transparent de vos nuits réfléchies (A.S. Pouchkine).
Périphrase
- un trope dans lequel le nom direct d'un objet, d'une personne, d'un phénomène est remplacé par une expression descriptive, qui indique les signes d'un objet, d'une personne, d'un phénomène non directement nommé : le roi des bêtes est un lion.
Ironie
- une technique de ridicule qui contient une évaluation de ce qui est ridiculisé. Il y a toujours un double sens dans l'ironie, où la vérité n'est pas ce qui est directement exprimé, mais ce qui est implicite : le comte Khvostov, poète aimé du ciel, chantait déjà en vers immortels les malheurs des rives de la Neva (A.S. Pouchkine).
Chiffres stylistiques
(basé sur une structure syntaxique spéciale du discours)
Appel rhétorique
- donner à l'intonation de l'auteur solennité, pathétique, ironie, etc. : Ô vous, descendants arrogants... (M. Yu. Lermontov)
Une question rhétorique
- une structure de discours dans laquelle un énoncé s'exprime sous la forme d'une question. La question rhétorique n’exige pas de réponse, mais ne fait que renforcer l’émotivité de la déclaration : Et une belle aube se lèvera-t-elle enfin sur la patrie de la liberté éclairée ? (A.S. Pouchkine)
Anaphore
- répétition de parties de segments relativement indépendants, sinon l'anaphore est appelée unité de début : Comme si tu maudissais les jours sans lumière, comme si les nuits sombres t'effrayaient
(A. Apoukhtine).
Épiphora - répétition à la fin d'une phrase, d'une phrase, d'un vers, d'une strophe.
Antithèse
- une figure de style basée sur l'opposition : Et le jour et l'heure, tant à l'écrit qu'à l'oral, pour la vérité, oui et non... (M. Tsvetaeva).
Oxymoron
- combinaison de concepts logiquement incompatibles :
mort vivant, âmes mortes etc.
Gradation
- regroupement membres homogènes phrases dans un certain ordre : selon le principe de signification émotionnelle et sémantique croissante ou décroissante : je ne regrette pas, je n'appelle pas, je ne pleure pas (S. Yesenin).
Défaut
- une interruption délibérée de la parole en prévision de la supposition du lecteur, qui doit compléter mentalement la phrase : Mais écoutez : si je vous dois... Je possède un poignard, je suis né près du Caucase (A.S. Pouchkine).
Sujet nominatif (présentation nominative) - un mot au nominatif ou une phrase avec le mot principal au nominatif, qui se trouve au début d'un paragraphe ou d'un texte et dans lequel est indiqué le sujet d'une discussion ultérieure (le nom du le sujet est donné, qui sert de sujet de discussion ultérieure) : Lettres. Qui aime les écrire ?
Parcellation
- rupture volontaire d'un simple ou phrase complexe en plusieurs phrases distinctes afin d'attirer l'attention du lecteur sur le segment mis en évidence, pour lui donner (au segment) un sens supplémentaire : La même expérience doit être répétée plusieurs fois. Et avec beaucoup de soin.
Parallélisme syntaxique
- construction identique de deux ou plusieurs phrases, lignes, strophes, parties de texte :
DANS ciel bleu les étoiles brillent,
Les vagues éclaboussent la mer bleue.
(les phrases sont construites selon le schéma suivant : lieu adverbial avec attribut, sujet, prédicat)
Un nuage traverse le ciel, un tonneau flotte dans la mer. (A. S. Pouchkine) (les phrases sont construites selon le schéma : sujet, lieu adverbial, prédicat)
Inversion
- violation de la séquence grammaticale généralement acceptée du discours : La voile solitaire devient blanche dans le brouillard bleu de la mer.
(M. Yu. Lermontov) (selon les règles de la langue russe : Une voile solitaire devient blanche dans le brouillard bleu de la mer.)