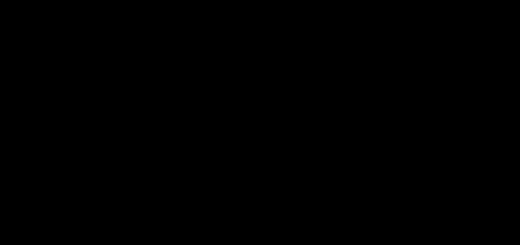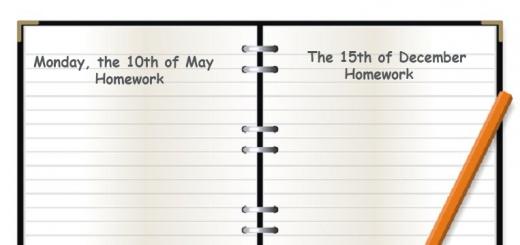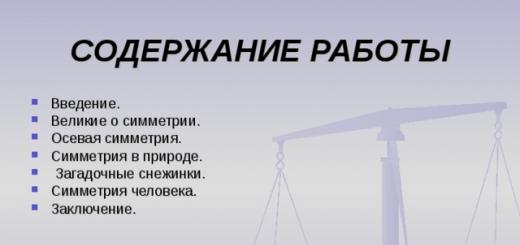Dans sa forme la plus générale et systématique, la théorie structure chimique(en abrégé TCS) a été formulé pour la première fois par le chimiste russe A. M. Butlerov en 1861, puis développé et complété par lui et ses étudiants et disciples (principalement V. V. Markovnikov, A. M. Zaitsev, etc.), ainsi que par de nombreux chimistes étrangers (Y. G. van' (t Hoff, J. A. Le Bel, etc.).
Considérons les principales dispositions du TCS classique et commentons-les du point de vue de la chimie structurale moderne.
1. Chaque atome d'une molécule est capable de former un certain nombre liaisons chimiques avec d'autres atomes.
Déjà dans la première moitié du XIXe siècle. En chimie, des idées se sont formées sur la capacité des atomes à se connecter les uns aux autres dans certaines relations. Selon Butlerov, chaque atome « est inné avec une certaine force qui produit des phénomènes chimiques (affinité). Dans une combinaison chimique, une partie ou la totalité de cette force est consommée. Cela a mis l'accent sur deux caractéristiques de l'interatomique interaction chimique: a) discrétion - toute l'affinité inhérente à un atome était censée être composée de parties séparées ou, selon Butlerov, d'"unités individuelles de force chimique", ce qui était clairement exprimé par le symbolisme des traits de valence (par exemple, H-O-H, H-C≡N et etc.), où chaque trait caractérisait une liaison chimique ; b) saturation - le nombre de liaisons chimiques formées par un atome est limité, c'est pourquoi il existe, par exemple, des systèmes moléculaires neutres de stabilité variable tels que CH, CH2, CH3, CH4, mais il n'y a pas de molécules CH5, CH6, etc.
Une mesure quantitative de la capacité d’un atome à former des liaisons chimiques est sa valence. Formation dans les années 1850 les concepts de valence et de liaison chimique ont constitué la condition préalable la plus importante à la création du TCS. Cependant, jusqu'au début du 20e siècle. signification physique l'accident vasculaire cérébral de valence, et donc la nature de la liaison chimique et de la valence, est restée floue, ce qui a parfois conduit à des paradoxes. Ainsi, en étudiant les propriétés des hydrocarbures insaturés, Butlerov a accepté en 1870 l'idée du chimiste allemand E. Erlenmeyer sur l'existence de liaisons multiples en eux. Entre-temps, on ne sait toujours pas pourquoi la liaison multiple s'est avérée moins forte (soumise aux réactions d'addition) que la liaison simple (non impliquée dans ces réactions). Il y avait d'autres preuves que certaines ou toutes les liaisons chimiques dans la molécule n'étaient pas égales.
Avec création chimie quantique Il est devenu clair que chaque ligne de valence correspond, en règle générale, à une liaison à deux centres et à deux électrons et que les liaisons chimiques peuvent différer en énergie, longueur, polarité, polarisabilité, direction dans l'espace, multiplicité, etc. (voir Liaison chimique ).
Le concept de liaison chimique implique la division des atomes d'une molécule en chimiquement liés et chimiquement non liés (voir figure), d'où découle la deuxième position du TCS.
H/O\H Atomes liés chimiquement
Atomes chimiquement non liés
2. Les atomes d’une molécule sont liés les uns aux autres dans un certain ordre, selon leur valence. C'était « l'ordre d'interaction chimique » ou, en d'autres termes, « la méthode de liaison chimique mutuelle » des atomes dans une molécule, que Butlerov appelait structure chimique. En conséquence, la structure chimique, clairement exprimée par une formule développée (parfois aussi appelée graphique, et en dernières années- topologique), montre quelles paires d'atomes sont chimiquement liées entre elles et lesquelles ne le sont pas, c'est-à-dire que la structure chimique caractérise la topologie de la molécule (voir Molécule). Dans le même temps, Butlerov a spécifiquement souligné que chaque composé n'a qu'une seule structure chimique et, par conséquent, une seule formule structurelle (graphique).
La position considérée du TCS est généralement valable aujourd’hui. Cependant, premièrement, ce n'est pas toujours structure moleculaire peut être véhiculé par une formule développée classique (voir Benzène), deuxièmement, dans les molécules non rigides, l'ordre des liaisons des atomes peut changer spontanément assez rapidement (voir Molécule), et troisièmement, la chimie moderne a découvert une large gamme de molécules avec des « propriétés inhabituelles ». " (par exemple, dans certains carboranes, un atome de carbone est lié à cinq atomes voisins).
3. Physique et Propriétés chimiques les composés sont déterminés à la fois par leur composition qualitative et quantitative, leur structure chimique, ainsi que par la nature des liaisons entre les atomes.
Cette disposition est centrale dans le TCS. Ce sont ses affirmations en chimie qui constituent le principal mérite scientifique de Butlerov. De cette position découlent un certain nombre de conséquences importantes : l'explication de l'isomérie par la différence dans la structure chimique des isomères, l'idée de l'influence mutuelle des atomes dans une molécule, ainsi que le sens et la signification des formules développées. de molécules est révélée.
En 1874, le TCS s'enrichit de concepts stéréochimiques (voir Stéréochimie), dans le cadre desquels il est possible d'expliquer les phénomènes d'isomérie optique, géométrique et conformationnelle (voir Isomérie).
En chimie moderne, le terme « structure moléculaire » est compris de trois manières : a) comme une structure chimique (c'est-à-dire la topologie de la molécule) ; b) comme une structure spatiale, caractérisant l'emplacement et le mouvement des noyaux dans l'espace ; c ) en tant que structure électronique (voir Molécule, Liaison chimique).
Ainsi, la position principale du TCS, d'un point de vue moderne, peut être présentée comme suit : les propriétés physiques et chimiques des composés sont déterminées par leur composition élémentaire quantitative et qualitative, ainsi que par les propriétés chimiques (topologiques), spatiales (nucléaires ) et la structure électronique de leurs molécules.
4. La structure chimique peut être étudiée méthodes chimiques, c'est-à-dire analyse et synthèse.
Développant cette position, Butlerov a formulé un certain nombre de règles pour « reconnaître la structure chimique » et les a largement appliquées dans ses travaux expérimentaux.
Actuellement, la structure des molécules est étudiée à la fois chimiquement et par des méthodes physiques(voir Analyse spectrale).
5. Les atomes inclus dans la molécule, à la fois chimiquement liés et non liés, ont une certaine influence les uns sur les autres, qui se manifeste dans la réactivité des atomes individuels et des liaisons de la molécule, ainsi que dans ses autres propriétés.
TCS, comme les autres théorie scientifique, est basé sur certains concepts de modèles qui ont un certain domaine d'applicabilité et ne reflètent que certains aspects de la réalité. Ainsi, en parlant de TCS, nous ne devons pas oublier qu'en réalité une molécule est un système intégral unique de noyaux et d'électrons, et que l'identification d'atomes individuels, de groupes fonctionnels, de liaisons chimiques, de paires d'électrons isolées, etc. Mais dès que cette approximation s’est avérée efficace pour résoudre divers problèmes chimiques, elle s’est généralisée. Dans le même temps, la dissection théorique, mentale, la structuration d'un objet (molécule) de nature intégrale nous oblige à introduire des idées supplémentaires dans la théorie, en tenant compte du fait que les fragments moléculaires sélectionnés (atomes, liaisons, etc.) sont réellement connectés et interagissent les uns avec les autres. À cette fin, le concept d'influence mutuelle des atomes (MIA) a été créé.
Les propriétés et l’état de chaque atome ou groupe fonctionnel d’une molécule sont déterminés non seulement par leur nature, mais aussi par leur environnement. Par exemple, l’introduction d’un groupe OH dans une molécule peut conduire à différents résultats :
Ainsi, lorsqu'on étudie la nature et l'intensité de l'influence de divers substituants sur les propriétés de la molécule, on procède comme suit : considérons des séries de réactions, c'est-à-dire un certain nombre de composés similaires qui diffèrent les uns des autres soit par la présence d'un substituant, soit par la présence d'un substituant. dans l'agencement de liaisons multiples, par exemple : CH2=CH-CH=CH-CH3, H2C=CH-CH2-CH=CH2, etc., ou selon certains autres détails structurels. Dans le même temps, ils étudient la capacité des substances de cette série à participer à des réactions similaires, par exemple, ils étudient la bromation du phénol et du benzène. Les différences observées sont attribuées à l’effet de différents substituants sur le reste de la molécule.
Quant aux composés organiques, l'un d'eux traits caractéristiques est la capacité d'un substituant à transférer son influence sur des chaînes d'atomes liés de manière covalente (voir Liaison chimique). Bien entendu, les substituants sont également influencés par le reste de la molécule. Le transfert de l'influence du substituant sur les liaisons a et l entraîne une modification de ces liaisons. Si l'influence des substituants est transmise avec la participation de liaisons a, alors le substituant présente un effet inductif ou effet I. S’il y a des liaisons π dans la chaîne, elles sont également polarisées (effet π). De plus, si la chaîne possède un système de liaisons multiples conjuguées (-C=C-C=C-) ou un substituant avec une seule paire d'électrons sur une liaison multiple (CH3-O-CH=CH2) ou sur un cycle aromatique, alors le transfert d'influence se produit le long d'un système de liaisons π (effet de conjugaison ou effet C), dans lequel le nuage électronique est partiellement déplacé vers la région de la liaison σ voisine. Par exemple, les substituants tels que -Br, -Cl, -OH, -NH2, qui ont des paires d'électrons libres, sont des donneurs d'électrons π. On dit donc qu’ils ont un effet +C. En même temps, ils déplacent la densité électronique vers eux-mêmes le long des liaisons σ, c'est-à-dire qu'ils ont un effet -I. Pour -Br, -Cl, l'effet I prédomine ; pour -OH et -NH2-, au contraire, l'effet +C prédomine. Par conséquent, disons que dans le phénol, la densité des électrons π sur le cycle benzénique est supérieure à celle du benzène, ce qui facilite l'apparition de réactions de substitution électrophile dans le phénol (par rapport au benzène).
La théorie de la structure chimique est également largement utilisée dans Pas chimie organique, surtout après la création de la théorie de la coordination par A. Werner en 1893 (voir Composés de coordination).
Diapositive 1>
Objectifs du cours :
- Éducatif:
- former des concepts sur l'essence de la théorie de la structure chimique des substances organiques, en s'appuyant sur les connaissances des étudiants sur la structure électronique des atomes d'éléments, leur position dans Tableau périodique DI. Mendeleïev, sur le degré d'oxydation, la nature de la liaison chimique et d'autres grands principes théoriques :
- la séquence d'arrangement des atomes de carbone dans la chaîne,
- influence mutuelle des atomes dans une molécule,
- dépendance des propriétés des substances organiques à la structure des molécules ;
- se faire une idée des progrès du développement des théories en chimie organique ;
- maîtriser les concepts : isomères et isomérie ;
- expliquer la signification des formules développées des substances organiques et leurs avantages par rapport aux formules moléculaires ;
- montrer la nécessité et les conditions préalables à la création d'une théorie de la structure chimique ;
- Continuez à développer vos compétences en matière de prise de notes.
- former des concepts sur l'essence de la théorie de la structure chimique des substances organiques, en s'appuyant sur les connaissances des étudiants sur la structure électronique des atomes d'éléments, leur position dans Tableau périodique DI. Mendeleïev, sur le degré d'oxydation, la nature de la liaison chimique et d'autres grands principes théoriques :
- Du développement:
- développer la réflexion techniques d'analyse, comparaisons, généralisations ;
- développer la pensée abstraite;
- entraîner l'attention des élèves lorsqu'ils perçoivent de grandes quantités de matériel ;
- développer la capacité d'analyser les informations et de mettre en évidence le matériel le plus important.
- Éducatif:
- à des fins d'éducation patriotique et internationale, fournir aux étudiants des informations historiques sur la vie et l'œuvre des scientifiques.
PENDANT LES COURS
1. Partie organisationnelle
- Salutations
– Préparer les élèves au cours
– Recevoir des informations sur les absents.
2. Apprendre de nouvelles choses
Plan du cours :<Annexe 1 . Diapositive 2>
I. Théories pré-structurelles :
– le vitalisme ;
– théorie des radicaux ;
– théorie des types.
II. Information brève sur l'état science chimique dans les années 60 du XIXème siècle. Conditions pour créer une théorie de la structure chimique des substances :
– la nécessité de créer une théorie ;
– les prérequis pour la théorie de la structure chimique.
III. L'essence de la théorie de la structure chimique des substances organiques A.M. Butlerov. Le concept d'isomérie et d'isomères.
IV. L'importance de la théorie de la structure chimique des substances organiques A.M. Butlerov et son développement.
3. Devoirs : résumé, paragraphe 2.
4. Conférence
I. Les connaissances sur les substances organiques se sont accumulées progressivement depuis l'Antiquité, mais la chimie organique n'est apparue comme science indépendante qu'au début du XIXe siècle. L'établissement de l'indépendance de la chimie organisationnelle est associé au nom du scientifique suédois J. Berzelius<Annexe 1
. Diapositive 3>. En 1808-1812 il publia son grand manuel de chimie, dans lequel il entendait initialement considérer, outre les minéraux, également les substances d'origine animale et végétale. Mais la partie du manuel consacrée aux substances organiques n'apparaît qu'en 1827.
J. Berzelius a vu la différence la plus significative entre les substances inorganiques et organiques dans le fait que les premières peuvent être obtenues par synthèse en laboratoire, tandis que les secondes sont censées se former uniquement dans les organismes vivants sous l'influence d'une certaine « force vitale » - un synonyme chimique. pour « âme », « esprit », « origine divine » des organismes vivants et de leurs substances organiques constitutives.
La théorie qui expliquait la formation de composés organiques par l’intervention de la « force vitale » s’appelait vitalisme. Elle fut populaire pendant un certain temps. En laboratoire, il a été possible de synthétiser uniquement les substances carbonées les plus simples, telles que le dioxyde de carbone - CO 2, le carbure de calcium - CaC 2, le cyanure de potassium - KCN.
Ce n'est qu'en 1828 que le scientifique allemand Wöhler<Annexe 1
. Diapositive 4> a réussi à obtenir la substance organique urée à partir d'un sel inorganique - cyanate d'ammonium - NH 4 CNO.
NH 4 CNO –– t –> CO(NH 2) 2
En 1854, le scientifique français Berthelot<Annexe 1
. Diapositive 5 > triglycéride reçu. Cela a nécessité un changement dans la définition de la chimie organique.
Les scientifiques ont essayé, sur la base de la composition et des propriétés, de démêler la nature des molécules des substances organiques, ils ont cherché à créer un système qui permettrait de relier entre eux les faits disparates qui s'étaient accumulés début XIX siècle.
La première tentative de création d'une théorie visant à généraliser les données disponibles sur les substances organiques est associée au nom du chimiste français J. Dumas.<Annexe 1
. Diapositive 6>. Il s'agissait d'une tentative de considérer d'un point de vue unifié un groupe assez large de composés organiques, que nous appellerions aujourd'hui dérivés de l'éthylène. Les composés organiques se sont avérés être des dérivés d'un radical C 2 H 4 - éthérine :
C 2 H 4 * HCl – chlorure d'éthyle (chlorhydrate d'étherine)
L'idée contenue dans cette théorie - l'approche d'une substance organique composée de 2 parties - a ensuite constitué la base d'une théorie plus large des radicaux (J. Berzelius, J. Liebig, F. Wöhler). Cette théorie est basée sur l'idée de la « structure dualiste » des substances. J. Berzelius a écrit : « toute substance organique est constituée de 2 Composants, portant une charge électrique opposée. J. Berzelius considérait l'oxygène comme l'un de ces composants, à savoir la partie électronégative, tandis que le reste, en réalité organique, aurait dû être un radical électropositif.
Dispositions de base de la théorie des radicaux :<Annexe 1 . Diapositive 7>
– la composition des substances organiques comprend des radicaux porteurs d'une charge positive ;
– les radicaux sont toujours constants, ne subissent pas de modifications, ils passent d'une molécule à l'autre sans modifications ;
– les radicaux peuvent exister sous forme libre.
Peu à peu, la science a accumulé des faits qui contredisaient la théorie des radicaux. C'est ainsi que J. Dumas a remplacé l'hydrogène par le chlore dans les radicaux hydrocarbonés. Il semblait incroyable aux scientifiques adeptes de la théorie radicale que le chlore, chargé négativement, puisse jouer le rôle de l'hydrogène, chargé positivement, dans les composés. En 1834, J. Dumas fut chargé d'enquêter sur un incident désagréable lors d'un bal dans le palais du roi de France : des bougies émettaient une fumée étouffante en brûlant. J. Dumas a établi que la cire à partir de laquelle les bougies étaient fabriquées était traitée au chlore par le fabricant pour la blanchir. Dans ce cas, le chlore est entré dans la molécule de cire, remplaçant une partie de l'hydrogène qu'elle contient. Les vapeurs suffocantes qui ont effrayé les invités royaux se sont révélées être du chlorure d'hydrogène (HCl). Par la suite, J. Dumas a obtenu l'acide trichloroacétique à partir de l'acide acétique.
Ainsi, l’hydrogène électropositif a été remplacé par le chlore, un élément extrêmement électronégatif, et les propriétés du composé sont restées presque inchangées. Puis J. Dumas a conclu que l'approche dualiste devait être remplacée par une approche de la connexion organisationnelle dans son ensemble.
La théorie radicale fut progressivement rejetée, mais elle laissa une profonde marque sur la chimie organique :<Annexe 1
. Diapositive 8>
– la notion de « radical » s'est solidement implantée en chimie ;
– l'affirmation sur la possibilité de l'existence de radicaux sous forme libre, sur la transition dans un grand nombre de réactions de certains groupes d'atomes d'un composé à un autre, s'est avérée vraie.
Dans les années 40 XIXème siècle L'étude de l'homologie a été initiée, ce qui a permis de clarifier certaines relations entre la composition et les propriétés des composés. Des séries homologues et des différences homologues ont été identifiées, ce qui a permis de classer les substances organiques. La classification des substances organiques basée sur l'homologie a conduit à l'émergence de la théorie des types (années 40-50 du XIXe siècle, C. Gérard, A. Kekule, etc.)<Annexe 1 . Diapositive 9>
L'essence de la théorie des types<Annexe 1 . Diapositive 10>
– la théorie repose sur une analogie dans les réactions entre les substances organiques et certaines substances inorganiques, acceptées comme types (types : hydrogène, eau, ammoniac, chlorure d'hydrogène, etc.). En remplaçant les atomes d'hydrogène dans le type de substance par d'autres groupes d'atomes, les scientifiques ont prédit diverses dérivés. Par exemple, le remplacement d’un atome d’hydrogène dans une molécule d’eau par un radical méthyle entraîne la formation d’une molécule d’alcool. La substitution de deux atomes d'hydrogène entraîne l'apparition d'une molécule d'éther<Annexe 1 . Diapositive 11>
C. Gérard a dit directement à ce propos que la formule d'une substance n'est qu'un enregistrement abrégé de ses réactions.
Toute l'org. les substances étaient considérées comme des dérivés de protozoaires substances inorganiques– hydrogène, chlorure d’hydrogène, eau, ammoniaque<Annexe 1 . Diapositive 12>
<Annexe 1 . Diapositive 13>
– les molécules de substances organiques sont un système constitué d'atomes dont l'ordre de connexion est inconnu ; les propriétés des composés sont influencées par la totalité de tous les atomes de la molécule ;
– il est impossible de connaître la structure d’une substance, puisque les molécules changent au cours de la réaction. La formule d’une substance ne reflète pas la structure, mais les réactions dans lesquelles la substance subit. Pour chaque substance, vous pouvez écrire autant de formules rationnelles qu’il existe de différents types de transformations que la substance peut subir. La théorie des types permettait une multiplicité de « formules rationnelles » pour les substances, en fonction des réactions qu'elles voulaient exprimer avec ces formules.
La théorie des types a joué un rôle majeur dans le développement de la chimie organique <Annexe 1 . Diapositive 14>
– a permis de prédire et de découvrir un certain nombre de substances ;
– a eu un impact positif sur le développement de la doctrine de la valence ;
– prêté attention à l'étude des transformations chimiques des composés organiques, ce qui a permis une étude plus approfondie des propriétés des substances, ainsi que des propriétés des composés prédits ;
- a créé une systématisation des composés organiques parfaite pour l'époque.
Nous ne devons pas oublier qu’en réalité les théories sont apparues et se sont remplacées non pas séquentiellement, mais existaient simultanément. Souvent, les chimistes ne se comprenaient pas bien. F. Wöhler affirmait en 1835 que « la chimie organique peut aujourd’hui rendre n’importe qui fou. Cela me semble une forêt dense pleine de choses merveilleuses, un immense fourré sans issue, sans fin, où l’on n’ose pas pénétrer… »
Aucune de ces théories n’est devenue la théorie de la chimie organique dans tous les sens mots. La principale raison de l'échec de ces idées était leur essence idéaliste : la structure interne des molécules était considérée comme fondamentalement inconnaissable, et toute spéculation à ce sujet était considérée comme du charlatanisme.
était nécessaire nouvelle théorie, qui se tiendrait sur des positions matérialistes. Cette théorie était théorie de la structure chimique A.M. Butlerov <Annexe 1 . Slides 15, 16>, qui a été créé en 1861. Tout ce qui était rationnel et précieux dans les théories des radicaux et des types a ensuite été assimilé par la théorie de la structure chimique.
La nécessité d'une théorie était dictée par :<Annexe 1 . Diapositive 17>
– des exigences industrielles accrues en matière de chimie organique. Il fallait approvisionner l’industrie textile en teintures. Afin de développer l’industrie alimentaire, il était nécessaire d’améliorer les méthodes de transformation des produits agricoles.
En relation avec ces problèmes, de nouvelles méthodes de synthèse de substances organiques ont commencé à être développées. Cependant, les scientifiques ont rencontré de sérieuses difficultés pour justification scientifique ces synthèses. Par exemple, il était impossible d’expliquer la valence du carbone dans les composés en utilisant l’ancienne théorie.
Le carbone nous est connu comme un élément à 4 valences (cela a été prouvé expérimentalement). Mais ici il semble retenir cette valence uniquement dans le CH4 méthane. Dans l'éthane C 2 H 6, si nous suivons nos idées, il devrait y avoir du carbone. 3-valent, et en propane C 3 H 8 - valence fractionnaire. (Et nous savons que la valence doit être exprimée uniquement en nombres entiers).
Quelle est la valence du carbone dans les composés organiques ?
On ne sait pas pourquoi il existe des substances avec la même composition, mais des propriétés différentes : C 6 H 12 O 6 - formule moléculaire du glucose, mais la même formule et du fructose (une substance sucrée - un composant du miel).
Les théories préstructurales ne pouvaient pas expliquer la diversité des substances organiques. (Pourquoi le carbone et l'hydrogène, deux éléments, peuvent-ils former de tels grand nombre différents composés ?).
Il était nécessaire de systématiser les connaissances existantes d'un point de vue unique et de développer un symbolisme chimique unifié.
Une réponse scientifiquement fondée à ces questions a été donnée par la théorie de la structure chimique des composés organiques, créée par le scientifique russe A.M. Butlerov.
Conditions de base, qui ont préparé le terrain pour l’émergence de la théorie de la structure chimique<Annexe 1 . Diapositive 18>
– la doctrine de la valence. En 1853, E. Frankland a introduit le concept de valence et a établi la valence pour un certain nombre de métaux en étudiant des composés organométalliques. Progressivement, la notion de valence s’est étendue à de nombreux éléments.
Une découverte importante pour la chimie organique a été l'hypothèse sur la capacité des atomes de carbone à former des chaînes (A. Kekule, A. Cooper).
L’une des conditions préalables était le développement d’une compréhension correcte des atomes et des molécules. Jusqu'à la 2ème moitié des années 50. XIXème siècle Il n'existait pas de critères généralement acceptés pour définir les concepts : « atome », « molécule », « masse atomique", "masse moléculaire". Ce n'est qu'au congrès international des chimistes de Karlsruhe (1860) que ces concepts ont été clairement définis, ce qui a prédéterminé le développement de la théorie de la valence et l'émergence de la théorie de la structure chimique.
Principes de base de la théorie de la structure chimique d'A.M. Butlerov(1861)
SUIS. Butlerov a formulé les idées les plus importantes de la théorie de la structure des composés organiques sous la forme de principes de base qui peuvent être divisés en 4 groupes.<Annexe 1 . Diapositive 19>
1. Tous les atomes qui forment des molécules de substances organiques sont connectés dans un certain ordre en fonction de leur valence (c'est-à-dire que la molécule a une structure).
<Annexe 1 . Diapositives 19, 20>
Conformément à ces idées, la valence des éléments est classiquement représentée par des tirets, par exemple dans le méthane CH 4.<Annexe 1 . Diapositive 20> >
Une telle représentation schématique de la structure des molécules est appelée formules développées et formules. Sur la base des dispositions sur la valence 4 du carbone et la capacité de ses atomes à former des chaînes et des cycles, les formules développées des substances organiques peuvent être décrites comme suit :<Annexe 1 . Diapositive 20>

Dans ces composés, le carbone est tétravalent. (Le tiret symbolise une liaison covalente, quelques électrons).
2. Les propriétés d'une substance dépendent non seulement des atomes et de leur nombre inclus dans les molécules, mais également de l'ordre de connexion des atomes dans les molécules (c'est-à-dire que les propriétés dépendent de la structure) <Annexe 1 . Diapositive 19>
Cette position de la théorie de la structure des substances organiques expliquait notamment le phénomène de l'isomérie. Il existe des composés qui contiennent le même nombre d’atomes des mêmes éléments, mais liés dans un ordre différent. Ces composés ont des propriétés différentes et sont appelés isomères.
Le phénomène d'existence de substances de même composition, mais de structure et de propriétés différentes, est appelé isomérie.<Annexe 1
. Diapositive 21>

L'existence d'isomères de substances organiques explique leur diversité. Le phénomène d'isomérie a été prédit et prouvé (expérimentalement) par A.M. Butlerov en utilisant l'exemple du butane
Ainsi, par exemple, la composition C 4 H 10 correspond à deux formules développées :<Annexe 1 . Diapositive 22>

Divers arrangement mutuel les atomes de carbone dans les molécules d'hydrocarbures n'apparaissent qu'avec le butane. Le nombre d'isomères augmente avec le nombre d'atomes de carbone de l'hydrocarbure correspondant, par exemple, le pentane a trois isomères et le décane en a soixante-quinze.
3. Par les propriétés d'une substance donnée, on peut déterminer la structure de sa molécule, et par la structure de la molécule, on peut prédire ses propriétés. <Annexe 1 . Diapositive 19>
Du cours de chimie inorganique, on sait que les propriétés des substances inorganiques dépendent de la structure réseaux cristallins. Les propriétés distinctives des atomes des ions s'expliquent par leur structure. À l'avenir, nous veillerons à ce que les substances organiques ayant les mêmes formules moléculaires, mais des structures différentes, diffèrent non seulement par leurs propriétés physiques, mais également par leurs propriétés chimiques.
4. Les atomes et les groupes d'atomes dans les molécules de substances s'influencent mutuellement.
<Annexe 1 . Diapositive 19>
Comme nous le savons déjà, les propriétés des composés inorganiques contenant des groupes hydroxo dépendent des atomes auxquels ils sont associés - atomes métalliques ou non métalliques. Par exemple, les bases et les acides contiennent un groupe hydroxo :<Annexe 1 . Diapositive 23>

Cependant, les propriétés de ces substances sont complètement différentes. La raison du caractère chimique différent du groupe OH (en solution aqueuse) est due à l'influence des atomes et des groupes d'atomes qui lui sont associés. Avec l'augmentation des propriétés non métalliques de l'atome central, la dissociation selon le type de base s'affaiblit et la dissociation selon le type acide augmente.
Les composés organiques peuvent également avoir différentes propriétés, qui dépendent des atomes ou groupes d'atomes auxquels les groupes hydroxyle sont liés.
La question de l'infusion mutuelle d'atomes A.M. Butlerov en discuta en détail le 17 avril 1879 lors d'une réunion de la Société physicochimique russe. Il a dit que si deux éléments différents sont associés au carbone, par exemple Cl et H, alors « ils ne dépendent pas l'un de l'autre dans la même mesure que le carbone : il n'y a pas de dépendance entre eux, la connexion qui existe dans une particule d'acide chlorhydrique... Mais s'ensuit-il que dans le composé CH 2 Cl 2 il n'y a aucune relation entre l'hydrogène et le chlore ? Je réponds à cela par un déni catégorique.
Comme exemple concret Il cite en outre l'augmentation de la mobilité du chlore lors de la transformation du groupe CH 2 Cl en COCl et dit à ce propos : « Il est évident que la nature du chlore présent dans la particule a changé sous l'influence de l'oxygène, bien que ce dernier ne s’est pas combiné directement avec le chlore.<Annexe 1 . Diapositive 23>

La question de l'influence mutuelle d'atomes directement non liés était le principal noyau théorique des travaux de V.V. Morkovnikova.
Dans l’histoire de l’humanité, il existe relativement peu de scientifiques dont les découvertes revêtent une importance mondiale. Dans le domaine de la chimie organique, ces mérites appartiennent à A.M. Butlerov. Selon l'importance de la théorie d'A.M. Butlerov est comparé à la loi périodique.
Théorie de la structure chimique A.M. Butlerova :<Annexe 1 . Diapositive 24>
– a permis de systématiser les substances organiques ;
– a répondu à toutes les questions qui se posaient alors en chimie organique (voir ci-dessus) ;
– a permis de prédire théoriquement l'existence de substances inconnues et de trouver les moyens de leur synthèse.
Près de 140 ans se sont écoulés depuis la création du TCS des composés organiques par A.M. Butlerov, mais même aujourd'hui, les chimistes de tous les pays l'utilisent dans leur travail. Dernières réalisations les sciences complètent cette théorie, la clarifient et trouvent de nouvelles confirmations de l'exactitude de ses idées fondamentales.
La théorie de la structure chimique reste aujourd’hui le fondement de la chimie organique.
TCS de composés organiques A.M. Butlerova a apporté une contribution significative à la création d'une image scientifique générale du monde, a contribué à la compréhension dialectique-matérialiste de la nature :<Annexe 1 . Diapositive 25>
– loi de transition des changements quantitatifs en changements qualitatifs peut être vu en utilisant l'exemple des alcanes :<Annexe 1 . Diapositive 25>.
Seul le nombre d'atomes de carbone change.
– la loi de l'unité et de la lutte des contraires peut être attribué au phénomène de l'isomérie<Annexe 1 . Diapositive 26>

Unité – dans la composition (identique), localisation dans l'espace.
L’opposé se situe dans la structure et les propriétés (séquence différente d’arrangement des atomes).
Ces deux substances coexistent ensemble.
– loi de négation de la négation - sur l'isomérie.<Annexe 1 . Diapositive 27>
Les isomères coexistant se nient par leur existence.
Après avoir développé la théorie, A.M. Butlerov ne le considérait pas comme absolu et immuable. Selon lui, cela doit se développer. Le TCS des composés organiques n’est pas resté inchangé. Son développement ultérieur s'est déroulé principalement dans deux directions interdépendantes :<Annexe 1 . Diapositive 28>
La stéréochimie est l'étude de la structure spatiale des molécules.
La doctrine de structure électronique atomes (nous a permis de comprendre la nature de la liaison chimique des atomes, l'essence de l'influence mutuelle des atomes et d'expliquer la raison de la manifestation de certaines propriétés chimiques par une substance).
Structure chimique d'une molécule représente l'aspect le plus caractéristique et unique d'elle, car il la définit les propriétés générales(mécanique, physique, chimique et biochimique). Toute modification de la structure chimique d'une molécule entraîne une modification de ses propriétés. Dans le cas de changements structurels mineurs introduits dans une molécule, de petits changements dans ses propriétés s'ensuivent (affectant généralement propriétés physiques), si la molécule a subi de profondes modifications structurelles, alors ses propriétés (notamment chimiques) seront profondément modifiées.
Par exemple, l’acide alpha-aminopropionique (Alpha-alanine) a la structure suivante :
 Alpha-Alanine
Alpha-Alanine Ce que nous voyons :
- La présence de certains atomes (C, H, O, N),
- un certain nombre d'atomes appartenant à chaque classe, qui sont liés dans un certain ordre ;
Toutes ces caractéristiques de conception déterminent un certain nombre de propriétés de l'alpha-alanine, telles que : solide état d'agrégation, point d'ébullition 295° C, solubilité dans l'eau, activité optique, propriétés chimiques des acides aminés, etc.
Lorsque le groupe amino est lié à un autre atome de carbone (c'est-à-dire qu'un changement structurel mineur s'est produit), ce qui correspond à la bêta-alanine :
 Bêta-alanine
Bêta-alanine Les propriétés chimiques générales restent encore caractéristiques des acides aminés, mais le point d'ébullition est déjà de 200°C et il n'y a pas d'activité optique.
Si, par exemple, deux atomes de cette molécule sont reliés par un atome N dans l’ordre suivant (changement structurel profond) :

Alors substance formée— Le 1-nitropropane dans ses propriétés physiques et chimiques est complètement différent des acides aminés : le 1-nitropropane est un liquide jaune avec un point d'ébullition de 131°C, insoluble dans l'eau.
Ainsi, relation structure-propriété permet de décrire les propriétés générales d'une substance de structure connue et, à l'inverse, permet de retrouver la structure chimique d'une substance, connaissant ses propriétés générales.
Principes généraux de la théorie de la structure des composés organiques
L'essence de la détermination de la structure d'un composé organique réside dans les principes suivants, qui découlent de la relation entre leur structure et leurs propriétés :
a) les substances organiques, à l'état analytiquement pur, ont la même composition, quelle que soit la méthode de préparation ;
b) les substances organiques, à l'état analytiquement pur, ont des propriétés physiques et chimiques constantes ;
c) les substances organiques de composition et de propriétés constantes n'ont qu'une seule structure unique.
En 1861, le grand scientifique russe A.M. Butlerov dans son article « Sur la structure chimique de la matière », il a révélé l'idée principale de la théorie de la structure chimique, qui consiste en l'influence de la manière dont les atomes d'une substance organique sont connectés sur ses propriétés. Il a résumé toutes les connaissances et idées disponibles à cette époque sur la structure des composés chimiques dans la théorie de la structure des composés organiques.
Les principales dispositions de la théorie d'A.M. Butlerov
peut être résumé ainsi :
- Dans une molécule d'un composé organique, les atomes sont connectés selon un certain ordre, qui détermine sa structure.
- L'atome de carbone dans les composés organiques a une valence de quatre.
- À même composition molécules, il existe plusieurs manières possibles de relier les atomes de cette molécule entre eux. De tels composés ayant la même composition mais des structures différentes étaient appelés isomères, et un phénomène similaire était appelé isomérie.
- Connaissant la structure d'un composé organique, on peut prédire ses propriétés ; Connaissant les propriétés d'un composé organique, on peut prédire sa structure.
- Les atomes qui forment une molécule sont soumis à une influence mutuelle qui détermine leur réactivité. Les atomes directement liés ont une plus grande influence les uns sur les autres, tandis que l’influence des atomes non directement liés est beaucoup plus faible.
Étudiant A.M. Butlerova — V. V. Markovnikov a continué à étudier la question de l'influence mutuelle des atomes, ce qui s'est reflété en 1869 dans son travail de thèse « Matériaux sur la question de l'influence mutuelle des atomes dans les composés chimiques ».
Crédit à A.M. Butlerov et l'importance de la théorie de la structure chimique sont extrêmement grandes pour la synthèse chimique. L’opportunité s’est ouverte de prédire les propriétés fondamentales des composés organiques et de prévoir les voies de leur synthèse. Grâce à la théorie de la structure chimique, les chimistes ont d’abord apprécié la molécule comme un système ordonné avec un ordre strict de liaisons entre atomes. Et à l’heure actuelle, les principales dispositions de la théorie de Butlerov, malgré les changements et les clarifications, sous-tendent la théorie moderne. idées théoriques chimie organique.
Catégories ,Créé par A.M. Butlerov dans les années 60 du XIXe siècle, la théorie de la structure chimique des composés organiques a apporté la clarté nécessaire aux raisons de la diversité des composés organiques, a révélé la relation entre la structure et les propriétés de ces substances, a permis d'expliquer la propriétés de composés organiques déjà connus et prédire les propriétés de composés organiques encore inconnus.
Les découvertes dans le domaine de la chimie organique (tétvalence du carbone, capacité à former de longues chaînes) permettent à Butlerov en 1861 de formuler les principales générations de la théorie :
1) Les atomes des molécules sont connectés selon leur valence (carbone-IV, oxygène-II, hydrogène-I), la séquence des connexions atomiques est reflétée par les formules développées.
2) Les propriétés des substances dépendent non seulement de composition chimique, mais aussi sur l'ordre de connexion des atomes dans la molécule (structure chimique). Exister isomères, c'est-à-dire des substances qui ont les mêmes quantités et composition de haute qualité, mais une structure différente et, par conséquent, des propriétés différentes.
C 2 H 6 O : CH 3 CH 2 OH – éthanol et CH 3 OCH 3 – éther diméthylique
C 3 H 6 – propène et cyclopropane - CH 2 =CH−CH 3
3) Les atomes s'influencent mutuellement, c'est une conséquence de l'électronégativité différente des atomes formant des molécules (O>N>C>H), et ces éléments ont influence différente au déplacement de paires d'électrons communes.
4) Selon la structure de la molécule matière organique on peut prédire ses propriétés, et à partir de ses propriétés, on peut déterminer sa structure.
La poursuite du développement TSOS reçu après avoir établi la structure de l'atome, accepté la notion de types de liaisons chimiques, types d'hybridation, découverte du phénomène isomérie spatiale(stéréochimie).
Billet n°7 (2)
L'électrolyse comme processus redox. Électrolyse de matières fondues et de solutions en utilisant le chlorure de sodium comme exemple. Utilisation pratiqueélectrolyse.
Électrolyse- il s'agit d'un processus redox qui se produit sur les électrodes lors du passage d'une constante courant électriqueà travers une solution fondue ou électrolytique
L’essence de l’électrolyse est la mise en œuvre de réactions chimiques utilisant l’énergie électrique. Réactions-récupérationsà la cathode et l'oxydation à l'anode.
La cathode(-) donne des électrons aux cations et l'anode(+) accepte les électrons des anions.
Électrolyse fondue de NaCl
NaCl-―>Na + +Cl -
K(-): Na + +1e-―>Na 0 | 2 pour cent récupération
A(+) :2Cl-2e-―>Cl 2 0 | 1 pour cent oxydation
2Na + +2Cl - -―>2Na+Cl 2
Électrolyse solution aqueuse NaCl
Dans l'électrolyse de NaC| Les ions Na + et Cl -, ainsi que les molécules d'eau, participent à l'eau. Lorsque le courant passe, les cations Na + se déplacent vers la cathode et les anions Cl - se déplacent vers l'anode. Mais à la cathode Au lieu des ions Na, les molécules d'eau sont réduites :
2H 2 O + 2e-―> H 2 +2OH -
et les ions chlorure sont oxydés à l'anode :
2Cl - -2e -> Cl 2
En conséquence, il y a de l'hydrogène à la cathode, du chlore à l'anode et NaOH s'accumule dans la solution.
Sous forme ionique : 2H 2 O+2e-―>H 2 +2OH-
2Cl - -2e -> Cl 2
électrolyse
2H 2 O+2Cl - -―>H 2 +Cl 2 +2OH -
électrolyse
Sous forme moléculaire : 2H 2 O+2NaCl-―> 2NaOH+H 2 +Cl 2
Application de l'électrolyse :
1)Protection des métaux contre la corrosion
2) Obtention de métaux actifs (sodium, potassium, alcalino-terreux, etc.)
3) Purification de certains métaux des impuretés (raffinage électrique)
Billet n°8 (1)
Informations connexes :
- A) La théorie de la connaissance est une science qui étudie les formes, les méthodes et les techniques d'émergence et les schémas de développement de la connaissance, son rapport à la réalité, les critères de sa vérité.
La base de la création de la théorie de la structure chimique des composés organiques est A.M. Butlerov s'est inspiré de la théorie atomique-moléculaire (travaux de A. Avagadro et S. Cannizzaro). Il serait faux de supposer qu'avant sa création, on ne savait rien dans le monde des substances organiques et qu'aucune tentative n'avait été faite pour justifier la structure des composés organiques. En 1861 (l'année où A.M. Butlerov a créé la théorie de la structure chimique des composés organiques), le nombre de composés organiques connus a atteint des centaines de milliers et l'identification de la chimie organique en tant que science indépendante a eu lieu en 1807 (J. Berzelius).
Prérequis pour la théorie de la structure des composés organiques
Une vaste étude des composés organiques a commencé au XVIIIe siècle avec les travaux d'A. Lavoisier, qui a montré que les substances obtenues à partir d'organismes vivants sont constituées de plusieurs éléments - carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre et phosphore. Grande valeur a eu l'introduction des termes « radical » et « isomérie », ainsi que la formation de la théorie des radicaux (L. Guiton de Morveau, A. Lavoisier, J. Liebig, J. Dumas, J. Berzelius), des succès dans la synthèse de composés organiques (urée, aniline, acide acétique, graisses, substances apparentées au sucre, etc.).
Le terme « structure chimique », ainsi que les fondements de la théorie classique de la structure chimique, ont été publiés pour la première fois par A.M. Butlerov le 19 septembre 1861 dans son rapport au Congrès des naturalistes et médecins allemands à Spire.
Principes de base de la théorie de la structure des composés organiques A.M. Butlerov
1. Les atomes qui forment une molécule d'une substance organique sont connectés les uns aux autres dans un certain ordre, et une ou plusieurs valences de chaque atome sont utilisées pour se lier les unes aux autres. Il n'y a pas de valences gratuites.
Butlerov a appelé la séquence de connexions des atomes « structure chimique ». Graphiquement, les connexions entre atomes sont indiquées par une ligne ou un point (Fig. 1).
Riz. 1. Structure chimique de la molécule de méthane : A – formule développée, B – formule électronique
2. Les propriétés des composés organiques dépendent de la structure chimique des molécules, c'est-à-dire Les propriétés des composés organiques dépendent de l'ordre de connexion des atomes dans la molécule. Après avoir étudié les propriétés, vous pouvez représenter la substance.
Prenons un exemple : une substance a une formule brute de C 2 H 6 O. On sait que lorsque cette substance interagit avec le sodium, de l'hydrogène est libéré et lorsqu'un acide agit sur elle, de l'eau se forme.
C 2 H 6 O + Na = C 2 H 5 ONa + H 2
C2H6O + HCl = C2H5Cl + H2O
Cette substance peut avoir deux formules développées :
CH 3 -O-CH 3 - acétone (diméthylcétone) et CH 3 -CH 2 -OH - alcool éthylique (éthanol),
Sur la base des propriétés chimiques caractéristiques de cette substance, nous concluons qu'il s'agit de l'éthanol.
Les isomères sont des substances qui ont la même composition qualitative et quantitative, mais des structures chimiques différentes. Il existe plusieurs types d'isomérie : structurelle (linéaire, ramifiée, squelette carboné), géométrique (isomérie cis et trans, caractéristique des composés à double liaison multiple (Fig. 2)), optique (miroir), stéréo (spatiale, caractéristique des substances, capables d'être localisées différemment dans l'espace (Fig. 3)).

Riz. 2. Exemple d'isomérie géométrique
3. Les propriétés chimiques des composés organiques sont également influencées par d'autres atomes présents dans la molécule. De tels groupes d'atomes sont appelés groupes fonctionnels, car leur présence dans la molécule d'une substance lui confère des propriétés chimiques particulières. Par exemple : -OH (groupe hydroxy), -SH (groupe thio), -CO (groupe carbonyle), -COOH (groupe carboxyle). De plus, les propriétés chimiques d'une substance organique dépendent moins du squelette hydrocarboné que du groupe fonctionnel. Ce sont les groupes fonctionnels qui assurent la diversité des composés organiques, grâce auxquels ils sont classés (alcools, aldéhydes, acides carboxyliques etc. Les liaisons carbone-carbone (plusieurs doubles et triples) sont parfois incluses comme groupes fonctionnels. S'il y a plusieurs groupes fonctionnels identiques dans une molécule d'une substance organique, alors on dit qu'elle est homopolyfonctionnelle (CH 2 (OH)-CH(OH)-CH 2 (OH) - glycérol), s'il y en a plusieurs, mais différents, on l'appelle hétéropolyfonctionnel (NH 2 -CH(R) -COOH – acides aminés).

Figure 3. Exemple de stéréoisomérie : a – cyclohexane, forme « chaise », b – cyclohexane, forme « baignoire »
4. Valence du carbone dans composés organiques est toujours égal à quatre.