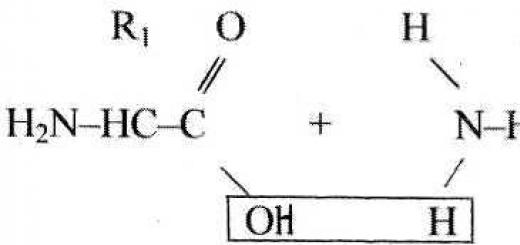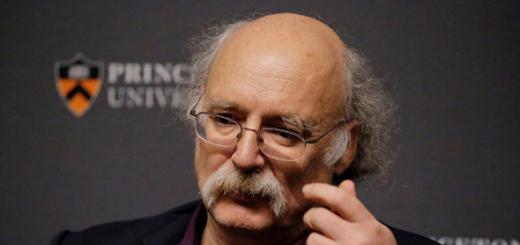Pour la première fois en Russie, l'histoire de Vsevolod Petrov « La Turdéenne Manon Lescaut », précédemment publiée dans le magazine « Nouveau monde" En annexe se trouvent les mémoires de Petrov sur les poètes Mikhaïl Kouzmine et Daniil Kharms, sur le critique d'art Nikolaï Pounine, époux d'Anna Akhmatova, ainsi que sur le peintre et graphiste Nikolaï Tyrsa. De plus, le livre contient des articles d'Oleg Yuryev et Andrei Uritsky consacrés à l'histoire.
Vsevolod Nikolaevich Petrov (1912-1978) n'a pas vu l'aube de la culture russe pré-révolutionnaire, mais c'est à elle qu'il s'est associé, étant constamment présent dans le cercle de ceux qui ont préservé ses fragments de l'oubli et ont témoigné de sa continuité. existence par le fait même de leur vie. Bien entendu, l'un de ses principaux refuges était l'appartement de Mikhaïl Alekseevich Kuzmin (plus précisément, une chambre dans un appartement commun). Apparemment, Kuzmin a grandement influencé Petrov. En 1932, Petrov, en tant qu'étudiant externe de 3e année à la Faculté d'histoire, entre au service du Musée russe, où il travaille avec les archives de Nikolaï Benois et rencontre Nikolaï Pounine, puis, par son intermédiaire, Anna Akhmatova.
A la fin des années 30, Petrov devient l'interlocuteur de Daniil Kharms : « La propriété la plus importante Il considérait l'écrivain comme faisant autorité. L’écrivain, dans sa conviction, doit présenter aux lecteurs des preuves si incontestables qu’ils n’osent pas s’exprimer contre elles. En 1939, Kharms, anticipant la guerre, lui dirait : « En prison tu peux rester toi-même, mais à la caserne tu ne peux pas, c'est impossible ! Qui aurait pu savoir que dans trois ans seulement, il finirait non pas en prison ou à la caserne, mais dans hopital psychiatrique, où il mourra de faim au début de 1942. Petrov écrira plus tard dans ses mémoires : « Les gens dont je parle étaient eux-mêmes des phénomènes artistiques. »
Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Petrov, comme des millions d’autres, se retrouve au front. Oleg Yuriev suggère qu'après sa démobilisation, il est apparemment tombé sur le best-seller de Vera Panova : le roman réaliste socialiste « Satellites », publié en 1946 et primé. Prix Staline. Le livre a frappé Petrov avec quelque chose (très probablement, la médiocrité), et il en a fait une réplique unique : l'histoire « Turdéenne Manon Lescaut ».
Maison d'édition d'Ivan Limbach
L'intrigue du livre est extrêmement courte. Personnage principal, un officier raffiné parmi ceux qui ont été persécutés et emprisonnés par les agents de sécurité, voyage dans un train-hôpital militaire et tombe amoureux d'une fille, Vera, en cours de route. Elle le trompe et finit par mourir lorsque la maison est bombardée. La relation entre Vera et l'officier est constamment critiquée par le « collectif », décrite sans détails et presque invisible. De tels « collectifs » se retrouvent souvent dans Littérature soviétique et le cinéma soviétique : ils ridiculisent et condamnent, mais certainement de manière amicale. Leurs participants savourent certaines situations de la vie d’autrui, inventent des blagues vulgaires et recherchent de nouveaux détails avec un plaisir particulier. Dans cette situation, peu importe que Vera continue ou non d'inviter des hommes chez elle, car chacun de ses choix sera discuté par ses compagnons de voyage depuis la position de contrôle omniprésent, qui ne peut que surgir au front. Cependant, Vsevolod Petrov n'est pas un écrivain soviétique, il envoie donc la conscience collective au-delà des limites de la ligne principale du récit, où elle n'apparaît que comme l'un des nombreux angles morts, comme une sorte de chemin populaire cahoteux qui semble jeter un coup d'œil. à travers la forêt et mène aux mécanismes cachés et bien huilés de l'époque. Malgré le fait que l'action de "La Turque Manon Lescaut" se déroule dans la Seconde guerre mondiale, cette guerre, jusqu'au dernier moment, reste aussi un tel angle mort : explosions, avions, trains - tout cela n'est qu'un fait, un fait qu'il faut non seulement tolérer, mais aussi contre lequel il est inutile de protester. Dès lors, une histoire d’amour apparaît immédiatement, écrasant le paysage, les participants et le chemin qui perd rapidement son sens. Autrement dit, la réalité est soumise à la simplification de Petrov au nom de la mise en œuvre d’une utopie personnelle du bonheur, dont parle Oleg Yuryev. Le personnage principal ne s’intéresse presque à rien. Il traverse des champs enneigés, lit « Les Douleurs du jeune Werther » et compare sa bien-aimée Vera à Manon Lescaut, dont la présence, par essence, fait aussi partie de son projet d'utopie personnelle : « J'ai pensé à quel point mon existence est vide, et sur le fait que la vie elle-même n'est rien, une ligne droite égale qui traverse l'espace, une ornière dans un champ enneigé, un néant qui disparaît. « Quelque chose » commence là où une ligne croise d’autres lignes, là où la vie entre dans la vie d’autrui. Toute existence est insignifiante si elle ne se reflète en personne ou en quoi que ce soit. Une personne n’existe que lorsqu’elle se regarde dans le miroir.
 Maison d'édition d'Ivan Limbach
Maison d'édition d'Ivan Limbach
J’oserais suggérer que Manon Lescaut, l’héroïne du roman éponyme de l’abbé Prévost, une jeune fille aux mœurs libres qui fatigue son amant, et le Chevalier des Grieux de Petrov deviennent une allégorie du XVIIIe siècle en général. À leur tour, les personnages principaux de l'histoire se trouvent dans une situation de transition : d'une part, ils sont fille soviétique et l'officier, de l'autre, variation imparfaite de l'allégorie, ombre sur les parois de la caverne de Platon. Peu à peu, un espace supplémentaire d'une autre culture se forme dans l'histoire - aristocratique, à laquelle le narrateur s'associe. Et pour l'aristocratie, la guerre était initialement un mode de vie, elle n'est donc pas prise en compte par Petrov, devenant - en quelque sorte - un état naturel (cela est également associé au phénomène d'une société totalitaire, où les gens ressentaient parfois le la guerre comme soulagement de leur sort : après tout, au front apparaît au moins un ennemi qui n'est pas visible dans les répressions). De plus, selon Walter Benjamin, dans une allégorie « n'importe quelle personne, n'importe quelle chose, n'importe quelle circonstance peut servir de désignation à n'importe quoi », et « cette possibilité prononce un verdict dévastateur et pourtant juste sur le monde profane : il est caractérisé comme un monde dans lequel les détails n'ont pas de signification particulière. Par conséquent - de l'allégorique à Et Denia - vient du désintérêt du narrateur pour les changements, de son observation détachée. Il se concentre sur Véra, et en même temps sa mort change peu dans l'esprit même du récit, puisque dans l'allégorie - je ferai encore référence à Benjamin - le récit final « s'étend devant le regard du spectateur comme un paysage préhistorique pétrifié ». c’est-à-dire qu’il ne s’ouvre pas à la lumière de la délivrance ou de la rédemption, comme cela se produit dans la littérature romantique. Ainsi, le narrateur se caractérise, par exemple, par les maximes suivantes : « Le romantisme brise la forme, et avec elle commence la désintégration du style. Il y a de la jeunesse et de la rébellion ici. Et la bourgeoisie se rebelle. Le grand et parfait Goethe traitait les romantiques avec dédain parce qu’il les considérait comme des philistins. »
Il faut mentionner encore une chose acteur: le docteur Nina Alekseevna, volontairement laissée dans l'ombre, jouant le rôle d'une confidente (le confident de Prévost est Tiberge, un ami de monsieur des Grieux). Au nom de Nina Alekseevna, la raison parle dans le roman, ce compagnon constant de tout texte du siècle des Lumières, auquel Petrov renvoie le lecteur. Cependant, la voix de la raison n’a aucun diktat : elle complète plutôt le discours du narrateur, exprime ses propres doutes et espoirs, en un mot, remplace le chœur d’une tragédie antique. Le personnage apparemment mineur est rempli d’amour alors qu’il regarde l’intrigue se dérouler. En général, Nina Alekseevna est une figure témoin, et le témoignage était très important pour Petrov, à en juger par les mémoires qu'il a laissés.
Si l'on se souvient que l'histoire a été créée dans les conditions de perception idéologique et héroïque de la Seconde Guerre mondiale, il deviendra alors clair que « la Turdienne Manon Lescaut » est une provocation voilée. En fait, Petrov met secrètement fin au célèbre accord tacite entre la littérature et l’État, qui implique que la littérature doit certainement quelque chose à quelqu’un. Petrov - à sa manière caractéristique - évite cela et joue le drame "sous le XVIIIe siècle", une stylisation qui est un défi presque imperceptible (et d'autres diraient un blasphème). Le mythe de la guerre se dissipe comme la fumée d’un obus, révélant un cratère, une blessure nue qui marque tout le monde. Petrov marque constamment des ruptures : avec le passé, avec le monde soviétique et enfin avec la fille Vera. Après tout, en rompant avec quelque chose ou quelqu'un, nous devenons libres, et la liberté ne doit pas nécessairement être douce, ce qui n'annule pas le désir d'en avoir. Ainsi, le garçon des « Aventures d'Aimé Leboeuf » de Kuzmin, faisant irruption dans la chambre de son amant et commençant tout juste à lui avouer son amour, trouve par hasard une fille sous les couvertures et s'enfuit.
Vsevolod Petrov. Tourdéenne Manon Lescaut. Une histoire d'amour : un conte ; Souvenirs. - Saint-Pétersbourg : Maison d'édition Ivan Limbach, 2016. - 272 p.
Petrov Vsevolod Nikolaïevitch Orthodoxe. Originaire de Kyiv. Il a fait ses études à l'école Vladimirsky de Kiev corps de cadets. Entré en service le 31 août 1900. Diplômé de Pavlovsk école militaire(1902). Libéré comme sous-lieutenant (10/08/1902) au 24e d'infanterie. Régiment de Simbirsk. Transféré au 7ème Bataillon de Pontons (12/11/1902). Affecté aux L-guards. Régiment lituanien (02/04/1903). 04/04/1903 muté dans le même régiment. Lieutenants de garde (Article 10.08.1906). Diplômé de l'Impériale Nikolaevskaya Académie militaire(1910 ; 1ère catégorie). Capitaine d'état-major des gardes. (pr. 26/05/1910 ; art. 23/05/1910 ; pour d'excellentes réalisations dans les sciences). Le commandement qualifié de la compagnie était servi dans la 165e infanterie. Régiment de Loutsk (02.11.1910-03.11.1912). Renommé Capitaines d'État-Major (Art. 23/05/1910). Art. adjudant du quartier général du 42e d'infanterie. divisions (22/01/1913-16/05/1915). Participant à la guerre mondiale. Identifiant. officier d'état-major pour les instructions du quartier général de la 24e armée. corps (16.05.-06.07.1915). Identifiant. officier d'état-major pour des missions au quartier général de la 10e armée. corps (à partir du 06/07/1915). Lieutenant-colonel (né le 6 décembre 1915 ; art. 6 décembre 1915 ; pour distinction de service) avec confirmation dans le poste. Le 13/03/1916 au même grade et poste. Identifiant. Chef d'état-major de la 7e division d'infanterie du Turkestan (à partir du 05/09/1916 ; en fonction le 01/03/1917). Le 03/01/1917 art. établi au grade de lieutenant-colonel le 6 décembre 1914. Pour la distinction, etc. officier d'état-major pour des missions au quartier général de la 24e armée. Le Corps a reçu les armes de Saint-Georges (VP 24/01/1917 ; pour la bataille du 27/04/1915). Colonel (né le 15/08/1917 ; Art. 06/12/1916). À la fin de 1917, il forme le régiment de cavalerie Gaydamat qui porte son nom parmi les Ukrainiens du front occidental. K. Gordienko. À 01.1918, il retire le régiment de Biélorussie à Kiev. Participé à la répression du soulèvement bolchevique à Kiev du 1er au 2 février 1918, à la résistance à l'offensive des troupes de Mouravyov sur Kiev. Du 2 au 3 mars 1918, commandant du 3e kuren du détachement séparé de Zaporozhye (com. K. Prisovsky). Plus tard, le commandant du 1er Zaporozhye porte son nom. Régiment K. Gordienko de haidamaks à cheval faisant partie du corps Zaporozhye. Depuis 06.1918 - à la disposition du chef d'état-major de l'État ukrainien. A partir du 29/07/1918 - chef d'état-major du 12e d'infanterie. divisions de l'armée de l'État ukrainien. Depuis 08.1918 - à la disposition du chef d'état-major de l'État ukrainien. À partir du 14/10/1918 - assistant du chef du département pédagogique des écoles d'infanterie de la direction scolaire principale du ministère militaire de l'État ukrainien. À partir du 28/10/1918 - assistant du directeur de la 2e Kyiv United Junker School. A partir du 01/12/1918 - assistant du chef de l'École d'instruction des officiers. Du 22/12/1918 - directeur de l'école des cadets de Jitomir. Alors qu'il occupait ce poste, le 13 mars 1919, il fut choqué au combat, mais resta à la tête de l'école. A partir du 02/06/1919 - commandant du groupe Volyn de l'armée de l'UPR. A partir du 09/07/1919 - Ministre de la Guerre de l'UPR. A partir du 05.11.1919 - Camarade Ministre de la Guerre de l'UPR. A partir du 01/05/1920 - Inspecteur d'infanterie de l'Armée de l'APR. Du 10/05/1920 - couronne générale. A partir du 03.1921 - 1er Quartier-Maître Général de l'Etat-Major de l'UPR. A partir du 19/08/1921 - Chef d'état-major général de l'UPR. Au 06.1922 à volonté retraité dans la réserve. En exil, il a vécu dans la ville de Khoust et a enseigné au gymnase d'État ukrainien de la ville. A donné des conférences à l'Université supérieure ukrainienne université pédagogiqueà Prague, il a enseigné au Real Gymnasium ukrainien de Modjar. Membre de la Société ukrainienne d'histoire et de philologie (1923-45). 14/03/15/03/1939, se trouvant alors dans la ville de Khust dans l'Ukraine des Carpates, il refusa de prendre le commandement des forces armées de l'Ukraine des Carpates, mais accepta d'aider le quartier général du Sich local. Le 30/06/1941 à Lvov, après que l'aile révolutionnaire de l'OUN (Bandera) eut déclaré le gouvernement ukrainien dirigé par Y. Stetsko, il le rejoignit en tant que ministre de la Guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il prend une part active aux négociations avec les Allemands sur le sort de l'Ukraine et des Ukrainiens. À plusieurs reprises, il reçut des offres pour diriger l'Armée de libération ukrainienne (1943) et l'Armée nationale ukrainienne (1945), mais refusa. Il était l'un des plus proches conseillers du commandant de l'armée ukrainienne. armée nationale Général P. Shandruk. Depuis 1945, il était en exil en Allemagne de l'Ouest. Décédé dans un camp de personnes déplacées à Ratisbonne. Récompenses : Ordre de Sainte-Anne, 3e classe. (1907); Saint Stanislas 2e Art. (1913 ; 08/04/1914) ; Saint Vladimir 4ème Art. avec épées et arc (VP 31/01/1915) ; épées pour l'Ordre de Saint-Stanislas, 2e classe. (VP 15/05/1915) ; Sainte Anne 4ème Art. (approuvé par VP le 02/07/1915) ; Sainte Anne 2e Art. avec des épées (approuvé VP le 13/03/1916) ; Arme de Saint-Georges (VP 24/01/1917). Octroi de l'ancienneté au grade de lieutenant-colonel à partir du 06/12/1914 (2ème additif au VP 15/08/1916 ; basé sur l'ordre d'après l'histoire militaire de 1916 n° 379, 483 et 535).
Famille
Père - Nikolai Werner-Petrov, capitaine (plus tard général de division) des troupes du génie, descendant d'un Suédois capturé par les troupes de Pierre Ier (d'où le nom de famille Petrov) pendant la guerre du Nord. La mère venait de la famille norvégienne Shtrolman.
Officier de l'armée russe
En tant qu'officier de l'armée russe, il organisait dans sa compagnie une formation militaire dans les langues nationales, que les soldats enrôlés dans la périphérie de la Russie parlaient mieux que le russe (à ce propos, il divisa la compagnie en sous-groupes basés sur la nationalité). Il a obtenu de bons résultats, mais ses supérieurs et de nombreux collègues ont réagi négativement à cette expérience, la considérant comme une menace pour l'unité de l'armée. L’un des officiers a traité Petrov de « Mazepa ».
Après l'arrivée au pouvoir de l'hetman P.P. Skoropadsky, il a été démis de ses fonctions, a vécu à Kiev, après avoir signé un engagement écrit de ne pas partir, et a été contraint de gagner sa vie en déchargeant des wagons. Il a ensuite été réintégré dans l'armée et nommé chef d'état-major de la 12e division, mais a été rapidement démis de ses fonctions parce qu'il était soupçonné de liens avec les rebelles (partisans de Simon Petlyura). Il travailla brièvement à la Direction générale des écoles militaires ; au cours de la dernière période du régime de l'Hetman, il fut nommé commandant en chef de la rive gauche de l'Ukraine pour combattre les rebelles (une telle nomination témoignait de l'extrême confusion des autorités).
L'un des premiers officiers supérieurs ukrainiens à soutenir Symon Petliura. Dès le début, le commandant du groupe Volyn, nommé à ce poste par le commandement de l'armée de la République populaire ukrainienne (UNR), a participé aux batailles contre les bolcheviks. Il a ensuite été directeur de l'école des cadets militaires de Jytomyr (« jeunesse »). En 1919 - Ministre de la Guerre de la République populaire ukrainienne. S - inspecteur armée ukrainienne(à cette époque, elle était déjà sur le territoire de la Pologne), général-cornet. V a été nommé chef d'état-major de l'armée de l'UPR et a participé à l'organisation du mouvement insurrectionnel sur le territoire ukrainien. Créateur des cours militaires pour les anciens de l'UPR à Kalisz, il y enseignait l'histoire militaire.
La vie en Tchécoslovaquie
Puis il s'installe en Tchécoslovaquie, où, à partir de 1923, il enseigne l'histoire de l'armée ukrainienne et l'éducation physique à l'École supérieure ukrainienne. institut pédagogique nommé d'après Mikhaïl Drahomanov à Prague. B - - enseignant éducation physiqueà l'Université Charles et à l'Institut polytechnique tchèque. S - membre correspondant de la Société historique militaire ukrainienne à Varsovie, S - membre de l'Institut sociologique ukrainien (à Prague) et de la Société historique et philologique ukrainienne (à Prague), où il a présenté des résumés sur des questions de géographie militaire, d'histoire et de physique éducation. V est l'un des fondateurs, vice-président et secrétaire scientifique de la Société scientifique militaire ukrainienne à Prague, où il a également lu des rapports sur des questions de stratégie militaire, de politique, de sociologie, d'histoire et de géographie. Il a enseigné la gymnastique au véritable gymnase ukrainien de Rzhevnitsy et, à partir de 1934, à Modřany, près de Prague. En 1929, il rejoint l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN). En 1931, il publie ses mémoires sur les événements de Lvov. guerre civile sur le territoire de l'Ukraine.
Après l'effondrement de la Tchécoslovaquie et l'occupation de la République tchèque par les Allemands, il fut ouvrier d'usine et continua à participer à la vie publique de l'émigration ukrainienne. Après le début de la Grande Guerre patriotique, les partisans de Stepan Bandera de l'Organisation des nationalistes ukrainiens l'ont nommé au poste de ministre de la Guerre d'Ukraine. Il a été élu par contumace président du Comité national ukrainien. Cependant, il n'a pas réellement commencé à exercer ces fonctions, car les Allemands ont durement réprimé l'initiative « Bandera ». Il a continué à travailler à l'usine.
dernières années de la vie
Il s'installe en Bavière, vit dans un camp de personnes déplacées près de Munich et, à partir de 1947, à Augsbourg. Deux jours avant sa mort, il a été élu membre à part entière de la Société scientifique Shevchenko. Il est décédé des suites d'une grave maladie causée par la malnutrition et le surmenage.
Procédure
- Pratiques militaro-historiques. Souviens-toi. Kiev, 2002.
- Maintien en puissance et militaire : Sots.-ist. dessin Prague ; Berlin, 1924 ;
- Amélioration des connaissances militaires // Actualités étudiantes. Prague, 1926. N° 6. P.6-11 ;
- Souvenez-vous des heures de la révolution ukrainienne (1917-1921). Lviv, 1927-1931. Première partie Dans le monde de Beresteysky. 1927 ; Partie 2. La vision du monde de Beresteysky avant l'occupation de Poltavi. 1928 ; Partie 3. De la campagne de Crimée au coup d'État de l'Hetman. 1930 ; Partie 4. Hetmanate et le soulèvement du Directoire. 1931.
- Opérations stratégiques de Bohdan Khmelnitsky pendant la guerre de 1648-1649 // Ukraine militaire. K., 1993. N° 6-8.
Famille
Père - Nikolai Werner-Petrov, capitaine (plus tard général de division) des troupes du génie, descendant d'un Suédois capturé par les troupes de Pierre Ier (d'où le nom de famille Petrov) pendant la guerre du Nord. La mère venait de la famille norvégienne Shtrolman.
Officier de l'armée russe
En tant qu'officier de l'armée russe, il organisait dans sa compagnie une formation militaire dans les langues nationales, que les soldats enrôlés dans la périphérie de la Russie parlaient mieux que le russe (à ce propos, il divisa la compagnie en sous-groupes basés sur la nationalité). Il a obtenu de bons résultats, mais ses supérieurs et de nombreux collègues ont réagi négativement à cette expérience, la considérant comme une menace pour l'unité de l'armée. L’un des officiers a traité Petrov de « Mazepa ».
Après l'arrivée au pouvoir de l'hetman P.P. Skoropadsky, il a été démis de ses fonctions, a vécu à Kiev, après avoir signé un engagement écrit de ne pas partir, et a été contraint de gagner sa vie en déchargeant des wagons. Il a ensuite été réintégré dans l'armée et nommé chef d'état-major de la 12e division, mais a été rapidement démis de ses fonctions parce qu'il était soupçonné de liens avec les rebelles (partisans de Simon Petlyura). Il travailla brièvement à la Direction générale des écoles militaires ; au cours de la dernière période du régime de l'Hetman, il fut nommé commandant en chef de la rive gauche de l'Ukraine pour combattre les rebelles (une telle nomination témoignait de l'extrême confusion des autorités).
L'un des premiers officiers supérieurs ukrainiens à soutenir Symon Petliura. Dès le début, le commandant du groupe Volyn, nommé à ce poste par le commandement de l'armée de la République populaire ukrainienne (UNR), a participé aux batailles contre les bolcheviks. Il a ensuite été directeur de l'école des cadets militaires de Jytomyr (« jeunesse »). En 1919 - Ministre de la Guerre de la République populaire ukrainienne. S - inspecteur de l'armée ukrainienne (à cette époque elle était déjà sur le territoire de la Pologne), général Cronet. V a été nommé chef d'état-major de l'armée de l'UPR et a participé à l'organisation du mouvement insurrectionnel sur le territoire ukrainien. Créateur des cours militaires pour les anciens de l'UPR à Kalisz, il y enseignait l'histoire militaire.
La vie en Tchécoslovaquie
Puis il s'installe en Tchécoslovaquie, où, à partir de 1923, il enseigne l'histoire de l'armée ukrainienne et l'éducation physique à l'Institut pédagogique supérieur ukrainien du nom de Mikhaïl Drahomanov à Prague. In - - professeur d'éducation physique à l'Université Charles et à l'Institut polytechnique tchèque. S - membre correspondant de la Société historique militaire ukrainienne à Varsovie, S - membre de l'Institut sociologique ukrainien (à Prague) et de la Société historique et philologique ukrainienne (à Prague), où il a présenté des résumés sur des questions de géographie militaire, d'histoire et de physique éducation. V est l'un des fondateurs, vice-président et secrétaire scientifique de la Société scientifique militaire ukrainienne à Prague, où il a également lu des rapports sur des questions de stratégie militaire, de politique, de sociologie, d'histoire et de géographie. Il a enseigné la gymnastique au véritable gymnase ukrainien de Rzhevnitsy et, à partir de 1934, à Modřany, près de Prague. En 1929, il rejoint l'Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN). En 1931, il publia à Lvov ses mémoires sur les événements de la guerre civile sur le territoire de l'Ukraine.
Après l'effondrement de la Tchécoslovaquie et l'occupation de la République tchèque par les Allemands, il fut ouvrier d'usine et continua à participer à la vie publique de l'émigration ukrainienne. Après le début de la Grande Guerre patriotique, les partisans de Stepan Bandera de l'Organisation des nationalistes ukrainiens l'ont nommé au poste de ministre de la Guerre d'Ukraine. Il a été élu par contumace président du Comité national ukrainien. Cependant, il n'a pas réellement commencé à exercer ces fonctions, car les Allemands ont durement réprimé l'initiative « Bandera ». Il a continué à travailler à l'usine.
dernières années de la vie
Il s'installe en Bavière, vit dans un camp de personnes déplacées près de Munich et, à partir de 1947, à Augsbourg. Deux jours avant sa mort, il a été élu membre à part entière de la Société scientifique Shevchenko. Il est décédé des suites d'une grave maladie causée par la malnutrition et le surmenage.
Procédure
- Pratiques militaro-historiques. Souviens-toi. Kiev, 2002.
- Maintien en puissance et militaire : Sots.-ist. dessin Prague ; Berlin, 1924 ;
- Amélioration des connaissances militaires // Actualités étudiantes. Prague, 1926. N° 6. P.6-11 ;
- Souvenez-vous des heures de la révolution ukrainienne (1917-1921). Lviv, 1927-1931. Première partie Dans le monde de Beresteysky. 1927 ; Partie 2. La vision du monde de Beresteysky avant l'occupation de Poltavi. 1928 ; Partie 3. De la campagne de Crimée au coup d'État de l'Hetman. 1930 ; Partie 4. Hetmanate et le soulèvement du Directoire. 1931.
- Opérations stratégiques de Bohdan Khmelnitsky pendant la guerre de 1648-1649 // Ukraine militaire. K., 1993. N° 6-8.
Vsevolod Nikolaïevitch Petrov(1912-1978) - Critique d'art russe, écrivain, mémoriste, activiste des musées, connaisseur de l'art russe.
Biographie
Vsevolod Nikolaevich Petrov appartenait à l'ancienne famille noble des Petrov. Il venait de la famille Petrov de Yaroslavl et Novgorod, qui a donné à la Russie des ingénieurs, des scientifiques et des hommes d'État célèbres.
Né le 13 avril 1912 dans la famille de N.N. Petrov, oncologue et académicien (à Saint-Pétersbourg, l'Institut d'oncologie porte son nom). Petit-fils du scientifique, ingénieur général N.P. Petrov, depuis 1900 - membre du Conseil d'État (représenté dans le célèbre tableau de Repin Réunion cérémonielle Conseil d'État 7 mai 1901).
Diplômé du 1er Soviétique lycéeà Leningrad (parmi ses camarades de classe se trouvait Pavel Zaltsman).
De 1929 à 1934, il étudie à l'Université de Léningrad.
Depuis 1931, il est employé du Département des Manuscrits du Musée Russe, où il entre en 2e année. Depuis 1934 - employé de la section des dessins du Musée russe, puis employé du département des manuscrits, du département d'art soviétique, de la section des gravures, de la section des dessins et chercheur principal au département de sculpture. (en 1939)
Étudiant et ami de N. N. Punin. Il découvrit dans les archives de Benoît une esquisse graphique qu'il avait réalisée - un portrait de I. Annensky, après quoi Pounine le présenta à Akhmatova, qui appréciait extrêmement Annensky. Il faisait partie du cercle de M. Kuzmin. Sous l'influence de M. Kuzmin, il commence à écrire de la fiction et continue de le faire jusqu'à la fin des années 40 ; L'histoire la plus célèbre a été écrite en 1946, mais publiée 60 ans plus tard, « La Turque Manon Lescaut », dédiée à la mémoire de Mikhaïl Kouzmine.
Il était ami avec les artistes Vl. Lebedev, N. Tyrsa, T. Glebova, V. Kurdov et d'autres. Il était également proche des écrivains d'Oberiut, dont D. I. Kharms, qui a dédié à Petrov l'histoire « Épisode historique » du dernier cycle « Cas ».
Membre des Grands Guerre patriotique. En juillet 1941, il fut mobilisé et passa le premier hiver du siège de Leningrad.
Après la fin de la guerre, il retourne au Musée russe en tant que chercheur principal au département de peinture. À la fin des années 1940, lorsque se développa une campagne contre le cosmopolitisme et le formalisme, la réputation de V. N. Petrov au Musée russe en souffrit.
Le 7 mars 1949, après examen de son « cas » lors d'une assemblée générale des employés, Petrov est renvoyé du Musée russe. Un mois et demi plus tard, il écrivit au comité local du Musée russe une demande de réintégration dans le service, le 28 avril 1949, mais ne fut pas réintégré.
Auteur de nombreux articles, travail de recherche sur l'histoire de la sculpture russe de l'ère du classicisme, sur l'association artistique « World of Art ». A écrit une monographie sur l'œuvre de V.V. Lebedev. Il a écrit sur de nombreux artistes, dont V. Borisov-Musatov, N. Altman, V. Konashevich, A. Pakhomov, Yu. Vasnetsov, T. Shishmareva.
Après la guerre, il vivait dans la rue à Léningrad. Mayakovskogo, 11 ans, app. 58. Les appartements de cette maison ont été rénovés après la guerre et l'appartement de Petrov comprenait des pièces de l'ancien appartement 8, où vivait D.I. Kharms.
Vie privée
Depuis 1950, il était marié à Marina Nikolaevna Rzhevuskaya (1915-1982), cousine et amie proche de la seconde épouse de D.I. Kharms, Marina Vladimirovna Malich.
Portraits
Il existe des portraits de V. N. Petrov par T. N. Glebova (années 1930), T. V. Shishmareva (1969).
Procédure
Petrov a laissé des mémoires, partiellement publiés après sa mort, des journaux et cahiers, de la prose (de son vivant, elle n'a pas été publiée, bien qu'elle ait été lue en privé). De son vivant, il n’a publié que des livres et des articles sur l’histoire de l’art russe dans la presse censurée. DANS dernières années Au cours de sa vie, il a reçu la visite, entre autres, de personnalités de la « seconde » culture de Léningrad (A. N. Mironov et autres).