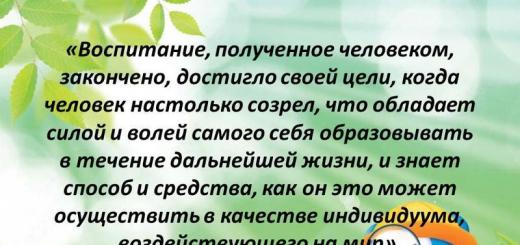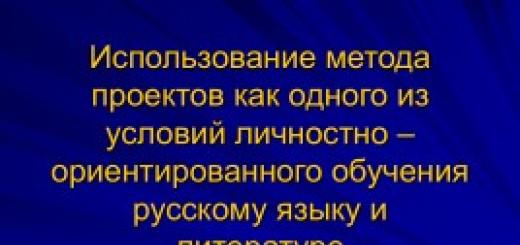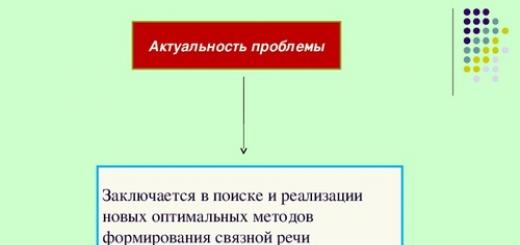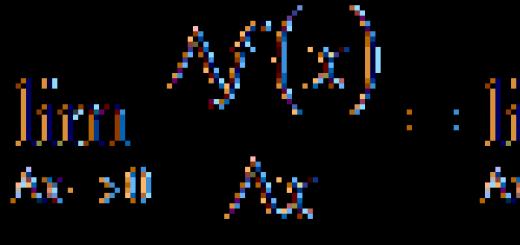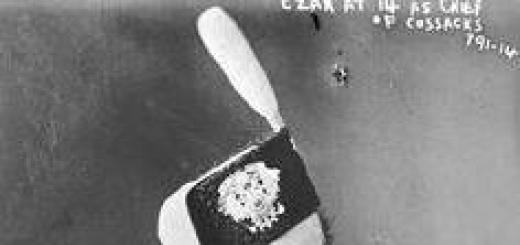TECHNIQUE DE LA PAROLE
INTRODUCTION
NOTES GÉNÉRALES SUR L'ÉTUDE DU COURS
CHAPITRE je . ORTHOÉPIE.
PRONONCIATION DES CONSONNES
TECHNIQUES DE PAROLE. DICTION.
Une brève description de la position de l'appareil articulatoire lors de la prononciation des voyelles.
VOYELLES
SONS NOTÉS E, je, Yo, Yu .
Questions d'auto-test
TRAVAIL SUR LE TEXTE
RÈGLES DE RÉPARTITION DES CONTRAINTES LOGIQUES
Lignes directrices pour comprendre l'expression expressive et logique discours correct
CHAPITRE II . MARQUES DE PONCTION, PAUSES GRAMMAIRES
Point-virgule
CÔLON
POINT D'EXCLAMATION
POINT D'INTERROGATION
ellipses
PAUSES LOGIQUES
Stress LOGIQUE
QUELQUES LOIS DE LA PAROLE ORALE
ANALYSE DU TEXTE LITTÉRAIRE D'UNE ŒUVRE DRAMATIQUE ET DU COMPORTEMENT DE PAROLE DES PERSONNAGES
ANALYSE DU TEXTE LITTÉRAIRE D'UNE ŒUVRE DRAMATIQUE À PARTIR DE LA POSITION DU COMPORTEMENT DE PAROLE DE L'ENSEIGNANT
LA PLACE DE LA GESTICULATION ET DE LA FAMILLE DANS LE COMPORTEMENT DE PAROLE DE L’ENSEIGNANT
LES RÉFÉRENCES
L'analyse logique du texte aidera les lycéens à percevoir la langue comme un organisme vivant, en constante évolution et en amélioration. Le développement de ces compétences est facilité par des exercices particuliers proposés dans cet ouvrage.
L'analyse logique du texte, dont le but est de travailler avec des œuvres littéraires, est en partie incluse dans la discipline « Culture de la parole » et dans la discipline « Lecture expressive ». Une étude réussie permettra, je pense, de résoudre les problèmes d'élocution de communication d'un adolescent avec son entourage, et augmentera également le degré d'expressivité de son discours.
L.N. Tolstoï a dit que l'art d'un écrivain consiste à trouver « le seul placement nécessaire des seuls mots nécessaires ». La tâche de l'enseignant, suivant le plan de l'auteur, est de pénétrer le secret de ce seul placement nécessaire des mots nécessaires et de le « montrer » aux élèves, en combinant dans cet affichage des fonctions éducatives et pédagogiques.
Lors du développement des compétences d'analyse logique du texte chez les élèves du secondaire, l'enseignant s'appuiera principalement sur la capacité des élèves à penser et à agir logiquement, sur les connaissances langue maternelle et ses caractéristiques - son vocabulaire, la construction spécifique de la phrase, la signification des signes de ponctuation, la sémantique des épithètes utilisées.
Les caractéristiques expressives du discours conversationnel oral en direct sont inépuisables et n'ont pas encore été entièrement étudiées par les scientifiques. Par conséquent, lorsqu'il travaille avec des écoliers, l'enseignant ne notera qu'un certain nombre de modèles de base du discours russe - lors de l'organisation des pauses et de l'accentuation dans la mélodie ( le mouvement de la voix vers le haut ou vers le bas au cours du développement d'une pensée, à son achèvement).
Les intonations peuvent être infiniment différentes lorsqu’on prononce la même phrase. Il ne devrait y avoir qu'une seule condition obligatoire : l'intonation doit transmettre avec précision le sens que l'auteur voulait exprimer. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de mouvements d'intonation en eux-mêmes, mais vous devez suivre le cercle de pensées, de visions, de sous-textes nécessaires pour révéler les intentions de l'auteur.
C'est ce qui permet de réussir à trouver les intonations nécessaires pour les seuls mots nécessaires. Par conséquent, afin de vous souvenir de l'expression trouvée d'une pensée, vous devez vous souvenir non pas de l'intonation, mais de son évolution logique, qui a conduit à la bonne, mot efficace, dans une perspective logique.
C'est pourquoi, parallèlement au développement de compétences en analyse logique de texte, les étudiants se familiarisent avec les lois discours oral. L'utilisation des propriétés expressives de cette dernière lors de la lecture d'une œuvre littéraire et lors de son travail repose bien entendu sur la connaissance des lois du langage, dont la compréhension aidera les lycéens à placer consciemment des signes de ponctuation, en se concentrant sur le sémantique du texte.
Le problème de la formation professionnelle des enseignants acquiert actuellement une importance et une pertinence particulières.
Le niveau d'exigences modernes pour les professionnels dans n'importe quel domaine, y compris l'activité créatrice d'un enseignant, est très élevé.
Un enseignant qui s'adresse aux enfants doit être maître de son métier. Si un enseignant prétend être une autorité, moralement et intellectuellement développée, alors il doit avoir non seulement connaissances nécessaires et être capable de les présenter méthodiquement correctement aux enfants, mais aussi être une personne créative avoir un style individuel activité pédagogique, essayez d'atteindre les sommets de l'excellence pédagogique.
En même temps, dans les activités de l’enseignant, il y a beaucoup de choses typiques, répétitives, stables, reflétées dans les lois, principes et règles déjà identifiés. Mais il y a aussi beaucoup de choses changeantes, variables, individuelles.
À chaque fois position générale doit être appliquée en tenant compte des circonstances spécifiques et du caractère unique de la situation donnée. L’enseignant doit « redécouvrir » ce que la science a découvert et se l’approprier. Et l’instrument d’influence de l’enseignant sur les élèves est la parole.
V.A. Soukhomlinsky a noté : « Le mot est le contact le plus subtil avec le cœur ; avec un mot, vous pouvez tuer ou ranimer, blesser,... semer la confusion et le désespoir. Dissiper les doutes et plonger dans le découragement, créer un sourire et susciter l'incrédulité. Inspirez au travail et engourdissez la force de l’âme.
Les enfants sont impressionnables, le problème se pose donc d'activer sur eux l'impact du discours émotionnel, qui contribue au développement de l'imagination, de la créativité et du sens esthétique.
En assurant ainsi le développement linguistique des enfants, l'enseignant crée les conditions de leur développement intellectuel, émotionnel, moral et les prépare à une participation active et active à la vie de la société.
Le point de départ de la formation de la culture de la parole chez les enfants est le discours de l’enseignant lui-même. M.A. Rybnikova souligne : « L'enseignant lui-même, sa manière de parler, sa parole expressive, son histoire, sa lecture de poésie - tout cela est un exemple constant pour les étudiants. »
Par conséquent, l'attention portée au discours exemplaire, qui est ce que devrait être le discours d'un enseignant, contribuera à développer chez les écoliers un goût linguistique, une attitude critique envers leur propre discours oral, la nécessité de l'améliorer, et les aidera à comprendre les règles de base de comportement de parole.
Ainsi, compte tenu du besoin urgent d'améliorer les capacités d'expression des enseignants, nous proposons de formuler le processus d'apprentissage pour les étudiants universitaires dans le cours « Culture de la parole », sur la base des dispositions suivantes :
1. La maîtrise des compétences de la culture de la parole fait partie intégrante de la maîtrise d'une spécialité et doit donc être réalisée en unité créative et méthodologique avec l'enseignement des disciplines à caractère humanitaire.
2. Le facteur le plus important pour maîtriser le cours est l'activation travail indépendantétudiants, dont l'aide sera apportée par les développements méthodologiques proposés dans certaines sections de la matière.
En train de travailler sur exercices pratiques il est nécessaire d'établir l'état général de l'appareil parole-voix de chaque élève, sa capacité à véhiculer une perspective logique de la pensée dans le texte, d'identifier et d'éliminer la présence de déficiences de diction, de voix, d'orthoépique, de déterminer leur nature (si nécessaire, se référer chez un phoniatre).
La culture de la parole de l’enseignant présente un certain nombre de qualités qui la distinguent de la culture quotidienne. Il doit paraître phonétiquement pur, littérairement correct et efficace.
La prononciation dans le discours pédagogique n'est pas seulement sa forme externe, mais aussi un moyen d'expression important. L’objectif le plus important du cours est donc de développer les compétences linguistiques professionnelles des étudiants.
Le cours « Culture de la parole » comprend les sections suivantes :
1. Culture de la parole et compétences professionnelles de l’enseignant.
2. Normes de prononciation de la langue russe.
4. Qualités communicatives du discours de l’enseignant.
5. Types d'œuvres vocales (genres) utilisées dans diverses situations éducatives.
Le manuel proposé comprend des lignes directrices pour des sections telles que « Orthopéie » et « Technique de la parole ». Leur tâche est de maîtriser les règles de prononciation littéraire de la langue russe et de corriger toutes sortes de troubles de la parole des étudiants.
Selon le programme, les cours se terminent par un test dont la principale exigence est la maîtrise de la langue de la matière, la connaissance des principes théoriques de base du cours, une analyse qualifiée du son de la parole d'autrui et de la sienne, et travail habile sur l'analyse logique d'un texte littéraire.
Orthoépie- il s'agit d'un ensemble de règles qui établissent une caractéristique unique langue littéraire prononciation considérée comme exemplaire. Le discours de l'enseignant doit être exemplaire en prononciation. Pour ce faire, vous devez apprendre normes de prononciation littéraire généralement acceptées.
Ces normes, qui se sont développées au XIXe siècle à la suite d'une étude et d'une sélection minutieuses, ont absorbé tout ce qu'il y a de meilleur et de caractéristique de la langue russe.
L'orthoepie russe moderne (le nom vient du grec ώρφος - correct et έπος - discours) a évolué avec le développement de la littérature et de l'art dramatique. Dans notre pays, il y a beaucoup régional dialectes et les dialectes, qui parfois ne peuvent être utilisés que comme caractérisation vocale de l'image .
Les élèves doivent apprendre les règles de base de la prononciation et savoir comment les utiliser.
Dans le discours russe, la question de accent correct, puisque l'accent peut être sur n'importe quelle syllabe, par exemple :
maison, prépare, apporté etc.
Différent syllabes accentuées changer le sens :
mu`a - muka, château - château .
Chaque mot de la langue russe en a un Syllabe accentuée(avec une voyelle accentuée), sans laquelle le mot en prononciation n'a pas de forme complète. Le caractère de la parole se manifeste dans de larges sons de voyelles chantées .
Pour prononciation correcte voyelles non accentuées du mot, l'attention doit être concentrée sur Syllabe accentuée.
Manger un certain nombre de règles pour la prononciation des voyelles non accentuées :
1 .Son non stressé [ À PROPOS] au début d'un mot et à syllabe précontrainte prononcé comme [ Λ ]:
emporter – [Λ] cacher , hache – t [Λ] depuis lors .
2 .« À PROPOS» non accentué, occupant la deuxième ou la troisième place avant une syllabe accentuée ou situé immédiatement après une syllabe accentuée, sonne comme un intermédiaire ( réduit) son, moyenne entre [ UN] Et [ Oui ].
Il est indiqué par le signe Kommersant :
passerelle - p[Ъ]dv[Λ] entreprise ;
gel - izm[Ъ] R.[Ъ] s ;
cheveux - bœuf[Ъ] Avec).
3 .Son non stressé [ UN] au début d'un mot et dans une syllabe non accentuée immédiatement avant celle accentuée, se prononce comme un court " UN »:
artiste- [UN] artiste, jardins - avec[UN] Oui .
4 .Son non stressé [ UN] après F, F prononcé comme UN :
chaleur – et[UN] ra , étapes - w[UN] gi , balles - w[UN] ry .
5 .Voyelles non accentuées [ U ], [Oui] dans la prononciation ne sont pas remplacés par d'autres sons, mais perdent leur longueur.
6 .voyelle [ ET] au début d'un mot devient [ Oui], si le mot précédent se termine par une consonne dure :
avec intérêt - avec[s] intérêt
sache juste que – Donc[s] savoir .
Mais si, selon le sens, il doit y avoir une pause entre les mots, alors la prononciation du son [ ET] reste inchangé:
J'écoute avec / intérêt le gel et le soleil .
7 .Voyelles non accentuées " E », « je" dans la prononciation, ils sonnent comme un son intermédiaire entre ET Et E, qui est désigné par le signe ET :
sorbier des oiseleurs - p[ET] Bina, le printemps – V[ET] dormir .
8. Son [ E] sous l'accent peut sonner différemment, selon les consonnes qui le suivent : avant les consonnes dures [ E] sonne large, ouvert, avant les sons doux – fermé, étroit :
E -large: m[E] je , P.[E] je , St.[E] T ;
E -fermé: P.[E] si , St.[E] mésange).
9. Combinaisons AO, OA, AA, OO prononcé de la même manière que [ AA ]:
sur la fenêtre - n[AA] genou
style militaire – P.[AA] armée
sur l'arche - n[AA] rke
monotone – un[AA] fantaisie .
10.A Et À PROPOS en combinaison avec U (AU, OU), placés bien avant l'accent, se prononcent avec réduit son [ UN], mais ne se transforme jamais en son [ U ]:
au hasard - n[Ъ] deviner dans les coins - p[Ъ] coins .
11 .Combinaisons OUI, IEà la fin des adjectifs pluriel prononcé comme YI, II :
vieux – vieux[YI], blanc Blanc[YI]
été - laissez-moi[IA], bleu bleu[IA].
12 .Finitions des adjectifs – GIY, -KIY, -HIY prononcé comme -G[Ъ] Oui , -À[Ъ] Oui , -X[Ъ] Oui :
long - devoir[Ъ] ème , large – large[Ъ] ème
calme – calme[Ъ] ème .
La prononciation des mots est différente de l’orthographe :
Andreevna - Andrevna, Nikolaevna - Nikolaevna;
Ivanovna - Ivanna, Alexandrovna - Aleksanna ;
Loukinichna – Loukinishna et ainsi de suite.
Certains sont des femmes et prénoms masculins en combinaison avec les patronymes se prononcent différemment de l'écrit :
Maria Ivanovna – Marie Ivanna
Pavel Pavlovitch – Pal Palych .
1. Les consonnes sonores à la fin d'un mot et avant que les consonnes sourdes ne soient prononcées comme sourdes :
carottes - carottes, carottes - carottes;
panier - vos, yeux - glaski, move - chaud;
baignoire - patinoire, ami - ami .
2 Les consonnes sourdes avant les consonnes sonores sont prononcées fort :
collection - collection, transaction - transaction, repos - repos .
Avant ceux exprimés R, L, M, N, V Il n'y a pas d'assimilation des consonnes sourdes aux consonnes sonores :
avec une jeune femme, avec un rôle, avec du citron
avec toi, avec Nina.
3 .Des sons SSH, ZSH, placés l'un à côté de l'autre, se prononcent comme double Chut :
est devenu bruyant - a fait du bruit, avec le manteau de fourrure - etSHFurs.
4 .Combinaisons de racines de mots ZZH Et LJ prononcé comme double doux MENSONGE :
plus tard - POZHZHE, visiteur - POZHZHY
levure - frisson, cri - cri
se plaindre - se plaindre.
5 .En combinaison avec des voyelles F, W, C toujours un son ferme :
Graisse - graisse, largeur - shyr, zinc - zinc.
6 .Combinaison MF et AF prononcé comme double SCH :
partition - Shchet, bonheur - Shchastye
le charretier est un cireur, sans thé - je bats.
7 .Combinaisons CC Et MP prononcé comme double H :
réparateur - réparateur, désespoir - désespoir.
8 .Combinaisons DC, centre commercial prononcé comme double C :
trente - troisTsTsat, père - oTsTsa.
9 .Des sons Chut, Ch toujours prononcé doucement :
brochet - brochet, thé - thé.
10 .Combinaisons DS Et TS dans les adjectifs, ils se prononcent comme C :
urbain – Gorotskoy, soviétique – Sovetskiy.
11 .Combinaison CHN a une double prononciation comme ShN Et CHN, parce que ShN reste dans les mots vivant langue parlée :
ennuyeux - ennuyeux, délibérément - populaire
boulangerie - boulangerie, insignifiante - insignifiante
oeufs brouillés
Dans les manuels, les étudiants doivent se familiariser avec une description plus détaillée des règles de prononciation des voyelles et des consonnes et de leurs combinaisons dans la langue littéraire russe moderne.
Ils doivent apprendre les normes de prononciation non seulement pendant les cours, mais aussi dans la pratique. discours de tous les jours qui doit être contrôlé.
Nous devons apprendre à écouter le discours des gens qui nous entourent, comparer la prononciation, suivre le discours des maîtres de scène, écouter les enregistrements des discours des lecteurs et des artistes, écouter les annonceurs de radio et de télévision.
Il est bon de pratiquer les règles de prononciation lors de lectures à haute voix, de réécrire des passages dans leur orthographe - tout cela permet de consolider les règles.
Une bonne diction signifie une prononciation claire et précise de chaque voyelle et consonne séparément, ainsi que des mots et des phrases.
Technique de la parole- une des sections de la culture de la parole, c'est la base culture de la parole. Une mauvaise diction rend difficile la compréhension de l’essence de ce qui est dit.
« Un mot au début froissé est comme un homme à la tête aplatie. Un mot dont la fin est inachevée ressemble à un homme aux jambes amputées. La perte de sons et de syllabes individuelles équivaut à un œil ou une dent arraché » (K.S. Stanislavski).
Une prononciation claire et précise est possible si vous disposez d’un appareil vocal normal et s’il fonctionne correctement. À appareil vocal comprennent : les lèvres, la langue, les mâchoires, les dents, le palais dur et mou, la petite langue, le larynx, la paroi postérieure du pharynx (pharynx), les cordes vocales.
Il peut y avoir des défauts dans la structure de l'appareil vocal qui provoquent zézaiement, zézaiement, bavure, une intervention médicale est alors nécessaire. Mais la cause d’une prononciation peu claire est une mauvaise habitude dont vous pouvez vous débarrasser grâce à un entraînement systématique.
Les étudiants doivent se rappeler que les exercices sont systématiques. Technique de la parole– une matière pratique, uniquement formation constante est une condition indispensable pour développer une diction claire. Même si le discours est pur, il nécessite encore des améliorations techniques.
Il faut connaître ses défauts, comprendre et maîtriser la position des parties de l'appareil vocal au moment de prononcer un son particulier. Vous devez pratiquer la technique de la parole pour que votre discours soit facile et libre.
K.S. Stanislavski a donné grande importance formation sur l'appareil vocal. Il y a souvent des gens avec un discours lent, une paresse de la langue et mauvais travail mandibule ( tension de la mâchoire).
Pour développer les organes de la parole, il faut engager gymnastique articulatoire, avec son aide, la flexibilité et la souplesse de l'appareil vocal et des muscles individuels sont développées. Les muscles qui nécessitent formation systématique. Le renforcement des muscles de la bouche et de la langue est une préparation au travail sur les sons de la parole.
Des exercices pour entraîner la mâchoire inférieure, les muscles labiaux et les muscles de la langue sont décrits dans les manuels et seront donnés au cours du processus. Travaux pratiques. Tous les exercices de gymnastique articulatoire doivent être effectués en séquence jusqu'à une assimilation complète et correcte.
Lorsque vous maîtrisez votre appareil vocal et comprenez les fonctions de ses différentes parties, vous pouvez alors passer à la correction des voyelles et des consonnes individuelles.
· ET - Mâchoire inférieure légèrement abaissé. La lèvre supérieure est relevée. Les bords des incisives inférieures et supérieures sont exposés. La distance entre les dents est petite (2 à 3 mm). Le bout de la langue repose sur les incisives inférieures.
· E- La mâchoire inférieure est légèrement plus abaissée que lors de la prononciation du I. Les incisives supérieures sont exposées. La distance entre les dents est le pouce, le bout de la langue au niveau des incisives inférieures.
· UN- La bouche est ouverte. La mâchoire inférieure descend plus que lorsqu'on prononce E. Les bords des incisives supérieures sont exposés. La distance entre les dents est de deux doigts placés l’un sur l’autre. La langue est plate.
· À PROPOS- Les lèvres sont arrondies et poussées vers l'avant. La langue est quelque peu tirée en arrière.
· U- Les lèvres sont poussées vers l'avant en forme d'entonnoir. La langue est fortement tirée en arrière.
· Oui- L'articulation de Y est la même que pour prononcer I ; seule la position de la langue change. Le bout de la langue est tiré vers l'arrière (comme en O).
Sons Yotated E, je, Yo, Yu consiste en une consonne [ Oui] et les voyelles [ E ], [UN ], [À PROPOS ], [U ].
Les exercices sur les voyelles peuvent constituer une bonne gymnastique articulatoire.
Prononcer des voyelles dans diverses combinaisons aide à développer et à renforcer la lèvre supérieure, langue, mâchoire inférieure.
Les voyelles forment la mélodie de la parole, sa sonorité. Voyelles 6 :
[I], [E], [A], [O], [U], [Y].
Faites un tableau à partir de ces sons, qui servira de base à la formation :
Je – E, je – E, je – E ;
E-A, E-A, E-A ;
A-O, A-O, A-O.
U – Y, U – Y, U – Y ;
O - U, O - U, O - U ;
Cet exercice peut être combiné de différentes manières, en changeant l'ordre et la séquence des voyelles puis des consonnes.
I – E – A – O – U – Y
Le premier son est accentué, les autres sont prononcés uniformément ;
I – E – A – O-U – S
Le deuxième son est accentué, etc.
Ces sons sont formés d'une combinaison de deux sons pour chaque consonne : E=Y+E, I=Y+A, E=Y+O, Y=Y+U.
Pour les exercices, vous devez alterner les voyelles avec les iotées.
Par exemple:
I-YI, E-E, A-Z, O-Y, U-Y.
Les consonnes plus difficile à prononcer. Ils prononcent un discours clarté, expressivité, aide à former des mots.
Lors de la prononciation des voyelles, une tension dans n’importe quelle partie de l’appareil vocal est nécessaire.
Lors de l'entraînement des consonnes, vous devez faire attention à l'élasticité et à la force des organes de la parole avec leurs arrêts et leurs sons plosifs.
Les sons des consonnes sont exprimés et la voix est impliquée dans leur prononciation :
[B], [V], [D], [D], [F], [H],
[L], [M], [N], [R] .
Des sons [M], [N], [L], [R] Ils sont également appelés sonores, car ils n'ont pas de sons sourds appariés.
Lors de la prononciation de consonnes sourdes, la voix n'est pas impliquée :
[P], [F], [K], [T],
[W], [Sh], [H], [C].
Des sons [C], [H], [Sh]- complexes, on les appelle affriquée(fusionné).
Par exemple:
son [ H] s'articule à partir de " ÈME" Et " SH »;
son [ SCH] s'articule à partir de " SH" Et " SH ».
Des sons [ S] et [Z] – sifflement ;
des sons [F], [Sh], [H], [Sh] – sifflement.
Exemple d'exercices pour les consonnes.
Son [ P.] - claquement [ B] - sonore.
1. Alternative : P, B(à plusieurs reprises).
2. PI – PE – PA – PO – PU – PY.
3. BI-BE-BA-BO-BU-BE.
4. PE – PE – PE – PO.
5. ÊTRE - BYA - ÊTRE - BO.
6. PIBB – PEBB – PUBB – POBB – PUBB – PIBB.
7. BIP - BEPP - BAPP - BOPP - BUPP - BUPP.
8. PIBBY – PEBBE – PABBA – POBBO – PUBBU – PYBBY.
9. BIPPY - BEPPE - BAPPA - BOPPO - BUPPU - BUPPY.
Tu peux inventer diverses options exercices, alternant des sons sourds et voisés avec toutes les voyelles.
Lorsque vous pratiquez la prononciation de sons individuels, vous devez vérifier la position correcte des parties de l'appareil vocal.
Les sons atténués sont plus difficiles à prononcer [ T] Et [ D ] (ÈME Et OUI).
Ces sons doivent être entraînés avec des voyelles iotées.
Par exemple:
TI, TE, TY, TY, TY, TI ;
DI, DE, DI, DI, DU, DI .
La structure d’un exercice d’articulation peut être la suivante :
1. TIDDY – TEDDE – TYADYA –
TYDDYO - TYUDDYU - TIDDY.
2. TI – DI – DI – TTI,
TE – DE – DE – TTE,
TYA – DA – DA – TTYA.
3. TE – DE – DE – TTE,
TYU - DU - DU - TYU.
Pour consolider la prononciation de chaque son, proposez des mots dans lesquels ce son serait au début et à la fin du mot, utilisez des proverbes et des dictons.
Par exemple:
· ET« Ils savaient qui ils battaient, c’est pourquoi ils ont gagné ;
· E- Celui qui sème et gagne ne deviendra pas pauvre ;
· À PROPOS- Le champ est rouge de mil, et la parole est avec l'esprit ;
· YUYU- Tu ne seras pas intelligent avec l'esprit de quelqu'un d'autre,
Celui qui n'aime pas les gens se détruit lui-même ;
· ET MOI- La tête est folle, comme une lanterne sans feu,
Faites une erreur, mais admettez-la ;
· ET – P.- Ipat est allé acheter des pelles,
Ipat a acheté cinq pelles,
j'ai traversé l'étang - j'ai attrapé une canne,
Ipat est tombé - il manquait cinq pelles.
· Oui"Comme Martyn, son altyn l'est aussi."
Pour parvenir à un discours expressif, il est nécessaire de parler clairement et clairement à une vitesse égale. Ceci est facilité en travaillant sur les virelangues.
L'enseignant doit également répondre à des questions tempo discours. Dans les cours, un discours rapide et facile est parfois requis, dont la clarté doit être extrêmement claire.
Par conséquent, travailler sur votre virelangue est un moyen d’obtenir une parole claire à tout rythme. La mémorisation mécanique et monotone des virelangues ne donnera jamais d'avantages pratiques.
En fonction du sens de la phrase, en la variant au fur et à mesure, en changeant l'intonation en conséquence, l'orateur utilisera facilement différents débits de parole.
Il n'est pas nécessaire de s'efforcer de prononcer rapidement des virelangues tout de suite. Au début, dites-le lentement, en prononçant chaque son individuellement, en vous arrêtant après chaque mot.
Lorsque vous prononcez un virelangue, assurez-vous que tous les sons prononcés sont complets, en évitant le flou et le flou.
Lorsque vous prononcez des virelangues, essayez de définir différentes tâches de performance (paramètres de parole internes).
Par exemple:
Lorsque j'interprète ce texte verbalement, j'ai envie de plaisanter, je veux me plaindre, je veux bavarder, je veux me vanter, etc.
Exemples:
1. « Tondez, tondez, tant qu’il y a de la rosée, à bas la rosée – et nous rentrerons à la maison. »
2. "Le protocole concernant le protocole a été enregistré comme protocole."
3. « Parlez-moi de vos achats !
Et les achats ?
À propos du shopping, du shopping,
sur mes achats."
DANS littérature pédagogique Vous trouverez du matériel textuel pour l'auto-apprentissage de la diction, un certain nombre de virelangues, des textes, des exercices qu'il faut pratiquer systématiquement, en les compliquant progressivement.
Une respiration bien organisée joue un rôle primordial dans la parole. Le manque d'air expiré nécessaire entraîne des pannes de voix, des pauses injustifiées, déformant la phrase.
Il ne faut pas oublier qu'un air consommé de manière inégale rend souvent impossible la fin d'une phrase et vous oblige à « extraire » les mots de vous-même.
La prononciation correcte, claire, expressive et belle des sons, des mots et des phrases dépend du fonctionnement de l'appareil vocal et d'une bonne respiration.
Au début des cours de développement respiratoire, il est nécessaire de se familiariser avec l'anatomie, la physiologie et l'hygiène de l'appareil respiratoire-vocal, avec types existants respiration.
Il ne faut pas oublier que le type de respiration diaphragmatique mixte est le plus approprié et le plus utile en pratique.
Sur cours individuels Il est conseillé aux étudiants de réaliser une série d’exercices de respiration avec un professeur.
Il existe un lien inextricable entre le souffle et la voix. Une voix correctement réglée est une qualité très importante dans le discours oral, notamment pour un enseignant.
Résonateurs sont des amplificateurs de son. Les résonateurs comprennent :
palais, cavité nasale, dents,
os du visage, sinus frontal .
Il se peut qu’une personne parle « plus bas » que ce qui correspond à la nature de ses données vocales. La voix s’avère alors compressée, manquant de sonorité.
Afin d'apprendre à vérifier le fonctionnement des résonateurs, vous devez effectuer divers exercices.
Par exemple:
Expirez l'air, inspirez (pas trop) et, en expirant, dites lentement sur une seule note :
MMMI – MMME – MMMA – MMMO – MMMU – MMMY.
Prononcez cette combinaison de sons sur différentes notes, en passant progressivement des notes graves aux notes aiguës (dans la limite des possibilités) et, à l'inverse, des notes aiguës aux notes graves.
Exercice:
Choisissez un poème avec un vers de taille moyenne, par exemple « Une voile solitaire est blanche » ou « J'aime un orage début mai ».
Dites la première ligne en une seule expiration, inspirez de l'air et dites les deux lignes suivantes en une seule expiration, inspirez à nouveau de l'air et dites trois lignes à la fois, etc.
Vous devez faire passer l’air de manière invisible par le nez et la bouche. Ainsi, lorsque nous effectuons des exercices de respiration, nous impliquons la respiration dans la formation de la voix.
2. Ne criez pas normalement.
3. Ne toussez pas si vous avez mal à la gorge.
4. Ne buvez pas de boissons très chaudes ou très froides.
5. Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin.
Les compétences de respiration et de formation de la voix acquises pendant les cours doivent être utilisées par les étudiants à tout moment lorsqu'ils travaillent sur le texte.
1. Parlez-nous des normes de prononciation littéraire.
2. Que savez-vous des dialectes et des accents ?
3. Quelle est la signification du stress dans un mot ?
4. Parlez-nous de la prononciation des voyelles accentuées.
5. Comment les voyelles non accentuées sont-elles prononcées ?
6. Pourquoi avez-vous besoin de pratiquer la technique de la parole ?
7. Qu'est-ce que la diction ?
8. Que faut-il faire pour corriger tel ou tel défaut de diction ?
9. Pourquoi la gymnastique d'articulation est-elle nécessaire ?
10. Quelles voyelles connaissez-vous ? Quel est leur rôle dans la parole ?
11. Que savez-vous des voyelles iotées ?
12. Nommez les consonnes et déterminez leur signification dans le discours. Parlez-nous de la classification des consonnes.
13. Comment fonctionne l'appareil vocal ?
14. Quel est le rôle de la respiration dans le discours scénique ?
Tâches pratiques.
1. Répétez les exercices de diction sur les voyelles et consonnes étudiées, les proverbes, les virelangues.
Analyse de texte logique est le principal moyen d'atteindre une expressivité maximale en lecture.
Le travail sur un texte littéraire est la base sur laquelle reposent tous les cours de technique de la parole.
Tout le travail préparatoire depuis la première lecture jusqu’à la représentation devant le public se résume au fait que l’interprète s’efforce de s’approprier le texte de l’auteur, le lecteur s’efforce de prendre la place de l’auteur.
Après avoir soigneusement analysé le matériel littéraire, l'étudiant doit créer son propre plan de performance.
Par où commencer à travailler sur le texte ?
Tout d'abord, après avoir lu une œuvre littéraire, vous devez exprimer (formuler) votre opinion, votre impression - cela mènera à une conclusion sur l'idée principale du passage.
Pour l’expression concrète d’une idée moyens artistiques, c'est à dire. V images, peintures l'auteur choisit sujet(ce qu'il écrit).
Idée- comme l'âme de l'œuvre, sujet- son corps.
L'étape clé de la lecture orale est lecture logique, transmettant le sens du texte sous une forme compétente et compréhensible.
Analyse logique basé sur les lois de la grammaire : les mots qui composent une phrase ont un sens lié les uns aux autres.
Les mots qui n'ont pas de sens les uns par rapport aux autres sont séparés par des pauses, appelées logiques, car elles aident à transmettre correctement l'idée de la phrase.
Prisonniers entre pauses logiques des mots et des phrases individuels sont appelés la parole bat.
Par exemple:
Bientôt (la lune et les étoiles) seront noyées dans un épais brouillard.
1 mesure 2 mesures 3 mesures
La parole, correctement répartie entre des groupes de mots, identifie avec précision la pensée sous-jacente. « Le travail sur la parole et les mots doit commencer par la division en battements de la parole, ou, en d'autres termes, par l'aménagement de pauses logiques » (K.S. Stanislavski, ouvrages collectifs, vol. III).
Le regroupement logique des mots influence l'interprétation correcte de l'œuvre et sa communication claire et convaincante.
Les pauses logiques obligent le locuteur à prononcer les mots contenus entre eux, sans les séparer, en douceur, comme un seul mot.
Selon l'endroit où se situe la pause, la phrase prend un sens différent.
Par exemple:
1. « C'est une enfant » ou :
« Elle est/une enfant » ;
2. « On ne peut pas pardonner/exiler en Sibérie » ou :
« Pardonne / ne peut pas être exilé en Sibérie » ;
3.« Vous ne pouvez pas exécuter/avoir pitié » ou :
« Exécuter / ne peut pas être gracié. »
Il peut être particulièrement difficile de transmettre le sens d’une phrase dans les cas où elle est composée de longs points. Lors de la lecture de telles phrases, leur taille détourne l’attention des élèves des mots qui définissent l’idée principale.
Par exemple:
« Le village de Kalouga /, au contraire, / est en grande partie entouré de forêt, / les huttes sont plus libres et plus droites, / couvertes de planches ; / les portes sont bien verrouillées, / la clôture dans la cour n'est pas emportée et ne tomber, / n'invite pas / chaque cochon de passage à lui rendre visite... »
(I.S. Tourgueniev « Khor et Kalinich »).
De longues périodes de discours se retrouvent souvent dans les œuvres d'I.S. Tourgueniev (par exemple, dans « Notes d'un chasseur »), L.N. Tolstoï (dans « Histoires de Sébastopol"), Charles Dickens (dans "The Pickwick Papers"), etc.
Des extraits de ces ouvrages peuvent servir de bon matériel pour travailler sur l'analyse des bases logiques du texte.
Les pauses sont divisées en trois groupes :
1. Une pause qui termine une déclaration, une dernière pensée, est indiquée par trois barres verticales (///) ;
2. Une pause, indiquant, d'une part, l'achèvement d'une partie de l'énoncé, et d'autre part, une éventuelle continuation de l'énoncé, est indiquée par deux lignes (//) ;
3. Une pause, indiquant que l'énoncé va continuer, est indiquée par une seule ligne (/).
En plus des pauses logiques, indiquées par des tirets, il y a des pauses à peine perceptibles, appelées pauses de réaction, noté apostrophe.
K.S. Stanislavski définit trois types de pauses : pause logique, psychologique et de contrecoup besoin de reprendre son souffle.
Pause logique aide à clarifier l'idée du texte, psychologique– donne vie aux pensées, aide à clarifier sous-texte.
Une pause logique est placée dans des phrases courantes complexes, principalement lorsque, pour la clarté de la phrase, nous devons séparer certains segments du discours des autres.
Le plus souvent, lors de la lecture, une pause est placée entre un groupe de mots liés au sujet et un groupe de mots liés au prédicat.
Par exemple:
« Monter les escaliers / menant à Petrovitch, / qui, pour être honnête, était pavé d'eau, / slops / et imprégné de part en part de cette odeur d'alcool / qui ronge les yeux, / et, comme vous le savez, est indissociablement présente sur tous les escaliers arrière des maisons de Saint-Pétersbourg, / - en montant les escaliers, / Akaki Akakievich / pensait déjà / à ce que Petrovitch demanderait, / et a mentalement décidé de ne pas donner plus de deux roubles.
(N.V. Gogol « Le Pardessus »).
Une attention particulière est requise pour respecter les signes de ponctuation et leur mise en évidence (tonification) correcte dans la prononciation du texte.
Si vous n'observez pas les signes de ponctuation lors de la lecture, cela entraînera un « babillage » du texte et une précipitation. "La lutte contre la précipitation consiste à étudier les intonations dictées par les signes de ponctuation", a déclaré K.S. Stanislavski.
Tous les signes de ponctuation nécessitent des intonations vocales obligatoires : point, virgule, points d'interrogation et d'exclamation ont leurs propres intonations vocales, qui leur sont propres.
Ces intonations ont un impact sur les auditeurs, ce qui les oblige à une certaine réaction : intonation interrogative - pour une réponse, exclamation - pour la sympathie et l'approbation, l'admiration, la protestation, un deux-points - pour la perception attentive d'un discours ultérieur - c'est un signe de une pensée à moitié achevée, obligeant à attendre une énumération, une clarification.
"J'adore la virgule", a déclaré K.S. Stanislavski, "c'est là que l'on peut se forcer à écouter".
Point- c'est aussi un signe d'arrêt dans le discours, mais la dernière syllabe du dernier mot avant le point doit sonner avec une intonation plus basse que les précédentes, et non plus haute, comme avec une virgule.
La tonalité (intonation) des points est différente. Les auditeurs après la période n'attendent pas la suite de la phrase, puisqu'elle est terminée.
Par exemple, la tonalité d'un point dans une phrase qui complète le texte d'un passage sera différente de celle des lignes initiales, lorsque le développement des événements et des pensées se poursuit.
Tiret- un signe qui n'a pas sa propre mélodie. Selon sa signification, un tiret peut ressembler à un point, une virgule, un deux-points, des points de suspension ou disparaître complètement.
Par exemple:
"Foma l'écoutait et - /…/ semblait boire du miel."
«Je suis paisible» (je suis paisible).
"Si nous nous faisons prendre, /,/ nous frapperons."
Ellipse- un signe indiquant l'incomplétude d'une pensée.
Point-virgule- un signe qui n'a pas sa propre mélodie constante. Cela ressemble soit à un point, selon le sens, soit à un point-virgule lorsque les phrases sont séparées.
Parfois, une virgule peut ressembler à un point.
Par exemple:
"La réalité de notre programme, ce sont les gens vivants, (.) c'est vous et moi."
Un point ressemble à une virgule lorsque deux phrases peuvent être reliées en une seule phrase.
Parallèlement à cela, une virgule peut sembler exclamative lors de l'énumération d'un changement rapide de phénomènes ou d'événements.
Par exemple:
"Et tout : pots, verres, bancs, tables -
Mars! Mars!
tout est allé dans le poêle.
(A.S. Pouchkine « Hussard »)
On voit qu'un signe de ponctuation peut se transformer en un autre. Les étudiants doivent s'entraîner en écoutant le ton correct d'un signe de ponctuation particulier ; vous devez lire à haute voix et sélectionner des exemples des différents sons des signes de ponctuation.
Les signes de ponctuation ne sont pas seulement des signaux d'arrêt, mais aussi des indices d'intonation : sémantique Et émotionnel .
Chaque groupe de mots doit avoir un accent, et un seul. L'accent met l'accent sur un groupe de mots.
Les mots accentués nécessitent une insistance particulière par rapport à la prononciation des autres mots.
Il existe plusieurs manières de souligner cela : élever la voix, faire une pause, ralentir, et parfois baisser la voix.
1. Sujet et prédicat.
Dans une phrase simple et sans extension, l’accent logique tombe sur l’un d’eux. Habituellement, le mot qui occupe la deuxième place prend l'accent.
Par exemple:
« Les champs sont vides ; les forêts étaient exposées.
2. Règle sur un nouveau concept :
UN) si le sujet et le prédicat sont un mot qui désigne un nouveau concept pour un texte donné, alors l'accent est mis sur celui-ci. Si les deux concepts sont évoqués pour la première fois, ils ressortent tous les deux.
B) si cette notion a déjà été évoquée dans le texte, alors elle n'est plus mise en avant
Par exemple:
"Ici maison ,
qui a construit Jack ,
et ça blé ,
qui est dans le noir placard stocké
dans la maison,
que Jack a construit."
On voit que les nouveaux concepts : "maison", "jack", "blé", "placard"- ressortir. En répétant des mots "maison", "Jack" l'accent y est retiré.
DANS) les prédicats dont le sens dans le texte réside dans le sens du sujet ne sont pas mis en évidence dans le texte.
Par exemple:
"Ça brillait foudre"," tonna tonnerre ».
3. Règle d'opposition.
Si un concept est affirmé pour en nier un autre, alors les deux termes opposés sont mis en évidence.
Par exemple:
« Je prendrai des vacances pas en ce année, et dans avenir« - cette année est opposée à l'avenir ;
"Dans nos veines sang, mais non eau » – « sang"opposé" eau »;
"C'est un bon pays Bulgarie, UN Russie le meilleur".
S'il y a une opposition cachée dans une phrase, alors le membre de la phrase qui constitue l'opposition cachée sera nécessairement accentué.
Par exemple:
"C'étaient de vraies fleurs"(en supposant qu'ils ne soient pas en papier).
4. Lorsqu'on combine plusieurs membres homogènes dans une phrase, ils doivent tous être mis en évidence .
Par exemple:
UN) "L'homme à la barbe avait intelligent , jeune , frais affronter";
B) "Ici a mangé , dormi , aimé , combattu , a commencé une négociation sans fin , attendions un avenir radieux , étaient malades Et mouraient ».
Il y a huit membres homogènes dans cette phrase, et des groupes de mots tels que « nous avons commencé des négociations sans fin », « nous attendions un avenir radieux » sont des termes homogènes courants, car ils expriment des concepts liés à ce que ces personnes ont fait ici.
5.Si la définition est exprimée par un nom au génitif, alors elle prend l'accent .
Par exemple:
« le sens de la phrase », « la puissance du son », « l'idée de l'œuvre ».
6. En comparaison, ce qui est le plus frappant sera ce à quoi on compare, et non ce à quoi on compare .
Par exemple:
« Le visage de la vieille femme était ridé comme une pomme séchée. »- un visage ridé est comparé à une pomme desséchée, donc les mots seront accentués "pomme séchée"
7. Un pronom ne peut jamais être un mot accentué.
Par exemple:
UN) "Je n'oublierai jamais cela";
B) "Je ne te dirai rien."
DANS phrase interrogative Le mot accentué est le mot qui exprime l’essence de la question.
Par exemple:
"As-tu pris la pomme?" Si nous voulons savoir OMS pris une pomme, on souligne le mot « Toi ».
S'il y a des oppositions, alors le pronom sera accentué.
Par exemple:
« Si vous ne venez pas nous rendre visite, alors moi ne sera pas là".
L'un des mots accentués est le mot accentué principal de la phrase entière, les autres mots accentués sont accentués dans une moindre mesure.
Certains mots du flux vocal ressortent le plus fortement, d'autres - plus faibles, d'autres - plus faibles et d'autres peuvent ne pas ressortir du tout.
Par exemple:
« Se préparant à partir / et serrant la main de Tsiolkovsky, / Nikita dit : // « si je viens te chercher demain, / tu iras à la gare / pour donner une conférence ///.
Dans la première mesure, nous soulignons le mot « partir", d'abord parce qu'il se situe au bout de la mesure, et deuxièmement, parce qu'il absorbe le sens de tout ce qui est exprimé dans la mesure - " sortie ».
Dans la deuxième mesure, le mot « main" - parce qu'il vient à la fin de la mesure et, en plus, les mots " tremblement main"signifier" séparation ».
Dans notre exemple, soulignons le mot le plus marquant : le plus accentué avec trois traits, le moins accentué avec deux traits, et encore moins souligné avec un trait.
Il s'avère ce qui suit :
"Se préparer partir et secouant Tsiolkovsky main, / Nikita dit: // "si je demain Je viendrai je te suis / tu iras à gare/ lire une conférence. »//
Nous avons donc tout un ensemble de contraintes - fortes, moyennes et faibles. " De même qu'en peinture il y a des tons, des demi-teintes et du clair-obscur, de même dans l'art de la parole il y a des gammes entières. différents degrés les accents, qui doivent être coordonnés pour que les petits accents ne s'affaiblissent pas, mais, au contraire, mettent en valeur le mot plus fortement, afin qu'ils ne le concurrencent pas, mais fassent une chose commune dans la structure et la transmission d'une phrase difficile. » (Paroles de K.S. Stanislavsky, extraites du livre de M. Knebel « La parole dans le travail de l'acteur »).
On observe la même chose lorsqu'un son est accentué dans un mot.
Par exemple:
En un mot " armoire"troisième syllabe" Non" - tambour, seconde " bi" - pré-choc, d'abord " ka" - faible.
On peut dire que le degré d'accentuation dans un mot est différent : le plus grand sur la syllabe accentuée, le moyen sur la syllabe préaccentuée, le moins sur la faible.
Parfois, l'accent est si insignifiant que la voyelle est complètement supprimée et n'est pas prononcée (dans le mot « fougère"le son [o] de la troisième syllabe est supprimé).
Pour savoir quels mots sont les principaux dans un tact de discours, vous pouvez également essayer d'écarter les mots dont vous pouvez vous passer et de laisser, pour ainsi dire, un squelette de phrases. Cette technique s'appelle " squelettisation" texte.
Mot accentué est le principal centre de pensée.
Pour trouver le centre logique de la pensée, il ne suffit pas de diviser simplement une phrase en battements de parole - les accents sémantiques dans chaque phrase individuelle ne sont déterminés que lorsqu'un lien est trouvé entre toutes les phrases unies par un thème principal.
En fonction de cela, des centres logiques sont déterminés dans chaque phrase, c'est-à-dire des mots qui révèlent ce sujet.
« Les mots impressionnants ne sont que des jalons au bord de la route le long desquels la pensée logique trouve son bon chemin jusqu'à l'oreille et au cœur du spectateur. Sans connaître la pensée que vous voulez exprimer, vous ne trouverez pas le mot « principal » dans la phrase » (N. Gorchakov « Diriger les leçons de K.S. Stanislavsky »).
Par conséquent, vous ne devriez jamais commencer à travailler sur un texte en trouvant des sujets ou des prédicats qui nécessitent une accentuation selon les règles de grammaire.
Prenons une phrase simple « Donne-moi une pomme" Selon les règles de grammaire, l'accent logique devrait être mis sur le hibou " pomme", cependant, il peut y avoir différentes circonstances qui changent le sens de la phrase, et alors le centre changera, par exemple : " donner j'ai besoin d'une pomme », « donne-moi pomme ».
Exercice :
Divisez le texte en barres de parole, placez des pauses et mettez l'accent.
« Le chemin du Calvaire ? Non, ce serait une erreur de dire cela. Il y avait, il y avait du tourment. Et il y avait des doutes, froids, épineux. Et parfois, le désespoir vous prenait à la gorge.
Tout était là, mais aussi des moments de délice, de bonheur extraordinaire et complet, quand soudain quelque part sur la route, dans l'obscurité, vous rencontrez une personne inconnue mais chère, et il ouvrira devant vous toutes les richesses de son âme, l'invaincue, belle âme russe et demandez : « Que faire, camarade ?»
(B. Gorbatov, « Invaincu »).
Chaque texte choisi par l'étudiant doit faire l'objet d'une analyse logique.
Principes de base de l'analyse logique du texte.
1. Les phrases doivent être divisées en temps de parole par des pauses grammaticales et logiques (les mots qu'elles contiennent sont combinés selon leur sens).
2. Dans chaque phrase, l'interprète doit clairement souligner les mots principaux.
3. Dans les phrases longues, sur de longues périodes, le groupe de mots principaux doit être séparé du groupe de mots secondaires pour corréler les différentes parties de la phrase.
4. Les phrases les plus importantes doivent être mises en évidence (c'est-à-dire qu'il doit y avoir une relation logique entre les phrases dans leur ensemble).
5. Sur la base de la compréhension de l'idée principale du travail analysé, il est nécessaire de découvrir et de mettre en évidence les points clés de toute la ligne de développement efficace du contenu.
L'élève doit être capable de transmettre l'idée principale à travers toutes les phrases du texte. C'est la condition principale pour maîtriser la perspective d'une œuvre littéraire.
Le lecteur doit tendre le fil de la pensée en développement de l'auteur à travers une chaîne de phrases individuelles, retracer la perspective dite logique de chaque partie de l'œuvre et de l'ensemble de l'œuvre dans son ensemble à partir du mot logique.
Maîtriser une perspective logique signifie voir une pensée se développer à travers des phrases individuelles et l'exprimer par des sons.
Pour retracer l'évolution de la pensée, il faut, en analysant des phrases individuelles, établir un lien interne entre elles.
« Entre tous ces mots accentués et non sélectionnés, il faut trouver le rapport, la gradation de force, la qualité de l'accent, et créer à partir d'eux des plans sonores et une perspective qui donnent du mouvement et du sens à la phrase. » (K.S. Stanislavski, ouvrages complets, vol. 3, p. 125).
S'il ne s'agit pas de phrases individuelles, mais d'un texte connecté, alors l'accent sera mis sur chaque phrase en fonction de sa connexion avec le reste.
Le degré d'importance d'un mot et la durée des pauses dépendent du contexte.
Transmettre une perspective logique permet de transmettre correctement l'idée d'une œuvre.
Questions d'auto-test.
1. Qu'est-ce qui est inclus dans l'analyse logique d'un texte ?
2. Pourquoi est-il nécessaire de diviser le texte en temps de parole ?
3. Quels types de pauses connaissez-vous ?
4. Comment les signes de ponctuation sont-ils lus ?
5. Nommez les règles de base de l'accent logique.
6. Quels sont les centres logiques de pensée ?
7. Quelle est la perspective logique d’un texte ?
Un point marque généralement la fin d'une phrase, mais baisser le ton sur un point peut être différent, selon l'endroit où se trouve le point : à la fin d'une phrase, d'un paragraphe ou d'une histoire.
La durée de la pause à un moment donné peut varier. Ainsi, des phrases courtes se terminant par un point contribuent à créer un rythme de parole énergique.
Exercice:
Lisez attentivement les exemples suivants. Faites attention à la variété des intonations et des pauses sur les périodes et en même temps aux qualités générales inhérentes à ce signe de ponctuation. Rappelez-vous le contenu de l'ensemble de l'œuvre dont l'extrait est tiré, précisez ce qui s'y passe :
Exemple I .
Extrait du poème « Poltava » de A.S. Pouchkine :
Les chapeaux sont colorés. Les lances brillent.
Ils battaient des tambourins. Les Serdyuks galopent.
Dans les formations, les régiments sont égaux.
La foule bouillonne. Les cœurs battent.
La route est comme la queue d'un serpent
Plein de monde, en mouvement.
Au milieu du terrain se trouve une plateforme fatale.
Lisez maintenant le passage en remplaçant les points par des virgules. Pensez aux changements dans la description de l’image de l’exécution de Kochubey.
Exemple 2 .
Monologue de Bessemenov tiré de la pièce « Le Bourgeois » de M. Gorki :
« Je dis : le sucre semoule est lourd et peu sucré, donc il n'est pas rentable.
Il faut toujours acheter du sucre avec la tête et l'injecter soi-même. Cela créera des miettes, et les miettes entreront dans la nourriture. Et le sucre est le plus léger, le plus sucré..."
Exemple 3 .
Un extrait du roman épique « Guerre et Paix » de Léon Tolstoï. C'est l'histoire de la façon dont l'attitude de son entourage envers le prince Andrei a changé après une audience avec l'empereur François :
« L'Empereur s'est dit reconnaissant et s'est penché. Le prince Andrei sortit et fut immédiatement entouré de tous côtés par des courtisans. Des yeux bienveillants le regardaient de tous côtés et des paroles douces se faisaient entendre.
L'aide de camp d'hier lui a reproché de ne pas séjourner au palais et lui a proposé sa demeure.
Le ministre de la Guerre s'approcha et le félicita de l'Ordre de Marie-Thérèse, 8e classe, que l'Empereur lui avait décerné. Le chambellan de l'Impératrice l'invita à voir Sa Majesté. L'archiduchesse voulait aussi le voir. Il ne savait pas à qui répondre et prit quelques secondes pour rassembler ses pensées.
L'envoyé russe l'a pris par l'épaule, l'a amené à la fenêtre et a commencé à lui parler.
Veuillez noter que tous les points sont à l'intérieur du paragraphe. Chaque courte phrase est une image distincte, révélant les caractères des personnes entourant le prince Andrei et reflétant son attitude face à ce qui se passe. L’expression orale du propos est ici extrêmement variée.
Les virgules ne sont utilisées que dans les phrases. Dans une phrase simple, elle sépare membres homogènes des offres de chacun d'eux circonstances clarifiantes mots des circonstances générales de lieu, d'heure, etc., mots d'introduction, appel etc.
Dans une phrase complexe, il peut séparer des phrases simples en son sein, en les plaçant avant une conjonction ou un mot allié.
Dans une phrase complexe sans union, une virgule est placée principalement lorsque les phrases simples qui la composent sont combinées connexion de coordination et ce lien entre eux est très étroit.
En cas de contraste ou de clarification du sens de la première partie d'une phrase complexe dans la seconde, etc. virgule entre proposition non syndiquée remplacé par un tiret ou deux points.
Lorsque les parties d’une phrase complexe sont relativement indépendantes, la virgule est remplacée par un point-virgule.
La virgule est très ambiguë et nécessite donc une intonation différente selon les cas. Ainsi, lors de l’énumération, elle a besoin d’élever constamment la voix. Ceci est particulièrement important à retenir lors de la transmission de structures syntaxiques complexes - période.
Exemple 1.
Lisez la phrase de « Deux hussards » de L.N. Tolstoï :
"Dans les années 1800, à une époque où il n'y avait pas de chemins de fer, pas d'autoroutes, pas de lampes à gaz, pas de lampes au stéarine, pas de canapés bas élastiques, pas de meubles en laque blanche, pas de jeunes hommes désillusionnés avec des lunettes, pas de femmes philosophes libérales, ni les charmantes les dames camélia, qui sont si nombreuses à notre époque - à cette époque naïve où, quittant Moscou pour Saint-Pétersbourg en charrette ou en calèche, elles emportaient avec elles toute une cuisine faite maison, roulaient pendant huit jours à travers des routes douces et poussiéreuses et sale route et croyaient aux côtelettes de Pojarski, aux cloches et aux bagels du Valdaï - lorsque les bougies de suif brûlaient les longues soirées d'automne, illuminant les cercles familiaux de vingt et trente personnes, lors des bals, des bougies de cire et de spermaceti étaient insérées dans des candélabres, lorsque les meubles étaient placés symétriquement, quand nos pères étaient encore jeunes, non seulement à cause de l'absence de rides et de cheveux gris, mais ils tiraient sur les femmes et de l'autre coin de la pièce se précipitaient pour ramasser accidentellement et non accidentellement des mouchoirs laissés tomber, quand nos mères portaient des tailles courtes et énormes manches et résolu des problèmes de famille en souscrivant des billets, lorsque les charmantes dames camélias se cachaient de la lumière du jour - à l'époque naïve des loges maçonniques, Martinistes, Tugenbund, à l'époque des Miloradovich, Davydov, Pouchkine - dans la ville du gouverneur de K. il y a eu un congrès des propriétaires fonciers et les élections nobles ont pris fin.
Exemple 2 .
En quoi les virgules sont-elles différentes des virgules de l’exemple n°1 ?
"Hier, à minuit, j'ai traversé la salle à manger et là, une bougie brûlait."(A.P. Tchekhov « Trois sœurs »).
Exemple 3.
"Mais il y a beaucoup de bonheur, tellement, mon garçon, qu'il y en aurait assez pour tout le quartier, mais personne ne le voit!"(A.P. Tchekhov « Bonheur »).
Dans le dernier exemple, il y a un cas de négligence de virgule (une virgule qui ne nécessite pas de pause est placée entre parenthèses).
Nous parlons :
"Mais il y a beaucoup de bonheur, tellement (,) mec que..."
Mais si l’adresse est en début de phrase, la virgule est respectée.
Nous dirions:
"Garçon, il y a beaucoup de bonheur..."
Il existe de nombreux cas de non-respect des virgules dans le discours oral. La virgule est généralement supprimée avant participe gérondif simple, puisqu'il crée, avec le verbe qu'il précise, un concept, une image unique :
"Mikhaila était assis (,) en fronçant les sourcils."
(A.N. Tolstoï « Pierre Ier »).
Mais dans le cas où le gérondif précède le verbe, il acquiert une plus grande indépendance et nécessite une pause après lui :
"Mikhaila était assis, les sourcils froncés."
Sans pauses, des mots d'introduction tels que bien sûr, probablement, peut-être, semble-t-il, peut-être mais à quoi bon, à mon avis, malheureusement, finalement etc.
Par exemple, nous disons :
"Je (,) semble (,) comprendre que vous (,) êtes offensé."
Un chercheur majeur et expert en langues, A.N. Ostrovsky V.A. Filippov parlait souvent des productions des pièces du grand dramaturge. Selon lui, les sommités du Théâtre Maly pensaient que les virgules dans les pièces d'Ostrovsky contribuaient à l'unité, à la douceur du discours, que les pauses devaient être presque supprimées, que les intonations devaient être mélodieuses, douces et floues. Cela s'applique particulièrement au discours des personnages féminins.
D'après les exemples ci-dessus, l'ambiguïté de la virgule est déjà visible : elle peut aussi séparer deux parties d'une même pensée (si comparaisons et contrastes), et se concentrer, capter l'attention (avec transferts).
Elle disparaît souvent avant appel, avec des mots d'introduction, avant les gérondifs et dans de nombreuses autres positions.
Nous vous suggérons d’être attentif à ce signe qui a tant de significations et qui est si souvent utilisé.
Exercice:
Sélectionnez des extraits des pièces de théâtre d’A.N. Ostrovsky qui contiennent de nombreuses énumérations.
En lisant attentivement, par exemple, les travaux d'I.S. Tourgueniev, on voit combien de fois il recourt au point-virgule lorsqu'il peint une large toile dans laquelle chaque détail est indissociable de l'ensemble du tableau.
Soulignant certains détails dans un grand morceau de texte, Tourgueniev y arrête notre attention, puis nous entraîne de plus en plus loin, constituant un tout à partir d'images individuelles.
Tâches:
Exemple 1 .
Lisez à haute voix l'extrait suivant de l'histoire d'I.S. Tourgueniev "Chanteurs":
Je sentais des larmes bouillonner dans mon cœur et monter à mes yeux ; des sanglots étouffés et retenus m'ont soudainement frappé... J'ai regardé autour de moi - la femme de l'embrasseur pleurait, appuyant sa poitrine contre la fenêtre.
Yakov lui jeta un rapide coup d'œil et éclata encore plus fort, encore plus doux qu'auparavant : Nikolaï Ivanovitch baissa les yeux ; Le clignotant s'est détourné ; Abasourdi, tout choyé, se tenait la bouche ouverte bêtement ; le petit homme gris sanglotait doucement dans le coin, secouant la tête dans un murmure amer ; et une lourde larme coula lentement sur le visage de fer du Maître Sauvage, sous ses sourcils complètement froncés ; Le rameur a porté son poing fermé sur son front et n’a pas bougé… »
Lorsqu'il décrit le chant d'un rameur, un écrivain a rarement recours au point-virgule. Mais alors Yakov se met à chanter.
Le rythme de l'histoire change, tout comme le placement des signes de ponctuation, chaque phrase regorge de points-virgules. Ils semblent attirer l’attention d’abord sur un auditeur, puis sur un autre.
Dans tous les cas, le point-virgule préserve intonation descendante, mais en même temps c'est différent à chaque fois et, à mesure que la pensée se développe, elle nécessite une intonation de plus en plus vive et riche.
Exemple 2.
Analysez l'exemple suivant tiré du roman d'A.S. Pouchkine « Eugène Onéguine » :
Tatiana dans la forêt ; l'ours est derrière elle ;
La neige est molle jusqu'aux genoux ;
Puis une longue branche autour de son cou
Du coup ça s'accroche, puis des oreilles
Les boucles d'oreilles en or seront arrachées de force ;
Une chaussure mouillée restera coincée ;
Puis elle laisse tomber le mouchoir ;
Elle n'a pas le temps de se lever ; craintes,
Il entend l'ours derrière lui,
Et même avec une main tremblante
Il a honte de relever le bord de ses vêtements ;
Elle court, il suit,
Et elle n'a plus la force de courir.
Exercice :
À l'aide de l'exemple de n'importe quelle œuvre de la littérature classique russe, démontrer le rôle du point-virgule dans un contexte artistique (description, réflexion, digression lyrique, etc.)
Le côlon rivalise souvent avec le tiret. Les deux signes servent à clarifier.
Exercice:
Lisez attentivement et analysez :
Exemple 1 .
« Yakov, apparemment, était envahi par le ravissement : il n'était plus timide, il se livrait entièrement à son bonheur ; sa voix ne tremblait plus - elle tremblait, mais avec ce tremblement intérieur de passion à peine perceptible qui transperce comme une flèche l'âme de l'auditeur..."
(I.S. Tourgueniev « Chanteurs »)
Très souvent, les deux points sont utilisés comme signe séparant le texte de l'auteur du discours direct. La pause dans ce cas est plus courte qu'au niveau des deux points dans une phrase.
Exemple 2.
Le héros de l'histoire « Ma vie » d'A.P. Tchekhov dit :
« Le gérant m’a dit : « Je te garde uniquement par respect pour ton vénéré père, sinon tu m’aurais quitté depuis longtemps. »
Je lui répondis : « Vous me flattez trop, Votre Excellence, en croyant que je peux voler. »
Et puis je l’ai entendu dire : « Emmenez ce monsieur, il m’énerve. »
En nous familiarisant avec l'histoire de la ponctuation russe, nous apprenons que l'étudiant de M.V. Lomonosov, A.A. Barsov, a été le premier à signaler un nouveau signe de ponctuation - « silencieux » ; ce signe fut plus tard appelé le « tiret ».
"Ce silence", écrit Barsov, "interrompt le discours qui a commencé soit complètement, soit pendant une courte période pour exprimer une passion cruelle, ou pour préparer le lecteur à quelque mot ou action extraordinaire et inattendu plus tard."
Au fil du temps, le contenu émotionnel du tiret s'est quelque peu atténué, la « passion cruelle » a plus souvent commencé à être indiquée à l'aide d'autres signes, mais la « préparation à un mot ou à une action inattendue » est restée. Les pauses sur un stand de tir sont généralement importantes, avec un grand stress psychologique, et les intonations sont vives et expressives.
Un tiret fait référence à des signes qui apparaissent généralement dans une phrase. Un tiret sert souvent à séparer des phénomènes opposés.
Deux tirets sont des signes mise en évidence; ils marquent le discours direct, et parfois un mot ou une phrase d'introduction.
Exercice:
Lisez à haute voix un épisode de « L'invité de pierre » de A.S. Pouchkine - la rencontre de Don Guan avec Don Carlos chez Laura :
Don Guan
Quelle rencontre inattendue !
Je serai à votre service demain.
Don Carlos
Maintenant maintenant.
Laura
Don Carlos, arrête ça !
Tu n'es pas dans la rue - tu es avec moi -
S'il vous plaît, sortez.
L'utilisation fréquente des tirets est caractéristique du style de M. Gorky. C'est là que la propriété d'un tiret de préparer l'auditeur à un mot ou à une action inattendue est largement utilisée.
Par exemple:
« Dans ce cas, vaquez à vos occupations. Avez-vous des affaires ?
C'est Bulychov qui renvoie les « autres » qui affluent vers lui comme des corbeaux vers une charogne, écrit A. Dikiy dans ses mémoires sur cette performance, lisez la seconde moitié de la phrase sans tiret, et cela s'avère être un ordinaire, spécifique , question quotidienne relative à un moment donné, à ce jour.
Lisez-le en gardant les tirets à l'esprit, et cela semblera immédiatement général et vous fera réfléchir : les gens ont-ils de vraies affaires ?
C'est exactement ce que demande Boulychov, parlant de la pièce par rapport aux « autres » en tant que procureur et accusateur... » (Dikiy A. Langage et personnage dans la dramaturgie de Gorki. – Collection « La parole dans les représentations de Gorki. » – M ., 1954, p.23).
Exercice:
Trouvez 5 exemples d’un tel placement de tirets dans les pièces de M. Gorky.
Le point d'exclamation est utilisé pour indiquer émotivité du discours. En même temps, avec le point, le point d'exclamation sert de délimiteur de phrase.
Tout comme un point, un point d’exclamation termine généralement une phrase. Elle peut s'exprimer oralement de manière très diverse, en fonction du contenu et des tâches effectives.
Une personne excitée utilise généralement largement toute la tessiture de sa voix, mais même aux notes les plus hautes lorsqu'elle s'exclame, on peut entendre intonation finale. La voix ne « pend » pas, comme c'est le cas avec les points de suspension - elle semble précise, concrète, affirmative.
Et pourtant, l’intonation dépend avant tout du contexte. Un sentiment est toujours le résultat d’une évaluation de certains événements.
Exercice:
Lit à voix haute:
« Comment lisez-vous ceci ! – il a parlé à voix basse. - Avec des voix différentes... Comme s'ils étaient tous vivants...
Aproska! J'ai vu... Quels imbéciles ! C'était drôle pour moi d'écouter... Et puis quoi ? Où iront-ils?
Dieu Seigneur! Après tout, tout cela est vrai.
Après tout, c'est ainsi qu'il existe de vraies personnes... De vrais hommes... Et tout comme les personnes vivantes, les voix et les visages...
(M. Gorki « Konovalov »).
Les points d'exclamation sont largement utilisés dans le théâtre et indiquent l'émotion de l'orateur. Les raisons de l'excitation sont très diverses et les manières d'exprimer leurs sentiments doivent également être différentes.
Un point d'interrogation est le plus souvent placé à la fin d'une phrase contenant une question directe, c'est-à-dire une question conçue pour obtenir une réponse immédiate.
Le point d'interrogation a de nombreuses nuances, selon ce qui est demandé, par qui, à qui, dans quel but.
Indépendamment de cela, les mots contenant une question sont marqués dans le discours en élevant la voix :
- D'où viens-tu, camarade ?
- Je viens d'ici, de la ville.
Il ne faut pas oublier qu’une question correctement posée exige activement une réponse et la recherche. Nous apprenons généralement comment exactement le héros d'une œuvre littéraire pose une question à remarques de l'auteur.
La forme interrogative ne contient pas toujours une question directe. Il est souvent utilisé comme technique spéciale de discours émotionnel - une question rhétorique.
Exercice:
Lisez à haute voix, déterminez quels mots mettent particulièrement l'accent sur la question :
Où est la justesse, quand un don sacré,
Quand un génie immortel
- pas comme une récompense
Amour brûlant, altruisme,
Travaux, zèle, prières envoyées -
Et il éclaire la tête d'un fou,
Des fêtards oisifs ?...
Ô Mozart, Mozart !
(A.S. Pouchkine « Mozart et Salieri »)
Exercice:
À l'aide de l'exemple de n'importe quel texte littéraire, commentez la composition constructions interrogatives, déterminer leur signification dans la structure de l'œuvre.
Les points de suspension se caractérisent par l'intonation de l'incomplétude. Ce signe nécessite un interprète d'une grande habileté, la capacité de transformer la parole sonore en parole mentale et de continuer à parler à voix haute. Habituellement, les points de suspension nécessitent également une longue pause.
Il existe de nombreuses raisons qui provoquent une interruption de la parole et, selon la raison, l'expression vocale des points de suspension change. Une interruption de la parole peut s'expliquer par l'excitation, ou peut-être par une pauvreté de pensée.
Dans le premier cas, un arrêt peut être nécessaire au moment de l'apogée, et dans le second, l'intonation peut être très pauvre, monotone, monotone.
Exercice:
Exemple 1 .
Lisez à haute voix et analysez le monologue d'Akulina dans « Le Bourgeois » de M. Gorki :
« Et dehors, il a recommencé à pleuvoir. Il fait plutôt froid ici. Il faisait chaud, mais il faisait froid.
La vieille maison... explose... oh-ho ! Et le père et les enfants sont à nouveau en colère... Son bas du dos, dit-il, lui fait mal.
Il est aussi vieux... Et tous les échecs et les dégâts... Les dépenses sont élevées... Les soins.
Exemple 2.
L'histoire du vieil homme Krasilnikov d'après l'histoire de P.I. Melnikov-Pechersky « Krasilnikov » :
"Mitka a vingt-neuf ans : il est grand temps qu'il commence à élever ses propres enfants...
Et j'ai commencé à conseiller Mitka : Il est temps pour toi aussi de respecter la loi... Choisissez simplement, dis-je, une femme non pas avec vos yeux, mais avec vos oreilles, écoutez le discours, si elle est raisonnable, découvrez quoi le genre de mari qu'elle est...
Je dis cela à Mitka, et il pâlit, puis son visage est tout taché... De quelle sorte de raison s'agit-il ?...
Il a torturé, torturé, torturé pendant une semaine - il était silencieux, pas un mot... Il est devenu complètement excité, il marche la tête baissée, il s'est penché en arrière après avoir mangé, il est devenu maigre, comme une allumette..."
ACTIVITÉS DE PONCTUATION
Exercice 1.
Lisez les exemples à voix haute. Faites attention à la façon dont les nuances de sens changent, et parfois le sens complètement, lorsque les signes de ponctuation sont modifiés.
Exemples
1. Il fait chaud, le soleil est au dessus.
Il fait chaud : le soleil est au dessus.
2 . L'hiver est rude, l'été est chaud.
L'hiver est rigoureux - l'été est étouffant.
3 . Les alouettes sonnent ! Des pigeons épais roucoulent ; les hirondelles volent ; les chevaux reniflent et mâchent ; Les chiens remuent doucement la queue.
Les alouettes sonnent, les pigeons roucoulent, les hirondelles s'envolent, les chevaux reniflent et mâchent, les chiens remuent doucement la queue.
4. Il est de retour.
Il est de retour?
Il est de retour!
5 . Tu rentres à la maison, tu manges, tu vas dormir
Quand vous rentrez à la maison, mangez et endormez-vous.
6 . Je n'ai pas vu le frère et la sœur de mon ami.
Je n'ai pas vu mon frère, mon camarade et sa sœur.
7. L'article pourra être publié.
L'article pourra être publié.
Tâche 2.
Lisez attentivement les trois passages suivants et comparez-les. Qu’ont-ils en commun et qu’est-ce qui est différent ?
Faites attention à l'emplacement des signes de ponctuation et, lors de la lecture des textes à haute voix, suivez les instructions décrites ci-dessus. Portez une attention particulière aux diverses fonctions des virgules.
Marquez les cas où une pause n'est pas nécessaire entre les virgules. Dites-nous comment vous expliquez les ellipses posées par l'auteur.
Exemple 1.
« Il restait encore dix milles jusqu'au village le plus proche, et un gros nuage violet foncé, venu de Dieu sait d'où, sans le moindre vent, mais rapidement, se dirigeait vers nous.
Le soleil, pas encore caché par les nuages, illumine brillamment sa silhouette sombre et les rayures grises qui s'étendent d'elle jusqu'à l'horizon.
Parfois, des éclairs éclatent au loin et un léger grondement se fait entendre, s'intensifiant progressivement, se rapprochant et se transformant en carillons intermittents qui embrassent tout le ciel.
Vasily se lève de la boîte et soulève le haut de la chaise ; les cochers mettent leurs pardessus et à chaque coup de tonnerre ils ôtent leur chapeau et se signent ; les chevaux dressent les oreilles, dilatent les narines, comme s'ils reniflaient l'air frais qui sent le nuage qui s'approche, et la chaise roule rapidement sur la route poussiéreuse.
Je me sens terrifiée et je sens le sang circuler plus vite dans mes veines. Mais les nuages avancés commencent déjà à couvrir le soleil ; là, il a regardé dernière fois, illumina le côté terriblement sombre de l'horizon et disparut.
Tout le quartier change soudain et prend un caractère sombre. »
(L.N. Tolstoï « Adolescence »).
Exemple 2.
« Comme l'absinthe sent fort sur les bordures ! J'ai regardé la masse bleue... Et mon âme était confuse.
Eh bien, dépêchez-vous, dépêchez-vous ! - J'ai pensé, - scintille, serpent d'or, tremble, tonnerre ! Bougez, roulez, déversez le nuage maléfique, arrêtez la langueur mélancolique !
Mais le nuage n’a pas bougé. Elle écrasait toujours la terre silencieuse... et semblait seulement gonfler et s'assombrir...
Et finalement la tempête s'est levée - la fête a commencé !
Je suis à peine rentré à la maison. Le vent hurle, se précipite comme un fou, des nuages rouges et bas se précipitent, comme déchirés en lambeaux, tout tourne, mélangé, submergé, une averse zélée se balance en colonnes abruptes, les éclairs aveuglent d'un vert ardent, le tonnerre brusque tire comme celle d'un canon, il y a une odeur de soufre..."
(I.S. Tourgueniev « Pigeons »).
Exemple 3.
« Mais un jour, un orage éclata sur la forêt, murmurèrent les arbres d'une voix sourde et menaçante. Et puis il devint si sombre dans la forêt, comme si toutes les nuits s'y étaient rassemblées à la fois, autant qu'il y en avait eu dans le monde depuis sa naissance.
Les petites gens marchaient entre les grands arbres et dans le bruit menaçant des éclairs, ils marchaient et, se balançant, les arbres géants craquaient et fredonnaient des chansons de colère, et les éclairs, survolant les cimes de la forêt, l'éclairèrent pendant une minute de bleu, froid ont tiré et ont disparu tout aussi rapidement, comme ils sont apparus, effrayant les gens.
(M. Gorki « Vieille femme Izergil »).
Tâche 3.
Combien de paragraphes y a-t-il dans ce passage ? Lors de la lecture à voix haute, faites attention au son varié des points au milieu du paragraphe et à la fin.
« Ils descendirent prudemment du rivage dans les fourrés de cactus. L’ombre de quelqu’un jaillit sous ses pieds. La boule hirsute courait le long des reflets de deux lunes.
Cela a commencé à grincer. Il grinça – de manière perçante, intolérante, subtile.
Les moulages scintillants des cactus bougeaient. Une toile d’araignée collée à mon visage, élastique comme un filet.
Soudain, la nuit retentit d'un hurlement insinuant et déchirant.
Il a été coupé. Tout était calme.
Gusev et Los coururent à grands pas à travers le champ, frissonnant de dégoût et d'horreur, sautant haut par-dessus les plantes ressuscitées.
Enfin, le boîtier en acier de l'appareil brillait à la lumière du croissant montant.
Nous l'avons créé. Asseyez-vous et soufflez.
Sauf pauses grammaticales, dans la conversation orale, il existe un certain nombre de pauses supplémentaires qui contribuent à une transmission plus précise de la pensée. Ils s'appellent " pauses logiques" ; et la partie de la pensée contenue entre deux de ces pauses est appelée « lien vocal ».
Dans le lien vocal, les mots sont regroupés selon leur signification autour d'un mot significatif, le plus important. Ainsi, dans une phrase simple, il y a généralement deux unités vocales : dans l'une, les mots sont regroupés autour du sujet, dans l'autre, autour du prédicat.
Prenons par exemple cette phrase :
« Dans toute œuvre d’art scénique | il y a pour ainsi dire plusieurs niveaux de sens »
(G. Boyadzhiev « L'âme du théâtre »).
Cette phrase contient deux unités vocales, clairement séparées à l'oral par une pause logique (à l'écrit nous la désignons par une ligne verticale).
Dans une phrase simple plus courante et, plus encore, dans une phrase complexe, il y a plus d'unités vocales et il est plus difficile de les isoler : il faut prendre en compte des nuances de pensée supplémentaires, la présence d'unités vocales de diverses contenu, qui ne peut être constitué que de membres mineurs de la phrase.
Une pause logique est l'un des moyens d'expression importants de la parole. L'emplacement et la durée des pauses logiques peuvent varier en fonction de la tâche principale, contexte, conditions de communication.
Dans le même temps, un certain schéma est observé dans la disposition des pauses logiques. Ainsi, les pauses logiques séparent toujours les parties d’une phrase complexe les unes des autres, même si la pause n’apparaît pas nécessairement exactement à la jonction entre elles.
Parfois une pause logique coïncide avec une pause grammaticale, parfois elle ne coïncide pas.
Exercice:
Lisez-le à haute voix. Placez des pauses (logiques) que vous jugez nécessaires pour clarifier vos pensées.
1. « Sur la Staritsa, il y a des dunes de sable le long des rives, recouvertes d'herbe et de ficelles de Tchernobyl. L'herbe pousse sur les dunes, on l'appelle herbe. Ce sont des boules denses gris-vert, semblables à une rose étroitement tordue.
Si vous sortez une telle boule du sable et la placez avec ses racines vers le haut, elle commence à se retourner lentement, comme un scarabée retourné sur le dos, redresse ses pétales d'un côté, s'appuie dessus et se retourne avec son racines vers le sol.
(K. Paustovski " Côté Meshcherskaya»)
2. « Mais après avoir fait l’éloge de ces théâtres chimériques, l’auteur ne les considère pas du tout comme des spectateurs idéaux. Ils sont félicités pour une autre raison : pour leur enthousiasme.
Parce qu’il gagne un « ticket supplémentaire » à la sueur de son front, cet amoureux du théâtre est tout le contraire du spectateur indifférent. »
(G. Boyadzhiev « L'âme du théâtre »).
Exercice:
Lisez les exemples en faisant attention aux pauses ; Décrivez la partie principale de chaque phrase et déterminez la séquence logique de développement du sujet.
1. « Le tintement des chaînes d'ancre, le rugissement des embrayages des voitures livrant des marchandises, le cri métallique des feuilles de fer tombant de quelque part sur le trottoir de pierre, le coup sourd du bois, le cliquetis des charrettes des chauffeurs de taxi, les sifflets des bateaux à vapeur, parfois des rugissements perçants, parfois sourds, les cris des marins et des douaniers, - tous ces sons se fondent dans la musique assourdissante d'une journée de travail et, se balançant de manière rebelle, se dressent bas au-dessus du port - de plus en plus de nouvelles vagues de sons s'élèvent vers eux du sol - parfois sourds, grondants, ils secouent sévèrement tout autour, puis aigus et tonitruants - ils déchirent l'air poussiéreux et sensuel"
(M. Gorki « Chelkash »).
2. « Neuf obstacles ont été dressés sur ce cercle : une rivière, une grande, de la taille de deux archines, une barrière vierge devant le belvédère lui-même, un fossé sec, un fossé avec de l'eau, une pente, une banquette irlandaise, composée ( un des obstacles les plus difficiles) d'un puits constellé de broussailles, derrière lequel, invisible pour le cheval, se trouvait également un fossé, de sorte que le cheval devait sauter par-dessus les deux obstacles ou être tué ; puis deux autres fossés avec de l'eau et un sec, et la fin de la course était en face du belvédère.
(L.N. Tolstoï « Anna Karénine »)
3. Le vent fait un bruit joyeux,
Le navire court joyeusement
Après l'île Buyan,
Au royaume du glorieux Saltan,
Le navire court joyeusement
Et le pays souhaité
C'est visible de loin.
Les invités débarquèrent ;
Et suis-les jusqu'au palais
Notre casse-cou s'est envolé.
(A.S. Pouchkine « Le Conte du tsar Saltan »)
Lorsque vous vous vérifiez, repensez à ce que vous souhaitez transmettre à vos auditeurs, quelle image peindre, dans quel but.
Combinez les mots en unités vocales selon ce principe : un concept, exprimé en plusieurs mots, a un mot principal sur lequel est basée la pensée, et est prononcé le plus doucement possible, presque sans pauses.
Si des pauses entre les mots qui le composent sont nécessaires pour transmettre plus clairement un concept (surtout lorsqu'il est exprimé dans un nombre de mots suffisamment important), alors ces pauses doivent être de durée plus courte que celles mettant en valeur le concept dans son ensemble.
Dans les exemples poétiques, n'oubliez pas la pause à la fin de chaque vers (ligne).
En parlant de pauses logiques, nous devrions nous concentrer spécifiquement sur la conjonction de connexion ET. Il n’y a généralement pas de virgule devant.
Une pause logique de plus ou moins longue durée avant une conjonction de coordination ET cela arrive presque toujours :
UN) minime lorsque cette union se situe entre des mots individuels ;
B) est grand lorsqu'il relie des parties communes d'une phrase, et encore plus lorsqu'il relie des parties d'une phrase complexe.
Le sens doit primer pour nous, car la grammaire et la syntaxe ne font que nous aider en cela. Nous recherchons des unités vocales dans une phrase, en nous concentrant sur le contenu.
Exemples:
"Elle a commencé à comprendre son propre cœur et a admis (,) avec un agacement involontaire qu'il n'était pas indifférent aux mérites du jeune Français."
(A.S. Pouchkine « Dubrovsky »).
- J'entrerai par la fenêtre ! - Je dis résolument et saute sur la fenêtre.
Je saute très facilement et magnifiquement sur la fenêtre, jette une jambe par-dessus le rebord et je ne remarque alors que la surprise moqueuse de mon amie et la confusion de Lily.
Je réalise immédiatement (,)que j'ai fait quelque chose de maladroit et je me fige à califourchon sur la fenêtre : une jambe est dans la rue, l'autre dans la pièce. Je m'assois et regarde Lilya.
(Yu. Kazakov « Bleu et Vert »)
Après le syndicat ET , devant la phrase participative, la pause n'est pas observée :
"Je me suis détourné et (,) évitant les flaques d'eau, je me suis dirigé vers le coffre à bagages."(Yu. Kazakov « À l'arrêt »).
Exercice:
Lisez les exemples, réécrivez-les, placez des pauses logiques.
Exemple 1.
« As-tu besoin d'une chambre ? - demanda le marchand d'une voix jeune et, grimaçant, commença à lui arracher la barbe. "Attends un peu, je vais te faire sortir maintenant."
(Yu. Kazakov «Maison sous une pente raide»).
Exemple 2.
« Et nous voilà à nouveau en train de contourner Moscou. Une soirée très étrange et folle.
Il commence à pleuvoir, nous nous cachons dans l’entrée qui résonne et, essoufflés par la course rapide, regardons la rue.
(Yu. Kazakov « Bleu et Vert »).
Exemple 3.
« Elle le reconnaît immédiatement, se cache au coin de la maison et, en sanglotant, l'observe. Elle ne croit plus à rien et, lorsque le skieur disparaît dans la forêt, elle va, en essuyant ses larmes, voir s'il reste des traces après lui.
(Yu. Kazakov « Bois de cerf »).
Dans chaque lien vocal (logique), les mots sont regroupés autour du mot principal. Ce mot s'appelle " percussion», puisqu'il est généralement prononcé avec une certaine amplification de la voix.
Phrase peut être constitué d’une ou plusieurs unités vocales. Ces liens sont hétérogènes dans leur importance ; par conséquent, les mots accentués des différentes unités vocales ne sont pas les mêmes.
Les mots qui portent l'idée principale de la phrase ressortent davantage ; les mots qui sont le centre des unités vocales « supplémentaires » sont mis en évidence avec moins d'emphase.
Le plus grand gain se produit dans les mots principaux de l’ensemble de la pièce sémantique. De plus, il existe une autre régularité du discours russe : une accentuation logique plus forte dans une unité vocale tombe sur son dernier mot.
Cette tendance générale se poursuit même s'il existe un besoin de mise en évidence sémantique particulière d'un mot au sein d'une unité vocale ( syntagmes), - alors le dernier mot du syntagme sera toujours mis en évidence, mais avec moins de force.
Si vous écoutez attentivement le discours familier, vous remarquerez que l'accent mis sur les mots principaux ne se produit pas tant en renforçant simplement la voix, mais en l'élevant ou en l'abaissant.
Contrainte de puissance– le plus primitif et le moins expressif. Le combiner avec une augmentation ou une diminution du ton rend la parole plus mélodique, riche et douce. L'accent logique devrait consister en un renforcement de la voix et un changement de ton.
Même dans une longue phrase, il y a souvent un mot le plus important (rarement deux ou trois) ; tous les autres mots le complètent, le clarifient et, par conséquent, ressortent avec moins de force.
L'isolement des mots principaux dépend principalement du contexte, des tâches efficaces qui découlent du contenu.
Dans la langue russe, il existe un certain nombre de caractéristiques syntaxiques qui aident à trouver les mots principaux des unités vocales. Examinons quelques-uns d'entre eux.
Moyens d'expression forts du langage - opposition. Les mots contrastés ont la capacité de mettre l’accent sur eux-mêmes. Chacune des règles permettant de définir l'accent logique comporte une clause : "s'il n'y a pas d'opposition ici".
De nombreux proverbes sont basés sur l'opposition :
« L'apprentissage est lumière – l'ignorance est obscurité » ;
"Plus ça change, plus c'est la même chose" etc.
Comme vous pouvez le constater, l’accent logique est porté par les deux mots contrastés.
Voici deux exemples illustrant l’idée de tirer l’accent logique d’autres mots principaux vers l’opposition :
« Il réalisa qu'il n'y avait rien de commun entre l'homme arrogant qui se tenait devant lui, vêtu d'une veste de brocart touffetée, en robe chinoise dorée, ceinturée d'un châle turc, et lui, un pauvre artiste nomade, vêtu d'une cravate usée et d'un foulard. frac usé.
(A.S. Pouchkine « Nuits égyptiennes »).
Ils s'entendaient bien. Vague et pierre
Poésie et prose, glace et feu
Pas si différents les uns des autres.
(A.S. Pouchkine « Eugène Onéguine »).
L'opposition n'est pas toujours clairement exprimée grammaticalement - sous la forme de mots appariés de sens opposés. Un jugement élargi peut contenir des phénomènes dont la signification est contrastée.
Exercice:
Lisez les exemples, mettez en évidence les phénomènes contrastés et transmettez-les en les lisant à haute voix.
Exemple 1.
Laura
Venez ouvrir le balcon.
Comme le ciel est calme ;
Air chaud immobile, nuit citronnée
Et ça sent le laurier, la lune brillante
Brille dans le bleu épais et sombre,
Et les gardes crient longuement : "C'est clair !..."
Et loin au nord
- à Paris -
Peut-être que le ciel est couvert de nuages,
La pluie froide tombe et le vent souffle.
(A.S. Pouchkine « L'invité de pierre »)
Boris
... On est fou quand les gens éclaboussent
Ou un cri ardent trouble notre cœur !
Dieu a envoyé la famine dans notre pays,
Les gens hurlaient
mourir dans l'agonie;
Je leur ai ouvert les greniers, je suis de l'or
Je l'ai dispersé pour eux, je leur ai trouvé du travail -
C'est moi
enragés, ils maudissaient !
L'incendie a détruit leurs maisons,
Je leur ai construit de nouvelles maisons.
On m'a reproché le feu !
Voici le tribunal de la foule :
cherche son amour.
(A.S. Pouchkine « Boris Godounov »)
En règle générale, il est mis en évidence par l'accent logique et comparaison(celui avec lequel le phénomène est comparé), puisqu'il permet de révéler très précisément l'essence du phénomène, de dessiner une image :
... Lui, brûlant de vengeance,
Atteint la demeure du méchant.
Le chevalier est déjà debout sous la montagne,
Le cor d'appel hurle comme une tempête,
Le cheval impatient bouillonne
Et la neige creuse avec un sabot puissant.
Le prince Karl attend.
Soudain, il
Sur un casque en acier solide
Frappé par une main invisible;
Le coup est tombé comme le tonnerre...
(A.S. Pouchkine « Ruslan et Lyudmila »)
Exercice:
Lisez attentivement les exemples, recherchez des comparaisons et surlignez-les lors de la lecture à haute voix.
Exemple 1.
Toujours modeste, toujours obéissant,
Toujours, comme le matin, joyeux,
Comme la vie d'un poète simple d'esprit,
Comme un baiser d'amour, chérie;
Les yeux, comme le ciel, sont bleus ;
Souriez, boucles de lin,
Tout dans Olga... Mais n'importe quel roman
Prends-le et tu le trouveras, n'est-ce pas,
Son portrait...
(A.S. Pouchkine « Eugène Onéguine »)
Exemple 2.
"La masse se tournait et se retournait, bourdonnait et s'inquiétait, comme une énorme bête laineuse - avec mille pattes, mille yeux, souple, comme un ours à fourrure."
(D. Fourmanov « Chapaev »).
Lorsqu’un nouveau concept apparaît dans une histoire, il est également mis en évidence avec une emphase logique. Ainsi, l'accent logique tombe sur le nom apparu pour la première fois dans l'ouvrage :
Onéguine, mon bon ami,
Né sur les rives de la Neva,
Où es-tu né ?
Ou alors ils brillaient, mon lecteur.
(A.S. Pouchkine « Eugène Onéguine »)
Lorsque les héros à venir ont déjà été nommés, il n'est pas nécessaire de les souligner spécifiquement lors d'une mention ultérieure :
Le roi traversait le village en voiture après la guerre.
Il chevauche - son cœur est aiguisé par une colère noire.
Il entend - derrière les buissons de sureau
La fille rit.
Les sourcils rouges menaçants froncent les sourcils,
Le roi frappa son cheval avec ses éperons,
Frappez la fille comme une tempête
Et il crie, son armure sonne...
(M. Gorki « La Fille et la Mort »)
S'il existe un mot défini (nom) et une définition (adjectif) et l'ordre habituel des mots (adjectif avant le nom), le mot habituellement défini est mis en évidence :
« blizzard d'hiver », « nuit noire », « homme sympa ».
Lorsqu'il est utilisé dans une phrase inversion(ordre des mots inversé), la définition est mise en évidence :
"C'est une personne sympathique, mais il ne sait pas grand-chose."
Si le concept est un nom avec une définition, également exprimé par un nom au génitif (c'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelle la « définition incohérente »), alors l'accent logique tombe sur la définition :
« le frère de la femme », « la maison du voisin », « le livre de la sœur ».
Le pronom n'est généralement pas accentué par l'accent logique. Ce n'est qu'en cas d'opposition ou avec une charge sémantique particulière qu'une exception est faite :
Vers nos voitures
Sur notre chemin
Notre
chargement
bois de chauffage.
(V.V. Maïakovski « Bien »)
Lorsqu'on combine un verbe avec un adverbe, l'accent est mis sur l'adverbe :
« C'est devenu calme » ; "Le blizzard faisait rage continuellement."
Cependant, étant donné ces schémas généraux de discours, ils ne peuvent pas être observés mécaniquement. Lorsque vous déterminez des mots dont le sens est important, vous devez d'abord découvrir leur signification par rapport à l'ensemble du texte.
Vous ne devez pas surcharger une phrase avec un grand nombre d'accents de force égale, car cela rend le discours monotone et monotone.
En transmettant chaque phrase dans un lien logique avec le texte précédent, en réfléchissant dans la perspective du développement de la pensée, nous calculons à l'avance la force de la voix et décrivons le modèle d'intonation du texte : nous voyons où nous devons laisser un " réserve » pour renforcer la voix, et où la renforcer autant que possible.
Des exercices constants développent les compétences nécessaires pour transmettre avec compétence le texte de l'auteur, transmettant aux étudiants l'essence des pensées de l'auteur. Le futur professeur a besoin de ce travail au même titre que les exercices d’orthographe à l’école.
Tâches:
1). En vous tournant vers les dictionnaires, clarifiez le contenu des concepts suivants :
réplique, remarque, texte et sous-texte, comportement de parole, action verbale, intention.
2). Préparez une lecture expressive des phénomènes VII - VII du 2ème acte de la comédie de N.V. Gogol « L'Inspecteur général », en vous concentrant sur leur place dans l'intrigue.
Objectif du travail : considération du texte comme « unité dynamique » du processus de création de discours.
Exemple de plan d'analyse
activité de parole
| Khlestakov, Gorodnichy et Dobchinsky. Le maire, entrant, s'arrête. Tous deux se regardent avec peur pendant plusieurs minutes, les yeux exorbités. |
Début actif de la communication non verbale : chacun voyait en face un dangereux ennemi. Ils regardent attentivement autour d’eux. Pause traîné. Tous deux sont confus et effrayés. |
| Le maire / ayant récupéré un peu et tendant les mains le long des coutures / Je vous souhaite une bonne santé! |
Il reprend ses esprits en premier. Posture et geste des domestiques chevronnés soulignent le caractère officiel de la visite. |
| Khlestakov /s'incline/ Mes salutations… |
Geste d'un civil. Incertitude de la réponse au salut / points de suspension / geste d'un civil. Incertitude de la réponse au message d'accueil /points de suspension/ |
| Maire Mon devoir, en tant que maire de cette ville, est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de harcèlement envers les passants et toutes les personnes nobles... |
Sous-texte /P./ : Je t'ai dérangé, mais la raison est valable. Intention /N/ : établir le contact, se présenter, convaincre de la noblesse de vos intentions. Intonation /Dans/ : tendu intérieurement. |
| Maire /à côté/ Oh mon Dieu, tellement en colère ! J'ai tout découvert, ces foutus marchands ont tout raconté ! |
J'ai entendu exactement intonation, pas des mots. L'attente se réalise : l'auditeur sait déjà tout et est déjà en colère. P.: ce qu'il faut faire? |
| Khlestakov / courageusement / Même si vous êtes là avec toute votre équipe, je n’irai pas ! Je vais directement chez le ministre !/Il frappe du poing sur la table/. Que faites-vous? Que faites-vous? |
La confusion de l’ennemi donne de la force : l’agressivité des menaces augmente, même si les principaux moyens d’influence restent intonation et gestes. |
| Le maire /étendu et tremblant de tout son corps/. Ayez pitié, ne détruisez pas ! Femme, jeunes enfants... ne rendent personne malheureux. |
N: se justifier de quelque manière que ce soit, susciter la pitié. Texte Et P. correspondre. Dans.: plaidant. |
| Khlestakov Non je ne veux pas! En voici un autre ! De quoi me soucier? Parce que tu as une femme et des enfants, je dois aller en prison, c'est super ! |
N: consolider l'initiative, augmenter la pression sur l'ennemi. Dans.: J’en suis sûr, peut-être même un peu d’ironie. |
| Maire /tremblant/ À cause de l'inexpérience, par Dieu, à cause de l'inexpérience. Richesse insuffisante... jugez par vous-même : le salaire du gouvernement n'est pas suffisant, même pour le thé et le sucre. S'il y avait des pots-de-vin, c'était très peu : quelque chose et quelques robes pour la table. Quant à la veuve du sous-officier ‹…› Mes méchants ont inventé ça ; C’est le genre de personnes qui sont prêtes à attenter à ma vie. |
P.: ne le gâche pas ! Je suis prêt à admettre mes « péchés », à les minimiser /qu'est-ce que, curieusement, l'auditeur a réussi à découvrir ?/. N: plaindre, justifier, porter l'attention sur les «méchants». Dans.: jeu de repentance et de sincérité, la voix tremble. |
| Maire /à côté/ Oh, chose subtile ! Eck, où a-t-il jeté ‹…› Eh bien, ça ne sert à rien d'essayer ! Ce qui va arriver arrivera, essayez-le au hasard. Si vous avez vraiment besoin d'argent ou de quoi que ce soit d'autre, alors je suis prêt à vous servir dès maintenant. Mon devoir est d'aider les passants. |
P.: Alors je t'ai cru. Et si c'était un indice ? Ici et plus loin, presque toutes les remarques du gouverneur sont précédées d'une remarque « à côté ». Il y a une lutte de motivations : vous ne pouvez pas vous tromper ! /Exemple convaincant intention interne/. La décision est prise. |
| Khlestakov Donnez-moi, prêtez-moi ! Je vais payer l'aubergiste tout de suite. Je voudrais seulement deux cents roubles, voire moins. |
La réaction est immédiate et attendue. Enfin, un contact a été pris. Texte Et P.. correspondre. Les partenaires se comprenaient - de leur point de vue. |
Fragment de la pièce de G. Polonsky « Nous vivrons jusqu'à lundi, ou le chandelier de Chaadaev ».
Exercice:
Analysez les aspects suivants du comportement de parole de l’enseignant Melnikov :
A) les formes de communication émotionnelle et verbale ;
B) la manière de définir la tâche d'apprentissage ;
B) correction et évaluation de la réponse .
PROGRÈS
|
TEXTE |
Question et direction principale de la réponse |
| Melnikov Asseyez-vous. Eh bien, tais-toi... / Il ôta la montre de sa main et la posa devant lui. Et à côté se trouve un chandelier en cuivre. |
Comment un tel début révèle-t-il le rapport à la classe ? Une rencontre de gens qui se connaissent depuis longtemps et se comprennent. Sous-texte du geste ? Ne perdons pas de temps. |
| La dernière fois, nous avons parlé du manifeste du 17 octobre... Nous avons parlé de la douceur trompeuse de cette carotte d'État... De la façon dont elle a été bientôt remplacée par un véritable bâton... |
Quel est l'intérêt de lister les questions ? Intention externe: "Répétons ça", interne : "écoutez, je détermine la direction, les contours de votre réponse" Exigences de réponse : laconicisme et la capacité. |
| Melnikov Sur le début de la première révolution russe. Répétons cela et passons à autre chose. Syromyatnikov ! |
Ce genre de devoir est-il habituel dans la classe ? Nom de famille donné. Le sous-texte est-il clair pour les élèves ? Allez répondre... |
| Syromyatnikov /Très surpris/ Quoi? |
Sous-texte ? Joue sur l'incompréhension, gagne du temps. |
| Melnikov Prêt? |
Sous-texte ? Je comprends la manœuvre, je veux en clarifier la raison. |
| Syromyatnikov Plus ou moins... Partir ? |
La réponse est évasive : et si cela « emportait » ? |
| Melnikov Et rapidement . |
Sous-texte ? Ne perdez pas de temps Ces brèves remarques sont-elles suffisamment informatives ? Justifiez votre jugement. |
| Faisant une faveur coûteuse au professeur, Syromyatnikov se rendit au tableau. Melnikov Nous écoutons. |
Nature de l'installation (nous) ? Par remarque définir l'action de la parole S., dictant caractère émotionnel plus loin communication : élève - enseignant - classe. |
| Syromyatnikov Alors... La politique du tsar était lâche et favorable aux vélos. |
Que signifie une pause d’incertitude dans une réponse ? Déterminez l’intonation de la réponse. |
| Melnikov Ve... Lequel ? |
Sous-texte ? Attention au dernier mot. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas. Répéter. |
| Syromyatnikov Ve... barboteuse de vélo ! |
Est-ce que /pause/ ressent l'erreur, mais ne peut pas la corriger lui-même ? |
| Melnikov Fidèle. Autrement dit, cela brise la foi, c'est traître. Plus loin. |
Comment corriger l'erreur ? Division intonationnelle du mot, sa sémantique, synonyme. Et immédiatement - une incitation à réagir. |
| Syromyatnikov Craignant pour sa position royale, le roi a bien sûr publié un manifeste. Il a promis au peuple une vie paradisiaque là-bas... |
Style d'expression ? Ne correspond pas à la situation /avec insistance familière/, alors l'incohérence s'intensifie. |
| Melnikov Ou plus précisément ? |
Sous-texte ? Là encore la manœuvre est comprise. |
| Syromyatnikov Eh bien, toutes sortes de libertés... d'expression, de réunion... Pourtant, il n'a rien fait de ce qu'il avait promis, alors pourquoi raconter des bêtises ? Ce bouffon est une réussite. Même Natalya Sergueïevna s'étouffe de rire. Syromyatnikov Ensuite, le roi a montré sa nature vile et a commencé à régner à l'ancienne. Il a bu du sang d'ouvrier... et personne n'a rien pu lui dire. |
Sous-texte ? Expressions faciales ? Utilisez une technique familière pour amuser la classe. A obtenu la réaction souhaitée. La réaction du professeur ? Ne s'arrête pas. Sur quoi repose-t-il ? contact AVEC. avec les auditeurs ? La position de l’enseignant : quand et comment mettre un terme à ce « discours » interminable ? Réaction de classe ? |
| Melnikov |
Demande et motivation . Sous-texte : il est temps de finir. |
| Syromyatnikov Peut ajouter. Après Pierre le Grand, la Russie n'a pas eu de chance avec les tsars - c'est mon opinion personnelle ! |
Sous-texte ? Peu importe à quel point vous surjouez, vous devez finir... mais le point sera posé « magnifiquement ». |
Les gestes et les expressions faciales sont naturels et nécessaires dans la communication orale entre les personnes ; ils créent en grande partie le caractère unique du discours parlé qui le distingue du discours écrit. rôle principal moyens non verbaux la communication s'acquiert au contact entre l'enseignant et la classe. Après tout, le public des enfants ressent très subtilement la correspondance ou l'incohérence du contenu du discours et des mouvements corporels qui l'accompagnent.
Par conséquent, l’objectif du comportement de parole d’un enseignant peut être défini comme suit : faire preuve de bonne volonté, de calme et de convivialité non seulement au niveau verbal (c’est-à-dire le contenu du discours), mais également au niveau de l’expression faciale et de la manière des gestes.
Acceptons d'appeler les gestes de tels mouvements porteurs d'informations qu'une personne effectue avec ses mains et sa tête pendant la parole.
Plus l'orateur se sent libre, plus son discours est émotif, plus ses gestes sont fréquents et distincts. Un geste apparaît le plus souvent à de tels moments du discours lorsque l'orateur souligne émotionnellement un mot ou une phrase.
Un geste soit accompagne un mot, complétant ou soulignant son sens, soit remplace un élément de l'énoncé. Il représente la perplexité, l'affirmation, la question, l'allusion, le chagrin, la joie, le ridicule et d'autres sentiments humains.
Mais le geste n'est pas toujours lié à la parole et agit en interaction étroite avec elle. Même dans les cas où un geste remplace une expression entière (un mot), il se concentre sur un certain sens, sur la communication de quelque chose qui est pertinent pour l'interlocuteur.
Ce discours les gestes sont différents des gestes Actions: tendit la main vers la pomme posée sur la table ; a levé le coude, se protégeant du coup - ces gestes et d'autres similaires ne contiennent aucun message, c'est-à-dire qu'ils n'expriment aucune signification ou émotion qui pourrait être transmise verbalement.
Pour les gestes de parole typiques les plus courants dans la langue, il existe des désignations stables :
Écartez vos mains en signe de surprise ;
haussa les épaules("Je ne sais pas")
SHAVEZ SA TÊTE(signe de négation)
YEUX LUNETTES(par étonnement), etc.
Un geste approprié dans une situation de communication n'est pas utilisé dans d'autres : dans sa facilité, le geste contraste avec l'atmosphère plus ou moins formelle qui caractérise la situation enseignant-classe.
Le geste de « se gratter la tête » comme symbole de perplexité, de recherche d'une solution, d'une énigme, etc., acceptable dans la communication entre amis, est perçu comme un signe de mauvaises manières ou d'excentricité dans le comportement de l'enseignant.
Tous les gestes dans communication verbale jouent des rôles différents. Certains servent à représenter un objet, avec l'aide d'autres locuteurs pointent un objet, d'autres ne peuvent être évités lors de l'expression de sentiments, et d'autres sont des désignations stables d'actions rituelles ou généralement d'étiquette.
GESTES IMPORTANTS transmettre une idée de la forme, de la taille, de l'emplacement d'un objet :
- Une si petite bulle, - geste de l'index et du pouce au niveau du visage : la distance qui les sépare indique la hauteur de la bulle.
J'ai acheté cette pastèque hier, environ 10 kilos !- en même temps, l'orateur semble serrer dans ses mains quelque chose de rond et de grand.
Il y a du courant ! C'est comme ça que tout tourne !- un mouvement circulaire de la main, pliée au niveau du coude (généralement dans un plan horizontal).
Les gestes fins servent non seulement à communiquer la forme d'un objet, son mouvement, etc., mais peuvent également transmettre des relations entre les personnes, des sentiments mutuels et des actions intellectuelles :
Ils sont comme ça les uns avec les autres(par inimitié) - en prononçant cette phrase, l'orateur se frappe avec les poings serrés.
Les chercheurs en discours familier russe moderne identifient les types de gestes suivants combinés à des significations abstraites :
geste extrême ou catégorique: coup de sabre avec la main combiné avec des mots PERSONNE, JAMAIS, RIEN, RIEN et etc.:
PAS VOLONTÉ JE LE FERAI! – le geste tombe précisément sur la partie « négative » de l'énoncé, il est mis en valeur par une emphase logique ;
Geste d'unification: lisse mouvement horizontal par la main:
TOUT LE MONDE Distribuez cette fiche à vos lecteurs ;
Geste d'aliénation, rejet de quelque chose: la main bouge brusquement de la poitrine vers le côté :
PAS BESOIN OBTENEZ-MOI DES MÉDICAMENTS !
Geste d'incertitude: mouvement de rotation alternatif de la main avec les doigts écartés :
DONC, QUELQUE CHOSE DE RAYÉ...
Ce sont des gestes picturaux plus ou moins généralement acceptés. Mais au cours du discours, des mouvements de la main peuvent survenir, déterminés uniquement par une déclaration donnée et associés à une situation spécifique. De tels gestes clarifient ce qui a été dit ou renforcent l'image créée par des moyens verbaux.
INDEXER LES GESTES- indiquer un objet et ainsi remplacer souvent le nom de l'objet, une description de ses propriétés, sa position dans l'espace, etc.
Les gestes de pointage sont largement utilisés dans le discours oral. Ils sont généralement accompagnés de pronoms et de mots démonstratifs ICI, CECI, CELA, LÀ et etc.
Des gestes de pointage se font également avec la tête. Par exemple, un simple mouvement de la tête de bas en haut (option : de bas en haut vers le côté) et revenir à sa position normale revient à indiquer ce qui se trouve à côté des enceintes, à leur vue : - Ce tableau devra être supprimé.
GESTES ÉMOTIONNELS très diversifiée. Ils haussent les mains de surprise ; en prévision de quelque chose d'agréable, ils se frottent les paumes les unes contre les autres. La surprise ou le doute s’exprime en relevant les épaules. Lorsqu'on s'adresse à un interlocuteur avec une question persistante, la persistance de la question est souvent soulignée par un geste : la paume du bras à moitié pliée au niveau du coude est tournée vers le haut et vers l'interlocuteur (au niveau de la poitrine).
Un rôle particulier et très important dans le système des moyens de communication est joué par les gestes exprimant l'accord et le désaccord, ainsi que par les gestes adoptés comme symboles lors des salutations, des adieux, des adressages et d'autres actes de communication déterminés par l'étiquette.
Un geste se superpose le plus souvent à un mot, soulignant, renforçant le sens qu'il véhicule, ou bien il remplace le mot, agissant à sa place et dans sa fonction. Mais dans les deux cas, le geste est un moyen de communication supplémentaire et non principal.
Il est possible de comprendre une personne qui parle sans gesticuler, même s'il sera nécessaire de surmonter un certain sentiment de contre-nature qui surgit dans son discours. Néanmoins, un geste est une composante importante d'un acte de parole : il confère du dynamisme à la parole, valorise l'essentiel et coupe ce qui est tenu pour acquis, lui donnant du naturel du point de vue des traditions de communication humaine acceptées dans un domaine donné. société.
Si l'enseignant, en tant qu'orateur, s'intéresse au succès de son discours, alors ses expressions faciales ne peuvent être inexpressives. Les étudiants peuvent toujours deviner sur leur visage à quel point l'enseignant est intéressé par sa performance. Et s'il a un « regard terne » et un « visage de pierre », une telle indifférence à ce qui se passe « infectera » certainement la classe.
Les expressions faciales doivent être relation étroite avec des gestes, et donc « vivants », changeant au cours de la parole, en interaction avec le public. Ce n'est que si l'enseignant contrôle son discours, l'accompagne de gestes et d'expressions faciales appropriés, s'il « contrôle son corps », qu'il est assuré de la victoire verbale et psychologique sur le public, du succès du travail sur lui-même, de la reconnaissance du travail acharné.
Exemple monologue intérieur interprète d'une œuvre poétique ou en prose, dans un style et une structure aussi proches que possible de discours intérieur .
I.A. Krylov « Le Corbeau et le Renard ».
Il y a deux lignes ici. Le premier c'est l'histoire : tu dis ça « Quelque part, Dieu a envoyé un morceau de fromage à un corbeau. »
La deuxième ligne - vous représentez un renard, donnez le ton d'un renard. La première chose par laquelle vous devez commencer est d’apprendre à raconter. Alors, vous avez pris la fable « Le Corbeau et le Renard ».
Quand as-tu commencé à dire : « Combien de fois ont-ils dit au monde que la flatterie est vile et nuisible ; mais tout n'est pas pour l'avenir..."– vous devriez avoir ce qui suit dans votre plan : et sur ce sujet je vais maintenant raconter une anecdote.
« Quelque part, Dieu a envoyé un morceau de fromage à un corbeau. Corbeau perché sur l'épicéa..."- alors vous avez commencé à le dire, et c'est votre première tâche.
La seconde consiste à représenter un renard. Cette tâche relève davantage de la tâche d’un acteur. Tout d’abord, trouvons le véritable contenu intérieur du renard.
Imaginez que vous ayez besoin d'évanouir quelqu'un à tel point qu'il oublie, « ouvre la bouche » et laisse tomber ce dont vous avez besoin.
Ou vous parlez à une dame âgée dont quelque chose dépend, avec qui vous voulez arnaquer quelque chose. Comment vous comporteriez-vous ?
I.A. Krylov « Le chat et le cuisinier ».
Et ici, nous devons rechercher le bien-être du conteur d'une blague. Cela vous donnera une ambiance volontairement drôle : « Je vais vous amuser avec une histoire. Je ne sais pas si vous allez rire ou pas, mais c'est l'incident, écoutez… »
Lorsque vous racontez, vous devez souligner : « Une sorte de cuisinier, alphabétisé(rappelez-vous qu'il était alphabétisé !)... J'ai couru de la cuisine à la taverne... »
Et puis, quand vous commencerez à vous faire passer pour un cuisinier, n’oubliez pas qu’il vient d’une taverne, et donc qu’il est probablement sifflant.
De plus, nous devons trouver une réponse à la question : comment un cuisinier lettré peut-il lire une leçon de morale... à un chat ?
Vous comprenez par vous-même ce que signifie être alphabétisé, ce que signifie être un peu ivre, ce que signifie lire une leçon de morale.
Nous sommes arrivés aux mots : "Et Vaska écoute et mange," - Une sorte de demi-ton est absolument nécessaire ici. Passez d’un ton continu et complet de l’histoire à un demi-ton.
Il est possible dans cette phrase "Et Vaska écoute et mange" jouez un narrateur qui rit de cette phrase. Seuls le narrateur et le cuisinier doivent avoir un ton différent - ne le manquez pas.
M. Yu. Lermontov "Sur la mort d'un poète".
Guérir de toute la terrible douleur du poète Lermontov suite à la mort du poète Pouchkine est une très grande tâche. Vous ne pouvez pas être Lermontov - donnez la voix et le tempérament de Lermontov.
Vous avez besoin de vous retrouver, de ressentir comment vous parleriez si vous étiez fortement submergé par un sentiment similaire, mais plus proche de vous.
Disons que vous avez un ami : comment réagiriez-vous s'il était pourchassé et tué ?
C'est ce qu'il est important de ressentir pour développer votre technique de parole interne et refléter vos expériences intérieures.
I.S. Tourgueniev « Moineau ».
Il y a quelques phrases dans cette œuvre qui donnent le ton principal, l'arôme de cette chose, la direction du tempérament.
Basique le ton - qu'est-ce que c'est ? Dramatique, héroïque, l'amour ? Il y a une comparaison : un énorme chien et un moineau qui fait preuve d'une force si énorme... et puis tout à coup la phrase : «J'étais impressionné.»
Je dois trouver mon attitude face à cela, cela me donnera mon ton principal. Le fait est qu’un si petit moineau fait preuve d’une maîtrise de soi et d’un courage énormes. C’est là, à partir de quelle attitude, j’aurai le ton juste.
Il doit y avoir ici une sorte de grande bonhomie, surprise ou autre, devant un fait qui semble si drôle (si petit, échevelé, plus petit qu'un poulet, mais qui grimpe sur un chien).
Il y a un élément de plaisir ici, et cet élément de plaisir entre dans votre attitude. Si vous vous y habituez, vous obtiendrez un véritable ton fondamental.
M. Sholokhov « Sol vierge renversé » (extrait).
(Extrait lorsque des villageoises frénétiques se sont précipitées sur Davydov).
Si vous étiez témoin de cette photo, comment le diriez-vous ? Vous venez en classe avec une lecture littéraire, c'est-à-dire que vous devez donner quelque chose que les enfants eux-mêmes ne pourraient pas obtenir en lisant, allongés sur le canapé à la maison, qui ne leur serait pas venu à l'esprit.
Et vous pouvez le donner, vous pouvez, si vous introduisez dans l'histoire votre individualité artistique, forte, profonde, saturée d'excellentes couleurs expressives - purement dictionnaire, déclamatoire, « dessin verbal » !
L'histoire sera racontée comme du point de vue d'un témoin, représentant une figure épique, compréhensive, omnisciente, qui regardait tout à travers les yeux de l'époque et des idées.
Il s'agit de l'histoire vivante et complète d'un participant aux événements, qui a vu dans les affrontements caractéristiques vivants à la fois une grande pensée, un grand humour et un grand toucher. Avec tout cela, un témoin de l'incident est venu ici et nous raconte cet événement.
Il faut le raconter comme si vous y étiez, il faut « s'habituer » à cette image à tel point que les auditeurs ont même l'impression que vous avez vraiment tout vu.
Il ne faut pas oublier que « l'intonation et les pauses elles-mêmes, en plus des mots, ont le pouvoir d'avoir un impact émotionnel sur les auditeurs » (Stanislavsky K.S. Travail d'un acteur sur un rôle // Œuvres complètes : En 8 vols. – Vol. 4. – p .286).
La capacité d'utiliser habilement les pauses, logiques et psychologiques, est un indicateur de l'expressivité du son de la parole de l'enseignant, preuve de la plénitude de sa force d'influence vitale.
1. Germanov « Un livre pour le lecteur ». Profizdat, 1964.
2. Verbovskaya N.L., Golovina O.L., Urnova V.V. L'art de la parole. "Russie soviétique", 1961.
3. Knebel MO Le mot dans le travail de l'acteur. Société panrusse du théâtre. M., 1964.
4. Rosenthal D.E. Une culture de la parole. Maison d'édition de l'Université d'État de Moscou, 1964.
5. Sarycheva E. Discours sur scène. – M., « Art », 1955.
6. Artobolevski G.V. Essais sur lecture artistique. Un manuel pour les enseignants. – M. : Gosuchpedgiz MP RSFSR, 1959.
7. Vasilenko Yu.S. À propos du professeur nu. – Pédagogie soviétique, 1972, n° 7.
8. Vasilenko Yu.S., comp. Production vocale vocale. Des lignes directrices. – M., 1973.
9. Gvozdev A.N. Stanislavski sur les moyens phonétiques du langage. Conférences pour les enseignants. – M. : APN RSFSR, 1957.
10. Député Gangsterm, Kozhevnikov V.A. Respiration et parole. – Dans le livre : Physiologie de la respiration. – L. : Nauka, 1973.
11. Ivanova S.F. Audition de la parole et culture de la parole. Manuel pour les enseignants. – M. : Éducation, 1970.
12. Knebel M.O. Un mot sur le travail de l'acteur. – M., 1970.
13. Kozlianinova I.P. Prononciation et diction. – M., 1977.
14. Kurakina K.V. Fondements de la technique de la parole dans les œuvres de K.S. Stanislavski. – M. : OMC, 1959.
15. Leonardi E.I. Diction et orthographe. – M., 1967.
16. Matusevitch M.I. Langue russe moderne. Phonétique. – M. : Éducation, 1976.
18. Nikolskaïa S.T. Technique de la parole. – M. : Connaissance, 1978.
19. Panov M.V. Langue russe moderne : Phonétique. – M. : Plus haut. école, 1979.
20. Promtova I. Yu. Nourrir la culture de la parole du réalisateur. – M., 1978.
21. Discours : articulation et perception. – M. : Nauka, 1965.
23. Savkova Z.V. Technique des mots qui sonnent. – M., 1988.
24. Stanislavski K.S. Collection op. tome 3. – M. : Art, 1955.
25. Discours sur scène. Didacticiel. Éd. I.P. Kozlianinova. – M. : Éducation, 1976.
26. Audition et parole dans des conditions normales et pathologiques/collecte. articles, vol. Moi, L., 1974.
27. Skvortsov L.I. Base théorique culture de la parole. – M., 1980.
28. Titova A.A. Diction et orthographe. Développement méthodologique dans le cours « Discours sur scène ». – M., 1981.
29. Fomitcheva M.F. Enseigner aux enfants la prononciation correcte. – M., 1989.
30. Khvattsev M.E. Comment se débarrasser soi-même des bavures. – M., 1964.
32. Schweitzer A. Respect de la vie. – M., 1992.
33. Chtchourtanov S.I. Comment notre parole répondra. – M., 1980.
LISTE DE RÉFÉRENCES SUPPLÉMENTAIRES
1. Aksenov V.I. L'art des mots artistiques. – M., 1954.
2. Annouchkine V.I. L'art rhétorique dans la Rus antique // discours russe. – 1992. - N°2.
3. Atwater I. Je vous écoute. – M., 1988.
4. Batrakova S.N. Techniques pédagogiques d'influence émotionnelle sur les élèves. – Iaroslavl, 1982.
5. Bakhtine M.M. Esthétique de la créativité verbale. – M. : Art, 1986.
6. Bryzgunova E.A. Différences émotionnelles et esthétiques dans le discours à consonance russe. – M. : Maison d'édition de l'Université d'État de Moscou, 1984.
7. Budagov S.N. Métaphore et comparaison dans le contexte de l'ensemble artistique // Discours russe. – 1973.- N°1.
8. Verbovaya N.P., Golovina O.M., Urnova V.V. L'art de la parole. – M. : Art, 1977.
9. Vovk V.N. Métaphore linguistique dans le discours littéraire. – Kyiv, 1986.
10. Gak V.G., Telia V.N. Métaphore dans le langage et le texte. – M. : Connaissance, 1988.
11. Gvozdev A.N. K.S. Stanislavski sur les moyens phonétiques du langage. – M., 1957.
12. Ginzburg L.Ya. Poétique de Mandelstam. – M. : écrivain soviétique, 1985.
13. Golub M.B., Rosenthal D.E. Les secrets d'un bon discours. – M., 1993.
14. Gorbushina L.A. Lecture expressive et narration. – M., 1975.
15. Gorelov I.N. Composantes non verbales de la communication. – M., 1980.
16. Grigoriev V.P. Sur le débat sur le mot dans le discours artistique // Le mot dans la poésie soviétique russe. – M., 1975.
17. Geste dans le discours familier. – M., 1973.
18. Ivanova S.F. Spécificités du discours public. – M., 1978.
19. Kanter A.A. Analyse systématique de l'intonation de la parole. – M. : VSh, 1988.
20. Kovalev V.P. Moyens expressifs discours artistique. – Kyiv : Heureux. école, 1985.
21. Ladyzhenskaya T.A. Norme littéraire en vocabulaire et phraséologie. – M., 1983.
22. Léontiev A.A. Énoncé comme sujet de linguistique, psycholinguistique et théorie de la communication // Syntaxe du texte. – M. : Nauka, 1979.
23. Maksimov V.I. Précision et expressivité du mot. – L. : Éducation, 1968.
24. Maîtrise de la parole orale / Éd. Golubkova/. – M. : Éducation, 1965.
25. Morgounov B.G. Lois de la parole sonore. – M. : Russie soviétique, 1986.
26. Naydenov V.S. Expressivité de la parole et de la lecture. – M., 1969.
27. Nikitine E.I. Discours russe : Un manuel sur le développement d'un discours cohérent. – M., 1993.
28. Odintsov V.V. Formes de vulgarisation du discours. – M., 1982.
29. Poukovski K.N. Pour un mot figuratif vivant. – M. : Connaissance, 1967.
30. Influence de la parole. Problèmes de psycholinguistique appliquée / Coll. Art./. – M. : Nauka, 1972.
32. Moyens d'expression de la parole. – L., 1982.
33. Savkova Z.V. Moyens expressifs d'interaction vocale dans la présentation de masse. – L., 1981.
34. Savkova Z.V. Moyens d'expression de la parole. – L., 1982.
35. Soukhomlinsky V.A. 100 conseils pour les enseignants. – M., 1986.
36. Ouspenski L.V. Une culture de la parole. – M., 1978.
37. Fedorov A.I. Discours figuré. – Novossibirsk, 1985.
38. Frank V.S. La vision poétique du monde de Pasternak // Revue littéraire. – 1990. - N°2.
39. Kharchenko V.K. Fonctions de la métaphore. – Voronej : Maison d'édition VSU, 1991.
40. Khrapchenko M.B. La nature du mot esthétique /sémiotique/. – M. : Nauka, 1975.
41. La parole humaine est puissante : Livre. Pour lecture extrascolaire. – M., 1984.
42. Cherdantseva T.Z La langue et ses images. – M., 1977.
43. Cheremisina N.V. Questions d'esthétique du discours artistique russe. – Kyiv : École Vishcha, 1981.
44. Tchoukovski K.N. Pour un mot figuratif vivant. – M. : Connaissance, 1967.
45. Leonardi E.I. Diction et orthographe. Recueil d'exercices sur le discours scénique. – M., Éducation, 1967.
46. Saricheva E.F. Mot de scène. – M., Russie soviétique, 1963.
47. Stanislavski K.S. Le travail de l'acteur sur lui-même, collection. op., tome III, partie II.
48. Prononciation littéraire russe et accentuation, dictionnaire-ouvrage de référence, éd. GÉORGIE. Avanesov et S.I. Ojegova.
Des cloches ou des cloches étaient suspendues à l'arc du cheval. On croyait qu'au cours d'un long voyage plein de dangers, la cloche chassait les forces du mal.
- Écoutez la sonnerie de la cloche, écrivez à quoi ça ressemble.
Publicité. (Joyeux, joyeux, gai, mélodique, espiègle).
Le héros du poème a également écouté la sonnerie de la cloche. Qu'a-t-il entendu ? Lis le.
(Râle péniblement).
- Expliquez le sens de ce mot.
- Pourquoi pensez-vous qu'il y a une telle contradiction : la joyeuse troïka de lévriers a une cloche ennuyeuse ? (L'anxiété dans le cœur du voyageur, même une cloche joyeuse ne le rend pas heureux.)
Lisez les strophes 1 et 2 de manière expressive. (Rythme, tempo, volume, accent logique, pauses).
8. Travail individuel.
- Lisez la strophe 3.
- Qu'a entendu d'autre le voyageur ? (Chansons d'un cocher)
- Qui est le cocher ?
Travailler avec un dictionnaire explicatif.
(« Yamshchik » est un conducteur de chevaux).
- Pourquoi chante-t-il ? (Pour égayer la monotonie d'un long voyage).
-Quel est le rythme de ces lignes ? (Au ralenti, il y a de nombreuses voyelles dans les mots (« udaloe », « natif »), cela traduit la mélodie interminable des chansons russes).
- De quoi parlent ses chansons ? Pourquoi y en a-t-il des tristes ? (Les chansons reflètent les difficultés de la vie).
- Comment comprenez-vous le mot « Oser » ?
Travailler avec un dictionnaire explicatif.
(«Darady» - fringant, courageux, joyeux, joyeux, joyeux).
- Comment ces chansons semblent-elles à un voyageur ? (« Quelque chose semble familier »). Pourquoi?
- Dans les brouillons de A. S. Pouchkine, il y avait les lignes suivantes :
« Le sentiment russe est simple
Entendu dans les chansons du cocher.
Travaillez en groupe.
- Choisissez des mots apparentés pour l'adjectif « natif ».
Publicité. (Patrie, printemps, proches, gens, nature)
- Les paroles de A. S. Pouchkine rapprochent l'homme de la nature. Quand on lit ses poèmes, on comprend plus profondément que l’homme fait partie de la nature.
9. Travail individuel
- Lisez la strophe 4.
- Quels mots et phrases contiennent cette strophe ? ( Mots courts, phrases brusques. Ils traduisent le mouvement de la charrette le long de la route d'hiver.)
- Trouvez des mots qui montrent le vide et la désolation de la zone. (« Pas de feu, pas de cabane noire »).
- Que ressent un voyageur sur une telle route ? Écris le.
Publicité. (Solitude, peur, anxiété, perte, impuissance, impuissance, mélancolie).
Affectation de groupe.
- Pensez-vous que la route est perdue, ou les voyageurs ont-ils l'espoir que leur voyage se terminera en toute sécurité ? Prouvez-le avec des lignes de texte.
Socialisation. Discours des représentants du groupe.
- Qu'est-ce que « Versta » ?
Travailler avec un dictionnaire explicatif.
"Versta" - 1) une ancienne unité de mesure de longueur. Le kilométrage est de 1,06 km.
2) des poteaux rayés installés le long de la route à une certaine distance.
- De quelle couleur sont les colonnes ?
Affectation de groupe. Voici des mots désignant des objets en noir et blanc. Choisissez un mot qui correspond au poème.
Socialisation. (Zèbre, canne de contrôleur de la circulation, vie). Les étudiants justifient leur choix.
Les jalons par leur couleur ressemblent à la vie humaine, qui présente également des rayures noires et blanches. Le poème contient aussi de la tristesse et de la joie, de la mélancolie et de l'espoir.
I. PAUSE LOGIQUE
ET Stress LOGIQUE.
Les maîtres de théâtre ont toujours pris grand soin non seulement de la diction, mais aussi de transmettre clairement le sens de la phrase et l'ensemble du texte du rôle. V.G. Sakhnovsky, rappelant les cours de K.S. Stanislavski avec les membres du studio, a écrit : « Parfois - et c'était particulièrement « dangereux » pour le déroulement de la répétition - Konstantin Sergueïevitch se penchait en avant, mettait sa main à son oreille et disait plutôt gentiment :
Comment? Je ne comprends pas.
L'interprète a répété.
Comment? - Konstantin Sergeevich a de nouveau demandé. - Je ne comprends rien...
Après cela, il commençait généralement à squelettiser la phrase, à mettre l'accent correctement et à transmettre l'idée, ou à travailler sur la diction de l'acteur »17.
N.V. Gogol dans une lettre à M.S. Shchepkin, parlant de la lecture de « L'Inspecteur général » aux acteurs, se souciait avant tout qu'ils se souviennent « du sens de n'importe quelle phrase, qui... peut soudainement changer d'une accentuation déplacée à un autre endroit ou à un autre mot... Un il ne faut pas imaginer, et transmettre, c'est d'abord transmettre des pensées... Il n'est pas difficile d'appliquer de la peinture ; Vous pourrez donner la couleur du rôle plus tard… » 18
Les lois qui aident l’acteur à comprendre la pensée de l’auteur et à la transmettre correctement dans le discours parlé sont appelées lois de la logique de la parole. Ils sont basés sur les lois de la grammaire : les mots qui composent une phrase ont un sens lié les uns aux autres. Grâce aux connexions sémantiques, les mots sont combinés en groupes ou phrases. Analysons la phrase : « Bientôt, la lune et les étoiles se noieront dans un épais brouillard. »
Les connexions sémantiques des mots de cette phrase (expression) seront les suivantes :
1. La lune et les étoiles se noieront - c'est un lien entre deux sujets et un prédicat.
Tous les autres mots sont regroupés selon leur signification autour du prédicat « se noiera ».
2. Ils vont bientôt se noyer.
3. Ils se noieront dans le brouillard.
4. Ils se noieront dans un épais brouillard.
Pour transmettre correctement le sens de cette phrase, nous ne pouvons pas combiner les mots « bientôt » et « lune » qui sont proches mais sans rapport de sens. "Bientôt" est lié au mot "couler", donc, pour les relier, nous devons séparer les mots sans rapport - "bientôt" du mot "lune" et "couler" du mot "étoiles". Les mots qui n'ont pas de sens les uns par rapport aux autres sont séparés par des pauses, appelées logiques, car elles contribuent à la transmission correcte de la pensée de la phrase. Les mots ou expressions individuels contenus entre des pauses logiques sont généralement appelés battements de parole. Nous accepterons de désigner les pauses graphiquement logiques par une barre oblique /.
Dans notre proposition, les pauses logiques sont réparties comme suit :
Bientôt / la lune et les étoiles / se noieront dans un épais brouillard.
1ère mesure 2ème mesure 3ème mesure
Cette phrase comporte trois temps de parole. Comme vous pouvez le constater, le nombre de mots dans chaque mesure peut être différent selon la répartition des pauses logiques.
Pour déterminer plus précisément l'emplacement des pauses logiques, vous devez vous rappeler qu'en russe, les mots d'une phrase dans une phrase ne sont pas toujours côte à côte. Ainsi, dans notre exemple, l’expression « va bientôt se noyer » est séparée par le sujet « lune et étoiles ». Le sens d’une phrase devient clair lorsque les phrases entières et leurs parties sont clairement définies dans notre esprit.
Lorsqu'un acteur ou un lecteur ne travaille pas suffisamment de manière réfléchie sur un texte et sépare des mots dont le sens est étroitement lié ou combine des mots appartenant à des rythmes de parole différents, un non-sens apparaît dans le discours. Par exemple, en obéissant au rythme d'un vers poétique et en ne réfléchissant pas au sens de la phrase, les élèves commettent souvent l'erreur suivante dans une phrase d'« Eugène Onéguine » :
Comme un vrai Français, dans votre poche
Triquet apporta le vers à Tatiana.
Ignorant la pause suggérée par la virgule, ils combinent le mot « dans ma poche » avec l'expression « vrai Français », détruisant ainsi le lien entre les mots « apporté dans ma poche » ; et sans s'arrêter après le mot « vers », ils prononcent le « vers » incompréhensible. Toute cette phrase semble ridicule.
Une division précise en battements de parole qui unissent certains mots et en séparent d'autres clarifie l'exactitude de la vision et du sens :
Comme un vrai Français / dans votre poche
Trike a apporté un vers / à Tatiana.
Désormais, l'auditeur comprend non seulement la surprise d'anniversaire, mais aussi le caractère de celui qui l'offre.
Les phrases complexes nécessitent un travail analytique encore plus sérieux, surtout lorsque la connexion sémantique des mots est rompue par une longue proposition subordonnée. Par exemple:
Des tumulus sentinelles qui s'élevaient çà et là au-dessus de l'horizon et de la steppe sans limites, regardant le rude o i m e r t v o.
La signification principale est contenue dans les parties mises en évidence phrase principale, il est donc très important de pouvoir mettre en évidence les relations logiques entre les différents éléments de la phrase.
Un acteur, comme tout artiste, pense en images. Ainsi, si sur l'écran de sa vision intérieure, grâce à un travail analytique et synthétique, apparaissent tout d'abord de sévères monticules gardiens, il ne pourra s'empêcher de les voir dans un certain espace - une steppe sans limites, fermée par un horizon. ligne - c'est exactement ce qu'il dessine subordonnée, dont il s'est distrait au cours du processus d'analyse, reliant des parties de la phrase principale.
Cependant, une phrase peut contenir des mots dont le sens peut facilement être combiné avec l'une ou l'autre phrase de la phrase donnée. Ensuite, la même phrase avec les mêmes mots, mais avec des phrases formées différemment et, par conséquent, avec d'autres pauses logiques, peut sonner dans plusieurs variantes sémantiques. Par exemple : « Le père l’a couvert du manteau de son frère. »
Dans cette phrase, le pronom « lui » peut également compléter le prédicat - le couvert (à qui ?) et être une définition du mot « manteau » - (à qui ?) lui.
Les pauses logiques qui déterminent le sens de ces options peuvent être situées après le mot « lui » (1ère option) et après le mot « manteau » (2ème option).
Différentes pauses donnent lieu à différentes options dans Et deni. Dans le premier cas, le manteau appartenant au frère est utilisé par le père pour couvrir quelqu'un. Dans le deuxième cas, le père couvre son frère avec un manteau appartenant à quelqu'un. L'un ou l'autre est choisi en fonction de l'idée principale du passage et du but de l'énoncé.
Son père le couvrit du manteau de son frère.
Son père le couvrit du manteau de son frère.
Ainsi, une pause logique, combinant les mots en battements de parole et séparant ces derniers les uns des autres, organise la compréhension de la pensée parlée. C'est pourquoi K.S. Stanislavski a écrit : « Le travail sur la parole doit toujours commencer par la division en battements de la parole ou, en d'autres termes, par le placement de pauses logiques » 19.
Les signes de ponctuation aident à identifier les pauses logiques dans le texte analysé. C'est plus difficile à faire dans une phrase sans ponctuation, surtout si elle est très courante. Par conséquent, lors de l'analyse d'une phrase, vous devez d'abord déterminer le groupe du sujet et le groupe du prédicat, il est ensuite plus facile de placer des pauses logiques au sein de ces groupes. Il faut rappeler que dans une phrase courante, si le sujet n'est pas exprimé par un pronom, le groupe de mots relatifs au sujet sera toujours séparé par une pause du groupe de mots expliquant le prédicat.
Comparer:
Ils marchaient côte à côte / au bord du Champ de Mars / se noyaient dans les congères.
La /ville bien-aimée /est apparue à travers la tempête de neige/ avec les lignes sombres de ses toits/ et les taches tourbillonnantes de lanternes.
Dans la première phrase, le sujet n'est pas séparé par une pause, puisque toute la charge sémantique est contenue dans le groupe de prédicats. Dans la deuxième phrase, le groupe sujet est une image entière dont le détail est donné par l'ensemble du groupe prédicat.
Il est particulièrement important de pouvoir séparer le groupe sujet et prédicat dans les phrases avec un ordre des mots inhabituel, que l'on retrouve le plus souvent dans le discours poétique. La langue russe se caractérise par un ordre libre des mots. La même phrase peut être dite en plaçant les mots différemment, par exemple :
Un étudiant passe un examen.
L'étudiant passe l'examen.
L'étudiant réussit l'examen.
Dans tous les exemples, les principales relations syntaxiques entre les mots ne sont pas violées : étudiant - sujet, réussite - prédicat, examen - objet. Mais le premier exemple est une phrase avec l'ordre des mots habituel le plus accepté, et les deux autres sont organisés de manière inhabituelle, l'ordre des mots y est différent, cela s'appelle inversion, ce qui en traduction exacte signifie "retourner", réarrangement. Pour comprendre les pauses logiques d'un texte inversé, vous devez restaurer l'ordre habituel des mots, cela facilitera l'identification des connexions sémantiques entre les mots. Avec l'ordre direct des mots dans une phrase, le sujet vient avant le prédicat, la définition - avant le mot à définir, le complément - après le mot qu'il complète, les circonstances s'agencent librement. Regardons un exemple de phrase d'inversion :
Et sur la patrie de la liberté éclairée
La belle aube va-t-elle enfin se lever ?
Rétablissons l'ordre habituel des mots :
La belle aube d’une liberté éclairée se lèvera-t-elle enfin sur la patrie ?
Or, il est clairement visible que le mot « sur la patrie » ne peut pas être combiné avec les mots « liberté éclairée », puisqu'il appartient au groupe du prédicat et est inclus dans la combinaison : « s'élèvera-t-il au-dessus de la patrie ». Ce mot doit être séparé par une pause logique des mots « liberté éclairée ».
Et sur la patrie /liberté éclairée/
La belle aube va-t-elle enfin se lever ?
Vous devez faire attention aux signes de ponctuation. Ce sont des lignes directrices pour diviser le texte en battements de parole ; Un signe de ponctuation signifie, à quelques exceptions près, une pause logique obligatoire.
Le fait de ne pas prêter attention aux signes de ponctuation conduit souvent à une distorsion du sens du texte. Prenons un exemple :
Soyez complètement timide, couvrez-vous d'un gant,
Tu n'es plus petite. cheveux russes,
Vous voyez, il est épuisé par la fièvre,
Grand Biélorusse malade.
Ce texte est souvent lu sans faire une pause logique au point de la deuxième ligne, après le mot « pas petit », et ainsi les mots « hair rus » deviennent la deuxième définition de la première phrase et sonnent comme une preuve absurde de l'idée de Vanya. maturité suffisante dans l'évaluation des phénomènes de la vie . La préservation du point renvoie cette définition au portrait d'un Biélorusse.
Deuxième exemple :
Les gens ont dételé les chevaux - et le prix d'achat
Avec un cri de hourra ! se précipita sur la route...
L'inattention portée au tiret après le mot « chevaux » fait du mot « kupchina » le deuxième ajout au verbe « dételé », ce qui fait que la phrase entière tourne à l'absurdité : « Le peuple a dételé les chevaux et la kupchina ».
Cependant, comme nous l’avons noté plus haut, les signes de ponctuation ne sont pas toujours des arrêts logiques. Rappelons ces exceptions :
1. Une virgule n'est pas un stop stop si elle sépare le mot d'introduction. Exemple:
I. Tourgueniev
Dans deux phrases de ce texte, les virgules qui mettent en évidence les mots d'eau « semblait » et « j'avoue » ne seront pas marquées par des pauses, car ces pauses rendraient très difficile la prononciation de la phrase et, par conséquent, rendraient difficile la prononciation de la phrase. transmettre le sens.
2. Les virgules séparant l'adresse au milieu et à la fin de la phrase ne sont pas marquées de pauses.
Merci, Rodina, pour le bonheur
Pour être avec vous dans votre voyage.
Écoute, monde ! Radios Vostok-2.
Déplacer ces appels au début des phrases nécessitera une pause après les signes :
Patrie, / merci pour le bonheur / d'être avec toi dans ton voyage. Monde! /écouter/ : Vostok-2 émet par radio.
3. La virgule placée entre la conjonction et la phrase participative n'est pas marquée d'une pause.
Au loin /le moulin/ frappe, /à moitié caché par les saules/ et, colorés dans l'air clair, /les pigeons/ tournent rapidement au-dessus de lui.
I. Tourgueniev
4. Une virgule n'est pas marquée d'une pause dans les phrases complexes, lorsque la connexion entre la proposition principale et la proposition subordonnée s'effectue par des conjonctions complexes : afin de ; pour; parce que ou relations : ça - ça ; tout ce que.
Je vous ai invité, messieurs, /s ceux-là m, h pour vous annoncer / une nouvelle très désagréable.
N'est-ce pas ohhça m'appartient, /ça ne t'appartient pas aussi ?
Et le rocher/soleil géant e, h alors Stepan pensa, / il dira tout à ce casse-cou.
Ainsi, un texte correctement analysé logiquement est le début du travail. L'analyse logique nécessite certaines connaissances dans le domaine de la syntaxe de la langue russe, une compétence particulière et, par conséquent, une formation préparatoire. Transmettre le sens d'un texte analysé dans la parole orale nécessite également beaucoup de formation.
L'intonation logique dépend de la nature des pauses logiques. Ce dernier peut se connecter et se déconnecter. Une pause de connexion dans la transmission du sens se produit lorsqu'une pensée continue son développement ; la voix, lorsqu'elle prononce une phrase pendant ces pauses, reste à une certaine hauteur, comme pour avertir du caractère incomplet de l'énoncé. Les pauses disjonctives servent à transmettre l'intégralité de la pensée ; pendant ces pauses, la voix descend et indique clairement que la pensée est complète. Ce n'est pas un hasard si K.S. En enseignant à un acteur l'art de la parole, Stanislavski a beaucoup insisté sur l'entraînement des intonations logiques.
La mélodie de la parole russe se caractérise par une douceur fluide, et une pause logique n'est pas toujours caractérisée par une interruption du discours ; elle s'effectue non seulement par des arrêts plus ou moins longs, mais très souvent seulement par un changement de hauteur de la voix. Les arrêts fréquents du discours l'alourdissent, mettent l'accent sur les mots, ce qui prive le discours d'expressivité et de beauté.
Ainsi, les pauses dans la phrase dont nous avons parlé au début de ce chapitre (bientôt la lune et les étoiles seront noyées dans un épais brouillard) peuvent être réalisées en changeant la mélodie de la voix.
Dans l'intonation logique, la voix sur le mot "bientôt" (la première mesure) montera, sur le premier mot de la deuxième mesure - "lune", il y aura une diminution du ton de la voix et une fusion seulement avec le deuxième mot de la mesure - « étoiles », la voix montera à nouveau légèrement, puis retombera sur le mot « couler », qui commence la troisième mesure, pour terminer la pensée de la phrase par une chute ; comme le dit K.S. Stanislavski, "la voix tombera au plus bas". La mélodie d'une pensée en développement nécessite l'habileté de ne pas baisser le ton de la voix, de maintenir la voix à une certaine hauteur jusqu'à l'achèvement de la pensée, qui est toujours marquée par un abaissement du ton de la voix. Par conséquent, au son d’une pensée en développement, le début de chaque mesure suivante sera plus haut que le début, mais plus bas que la fin de la mesure précédente. Le dernier temps de parole est prononcé de plus en plus bas vers le dernier mot.
Dans les phrases avec des signes de ponctuation, les mouvements d'intonation sont dirigés par ces signes. K.S. Stanislavski l'a rappelé avec insistance aux acteurs, exigeant qu'ils reproduisent fidèlement dans leur voix l'intonation correspondant à la nature d'un signe particulier : point, virgule, deux-points, etc. « Sans ces intonations, dit Stanislavski, ils ne rempliront pas leur but... Soustrayez du point sa dernière chute de voix, et l'auditeur ne comprendra pas que la phrase est terminée et qu'il n'y aura pas de suite. Enlevez le son caractéristique « coassement » du point d'interrogation, et l'auditeur ne comprendra pas qu'il lui pose une question à laquelle il attend une réponse... Ces intonations ont une sorte d'impact sur les auditeurs, les obligeant faire quelque chose : une figure phonétique interrogative - à la réponse ; point d'exclamation - à la sympathie et à l'approbation ou à la protestation, deux points - à la perception attentive d'un discours ultérieur, etc. 20 . Compte tenu de la nature de la virgule, Stanislavski a noté sa « propriété miraculeuse » : au dernier syllabe du mot, debout devant la virgule, pliez le son vers le haut. « Sa boucle, comme une main levée en signe d'avertissement, oblige les auditeurs à attendre patiemment la suite d'une phrase inachevée » 21. Un point-virgule dans le discours parlé se caractérise par une certaine diminution de l'intonation, moindre qu'avec un point, mais beaucoup plus qu'avec une virgule, puisqu'un point-virgule délimite généralement les parties d'une phrase qui ont déjà des virgules. Par exemple:
Il n'est pas tombé amoureux, n'a pas pensé au mariage et n'a aimé que sa mère, sa sœur et le jardinier Vasilich ; j'aimais bien manger, dormir après le dîner, parler de politique, de sujets sublimes.
Au début, du lac qui vacillait faiblement au pied des pins flamboyants, les puissants appels de trompettes des cygnes se firent entendre ; Ils flottaient majestueusement et instablement au-dessus de la steppe, comme les premiers accords d'une symphonie solennelle, et se figeaient lentement, lentement au loin.
M. Boubennov
Ekaterina Dmitrievna a raconté la nouvelle à la datcha : un chien enragé est arrivé de Touchino et a mordu les deux poulets des Kishkin ; Aujourd’hui, nous avons déménagé dans la datcha Simovskaya des Zhilkins, et immédiatement leur samovar a été volé ; Matryona, la cuisinière, a encore fouetté son fils.
A. Tolstoï
L'intonation du signe tiret se caractérise non seulement par une montée, mais aussi par une pause beaucoup plus longue que la pause à la virgule. Ce signe étant particulièrement fréquent dans le discours expressif, ses fonctions ne peuvent être clarifiées à chaque fois que dans leur contexte.
L'incapacité de maîtriser l'art de la production vocale d'une mélodie logique rend difficile la compréhension de la pensée parlée et, à l'inverse, l'art de transmettre de manière expressive et vivante le développement sémantique d'une phrase avec sa voix libère le locuteur et l'auditeur. de la tension qui fait que les premiers se précipitent et empêche les seconds de percevoir le discours dans toute sa plénitude non seulement sémantique, mais aussi émotionnelle et expressive.
Une condition nécessaire pour une communication correcte et vivante des pensées à l'auditeur est également la capacité de prononcer ensemble les mots inclus dans un rythme de parole, de les prononcer comme un seul grand mot. Et tout comme dans un mot une des syllabes est plus importante, de même dans une mesure il y a toujours un mot qui doit ressortir plus clairement que les autres, et dans certaines mesures il y aura un mot qui est le plus important pour l'ensemble de la mesure. j'ai pensé à la phrase. On l'appellera accent logique principal d'une phrase. Tous les autres mots surlignés dans les barres seront appelés contraintes logiques secondaires.
Lorsqu'on parle d'une phrase prise sans lien avec les autres, hors contexte, l'accent logique lors de la lecture est déterminé par l'organisation rythmique de cette phrase : généralement le rythme d'une phrase narrative russe nécessite l'accent sur le dernier mot significatif de chaque discours. battement si la phrase se compose de plusieurs temps de parole, ou simplement sur le dernier mot d'une phrase si elle se compose d'un battement de parole.
Acceptons de désigner l'accent logique par une ligne horizontale sous le mot accentué.
Enfiler,/ébouriffé par le vent/ je me suis lancé rivages/ peigné fréquemment vagues.
Allait tempête.
Le mot accentué principal dans la première phrase ne peut être déterminé qu'en fonction du but et du but de la déclaration. Si l'essentiel est de prêter attention à la raison de l'apparition des vagues sur le Don, alors le mot principal sera le mot « vent », mais si nous parlons de l'image d'une tempête, alors le mot principal sera le mot « vagues ».
Si vous incluez cette phrase dans un segment de discours sémantiquement complet, c'est-à-dire la prenez dans son contexte, alors l'accent (l'essentiel) dans cette phrase sera déterminé tâche commune tout le texte. Cette phrase est tirée de " Don tranquille» Cholokhov. C'est l'une des phrases du texte qui décrit l'orage.
Au dessus de la ferme / est devenu marron nuage./Don,/ échevelé par le vent/jeté dessus rivages/ peigné fréquemment vagues./Derrière les lavades/ le ciel était brûlant/ sec foudre,/ écrasé le sol / avec de rares grondements / tonnerre./ Sous le nuage, / étalé, / le vautour tournait Pas il a été poursuivi en criant corbeaux./ Nuage / respiration froideur, / j'ai longé le Don, / de l'ouest. /Pour un prêt /de façon menaçante est devenu noir,/ steppe/ dans l'expectative était silencieuse./Dans la ferme/ applaudir/ verrouillable volets; des Vêpres, /être baptisé,/ les vieilles femmes étaient pressées; /sur le terrain de parade/ balancé/ gris colonne poussière, et la terre, chargée de l'aube du printemps, /a déjà été semée/ les premiers grains pluie.
Chaque phrase de ce passage fait partie de la description d'un orage, et les mots : nuage, vagues, éclairs, tonnerre, oiseaux volant dans les airs - cerf-volant et corbeaux ; le ciel menaçant et le silence de la steppe, les volets battants, les vieilles femmes pressées, une colonne de poussière, la pluie, tels sont en quelque sorte les principaux signes d'un orage. Ces mots seront l’accent principal du passage. Toutes les autres accentuations dans les mesures de phrases sont des couleurs de détail. Ils sont soulignés par des pauses logiques.
Par conséquent, il est possible de comprendre la gradation des contraintes (principales et secondaires) uniquement à partir de idée principaleœuvre ou la signification sémantique d’un passage.
Le chemin de l’analyse logique est toujours un chemin qui va du tout à la partie et de la partie au tout. C'est le seul moyen d'établir les mots d'accentuation, les mots principaux de la pensée, et de déterminer le poids relatif des autres dans le cours global du développement de l'idée principale d'une œuvre ou de sa partie (passage).
Ainsi, lors de la détermination de l'accent principal, nous devons nous rappeler qu'il met en évidence le mot considéré comme le plus important pour transmettre l'idée et recréer l'image de l'histoire.
Dans une phrase sortie de son contexte, nous sommes libres d'exprimer toutes les variantes de pensée, selon notre désir d'affirmer une chose et pas une autre. Par exemple : « J’étudie dans une université de théâtre. » Dans cette phrase, le mot principal accentué peut être n'importe quoi : le mot « je », et le mot « étudier », et le mot « au théâtre », et le mot « à l'université ». Si nous affirmons que c'est moi, et personne d'autre, qui étudie dans une université de théâtre, alors le mot d'accent principal sera « je » ; s'il est nécessaire de souligner que j'étudie et que je ne suis pas seulement répertorié comme étudiant, alors l'accent sera mis principalement sur le mot « étudier » ; Voulant noter qu'il s'agit de l'université du théâtre, et non de aucune autre université, nous soulignerons certainement le mot « au théâtre » ; S’il faut toutefois souligner qu’il ne s’agit pas d’un cercle, ni d’un studio, mais d’une université, alors le dernier mot « à l’université » retiendra l’attention. Mais la même phrase, prise hors de son contexte, peut véhiculer l'énoncé du fait lui-même : « Je suis étudiant dans une université de théâtre », sans opposer l'un à l'autre, comme ce fut le cas dans les cas analysés. Ensuite, la phrase sonnera selon le rythme narratif caractéristique du discours russe, avec une charge sémantique légèrement plus grande du dernier mot, sans préférence particulière pour l'accentuation par rapport aux autres mots, puisque toute préférence marquée pour l'accentuation d'un mot par rapport à d'autres évoquent inévitablement dans la perception de l'auditeur une objection. Déclaration introductive.
J'étudie en théâtre université
Les observations du discours en direct et la pratique des maîtres de théâtre travaillant sur son expressivité nous permettent de parler d'un certain nombre de lois qui mettent en garde contre des accents logiques incorrects.
Regardons ces lois.
Accent logique
Abstrait leçon ouverte développement de la lecture et de la parole
5ème année
Lieu de travail:Éducation spéciale (correctionnelle) de Novoropsk
Internat de type VIII
Sujet de la leçon : A.S. La « Route d’hiver » de Pouchkine
Objectifs de la leçon: recréer dans l’imagination des élèves une image d’un hiver ennuyeux
routes; révéler les sentiments qu'éprouve le poète.
Objectifs de la leçon:-améliorer la lecture expressive et les compétences orales
dessin verbal; intensifier et élargir
le vocabulaire des élèves ;
Corriger et développer les idées et l'imagination
la base d'exercices de dessin verbal ;
Cultiver l'intérêt pour les poèmes d'A.S. Pouchkine.
Matériel de cours : portrait d'A.S. Pouchkine,
illustration du poème.
Pendant les cours
I Moment organisationnel.
Se redresser. Placez vos mains sur votre bureau.
II Attitude psychologique.
Quelle est votre humeur aujourd'hui ?
(Bien).
Souriez-vous les uns les autres. Donnez-moi aussi vos sourires. Merci.
Si un cours commence par un sourire, alors vous pouvez espérer qu’il se passera bien.
III Vérification des devoirs.
Quel poème avez-vous appris lors de la leçon précédente ?
(Nous avons fait connaissance avec le poème « Bouleau »)
(Sergueï Yesenin).
Qu'est-ce qui vous a été assigné pour l'auto-apprentissage ?
(Apprenez le poème par cœur).
Les élèves récitent le poème à tour de rôle. L'enseignant évalue leur lecture.
IV Remarques d'ouverture.
Aujourd'hui, nous ferons un voyage dans un passé lointain et lointain, où vivait le grand poète russe Alexandre Sergueïevitch Pouchkine. Voici son portrait.
(Le portrait est épinglé au tableau).
A cette époque, il n’y avait ni chemin de fer, ni voiture, ni bus.
À votre avis, que conduisaient les gens à l'époque ?
(À cheval).
Droite. Les gens montaient à cheval dans des chariots. Les chevaux étaient conduits par un cocher.
COMME. Pouchkine a dû se déplacer d'un endroit à un autre à plusieurs reprises et non de son plein gré.
Le poète voyageait sur une route hivernale ennuyeuse pour s'exiler de Saint-Pétersbourg vers son domaine Mikhailovskoye. Cette route lui apporta mélancolie et solitude.
Dans l'un de ses poèmes, Pouchkine a peint le tableau d'une route d'hiver.
V Message du sujet de la leçon
Ainsi, le sujet de notre leçon est « A.S. Pouchkine "Route d'hiver".
VI Préparer les élèves à percevoir le poème.
Clarification de certains mots et explication d'expressions peu claires.
Dans le poème que nous allons lire aujourd'hui, le mot apparaît brouillards. Vous savez tous ce qu'est le brouillard. Dites des phrases avec ce mot. (Il y avait un épais brouillard le matin. On ne voit rien à cause du brouillard).
Il y a plus de deux cents ans, le mot « brouillard » signifiait « nuage » (« nuages de brouillard »).
Le mot apparaît également dans le poème clairières. Où avez-vous vu les clairières ? (Dans la foret).
Les clairières sont également appelées espaces larges et plats - plaines.
Et il y aura aussi une expression "les kilomètres sont rayés." Les verstes rayées sont des piliers peints en blanc et noir, dressés le long de la route à chaque verste.
(Le professeur les montre dans l'illustration).
Une verste est une mesure de longueur légèrement supérieure à un kilomètre. Distance antérieure Cela ne se mesurait pas en kilomètres, mais en miles.
VII Lecture d'un poème d'A.S. La « Route d’hiver » de Pouchkine par un professeur et des élèves.
Et maintenant, je vais vous lire ce poème. Écoutez attentivement pendant que je lis.
Le professeur lit un poème.
Quelle image vous est apparue en écoutant ce poème ?
(Les étudiants parlent).
Maintenant, lisez ce poème pour vous-même. Pendant que vous lisez, marquez les mots que vous ne comprenez pas.
Quels mots ne comprenez-vous pas ?
- Je ne comprends pas le mot « nature sauvage » ?
- Région sauvage- un endroit éloigné, loin des gens.
- Je ne comprends pas le mot « lévrier » ?
- Levrette(trois) – rapide.
VIII Conversation sur le contenu du poème avec lecture sélective et travail de vocabulaire accessoire.
Questions et devoirs.
1) Pourquoi le poème s’appelle-t-il « Winter Road » ?
(Parce que c'est décrit en hiver).
2) À quelle heure de la journée la route d'hiver est-elle décrite ?
(La nuit).
3) Comment Pouchkina décrit-il le ciel, la lune ? Lis le.
4) Comment la zone traversée par la route est-elle décrite ? Lis le. Comment comprenez-vous l'expression maison noire?
Autrefois, il y avait une cabane à fumée chauffée au noir, c'est-à-dire sans tuyau. Lors du chauffage, la fumée remplissait toute la cabane et les murs étaient enfumés et noirs, d'où le nom de « cabane noire ».
5) - Regardez l'illustration. Décrivez la zone qui y est représentée.
(Plaine enneigée monotone, déserte, déserte, sourde, pas une seule cabane n'est visible, seulement des kilomètres rayés).
Pouchkine a brossé un tableau en quelques mots : de vastes plaines enneigées. Une autoroute les traverse. La lune apparaît derrière les nuages et sa triste lumière se répand sur la route. Ni la cabane ni la lumière ne sont visibles. Sourd, déserté, déserté.
Et puis le silence est rompu.
Qui voyez-vous sur cette illustration ?
(Trois chevaux blancs attelés).
Comment pouvez-vous les appeler différemment ?
(Troïka).
Regardez comme ils sont beaux. Une cloche est fixée à l'arc du cheval du milieu.
Que font-ils?
(Ils courent le long de la route).
Qui contrôle les chevaux ?
(Cocher).
À votre avis, qui monte dans la calèche ?
(Pouchkine monte dans le chariot).
6) - Que dit le poème sur la troïka ?
("Sur la route ennuyeuse de l'hiver
Trois lévriers courent."
7) - Quels sons entendez-vous ?
(Le grincement des patins, la cloche, le chant du cocher).
Comment sonne la cloche ? Lis le.
Le professeur explique les mots :
monotone– produire le même son monotone ;
fatigant- Provoque de la fatigue et de l'épuisement.
Pouchkine souligne par ces mots l'ennui et la monotonie de la route.
Quel genre de chansons le cocher chante-t-il ? Lis le.
Comment comprenez-vous l'expression "festivités"?
(Amusement exubérant).
Quelles chansons le cocher chante-t-il ?
(Joyeux et triste).
Le peuple russe a créé de nombreuses chansons tristes qui parlent de sa triste vie. Mais les Russes aiment aussi les chansons drôles et veulent parfois oublier leur vie difficile. Ainsi, dans certaines chansons, on entend des « réjouissances audacieuses », dans d’autres – « une mélancolie sincère ».
Comment Pouchkine parle-t-il de ces chansons ? Lis le.
(« Quelque chose me semble familier
Dans les longues chansons du cocher").
Pourquoi entendez-vous quelque chose de « natif » chez eux ?
Indigène- c'est du russe.
Pouchkine aimait le peuple russe, ses chansons et ses contes de fées.
8) - Comment toute cette image de la route apparaît-elle au poète ?
(terne, ennuyeux, triste, triste).
9) - Quels mots et expressions vous aident à imaginer la monotonie et l'ennui d'une route hivernale ? Trouvez-les dans le texte du poème et lisez-les.
(La lune jette une lumière triste, des prairies tristes, la cloche monotone tinte péniblement, le désert et la neige).
La route hivernale et ennuyeuse a apporté de la mélancolie au poète. Cette mélancolie était intensifiée par la voix sourde du cocher chantant des chansons tristes.
10) - Quels sentiments le poète éprouve-t-il ?
(Sentiments de tristesse, tristesse, fatigue, solitude).
11) - Quelle humeur ce poème évoque-t-il en vous ?
(Triste, triste).
Vous voyez à quel point Pouchkine a merveilleusement choisi ses mots et ses expressions : l'image d'une route hivernale et ennuyeuse apparaît sous nos yeux lorsque nous lisons un poème, et l'humeur du poète, ses sentiments nous sont transmis.
IX Former les étudiants à la lecture expressive d'un poème.
Les élèves sont invités à réfléchir à la manière de lire le poème afin de mieux imaginer la zone déserte et terne, la triste lumière de la lune, la chanson du cocher et les sentiments du poète.
Un travail de lecture de chaque strophe est donné, l'intonation, l'accent logique, les pauses, les thèmes, le ton de la voix sont justifiés.
X Tâche d'auto-apprentissage.
Apprenez le poème par cœur.
XI Résumé de la leçon.
Avec quel poème d'A.S. Avez-vous rencontré Pouchkine aujourd'hui ?
As tu aimé ce poème?
L'enseignant évalue les lectures et les travaux des élèves en classe.
La leçon est terminée.
Les pauses logiques ne sont pas les seules à nous aider à transmettre avec précision et clarté les pensées de l’auteur au public. Ceci est également facilité par le placement et le respect corrects contraintes logiques.
L'accent logique est la sélection, à l'aide de moyens sonores, d'un mot ou d'un groupe de mots parmi d'autres mots dans une phrase ou un cycle de discours. Dans chaque battement de discours, il y a un mot qui se distingue par sa signification dans le discours parlé en élevant, en abaissant ou en renforçant le son de la voix. Cette accentuation de l'intonation d'un mot s'appelle - chronométré stress logique.
"Maintenant c'est finiSEPTEMBRE , / et les saules / encoren'est pas devenu jaune ".
Un battement de discours individuel contient rarement une pensée complète, c'est pourquoi l'accent de chaque battement de discours doit être subordonné à l'accent principal de la phrase entière. L'accent logique peut être sur n'importe quel mot significatif, où qu'il se trouve - au début, au milieu ou à la fin d'un temps de parole. Mais souvent, le mot logiquement accentué se trouve à la fin d'un temps de discours, ce qui est typique de l'intonation russe.
Une phrase peut avoir plusieurs accents logiques (selon le nombre de battements de parole), mais l'un d'eux est l'accent principal de la phrase - accentuation des phrases. L'accent logique principal subordonne tous les autres mots accentués de la phrase, tout comme un mot accentué ordinaire subordonne tous les mots non accentués de son tact de discours.
" Fille , /CatherineIvanovna , / jeunejeune femme , / joué le ROYAL " .
Il existe différentes manières de mettre en évidence les mots accentués : ils sont mis en évidence en élevant, en baissant, en ralentissant ou en renforçant la voix, ainsi qu'en utilisant des pauses. Toutes les méthodes de mise en évidence d'un mot accentué sont généralement utilisées en combinaison les unes avec les autres.
L'accent mis sur les mots accentués dépend du contexte et des tâches efficaces. Cependant, il existe des lois et des règles pour définir des contraintes logiques. Les lois sont universelles et sont toujours observées ; les règles prescrivent.
Loi d'un nouveau concept
Les mots qui désignent de nouveaux concepts inconnus du texte précédent (noms de personnes, d'objets, de propriétés, d'actions, etc.) sont soulignés. Les concepts familiers, comme ceux mentionnés précédemment, ne sont généralement pas choquants. Ils ne peuvent être mis en évidence que dans les cas où le sens ou la construction particulière de la phrase l'exige.
« Onéguine, mon bon ami,
Né sur les rives de la Neva..."
Une fois inversé sur les définitions exprimées par des adjectifs
"Neige, /en forme d'aiguille et lâche ,/ sont tombés en grappes.
Oppositions
Les mots opposés sont mis en évidence par leur intonation. L'opposition se compose généralement de deux parties. Dans l’un, quelque chose est nié pour affirmer quelque chose dans l’autre. Parfois une des parties de l’opposition n’est qu’implicite (opposition cachée). Quel que soit l’ordre dans lequel sont disposées les parties de l’opposition, ce qui est affirmé ressort plus fortement et toujours en baissant la voix comme accent principal.
"Je ne fumerais pasbaiser ,
si je pouvais l'obtenir"Kazbek" » .
"Pas d'exécutioneffrayant , - / le tien fait peurdisgrâce » .
"Pasgenre , / UNesprit Je ferai de toi un gouverneur.
Les concepts approuvés sont « Kazbek », « défaveur », « esprit », ils nécessitent donc de baisser la voix et de la renforcer considérablement. Les mots « shag », « exécution » et « naissance » sont des concepts niés et nécessitent d’élever la voix (sans la renforcer).
"Tu devrais, tu sais,à la marine
Avec ton appétit."
Le mot « à la flotte » est une opposition cachée (à la flotte, pas à l'infanterie).
Comparaisons.
Lorsque l'on compare, généralement, seul ce qui ressort est à quoi est-ce comparé ? sujet, propriété, etc. Les syndicats à l'aide desquels se forme un chiffre d'affaires comparatif ne peuvent pas être choquants.
"Toujours modeste, toujours obéissant,
J'aime toujoursmatin , joyeux,
Commentvie d'un poète , simple d'esprit,
Commentbaiser d'amour , cher."
Proposition non élargie.
Dans les phrases rares, qui se composent généralement d'un sujet et d'un prédicat, l'accent est généralement mis sur le dernier mot. Par conséquent, avec l'ordre direct des mots dans de telles phrases, le prédicat devient accentué, et dans les phrases inversées, le sujet devient accentué. Lorsque le sujet et le prédicat sont des concepts nouveaux, ils se démarquent tous deux. Le prédicat, dont le sens est en quelque sorte contenu dans le sujet, n'est pas mis en évidence, peu importe où il se trouve dans la phrase non étendue.
"Gravehiver . Mais : l'hiverrude JE".
Mots explicatifs pour les verbes.
Si l'offre contient ajouts ou circonstances expliquant le verbe, alors ce sont eux qui reçoivent l'accent, pas le verbe. Les verbes eux-mêmes ne sont mis en évidence que dans les phrases peu courantes, lorsqu'ils sont à la deuxième place, ainsi que lorsqu'ils sont contrastés et énumérés. Les adverbes avec un verbe, ils nécessitent l'accentuation s'ils remplacent presque le verbe dans le sens. Mais les adverbes qualitatifs ne nécessitent pas d’accentuation.
"Un jouren automne / Je revenais deBakhchisaraï /V Yalta / à traversAi-Petri » .
Ici, l'accent est mis sur la circonstance du temps ( en automne) et les circonstances du lieu (depuis Bakhchisaraï, V Yalta, à travers Ai-Petri), qui expliquent les verbes.
"Je suis à fond /courir couru. Mais : je suis à fond /couru ».
L'adverbe est mis en évidence ici courir, et verbe couru. Le mot « courir » dans son sens peut remplacer le verbe « courir ».
Énumération. Membres homogènes de la phrase.
L'énumération est caractérisée par un « mouvement de voix » particulier - une perspective montante et logique. Sur les mots énumérés, la voix monte tout le temps, indiquant que la pensée n'est pas encore terminée et qu'elle se poursuivra, et seulement sur le dernier d'entre eux, si la phrase se termine, la voix descend. Le pouvoir de mettre en évidence les mots répertoriés augmente. Membres homogènes d'une phrase (exprimés en un mot ou une phrase), parfois des phrases entières nécessitent une intonation d'énumération.
"C'est çacognement , / Etcrier , / Etcloches n'entends pas."
« Ils défilent /cabines ,/ femmes ,/
garçons ,/ magasins , / lanternes /,
Palais ,/ jardins ,/ monastères …»
Définitions exprimées par un nom au génitif.
"Depuis les fenêtresvoisin / on entendait de la musique."
« D'ici, je vois /ruisseaux naissance,/
Et le premier / formidableglissements de terrain / mouvement."
Appel.
L'adresse au début de la phrase est soulignée par un accent logique et une pause. Au milieu et à la fin d'une phrase, le discours ne nécessite pas d'accentuation et fait partie du tact de discours.
« Victor , / donne-moi balle ».
« je t'en supplie toi(,) fille, / ne pars pas ».
« Ne criez pas (,) Léna."
Identification de concepts répétés.
« j'y vais, j'y vais en plein champ ;/
Clocheding-ding-ding …/
Effrayant, effrayant involontairement /
Parmi les plaines inconnues.
Résumer des mots prendre des contraintes logiques.
"Maintenant, il n'y a plus de montagnes,/pas de ciel,/pas de terre –//Rien n'était pas visible."