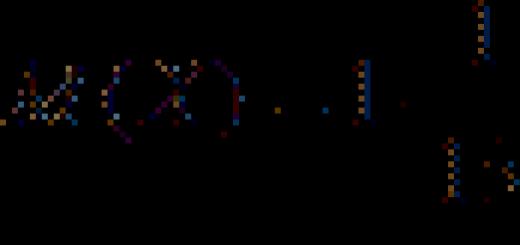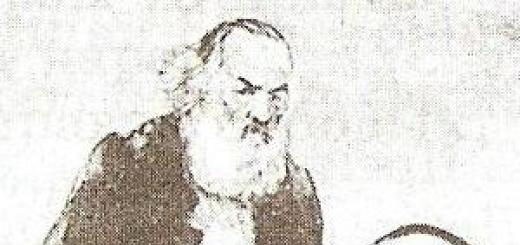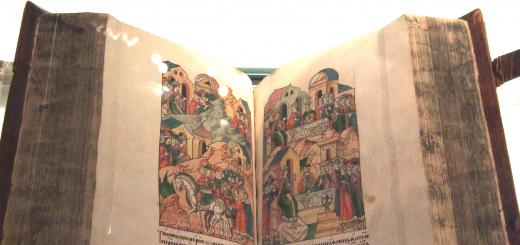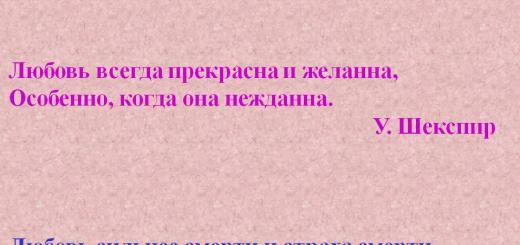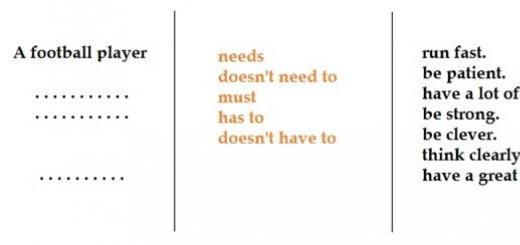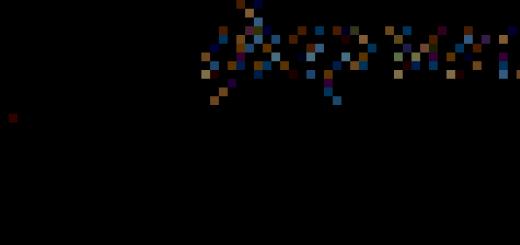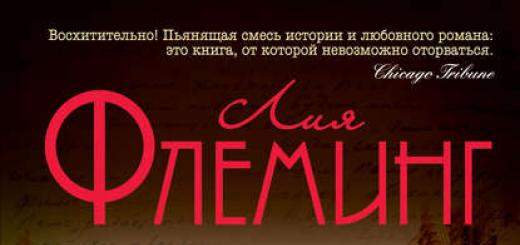L'État du Sénégal est situé en Afrique de l'Ouest, à côté de la Guinée et de la Guinée-Bissau au sud. Au nord se trouve la frontière avec la Mauritanie, à l'est avec le Mali. Les territoires occidentaux sont baignés par l'océan Atlantique. Au centre du pays se trouve l'État de Gambie. La capitale du Sénégal est la ville de Dakar.
Population du Sénégal
Le pays abrite plus de 10 millions d'habitants, dont 37 % de Wolof, 17 % de Sérère, 17 % de Peuls, 9 % de Maldigo, 9 % de Toucouleur.
Nature du Sénégal
Dans les terres désertiques du nord ne poussent que des arbustes et de l'herbe, dans le sud se trouvent des forêts denses de tecks, de palmiers et de bambous. Au Sénégal, on trouve des lions, des guépards, des éléphants, des antilopes, des hippopotames, des crocodiles et un grand nombre d'espèces de serpents.
Conditions climatiques du Sénégal
Au nord du pays, le climat est majoritairement sec, subéquatorial, au sud il est tropical, avec des pluies fréquentes. La température moyenne est d'environ +23...25°C, les vents du Sahara apportent souvent des tempêtes de sable.

Langue du Sénégal
La langue officielle du pays est le français, beaucoup parlent anglais. La population locale parle de nombreux dialectes.
Cuisine
Le riz est toujours utilisé dans la cuisine traditionnelle sénégalaise. Il peut servir de plat d'accompagnement, peut être un ingrédient pour préparer un plat de fête copieux ou peut être présent dans un dessert aux fruits sucrés. Les chefs locaux préparent des sauces insolites et exotiques à base d'oignons, d'ail et de légumes. Ils sont généreusement versés sur des délices de viande ou des bouillies, donnant aux plats un goût original unique.
Religion
Au Sénégal, 92 % des musulmans sont sunnites, environ 3 % des chrétiens sont catholiques et un peu plus de 5 % adhèrent aux croyances africaines.
Vacances au Sénégal
Le 23 août est la journée des tirailleurs au Sénégal. Le 4 avril est le jour de l'indépendance au Sénégal, le 1er février est le jour de la Confédération.
Devise
L'unité monétaire du Sénégal est le franc CFA BCEA (code XOF).

Temps
Dans le temps, le Sénégal a 4 heures de retard sur Moscou.
Principales stations balnéaires du Sénégal
De tous les pays de la région ouest-africaine, le Sénégal possède l’infrastructure touristique la plus développée. Dans les grandes villes et les centres de villégiature, il existe non seulement de grands hôtels confortables, mais aussi de petits hôtels privés à l'atmosphère chaleureuse et familiale. La station balnéaire de Petit Côté est célèbre pour son climat toujours ensoleillé et son océan calme ; ses plages de perles, ses eaux claires et ses paysages pittoresques attirent les touristes européens depuis de nombreuses années. A proximité se trouve la station balnéaire de Sali, où les clients se voient proposer un riche programme d'animations. Les personnes intéressées peuvent faire du surf ou du ski nautique, les pêcheurs ont la garantie d'une riche prise et des safaris sont organisés pour les personnes intéressées. Le ski est surtout développé en tant que station ultramoderne avec une gamme de procédures à la mode et un service discret. Saint-Louis offre de merveilleuses vacances à la plage, au cœur d'une magnifique nature africaine.
Sites touristiques du Sénégal
Dakar est célèbre pour ses nombreux musées avec d'excellentes expositions, les musées maritimes, historiques et des peuples noirs d'Afrique et d'art africain sont particulièrement populaires. La Grande Mosquée ou Grande Mosquée et le Palais Présidentiel, l'Hôtel de Ville sont les plus beaux édifices de la ville. Marchés locaux colorés, phares sur la côte, plages aménagées, tout cela fait de Dakar un centre de loisirs attractif pour les touristes.
D'un point de vue touristique, les villes de Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor et Kaolack, ainsi que l'île de Gorée sont également intéressantes.
Une merveille naturelle du Sénégal est le Lac Rose (Retba), ainsi nommé en raison de sa couleur particulière. L'eau du lac a une telle concentration de sel qu'un seul micro-organisme peut y vivre : une bactérie qui produit un pigment rose vif. De Dakar au lac – 30 km.
A proximité se trouve une réserve de tortues, un lieu particulièrement apprécié des touristes avec enfants. Les sépultures anciennes avec des pierres tombales en forme d'anneaux de pierre trouvées au Sénégal sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et représentent un incroyable spectacle mystique. La réserve de biosphère du Niokolo-Koba est soigneusement protégée par l'État ; elle est présentée aux touristes avec une extrême prudence, car les espèces d'oiseaux les plus rares et une végétation unique y sont sauvées de l'extinction.
Le contenu de l'article
République du Sénégal. État d'Afrique de l'Ouest. La capitale est Dakar (1,7 million d'habitants - 2002). Territoire – 196,7 mille mètres carrés. km. Division administrative : 11 régions. Population – 12 millions 323 mille 252 (estimation de juillet 2010). La langue officielle est le français. Religion – Islam, christianisme et croyances traditionnelles africaines. L'unité monétaire est le franc africain (franc CFA). Fête nationale - Jour de l'Indépendance (1960), 4 avril.
Situation géographique et limites.
Un État continental sur la côte atlantique. La longueur du littoral est de 531 km. Elle est limitrophe au nord avec la Mauritanie, à l'est avec le Mali, au sud avec la Guinée et la Guinée-Bissau et à l'ouest avec la Gambie.
Nature.
La majeure partie du territoire sénégalais est couverte de végétation de savane (acacias, baobabs, gypaète barbu, herbe à éléphant, bambous, ronier, tamarin). Il existe un acacia arabe qui produit de la résine de gomme arabique. Les régions du nord représentent ce qu'on appelle la zone. Sahel (savane désertique). Dans la partie sud-ouest du pays, des forêts mixtes de feuillus et de sempervirents sont préservées, dans lesquelles poussent des acajas (acajou), des bavolniks, des karités (arbres à beurre), des lianes, des palmiers doum et des caroubiers. Les grands animaux comprennent les antilopes, les guépards, les hyènes, les sangliers, les léopards et les chacals. Les lièvres, les singes et de nombreux rongeurs sont également courants. L'avifaune est diversifiée (cigognes, oies, vautours, outardes, grues, échassiers, perdrix, aigles, perroquets, calaos, autruches, oiseaux tisserins, canards, flamants roses, pintades), de reptiles (dont varans, cobras et pythons), ainsi que ainsi que le monde des insectes (moustiques, mouches tsé-tsé, criquets, termites). Il existe six parcs nationaux. Dans les eaux côtières et les rivières, on trouve beaucoup de poissons (requins, dorades, maquereaux, bars, sardinelles, harengs, poissons-chats, thon), de poulpes et de mollusques crustacés.
Minéraux - diamants, bauxite, fer, or, calcaire, ilménite, cuivre, marbre, sel gemme, pétrole, gaz naturel, rutile, titane, tourbe, phosphates, zirconium.
Population.
La densité moyenne de population est de 62,6 personnes. par 1 m² km. Sa croissance annuelle moyenne est de 2,48%. Taux de natalité – 37,27 pour 1 000 personnes, mortalité – 9,5 pour 1 000 personnes. La mortalité infantile est de 57,7 pour 1000 naissances. 42,2% de la population sont des enfants de moins de 14 ans. Résidents de plus de 65 ans – 3%. L'espérance de vie est de 58,9 ans (hommes – 57,48 ans, femmes – 50,86). (Tous les indicateurs sont donnés dans les estimations pour 2010). Pouvoir d'achat de la population en 2009 – 1900 dollars américains.
Le Sénégal est un État multiethnique. Plus de 90% de la population – peuples africains: Wolof (43,3%), Pular (23,8%), Sérère (14,7%), Diola (3,7%), Malinké (3%), Soninké (ou Sarakol - 1,1%), Fulbé et Toucouleur. Plusieurs pour cent de la population sont des Arabes, des Européens (principalement des Français vivant à Dakar) et des Maures. Les régions du sud (Casamance) sont les plus diversifiées sur le plan ethnique. Parmi les langues locales, les langues les plus répandues sont celles des peuples wolof, peul, sérère, soninké, malinké et diola.
En 1982, en Casamance, où la majorité de la population est composée de catholiques diolas, des soulèvements armés de séparatistes exigeant l'autonomie ont commencé et se sont poursuivis jusqu'en décembre 2004. Ces manifestations étaient menées par le Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (MDCC), créé sur une base ethno-confessionnelle. Le Président de la DDSC est l'Abbé D. Senghor, Général. seconde. – JMFBiagi (2005).
Le Sénégal a un taux d'urbanisation élevé, la population urbaine représentant plus de 42 % (2004). Grandes villes - Thiès (228 mille habitants), Kaolack (199 mille habitants), Ziguinchor (180,5 mille habitants) et Saint-Louis (132,4 mille habitants) - 1996.
Il y a eu une migration de travail des Sénégalais vers le Gabon, la Gambie et la Côte d'Ivoire Depuis le début des années 2000, le Sénégal (avec le Nigeria et la RDC) a été l'un des premiers pays d'Afrique en termes de nombre d'émigrants et de réfugiés. les pays de l’Union européenne.
Religions.
Le Sénégal est l'un des États les plus islamisés du continent africain. Les musulmans (professant l'islam sunnite) représentent environ. 90 % de la population sont chrétiens (la majorité professent le catholicisme) - 5 %, env. 5% (principalement des habitants des régions du sud) adhèrent aux croyances traditionnelles africaines (animalisme, fétichisme, culte des ancêtres, forces de la nature, etc.) - 2003. Il existe également un petit nombre d'adhérents au bahaïsme.
La pénétration de l’Islam a commencé au premier semestre. 11ème siècle pendant la période d'existence de la formation étatique Tekrur sur le territoire du Sénégal. Il est devenu le premier pays d’Afrique de l’Ouest à s’islamiser. Les ordres soufis (tarikat) de Tijaniyya, Muridiyya et Qadiriya sont particulièrement influents parmi les musulmans sénégalais. La propagation du christianisme a commencé au XVIIe siècle. Le Sénégal se caractérise par la tolérance religieuse.
GOUVERNEMENT ET POLITIQUE
Structure de l'État.
République présidentielle. Il existe une constitution en vigueur, approuvée par référendum national le 7 janvier 2001. Le chef de l'État et commandant en chef des forces armées est le président, élu au moyen d'élections générales directes (au scrutin secret) pour un mandat. Mandat de 5 ans. Le président ne peut être élu à ce poste que deux fois au maximum. Le pouvoir législatif est exercé par le parlement (Assemblée nationale), composé de 120 députés (dont 65 sont élus par circonscriptions territoriales, 55 par listes de partis). Les députés sont élus au suffrage universel direct, au scrutin secret. Sa durée de mandat est de 5 ans ; il peut être dissous par le président au plus tôt 2 ans après les élections législatives.
Drapeau d'État. Un panneau rectangulaire composé de trois bandes verticales de même taille en vert (au niveau de la tige), jaune et rouge. Au centre de la bande jaune se trouve l’image d’une étoile verte à cinq branches.
Dispositif administratif.
Le pays est divisé en 11 régions constituées de départements.
Système judiciaire.
Basé sur les principes du droit civil français. Il existe les Conseils constitutionnel et d'État, ainsi que la Cour de cassation, qui réglemente les activités des cours et tribunaux qui lui sont subordonnés.
Forces armées et défense.
Les forces armées nationales comptent 9,4 mille personnes. (forces terrestres - 8 mille personnes, force aérienne - 800 personnes et forces navales - 600 personnes). Forces de gendarmerie paramilitaire - 5,8 mille personnes. (Données de 2002). Le service militaire (2 ans) s'effectue par conscription. La France et les États-Unis apportent une aide logistique pour équiper et entraîner les forces armées. En 1996, avec l'aide de la France, un centre de formation militaire a été ouvert à Thiès, où sont formés des officiers de 13 pays de la sous-région (Bénin, Gabon, Guinée, Congo, etc.). Il existe sur le territoire du pays un contingent des forces armées françaises d'un montant de 1 150 personnes. (2002). En juin 2005, des unités des forces armées sénégalaises (aux côtés des troupes des États-Unis, de l'Algérie, de la Mauritanie, du Mali, du Maroc, du Niger, de la Tunisie et du Tchad) ont participé à des manœuvres militaires dans le désert du Sahara, baptisées Flintlock 2005. Le quartier général opérationnel des manœuvres était situé à Dakar. Les dépenses de défense en 2004 se sont élevées à 107,3 millions de dollars (1,5 % du PIB).
Police étrangère.
Elle repose sur la politique de non-alignement. Le principal partenaire en politique étrangère est la France. Le Sénégal entretient des relations de bon voisinage avec la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau, incl. dans le cadre de l'Organisation pour l'utilisation efficace des ressources de la Gambie. Les relations entre le Sénégal et la Gambie sont compliquées en raison de la contrebande de produits industriels à travers le territoire gambien (les droits de douane sont moins élevés sur de nombreuses marchandises importées), ainsi qu'en raison de l'afflux d'un grand nombre de réfugiés sénégalais qui se sont installés en Gambie. à la fin. années 1990 à la suite du conflit casamançais. Jusqu'en 2005, un programme de coopération avec Taiwan, reconnu par le Sénégal en 1996, a été mis en œuvre avec succès. 150 millions de dollars. Au début. En novembre 2005, le Sénégal a mis fin aux relations diplomatiques avec Taiwan et les a rétablies avec la RPC (elles ont été rompues en 1996 après que le Sénégal a reconnu Taiwan).
Les représentants du Sénégal (diplomates, politologues, avocats et économistes) ont occupé à plusieurs reprises des postes élevés au sein de l'ONU, de l'UNESCO et d'autres organisations internationales.
Les relations diplomatiques entre l'URSS et le Sénégal ont été établies le 14 juin 1962 (la première délégation gouvernementale de l'URSS s'est rendue au Sénégal en 1961). La coopération bilatérale a été menée dans le domaine des relations commerciales et économiques (dont en 1970-1973, l'URSS a construit 10 thoniers pour le Sénégal), scientifique et technique (exploration géologique, échanges scientifiques) et culturelle, ainsi que dans le domaine de médecine et assistance à la formation du personnel national pour le Sénégal. En décembre 1991, la Fédération de Russie a été reconnue comme successeur légal de l’URSS. La reprise des relations russo-sénégalaises a débuté mardi. sol. années 1990 Le Sénégal a reçu la visite d'une délégation de la Douma d'État de la Fédération de Russie (1996), du ministre russe des Affaires étrangères E.M. Primakov (1997) et du président du Conseil de la Fédération E.S. Stroev (2000). En mai 2000, des consultations entre le ministère russe des Affaires étrangères et le Sénégal ont eu lieu à Dakar ; des travaux sont en cours pour actualiser le cadre juridique des relations bilatérales. Depuis 1997, une mission commerciale russe opère à Dakar. En 1997, la première foire-exposition « Journées des régions russes en Afrique de l'Ouest » a eu lieu au Sénégal, et en 1998, lors de la prochaine foire des produits russes, env. 100 entreprises de la Fédération de Russie. KAMAZ russe à la fin. Années 1990 - début Dans les années 2000, il remporte à plusieurs reprises le rallye Paris-Dakar. En janvier 2005, l'équipe KAMAZ de Naberezhnye Chelny (Fédération de Russie) a de nouveau remporté la 1ère place dans la catégorie camions lors du rallye annuel Barcelone-Dakar. Jusqu'en 2003, 624 Sénégalais suivaient des études supérieures dans des universités d'URSS et de Russie ; en 2004, 35 étudiants sénégalais étudiaient dans des universités russes.
Organisations politiques.
Un système multipartite s'est développé dans le pays (environ 40 partis politiques et associations – 2004). Les plus influents d’entre eux :
– « Parti Démocratique Sénégalais», SDP(Parti démocratique sénégalais, PDS), gène. seconde. – Abdoulaye Wade, secrétaire général adjoint – Idrissa Seck. Parti au pouvoir, principal en 1974 ;
– « Mouvement pour le socialisme et l'unité», DSE(Mouvement pour le socialisme et l "unité, MSU), Secrétaire Général - Ndiaye Bamba (Bamba N" Diaye). Fête créée en 1981 sous le nom de « Mouvement populaire démocratique », a reçu son nom actuel en 2001 ;
– « Ligue Démocratique - Mouvement pour la création du Parti Travailliste», DL-DSPT(Ligue démocratique – Mouvement pour le parti du travail, LD – MPT), gène. seconde. – Abdoulaye Bathili. Fête principale en 1981 à la suite de la scission du Parti africain pour l'indépendance du Sénégal, principal. en 1957 ;
– « Rassemblement National Démocratique», NDO(Rassemblement national démocratique, RND), gén. seconde. – Diouf Madior (Madior Diouf). Fête créée en 1976, jusqu'en 1981, elle a fonctionné illégalement ;
– « Parti de l'indépendance et du travail», VCN(Parti de l'indépendance et du travail, PIT), Secrétaire Général - Dansokho Amat. Fondé en août 1981 sur la base du Parti Africain de l'Indépendance du Sénégal ;
– « Parti Socialiste du Sénégal», Merci(Parti socialiste du Sénégal, PS), le siège est vacant, agira. Secrétaire - Dieng Ousmane Tanor Dieng. Créé en 1948 sous le nom de « Bloc démocratique sénégalais », en 1958-1976, il s'appelait « Union progressiste du Sénégal » ;
– « Union pour le renouveau démocratique», DE À(Union pour le renouveau démocratique, URD), leader - Djibo Laity Ka. Fête principale en 1998 à la suite de la scission du Parti Socialiste du Sénégal.
Associations syndicales - « Confédération nationale des travailleurs du Sénégal », CNTS (Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal, CNTS). Secrétaire général : Modi Guiro. Créé en 1969, rassemble 120 mille adhérents, est sous l'influence du Parti Socialiste du Sénégal.
ÉCONOMIE
Le Sénégal appartient au groupe des pays les moins avancés. La base de l'économie est le secteur agricole. C’est l’un des pays en développement constant d’Afrique de l’Ouest. Le PIB par habitant en 2005 (estimation) était de 961 dollars EU.
Le PIB s'élève à 18,36 milliards de dollars américains, avec une croissance annuelle moyenne de 5 à 6 %. Le taux d'inflation est de 0,8%, l'investissement est de 20,1% du PIB (données de 2004). 54 % de la population est au seuil de pauvreté, le chômage est de 48 % (parmi les jeunes urbains - 40 %) - données de 2001. En janvier 2005, des grèves des travailleurs des transports ont eu lieu dans tout le pays. Des marches de protestation étudiantes ont également eu lieu à Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et dans d'autres villes pour exiger des solutions aux problèmes sociaux.
Une aide financière est apportée par la France, Arabie Saoudite, l'Inde et Taïwan (après le rétablissement des relations diplomatiques entre le Sénégal et la RPC début novembre 2005, Taïwan a annoncé la fin de ses programmes d'assistance). La dette extérieure du Sénégal s'élève à 3,92 milliards de dollars (2002).
Ressources en main d'œuvre.
Population économiquement active – 4,65 millions de personnes. (2004).
Agriculture.
La part du secteur agricole dans le PIB est de 15%, il emploie 70% de la population économiquement active (2009). 12,78% des terres sont cultivées (2001). Le secteur agricole fournit 1/3 des besoins alimentaires nationaux. Les principales cultures d'exportation sont l'arachide (75 % de toutes les terres cultivées en sont occupées) et les mangues. Les principales cultures vivrières sont la patate douce, les légumineuses, le maïs, le manioc, le mil, le riz, le sorgho et l'igname. Des avocats, des ananas, des bananes, des melons, des noix de coco, des légumes, de la papaye, de la canne à sucre, du coton et des agrumes sont également cultivés. Les criquets causent des dégâts importants à l'agriculture.
Depuis 1994, la pêche se développe de manière dynamique (captures de crevettes, homards, maquereaux, sardinelles, sardines, thon) et la transformation du poisson. Les pays de l’Union européenne fournissent une aide financière et technique importante au développement de l’industrie. La pêche représente 27 % des recettes d'exportation du Sénégal (2002). L'élevage (élevage de chameaux, chèvres, bovins, chevaux, moutons, ânes et porcs) est un secteur traditionnel de l'économie, employant 20% de la population. L’aviculture est développée partout au Sénégal.
Industrie.
La part dans le PIB est de 21,4%, elle emploie plus de 10% de la population économiquement active (2009). Il existe plus de 300 entreprises industrielles. Les principales industries sont l'exploitation minière, l'alimentation, l'éclairage et la chimie. L'extraction de diamants est en cours minerai de fer, gaz naturel, tourbe et phosphates. Les nouveaux codes miniers et pétroliers adoptés en 1997-1998 contribuent à l’afflux d’investissements étrangers dans l’industrie.
Il existe des usines produisant du beurre de cacahuète, de la farine, de la bière, des confiseries, du sucre, du lait concentré et du poisson en conserve. Il existe plusieurs dizaines d'entreprises de textile et d'habillement. Il existe une usine de chaussures qui produit également des chaussures pour l'exportation. L'industrie chimique est développée (production de produits pétroliers, d'engrais, de produits pharmaceutiques, de savon, de parfums et de plastiques). Des matériaux de construction sont produits, principalement du ciment. Génie mécanique : il existe un grand chantier de réparation navale, des usines d'assemblage de voitures, des entreprises produisant des machines agricoles et des équipements électriques. La transformation des métaux a été établie - la production de conteneurs, d'ustensiles métalliques et de fûts.
Échange international.
Le volume des importations dépasse largement le volume des exportations : en 2004, les importations (en dollars américains) s'élevaient à 2,13 milliards, les exportations à 1,37 milliard. La base des importations est le carburant diesel, les machines, les équipements, les produits alimentaires, les biens de consommation et Véhicules. Les principaux partenaires d'importation sont la France (24,8%), le Nigeria (11,9%) et la Thaïlande (6,1%) - 2004. Les principaux produits d'exportation sont les arachides, l'huile et les tourteaux d'arachide, les produits pétroliers, le poisson, les acides sulfurique et phosphorique, les phosphates et le coton. . Les principaux partenaires à l'exportation sont l'Inde (14,4%), le Mali (13,1%), la France (9,8%), l'Italie (7,3%), l'Espagne (6,6%), la Guinée-Bissau (5,6%) et la Gambie (4,8%). – 2004.
Énergie.
Le pays couvre pleinement ses besoins en électricité. Il est produit dans six centrales thermiques. La production d'électricité en 2002 était de 1,74 milliard de kilowattheures. 30,4% du territoire sénégalais est électrifié (en milieu rural, ce chiffre est de 4%).
Transport.
Réseau de transport développé. Le principal moyen de transport est l'automobile. La longueur totale des routes est de 14,5 mille km (avec revêtement dur - 4,27 mille km) - 2003. Au final. Dans les années 1990, Taiwan a fourni une aide financière (47,6 millions de dollars) pour la reconstruction des autoroutes. La première voie ferrée, Dakar – Thiès – Saint-Louis, a été construite entre 1882 et 1885. Longueur totale les chemins de fer est de 1350 km (2004). Le réseau ferroviaire du Sénégal est relié aux chemins de fer du Mali. Le port maritime de Dakar est l'un des plus grands au monde et le deuxième (après le port d'Abidjan en Côte d'Ivoire) pôle de transport le plus important de la côte ouest du continent africain. Le long des voies navigables (Casamance, Saloum). et les fleuves Sénégal sont navigables) est de 1 000 km. Commerce, la flotte se compose de 190 navires (2002). Il existe un oléoduc d'une longueur de 564 km. Il y a 20 aéroports et sites d'atterrissage (9 d'entre eux ont une surface dure). - 2004. Aéroport international - Dakar-Jof du nom de L. Senghor.
Finances et crédit.
L'unité monétaire est le franc CFA (XOF), composé de 100 centimes. (Outre le Sénégal, le franc CFA – le franc de la Communauté Financière Africaine – est l'unité monétaire du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Togo.) En décembre 2004, le taux de change national était de : 1 USD = 528,3 XOF.
Tourisme.
Les touristes étrangers sont attirés par les plages de sable fin de la côte océanique, les hôtels confortables, les monuments historiques associés à l'époque de la traite négrière, ainsi que par la culture originale des populations locales. Le tourisme au Sénégal est l'une des industries les plus dynamiques, qui occupe la deuxième place en termes de recettes en devises. L'industrie du tourisme emploie env. 15,5% de la population économiquement active (2002). Le tourisme d'affaires se développe. Environ des gens viennent dans le pays chaque année. 500 mille touristes étrangers. La France apporte une aide financière importante au Sénégal pour le développement de son industrie.
Attractions à Dakar : le palais présidentiel, le Musée d'Art Africain, la Grande Mosquée de Médina, la Cathédrale Catholique, le marché de la ville. Autres attractions : forts du XVIIe siècle, le Musée Maritime, la Maison des Esclaves avec des cellules d'esclaves (les objets classés sont situés sur l'île de Gore, située à 4 km de Dakar), d'anciens édifices religieux de 2 à 3 000 av. e. (près de la ville de Kaolak), une mosquée avec un minaret de 87 mètres dans la ville de Tuba (le centre spirituel de la tariqa Muridiyya), ainsi que les parcs nationaux Nyokolo-Koba et Dzhuj (inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ). Le plat national principal est putain de diène(riz au poisson). Autres plats sénégalais : Yassa(viande de poulet), dem en Saint-Louisien(gefilte poisson), Bassi-salé(couscous à base de millet, agneau, légumes, raisins secs, dattes et feuilles sèches de baobab broyées), mafé(ragoût).
La meilleure période pour passer des vacances dans les stations balnéaires du Sénégal (Les Almadies, Cap Skiring, Saly, etc.) est septembre-octobre. Les premiers touristes soviétiques ont visité le pays dans les années 1960 et 1970. De nombreuses agences de voyages russes offrent la possibilité de se détendre au Sénégal.
SOCIÉTÉ ET CULTURE
Éducation.
La première école primaire fut ouverte en 1816, le premier collège en 1843.
Officiellement, 6 années d'enseignement primaire sont obligatoires et les enfants commencent à l'âge de sept ans. L'enseignement secondaire (7 ans) commence à l'âge de 13 ans et se déroule en deux étapes : 4 et 3 ans. Afin d'améliorer le niveau d'éducation, le gouvernement a adopté en 1995 un plan spécial jusqu'en 2008. En 2005, 80 % des enfants de l'âge correspondant fréquentaient l'école primaire et secondaire (en 2000, 66 %). Moins de 50 % des enfants terminent l’école primaire.
Le système d'enseignement supérieur comprend deux universités - Cheikh Anta Diop à Dakar (ouverte en 1949, reconnue universitaire en 1957) et l'Université Gaston-Berge à Saint-Louis (fondée en 1990), - l'Institut de Technologie (G. Dakar ), ainsi que 5 collèges situés dans la capitale et à Thiès. En 2002, 874 enseignants et 20 mille étudiants étudiaient dans cinq facultés de l'Université Cheikh Anta Diop, et 89 enseignants et 2 157 étudiants à l'Université Gaston-Berge. Les deux universités sont sous contrôle de l'État, la langue d'enseignement est le français. En 1996, débutent les travaux de création d'une université panafricaine à Sebikotan (près de Dakar). Les Sénégalais font également des études supérieures à l'étranger, principalement en France, aux États-Unis et au Canada. Ils travaillent env. 15 instituts de recherche et centres scientifiques menant des recherches dans les domaines de l'agronomie, de la médecine vétérinaire, des ressources halieutiques, de la géologie et de la médecine. Le problème de la « fuite des cerveaux » du pays est aigu. En 2003, 40,2 % de la population était alphabétisée (50 % d'hommes et 30,7 % de femmes).
Soins de santé.
Le taux d'incidence du SIDA est de 0,8% (2003). En 2003, il y avait 44 000 personnes atteintes du SIDA et infectées par le VIH, 3 500 personnes sont mortes. Les médecins sont formés à la Faculté de Médecine de l’Université Cheikh Anta Diop et à l’étranger. Selon le rapport de l'ONU sur le développement humanitaire de la planète, le Sénégal occupait en 2001 la 156ème place dans le classement des pays.
Architecture.
Il existe plusieurs types d'habitations traditionnelles parmi les populations locales. DANS régions occidentales des cabanes en pisé de forme carrée sont érigées sous un toit d'herbe à quatre pentes. Dans l'est du pays, les habitations rondes faites de branches tressées, recouvertes d'un toit d'herbe en forme de cône, ainsi que les cabanes rectangulaires avec auvents, sont courantes. Les habitants du sud construisent principalement des maisons en pisé rondes, rectangulaires ou carrées, utilisant souvent des blocs de banco roulés à la main, un mélange d'argile et de paille, comme matériau de construction. On y trouve également des habitations de forme ovale entourées d'une véranda. Leurs murs sont décorés de peintures rouges et bleues.
La construction de mosquées constitue un aspect particulier de l'architecture. Dans les villes modernes, les maisons sont construites à partir de structures en brique et en béton armé. Les quartiers d'affaires des villes sont constitués d'immeubles à plusieurs étages.
Beaux-arts et artisanat.
L'origine des beaux-arts sur le territoire du Sénégal moderne a commencé avant JC : dans d'énormes monticules de sable (8e-6e siècles avant JC, régions centrales), les archéologues ont découvert des céramiques, des armes ainsi que des bijoux en or et en métaux. Le Musée de l'Institut Fondamental de l'Afrique Noire (Dakar, fondé en 1936) possède une riche collection d'art traditionnel africain.
Les beaux-arts professionnels se développent depuis les années 1950. L'École des Beaux-Arts a ouvert ses portes à Dakar en 1972, où enseignaient des enseignants ayant reçu une éducation artistique en France, ainsi que l'ethnographe et artiste français P. Lauds. Artistes sénégalais - Amadou Yero Ba, Papa Sidi Diop, Ibou Diouf, Ibrahim Ndiaye, Papa Ibra Tall. Des expositions d'artistes sénégalais ont eu lieu à Moscou en 1965, 1970 et 1975. Le célèbre artiste et designer sénégalais Oumou Sy participe depuis 2004 à un projet continental visant à créer le premier opéra africain appelé « Opéra du Sahel ». décoration et costumes pour l'opéra.
Les métiers et arts les plus courants sont la poterie, la sculpture sur bois (fabrication de meubles et d'ustensiles ménagers), le bronzage, le tissage (masques rituels, ceintures, sacs et nattes aux couleurs vives), ainsi que le tissage, incl. production de tapis. Les bijoux artisanaux occupent une place particulièrement importante ; les objets en argent et en or fabriqués par les artisans wolof sont très populaires.
Littérature.
Basé sur les riches traditions de créativité orale (mythes, chansons, proverbes et contes de fées) des peuples locaux. Le folklore est étroitement lié à l'art des griots ( Nom commun conteurs et musiciens-chanteurs professionnels en Afrique de l’Ouest). La littérature sénégalaise moderne se développe en français et dans les langues locales des peuples wolof, diola, malinké, sérère, soninka et peul.
D'abord Travail littéraire- le récit « Force - Bienveillance » de Bakary Diallo, publié en 1926. La formation de la littérature nationale est étroitement liée à l'œuvre de Léopold Sédar Senghor, l'un des fondateurs du mouvement dans les années 1930. Négritude(proclamation de l’identité et de l’unité de la culture négro-africaine, nécessité de se tourner vers les origines et d’étudier ses propres valeurs culturelles). Senghor commence à publier en 1934 à Paris. Le premier recueil de ses poèmes - Chansons au crépuscule– publié en 1945. La participation à la Résistance française se reflète dans le cycle lyrique et journalistique de Senghor Victimes noires(1948). Ses autres oeuvres - collection Motifs éthiopiens, poème Élégie aux vents, cycle de poèmes Lettres d'automne. Les œuvres de Senghor ont été publiées dans de nombreux pays. En 2006 sera célébré le 100e anniversaire de la naissance du poète. D'autres poètes du Sénégal sont Amadou Moustapha Wade, Lamine Diakhate, Amadou Traoré Diop, David Diop, Ousmane Sembène (le premier des écrivains nationaux à recevoir une reconnaissance internationale), Malik Fall.
Le fondateur de la prose sénégalaise est Ousmane D. Sose. Son premier roman Karim, publié en 1935. Écrivains sénégalais - Nafissatou Diallo, Birago Diop, Cheikh Hamidou Kana, Abdoulaye Saji, Ousmane Sembène, Aminat Sow Fall et d'autres. Certaines œuvres de Senghor et Sembène ont été traduites en russe et publiées en Union soviétique.
En mai 2005, l'association littéraire française « Nouvelles Pléiades » a créé le prix international L. Senghor. Cet honneur récompensera chaque année un poète dont les œuvres « démontrent pleinement la richesse et l’énorme potentiel de la langue française ».
Musique.
La musique nationale a des traditions anciennes. Il s'est formé sur la base de la musique des peuples locaux et est étroitement lié à l'art des griots ; il a également connu une influence significative de la culture musicale arabe et européenne. Dans la seconde moitié. 20ième siècle L'influence de la musique pop américaine se fait sentir, de nouveaux styles apparaissent et se diffusent largement.
Jouer des instruments de musique, chanter et danser sont étroitement liés à vie courante les populations locales. Instruments de musique - une variété de balafons, tambours (djembé, tama, paliela - chez le peuple Tukuler, ils sont joués exclusivement par des femmes), gnagnur, cloches, xylophones (kora, etc.), arcs musicaux à une corde, hochets, cors , hochets et flûtes. Le chant est développé, les chansons se distinguent par une variété de genres. Le chant rituel, accompagné de musique et de danse, est particulièrement important.
Le Sénégal a initié et organisé le 1er Festival Mondial d'Art Négro-Africain (FESMAN) en 1966. A l'étranger, le nom du chanteur Youssou Ndour est connu. En février 2004, plusieurs groupes folkloriques et groupes musicaux sénégalais ont participé au 1er Festival international de musique nomade qui s'est tenu à Nouakchott (Mauritanie). En novembre 2004, le chanteur et musicien sénégalais Abdou Guité Seck est devenu l'un des trois finalistes du prestigieux concours international « Musiques du monde », organisé par Radio France Internationale depuis 1981 dans le but de favoriser le développement des musiques nationales en Afrique. , les Caraïbes et la région. océan Indien. Les chansons d'Abdou Gite Seck sont une combinaison de rythmes sénégalais et de rock occidental. Le groupe franco-sénégalais « Vok », dans lequel il a travaillé, a été lauréat du prix « Musique du monde » en 2000. En 2003, ce prix a également été décerné à un musicien sénégalais, Didier Awadi, qui dirige le rap. groupe « Positive Black Sull ».
Parmi les musiciens et chanteurs contemporains, citons Baaba Maal (leader du groupe « Daande Lenol » (« Voix du peuple »), qui interprète la musique traditionnelle des peuples wolof et mandingue, ainsi que la musique funk et reggae) et le griot Mansour Sek. également populaire. Des festivals de musique jazz ont lieu à Saint-Louis. Au cours de l'été 2005, un spectacle de deux jours réunissant des stars de la musique du monde appelé « Africa Live » a eu lieu à Dakar, dont les bénéfices ont été reversés au fonds de lutte contre le paludisme.
Le compositeur sénégalais Gou Ba participe à un projet continental visant à créer le premier opéra africain, baptisé Opéra du Sahel (il co-écrit la musique avec des compositeurs du Nigeria, de Guinée-Bissau et des Comores). Le projet, évalué à 6 millions de dollars, est financé par la Fondation Prince Claus des Pays-Bas. L'achèvement des travaux sur la musique de l'opéra est prévu pour juin 2006. La décision chorégraphique du futur spectacle a été confiée à la célèbre danseuse sénégalaise Germaine Acogny.
En décembre 2006, le prochain Festival mondial d'art négro-africain (FESMAN-3) s'ouvrira au Sénégal. Le coût de son organisation est estimé à 7,5 milliards de francs CFA (200 millions de dollars américains), soit 3 fois plus que le montant dépensé pour le 1er festival.
Théâtre.
L’art théâtral national moderne se forme sur la base d’une riche créativité traditionnelle. Il a été fortement influencé par le travail des griots qui mettaient en scène des performances d'improvisation. Le Sénégal a été l'un des premiers pays d'Afrique de l'Ouest à introduire le théâtre scolaire. L'école de théâtre française de U. Ponty, ouverte dans les années 1930 à Dakar, devient le centre de création du théâtre dramatique africain. Il forme non seulement des étudiants du Sénégal, mais aussi d'autres pays d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Côte d'Ivoire, Mali), qui deviendront plus tard des personnalités du théâtre. Dans les années 1950, un conservatoire de musique et d'art dramatique fonctionne à Dakar. Français.
En 1961, est créé l'Ensemble National du Ballet du Sénégal, dirigé par Maurice Sonar Senghor. La troupe part en tournée dans les pays d'Europe occidentale et se produit en 1965 et 1970 à Moscou. Des troupes de théâtre amateurs sont créées. Le premier théâtre professionnel est créé à Dakar en 1965 et porte le nom de « Théâtre du nom ». Daniel Sorano." Elle était également dirigée par M. S. Senghor. En plus des pièces d'auteurs locaux et des classiques étrangers, le théâtre a mis en scène Auditeur N.V. Gogol, et au « Théâtre nègre » (également situé dans la capitale) - une pièce de théâtre Ours A.P. Tchekhov. Dramaturges sénégalais - Amadou Cissé Dia, Abdou Anta Ka, Cheikh Ndao, metteurs en scène - R. Hermantier et autres.
Cinéma.
Son émergence est associée aux activités du « Groupe du cinéma africain », créé en 1955 par des étudiants sénégalais (P. Vieira, J. M. Kahn, R. Keristan et M. Sarre), formés à l'Institut du cinéma de Paris. Ils ont réalisé le premier documentaire sénégalais intitulé Africains sur la Seine(1955). Premier long métrage - Noir de...– a été réalisé par le réalisateur (également poète et romancier célèbre) Sembène en 1966. Le film est considéré comme l’un des premiers longs métrages africains, et Sembène est souvent appelé le « père du cinéma africain ». Il a également réalisé des films Émitaï (1971), brioche (1975), Seddo(1977), etc. Sembène effectue un stage au studio de cinéma du nom. Gorki des célèbres réalisateurs soviétiques Sergei Gerasimov et Mark Donskoy. En mai 2005, dans le cadre du Festival international de Cannes, il dirige une master class qui suscite un grand intérêt tant auprès des spécialistes que du public. Les autres réalisateurs sont B. De Bey, P. Vieira, U. Mbaye, A. Samba Makarama, B. Senghor, J. Diop Mambetti, T. Sow, M.J. Traoré. Un festival de films africains se tient à Dakar.
Presse, radio, télévision et Internet.
Publié en français :
– le quotidien national « Le Soleil », ainsi que les journaux indépendants « Le Matin » et « Sud Quotidien » (« Quotidien du Sud ») ;
– bulletin hebdomadaire gouvernemental « Journal Officiel de la République du Sénégal » - « Journal Officiel de la République du Sénégal », journal interafricain sur le sport et la culture « Zone II » (Zone II) ), le journal satirique Le Politicien ) et l'hebdomadaire catholique Afrique Nouvelle ;
- les journaux mensuels "Ouest Africain" (L"Ouest Africain - "African West"), "L"Unité Africaine - "Unité Africaine", l'organe imprimé du Parti Socialiste du Sénégal) et les magazines "Afrique" (Afrique - "Afrique"), les magazines illustrés "Bingo" et "Senegal d'Aujourd'hui", ainsi que les magazines socio-politiques et revue littéraire Ethiopiques, l'organe de presse du Parti démocratique sénégalais ;
– journaux parus à intervalles de quelques mois ou de manière irrégulière : Le Carrefour - « Carrefour », « Le Rénouveau » - « Renaissance », l'organe imprimé de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal), Muntu Afrique, « Fagaru » ( Fagaru - "Vigilance", l'organe imprimé du parti "Ligue Démocratique - Mouvement pour la Création du Parti du Travail") et la revue "Slaviste" (Le Slaviste - "Slaviste").
Sont publiés en langues locales: l'hebdomadaire "Sopi" (Sopi - traduit de la langue wolof signifie "Changement", l'organe imprimé du Parti démocratique sénégalais), le journal mensuel "Daan Doole" - "L'Ouvrier", l'organe imprimé du "Parti de l'Indépendance et du Travail") et le magazine "Taxaw" (Taxaw - "Get Up", l'organe imprimé du Parti National Démocratique association") et la revue bimensuelle "Gestu" (Gestu - "Recherche", l'organe imprimé du "Parti de l'Indépendance et du Travail").
L'agence de presse gouvernementale « Agence de Presse du Sénégal », APS (Agence de Presse Sénégalais, APS) est en activité depuis le 2 avril 1959. Le service public de radiodiffusion et de télévision « Radiodiffusion-Télévision Sénégalais, RTS » est en activité depuis 1972. Radio et les émissions de télévision sont diffusées en français, en arabe, en portugais et dans six langues locales. Le Sénégal possède l’un des réseaux Internet les plus développés du continent africain. Les services de télécommunications sont utilisés par 10 % de la population du pays (plus d'un million de personnes). En 2003, il y avait 225 000 internautes.
HISTOIRE
Période antique.
Les débuts de l'histoire du Sénégal sont marqués par la migration progressive des Wolof et des Sérères du nord-est vers le sud-ouest. Il semble que ces mouvements aient été provoqués par la pression des Berbères au nord et des Soninka à l’est. Les Tucouleurs sont apparues dans la vallée du fleuve Sénégal au IXe siècle. et y fonda l'état de Tekrur, aux Xe-XIVe siècles. occupé le territoire du Sénégal et du Mali modernes avec la capitale sur le site ville moderne Podor. Berbères, qui au 10ème siècle. s'installa sur une île dans le cours inférieur du fleuve Sénégal et convertit certains Tukuleurs à l'islam. A la fin du XIe siècle. Les tukuleurs musulmans sous la direction de la dynastie berbère almoravide ont participé à la défaite de l'État du Ghana. Au 14ème siècle l'expansion territoriale a commencé vers l'ouest de l'État du Mali, où régnait la dynastie islamisée Keita. Les Maliens ont capturé Tekrur et, au sommet de leur État, contrôlaient le cours supérieur des fleuves Sénégal et Faleme. L’expansion du Mali a contraint les Sérères non musulmans à se retirer dans la région de Kaolaka, où ils vivent encore aujourd’hui. Depuis le XVe siècle. Les Maures, résidents des régions du nord du Sénégal, ont joué un rôle important dans la propagation de l'islam. Au milieu du XVe siècle. le fils du pasteur tucouleur N "Diadian N" Dyai a mené la lutte wolof contre les envahisseurs tucouleurs et a unifié les zones situées entre le fleuve Sénégal et le cap Almadi dans l'état du Jolof. Commencé au 17ème siècle. la rivalité entre les différentes parties de cet État (Wolof, Kayor, Baol et Valo) a conduit à son effondrement. Aux XVIIIe et XIXe siècles, profitant de la fragmentation des Wolof, ils furent attaqués par les belliqueux émirats maures situés au nord du Sénégal. Aux XVe-XVIIIe siècles. Il y a eu un renforcement temporaire du pouvoir des dirigeants Tukuler, vassaux de l'une ou l'autre dynastie étrangère, mais l'effondrement de l'État du Jolof a signifié la fin de l'existence dans cette région de grandes formations étatiques créées sur une base tribale.
19ème siècle a été marquée par l’expansion coloniale française et la renaissance concomitante de l’Islam et sa propagation sur le territoire du Sénégal moderne. Au milieu du 19ème siècle. Tukuler al-Hajj Omar a déclenché une guerre de religion dans les régions du nord-est, mais après un affrontement avec les Français, il a été contraint de déplacer les opérations militaires plus à l'est. Une forme unique de protection contre les Français a été la conversion massive des Wolof occidentaux à l'islam, et après la capture du pays par les colonialistes français, la population de Casamance a suivi l'exemple des Wolof.
Période coloniale.
Avec son apparition au XVe siècle. Les Portugais ont commencé la pénétration des Européens dans les régions côtières du Sénégal. Les Portugais furent suivis par les Néerlandais, les Anglais et les Français. Fin du XVIIe siècle et tout le XVIIIe siècle. ont été marquées par la rivalité anglo-française pour le contrôle des côtes du Sénégal. Les Européens en exportaient principalement de la gomme arabique et des esclaves. Au début du 19ème siècle. Les cacahuètes sont devenues le principal produit d’exportation rentable. Jusqu'au milieu du 19ème siècle. Le contrôle français se limitait principalement à Saint-Louis, Gorée et Rufisque. Pendant le Second Empire français, sous le gouvernement du général Louis Federbe (1854-1865), puis pendant les 30 premières années de la Troisième République, les Français, utilisant la force, augmentèrent considérablement la superficie de leurs possessions coloniales. .
En 1895, le Sénégal a été déclaré colonie de la France, puis inclus dans l’Afrique occidentale française. centre administratif qu'est devenue la ville de Dakar en 1902.
Alors que la grande majorité de la population africaine du Sénégal était privée des droits humains fondamentaux, les habitants autochtones des villes de Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar, qui ont reçu le statut de communes, sont devenus l'objet de la politique française de « assimilation". La population de ces villes se vit accorder les droits des citoyens français, notamment le droit de participer aux élections d'un député au Parlement français, dont elle jouit en 1848-1852, puis sans interruption à partir de 1871. Le premier député africain du Parlement français L'Assemblée nationale était Blaise Diagne, qui en 1914-1934 représentait les intérêts du Sénégal. En 1879, un conseil général élu est créé pour les villes municipales. Son importance diminue lorsque, en 1920, des dirigeants de l'intérieur du Sénégal entrent dans sa composition et qu'il est rebaptisé conseil colonial. Malgré sa subordination à l'administration coloniale française, cet organisme a joué pendant l'entre-deux-guerres un rôle important dans la formation des hommes politiques locaux. Ainsi, l'un des hommes politiques sénégalais, le Dakarien Lamine Gay, élu en 1945 au parlement français, a réussi à obtenir l'abolition du travail forcé et la différence de statut entre les habitants des villes communales et le reste de la population du pays.
De 1946 à 1958, le Sénégal, comme les autres colonies françaises d'Afrique de l'Ouest, avait le statut de « territoire d'outre-mer » de la France, avec sa propre assemblée territoriale et membre du Parlement français, et progressivement de plus en plus de Sénégalais ont obtenu le droit de vote. À mesure que le nombre d'électeurs augmentait, Léopold Sédar Senghor commença à partir de 1948 un travail politique dans les zones rurales et créa un nouveau parti politique qui, à partir de 1951, sous divers noms, domina la vie politique du pays. Les positions d'une autre personnalité politique marquante de l'époque, Lamin Gay, qui s'appuyait principalement sur la population des villes communales, ont été mises à mal.
En 1958, après l'arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle, Senghor a appelé le peuple sénégalais à voter par référendum en faveur de la constitution de DeGaulle et à voter pour le statut d'autonomie au sein de la Communauté française. Ses opposants de gauche ont incité sans succès ses concitoyens à voter contre l’autonomie et pour l’indépendance immédiate. Au début de 1959, le Sénégal et l'ancien Soudan français formèrent la Fédération du Mali, qui devint indépendante en juin 1960 au sein de la Communauté française. En août de la même année, le Sénégal quitte la fédération et est reconnu comme État souverain.
Période de développement indépendant.
En décembre 1962, après l'arrestation du Premier ministre Mamadou Dia pour préparation de coup d'État, L. Senghor introduit une forme de gouvernement présidentiel dans le pays. Durant sa présidence, Senghor a rarement eu affaire à des forces d’opposition organisées. En 1968, il parvient à neutraliser une grève générale menée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Plus tard, cette plus grande association syndicale a été placée sous le contrôle du parti au pouvoir. Le 31 décembre 1980, Senghor démissionne. Son successeur à la présidence fut Abdou Diouf, Premier ministre depuis 1970. En juillet 1981, Diouf envoie des troupes sénégalaises en Gambie pour réprimer une tentative de coup d’État. Peu de temps après, un accord fut conclu entre les deux États pour créer la confédération sénégambie, qui entra en vigueur en février 1982. En 1989, cet accord prit fin.
Bien qu'A. Diouf et le Parti Socialiste du Sénégal aient obtenu des succès significatifs aux élections présidentielles et parlementaires de 1983 et 1988, les groupes d'opposition ont dénoncé des abus de la part de leurs rivaux pendant la campagne électorale, et les élections de 1988 ont été accompagnées de troubles majeurs. En 1989, le parti au pouvoir a fait un certain nombre de concessions à l'opposition, mais les opposants au régime au pouvoir ont continué à se battre pour le droit d'accès aux médias d'État. Bien que la Constitution ait été amendée en 1991 et que la loi électorale ait été révisée, les élections présidentielles de 1993 ont été à nouveau accompagnées de troubles civils. Néanmoins, A. Diouf a été réélu président pour un nouveau mandat de sept ans. Lors des élections législatives de 1998, le Parti socialiste du Sénégal au pouvoir a remporté la majorité des sièges (93 sièges), suivi par le Parti démocratique du Sénégal (23 sièges) et le Mouvement pour le renouveau démocratique (11 sièges). D'une manière générale, le Sénégal mène une politique interétatique et intérieure apaisée et déploie des efforts visant au redressement financier du pays et à l'élimination de la dette extérieure et intérieure.
Le Sénégal au 21ème siècle
Les élections présidentielles de 2000 se sont déroulées en deux tours. Parmi les six principaux candidats, le candidat du Parti socialiste du Sénégal (PPS) Abdou Diouf (41,33% des voix) et le candidat du bloc d'opposition des partis Alternative 2000 Abdoulaye Wade (30,97%) se sont qualifiés pour le second tour en mars. 19 voix), briguant ce poste pour la 5ème fois. Wad a gagné, pour lequel 969,33 mille voix ont été exprimées (58,49 %), Diouf a obtenu 41,51 % des voix (687,97 mille personnes). Le transfert pacifique du pouvoir dans le cadre des normes constitutionnelles a permis de maintenir la stabilité politique dans le pays.
En 2000, Wade a présenté le Plan Omega pour le développement de l'Afrique, qui ressemblait à bien des égards au Partenariat du Millénaire pour le Programme de relance de l'Afrique (MAP), élaboré conjointement au cours de la même année par les présidents sud-africains (T. Mbeki). ), l'Algérie (A. Bouteflika) et le Nigeria (O. Obasanjo). Le 11 juillet 2001 à Lusaka (Zambie), lors du prochain sommet de l'OUA, ces deux programmes ont été approuvés et regroupés dans un document appelé NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique).
La nouvelle constitution, adoptée le 7 janvier 2001, a aboli le Sénat. Les élections législatives prévues pour 2003 ont eu lieu en avance le 29 avril 2001. Partis soutenant le président Wade (Ligue Démocratique - Mouvement pour la Création du Parti Travailliste (ML - DSPT), Mouvement pour le Socialisme et l'Unité (DSU), etc. ), réunis dans une coalition appelée « Sopi » (traduit de la langue wolof - « changement »). La coalition a remporté une victoire écrasante : 89 des 120 sièges de l'Assemblée nationale. L'Alliance des Forces du Progrès (ASP - un bloc électoral de partis dirigé par le Parti Socialiste du Sénégal) a obtenu 11 sièges, et elle-même en a remporté 10.
Le Sénégal a réussi à maintenir la stabilité politique. Le 30 décembre 2004, un accord de paix est signé entre le gouvernement du Sénégal et le MFDC (Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance). A l'ordre du jour figurent les problèmes du déminage en Casamance, ainsi que l'élimination des armes légères illégales (il y en a jusqu'à 6 000 unités - début 2005).
Le gouvernement Wada continue de poursuivre une politique de libéralisation économique. Le Sénégal a créé le système d’incitations fiscales le plus favorable aux investisseurs étrangers en Afrique de l’Ouest. Un conseil présidentiel d'investissement a été créé pour développer le programme d'investissement. En 2002, les investissements français dans l'économie du Sénégal s'élevaient à 35 millions d'euros (dans l'économie du Mali - 7 millions, de la Guinée - 5 millions). En 2004, le niveau de l'impôt sur les sociétés a été réduit de 33 à 25 pour cent. Des réformes sont en cours dans le domaine de la législation douanière pour promouvoir le développement des échanges commerciaux. En janvier 2005, Wad a annoncé l'intention du gouvernement de créer prochainement une commission chargée de réformer la législation foncière. Une grande attention est accordée au développement du secteur des télécommunications. Une campagne est en cours pour lutter contre la bureaucratie et la corruption. Selon une étude menée par la Banque mondiale (BM) en 2004, les procédures bureaucratiques d'enregistrement des entreprises au Sénégal prennent moins de temps que dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne. En 2005, 250 entreprises françaises ont ouvert leurs bureaux dans le pays. En 2005, le Sénégal se classait au 78ème rang (sur 159) dans le classement de Transparency International en matière de corruption. Des programmes de développement culturel et sportif sont mis en œuvre (en 2005, le gouvernement a alloué 1,6 milliard de francs CFA pour assurer la participation des athlètes sénégalais aux compétitions internationales).
La 5e Conférence annuelle sur le développement mondial a eu lieu à Dakar du 24 au 26 janvier 2005. Le forum a abordé les questions des relations et de l'influence mutuelle entre les pays développés et les pays en développement.
En raison de la nécessité de financer un programme gouvernemental destiné à aider les personnes touchées par les inondations dans certaines régions du pays à l'été 2005, Wade a reporté les élections législatives prévues pour 2006. L'opposition a accusé le président de ne pas vouloir abandonner le pouvoir. Il a également été critiqué pour ses fréquents voyages (essentiellement à l'étranger), au cours desquels il a passé plus d'un an sur les 4 années de son pouvoir (il s'est rendu seul en France 28 fois au cours de ces années). Cependant, le président Abdoulaye Wade a été réélu en mars 2007.
Cependant, lors des élections de 2012, Wade a été battu au deuxième tour de l'élection présidentielle (au premier tour, il était en tête avec 34,8 % des voix), perdant face à l'ancien Premier ministre, fondateur et président de l'Alliance pour le Parti de la République, Macky Sell. Les principaux responsables politiques de l'opposition et les organisations publiques du Sénégal se sont prononcés en faveur de cette dernière.
Le Sénégal reste l'une des démocraties les plus stables d'Afrique.
Lioubov Prokopenko





Littérature:
Histoire récente Afrique. M., « Sciences », 1968
Kashin Yu.S. Sénégal. M., « Pensée », 1973
Clark, A.F., et Phillips, L.C. Dictionnaire historique du Sénégal. 2e éd. Metuchen, New Jersey, Scarecrow Press, 1994
Barry Boubacar. Aspects internationaux du conflit armé au sud du Sénégal. M., Maison d'édition de l'Institut d'études africaines de l'Académie des sciences de Russie, 1999
Sadovskaïa L.M. Dirigeants du Sénégal et de la Tunisie. M., Maison d'édition de l'Institut d'études africaines de l'Académie des sciences de Russie, 2000
Le monde de l'apprentissage 2003, 53e édition. L.-N.Y. : Europa Publications, 2002
Bellito, M. Une histoire du Sénégal et de ses entreprises publiques. Paris, L'Harmattan, 2002
Afrique au sud du Sahara. 2004. L.-N.Y. : Europa Publications, 2003
Où vas-tu, Afrique ? Etudes historiques et politiques
Pays africains et Russie. Annuaire. M., Maison d'édition de l'Institut d'études africaines de l'Académie des sciences de Russie, 2004
SÉNÉGAL
République du Sénégal, un État d'Afrique de l'Ouest ayant accès à l'océan Atlantique. Elle est limitrophe au nord avec la Mauritanie, à l'est avec le Mali, au sud avec la Guinée et la Guinée-Bissau. La frontière nord du pays longe le fleuve Sénégal et la frontière orientale coïncide presque avec le lit de l'affluent sénégalais, le fleuve Falémé. Depuis la côte, le territoire du petit État de Gambie s'étend profondément au Sénégal dans le cours inférieur du fleuve Gambie. Superficie 196,7 mille mètres carrés. km, population 9,88 millions d'habitants (1998). La capitale est Dakar (1,5 million d'habitants, avec une banlieue d'environ 2 millions d'habitants). Dans le passé, c'était une colonie de la France, faisant partie de l'Afrique occidentale française. En 1960, le Sénégal accède à l'indépendance, mais entretient des relations économiques étroites avec l'ancienne métropole.



Nature. Le Sénégal est un pays plat. L'altitude moyenne absolue de la surface est de 60 m, ce n'est que dans l'extrême sud-est qu'elle s'élève à environ 150-400 m au-dessus du niveau de la mer, et dans les contreforts du massif du Futa Djallon, c'est la plus grande altitude. point haut pays - 581 m d'altitude La majeure partie du Sénégal est confinée à la zone de savane. Seules les régions du nord du pays comprennent la zone sahélienne (savane désertique). Au sud-ouest, dans le cours inférieur du fleuve Casamance, des forêts mixtes de feuillus et sempervirentes ont été préservées. Le littoral au nord de Dakar est aplati, tandis qu'au sud il est plus découpé. Voici les estuaires marécageux des fleuves Sine, Saloum et Casamance. La plupart grandes rivières pays - le Sénégal, la Gambie et la Casamance - ont un flux constant. Pendant la saison sèche, le fleuve Sénégal n'est navigable que jusqu'à la ville de Podor, et pendant la saison des pluies, il est navigable dans tout le pays. Les rivières restantes s'assèchent pendant la saison sèche. Au nord-est du pays se trouve un grand lac Gyor.
Climat Le Sénégal est un pays subéquatorial, passant d'aride au nord (250 à 300 mm de précipitations par an) à humide au sud (jusqu'à 1 500 mm de précipitations). La saison des pluies dans le nord dure de juin à septembre et dans le sud de mai à novembre (lorsque le transport aérien du sud-ouest au nord-est prédomine). Pendant la longue saison sèche, le vent sec Harmattan souffle constamment du nord-est, du désert du Sahara.
Population et société. La population du Sénégal se compose de trois grands groupes ethnolinguistiques : les Sénégambiens, les Fulbé et les Mandé. Le groupe sénégambien (65 % de la population du pays) comprend les peuples Wolof (le plus nombreux), Sérère, Lébu et Diola. On pense que les Peuls sont installés dans toute l’Afrique de l’Ouest où les conditions sont propices au pâturage. Initialement, ils occupaient la vallée du fleuve Sénégal et les zones de savane au sud du méandre du fleuve, et les Peuls descendaient du mélange du peuple local Toukouler avec les conquérants berbères. Les Fulbé représentent environ 25 % de la population du Sénégal. Les peuples Malinké et Soninké (Sarakol) représentent 7% de la population. Ils constituent le noyau du groupe Mandé. Dans le passé, Malinka et Soninka ont joué un rôle de premier plan dans agriculture et la vie politique de l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, il y a 1% de Maures et 2% d'Européens et de Libanais. Des Européens, principalement des Français, vivent à Dakar.


Il n’y a pas de problème linguistique particulier au Sénégal. Parce que la langue wolof est apparentée aux langues sérère et lébu et que les personnes parlant ces trois langues se comprennent, le wolof est de plus en plus utilisé comme langue de communication interethnique. Le sérère est une forme archaïque de la langue peule, également largement parlée dans le pays. La langue officielle est le français. Au Sénégal, les différences religieuses jouent un rôle bien plus important que les différences ethniques. Tant la majorité musulmane (94 % de la population en 1988) que la minorité chrétienne (4 %) s'efforcent d'augmenter le nombre de leurs coreligionnaires. La secte mouride de l'ordre musulman de Kadriya, qui prône la renaissance de l'islam originel, travaille activement à la diffusion de l'islam. Ses adeptes mettent l'accent sur la solitude et le travail acharné. La plupart des adeptes des mourides sont des paysans wolof engagés dans la culture de l'arachide. Ils constituent une partie riche de la société sénégalaise et jouissent d’une influence politique importante. 25 % des chrétiens, catholiques pour la plupart, sont européens. Distribution Enseignement chrétien Les Sénégambiens vivant en ville sont activement impliqués. L'un des premiers résultats de l'islamisation de la population fut l'émergence d'une sorte de système de castes dans la société, qui assignait par exemple les forgerons et les musiciens aux niveaux inférieurs de la hiérarchie sociale. Au fur et à mesure de la modernisation du pays, le système des castes a progressivement cédé la place à la division de la société en différentes couches sociales.
Système politique. Les institutions politiques modernes du Sénégal ont été créées par Léopold Sédar Senghor, président du pays de 1960 à 1980. En juin 1960, la Fédération du Mali, qui comprenait le Sénégal, déclarait son indépendance politique. En août de la même année, la fédération se dissout et le Sénégal devient un État indépendant. Le poste de premier président du pays a été occupé par Senghor et celui de premier ministre par Mamadou Dia. Après que Senghor ait vaincu son adversaire Dia lors de la crise politique de décembre 1962, un système de gouvernement présidentiel fut introduit au Sénégal en mars 1963. En 1970, le poste de Premier ministre a été rétabli, mais désormais le Premier ministre est subordonné au président. Lorsque Senghor a démissionné en décembre 1980, son successeur à la présidence était Abdou Diouf, qui avait été Premier ministre du pays pendant 10 ans. Diouf a ensuite été élu président en 1983, 1988 et 1993. Selon la constitution sénégalaise de 1963, le président et les députés sont élus au suffrage universel direct. Selon les amendements constitutionnels de 1991, chapitre pouvoir exécutif- le président est considéré comme élu à la majorité des voix si au moins un quart du corps électoral est présent. Le président est élu pour un mandat de sept ans et n'a pas le droit de remplir plus de deux mandats. Les élections de 140 députés au parlement monocaméral (Assemblée nationale) ont lieu tous les cinq ans. La moitié des députés au plus haut niveau corps législatif Les Sénégalais sont élus lors d'élections générales directes au scrutin proportionnel dans chacune des 10 régions du pays (Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda, Lougas, Saint-Louis, Tambacounda, Thiès et Ziguinchor), et la moitié au scrutin majoritaire. En 1991, la Cour suprême était composée de la Cour constitutionnelle, Conseil d'État et la Cour suprême d'appel. La principale formation politique est le Parti Socialiste du Sénégal (SPS). Le parti a été créé par Senghor en 1948 et est resté longtemps sous l’influence de son fondateur après sa démission de la présidence. Jusqu’en 1976, le parti s’appelait l’Union Progressiste du Sénégal (PUS). L'Union des forces de droite est un parti de coalition qui, dans ses activités, prend en compte les intérêts de nombreux clans et factions. Le bastion du parti est constitué par les zones de culture de l'arachide. Ils sont situés à proximité des villes de Thiès, Diourbel et Kaolack, où l'influence des mourides est forte. Les principales forces d'opposition (outre les partis d'opposition) sont le mouvement séparatiste terroriste de la région Casamance et les étudiants de l'Université de Dakar. Du milieu des années 1960 au milieu des années 1970, lorsque Senghor a permis aux organisations politiques d’opposition de fonctionner, le Sénégal était un État à parti unique. Il existe actuellement 19 partis politiques enregistrés dans le pays. Aux élections législatives de 1998, le SPS a remporté (93 sièges), le Parti démocratique libéral du Sénégal (DPS, 23 sièges) est arrivé en deuxième position, suivi du Mouvement du renouveau démocratique (11 sièges). La Ligue Démocratique - le Mouvement pour la Création du Parti Travailliste (ML - DSPT), le Parti de l'Indépendance et du Travail du Sénégal (PNTS), le Mouvement pour le Socialisme et l'Unité et le Rassemblement National Démocratique - ont une certaine influence dans la vie politique. du pays. Dans police étrangère Le Sénégal vise la France, le monde musulman et les pays africains francophones. La relation privilégiée entre le Sénégal et la France est garantie par de nombreux traités et accords ; le Sénégal reçoit une aide financière importante de la France. Le Sénégal est membre de l'ONU, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Organisation de l'unité africaine, de la Banque islamique de développement, de l'Organisation de la Conférence islamique et membre associé de l'UE.
Économie. Le Sénégal est un pays agricole, produisant traditionnellement du mil et du riz pour la consommation intérieure et des arachides pour l'exportation. Malgré le fait qu'en 1994 près de 75 % de la population économiquement active était employée dans l'agriculture, la part de ce secteur ne représentait que 23 % du PIB. La plus grande part du PIB provenait du secteur des services, suivi du secteur minier et manufacturier. Ajusté du niveau des prix intérieurs, c'est-à-dire Sur la base de la parité de pouvoir d'achat, le PIB du Sénégal en 1995 était de 14,5 milliards de dollars, soit 1 600 dollars par habitant. Pendant plusieurs décennies, le taux de croissance économique moyen était inférieur à 3 %. Après la dévaluation du franc CFA en 1994 et l'introduction de mesures de libéralisation de l'économie, sa croissance réelle a été de 4,5% en 1995. Le revenu moyen des citadins est supérieur à celui des ruraux, et celui des Européens est bien supérieur à celui des ruraux. celui des Africains. La population des vallées des fleuves Sénégal et Casamance vit particulièrement mal. Bien que le Sénégal soit l'un des deux pays les plus industrialisés de l'Afrique occidentale française, ainsi que son centre administratif, commercial et industriel, il est contraint d'importer la plupart des produits manufacturés dont il a besoin. Ce sont principalement des Africains qui ont servi dans la fonction publique, mais les Français occupent toujours un certain nombre de postes de direction importants et travaillent dans des domaines nécessitant une formation professionnelle élevée. Les grandes sociétés commerciales et de nombreuses industries sont toujours détenues ou contrôlées par les Français. Le créneau économique des immigrants libanais est l'intermédiation. En outre, ils contrôlent le commerce de gros et de nombreuses sociétés commerciales de taille moyenne.
Agriculture et pêche. Même si la culture de l'arachide a diminué, elle reste la principale culture de rente du pays. Cependant, sa production annuelle moyenne est passée de 1 million de tonnes dans les années 1970 à 800 000 tonnes dans les années 1990. L'augmentation de la production de sucre, de riz et surtout de coton (40 000 tonnes en 1996) a contribué à atténuer le problème de l'instabilité des cultures d'arachide et des fortes fluctuations des prix mondiaux de cette culture. La canne à sucre est cultivée au nord dans la région de Saint-Louis. Depuis 1971, la culture fruitière orientée vers le marché (principalement les agrumes) se développe avec succès. Les céréales cultivées sont le sorgho, le maïs et le riz (ce dernier dans les plaines inondables des fleuves Sénégal et Casamance), en outre, le manioc, l'igname et le palmier à huile sont cultivés. La pêche maritime s'est développée de manière si dynamique qu'elle a commencé à rivaliser en importance économique avec la production d'arachides. Environ. 270 tonnes de poisson. La pêche dans les eaux côtières du Sénégal est réglementée par des accords commerciaux avec l'UE et plusieurs pays africains. Les bovins, ovins et caprins sont élevés pour la consommation domestique. Approximativement valable au Sénégal. 300 entreprises industrielles. Les principales industries sont l'alimentation, l'éclairage, la chimie, l'exploitation minière et le ciment (environ 400 000 tonnes de ciment sont produites par an). La base de l'industrie alimentaire est la production de beurre de cacahuète (96 000 tonnes par an). De plus, Dakar dispose d'usines de transformation du poisson qui congèlent et conservent le poisson, principalement le thon. Depuis la fin des années 1960, les phosphorites représentent une part importante des revenus d’exportation. Leur production est d'env. 2,5 millions de tonnes par an.
Commerce intérieur et transports. Le réseau routier et ferroviaire le plus dense se trouve à l’ouest et au centre du pays. La ligne ferroviaire s'étend à travers le pays d'ouest en est et relie le Sénégal à la capitale du Mali, Bamako. En 1993, les travaux d'agrandissement du port de Dakar, le plus grand port de la côte ouest-africaine, ont été achevés. En 1995 et 1996, le volume de marchandises transitant par ce port a augmenté de 16 %. Les ports moins importants sont Khaolack, Saint-Louis et Ziguinchor. Dakar possède un important aéroport international et des projets sont en cours pour en construire un autre à proximité de la capitale. La construction du barrage de Jama a permis de prolonger par quatre la partie navigable du fleuve Sénégal.
Échange international. Le principal partenaire commercial du Sénégal est la France, qui représentait 34% des importations en 1991 et env. 32% des exportations. En 1991, la valeur des importations s'élevait à près de 1,1 milliard de dollars et celle des exportations à 683 millions de dollars. Le déficit commercial chronique a été couvert par des reports de paiement de la dette (sous réserve de la mise en œuvre des programmes du FMI), ainsi que par des annulations de dettes envers les créanciers occidentaux. ainsi que par le biais de prêts et de subventions de la France, du FMI et de la Banque mondiale. En 1986, les produits de la mer sont devenus le principal produit d'exportation, devant les arachides ; en 1994, ils représentaient 31 % de la valeur de toutes les exportations. Les produits pétroliers, les produits chimiques et les phosphorites occupent également une place importante dans les exportations. Les principaux produits importés sont la nourriture, les équipements industriels, le pétrole, les médicaments et les voitures.
Banque, circulation monétaire et budget. Le Sénégal fait partie de la zone franc française et est membre de l’Union monétaire ouest-africaine. La monnaie, le franc CFA, est rattachée au franc français. Son émission est contrôlée par la Banque Centrale, ainsi que par les pays africains situés dans la zone du franc CFA et dans la zone de couverture de la France. Afin d'améliorer la compétitivité économique et de stimuler la croissance de la production, le franc CFA a été dévalué de 50 % en 1994. La politique de crédit est déterminée par la Banque centrale du Sénégal en collaboration avec un comité gouvernemental spécial. Les activités de banque commerciale sont exercées par quatre banques locales, dont une partie du capital social est détenue par des banques des États-Unis et d'Europe occidentale, ainsi que par une banque d'État. Le budget de l'État du Sénégal pour 1997 prévoyait des recettes de 817 millions de dollars et des dépenses de 869 millions de dollars. Une part importante des recettes publiques provient du tourisme étranger (170 millions de dollars en 1996). Le programme d'investissement public approuvé en 1997 prévoit l'allocation de 174 millions de dollars sur une période de trois ans pour réparer les autoroutes, les systèmes d'approvisionnement en eau urbains et d'autres éléments d'infrastructure. La construction d'équipements est financée principalement avec l'aide de la France, de l'UE, de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale et de divers fonds arabes.
Culture. Le système éducatif sénégalais est calqué sur celui français. Certes, depuis 1978, l'étude de la langue wolof a été introduite dans le programme des institutions pédagogiques. Il existe une forte proportion d’enfants qui ne reçoivent aucune éducation. Ainsi, en 1992, seuls 58 % des enfants de l'âge correspondant fréquentaient l'école primaire. Seul un tiers de la population adulte est alphabétisé. En 1992, il y avait environ. 725 mille enfants, dans le secondaire et technique - 191 mille, dans l'enseignement supérieur les établissements d'enseignement- D'ACCORD. 22 mille. La plus grande université du pays est l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans le cadre de cette université se trouve un institut de renommée mondiale Recherche basique Afrique noire. En 1990, l'Université de Saint-Louis ouvre ses portes. Les représentants de l'ancienne génération de l'intelligentsia sénégalaise, opposants à la politique d'assimilation, ont commencé à développer la théorie de la négritude, basée sur des idées sur le caractère unique de la race noire et sa contribution à la civilisation mondiale, même dans les années d'avant-guerre. . Parmi les humanitaires et hommes politiques de renom figurent : les historiens Cheikh Anta Diop et Lye Abdoulaye, les politologues Mamadou Dia et Majmut Diop, les poètes Léopold Sédar Senghor et David Diop, les écrivains Abdoulaye Saji, Ousmane Sosé, l'écrivain et folkloriste Birago Diop. Le premier écrivain sénégalais à atteindre une renommée internationale fut l'écrivain Sembène Ousmane, qui deviendra plus tard un réalisateur prolifique. Beaucoup le considèrent comme le père du cinéma africain. Les bijoutiers wolof sont célèbres pour leurs objets en or et en argent. Le pays maintient des traditions de chant et de danse qui incorporent des éléments de la musique populaire occidentale.
Histoire. Les débuts de l'histoire du Sénégal sont marqués par la migration progressive des Wolof et des Sérères du nord-est vers le sud-ouest. Il semble que ces mouvements aient été provoqués par la pression des Berbères au nord et des Soninka à l’est. Les Tuculers sont apparus dans la vallée du fleuve Sénégal au IXe siècle. et y fonda l'état de Tekrur, qui aux Xe-XIVe siècles. a occupé le territoire du Sénégal et du Mali modernes avec sa capitale sur le site de la ville moderne de Podor. Berbères, qui au 10ème siècle. s'installa sur une île dans le cours inférieur du fleuve Sénégal et convertit certains Tukulers à l'islam. A la fin du XIe siècle. Les tukulers musulmans sous la direction de la dynastie berbère almoravide ont participé à la défaite de l'État du Ghana. Au 14ème siècle l'expansion territoriale a commencé vers l'ouest de l'État du Mali, où régnait la dynastie islamisée Keita. Les Maliens ont capturé Tekrur et, au sommet de leur État, contrôlaient le cours supérieur des fleuves Sénégal et Faleme. L’expansion du Mali a contraint les Sérères non musulmans à se retirer dans la région de Kaolaka, où ils vivent encore aujourd’hui. Depuis le XVe siècle. Les Maures, résidents des régions du nord du Sénégal, ont joué un rôle important dans la propagation de l'islam. Au milieu du XVe siècle. le fils du pasteur Toukouler N "Diadian N" Dyay a mené la lutte wolof contre les envahisseurs Toukouler et a unifié les zones situées entre le fleuve Sénégal et le cap Almadi dans l'État du Jolof. Commencé au 17ème siècle. la rivalité entre les différentes parties de cet État (Wolof, Kayor, Baol et Valo) a conduit à son effondrement. Aux XVIIIe et XIXe siècles, profitant de la fragmentation des Wolof, ils furent attaqués par les belliqueux émirats maures situés au nord du Sénégal. Aux XVe-XVIIIe siècles. Il y a eu un renforcement temporaire du pouvoir des dirigeants Tukuler, vassaux de l'une ou l'autre dynastie étrangère, mais l'effondrement de l'État du Jolof a signifié la fin de l'existence dans cette région de grandes formations étatiques créées sur une base tribale. 19ème siècle a été marquée par l’expansion coloniale française et la renaissance concomitante de l’Islam et sa propagation sur le territoire du Sénégal moderne. Au milieu du 19ème siècle. Tukuler al-Haj Omar a déclenché une guerre de religion dans les régions du nord-est, mais après un affrontement avec les Français, il a été contraint de déplacer les opérations militaires plus à l'est. Une forme unique de protection contre les Français a été la conversion massive des Wolof occidentaux à l'islam, et après la capture du pays par les colonialistes français, la population de Casamance a suivi l'exemple des Wolof. Avec son apparition au XVe siècle. Les Portugais ont commencé la pénétration des Européens dans les régions côtières du Sénégal. Les Portugais furent suivis par les Néerlandais, les Anglais et les Français. Fin du XVIIe siècle et tout le XVIIIe siècle. ont été marquées par la rivalité anglo-française pour le contrôle des côtes du Sénégal. Les Européens en exportaient principalement de la gomme arabique et des esclaves. Au début du 19ème siècle. Les cacahuètes sont devenues le principal produit d’exportation rentable. Jusqu'au milieu du 19ème siècle. Le contrôle français se limitait principalement à Saint-Louis, Gorée et Rufisque. Durant le Second Empire français, sous le gouvernement du général Louis Federbe (1854-1865), puis pendant les 30 premières années de la Troisième République, les Français, usant de la force, augmentèrent considérablement la superficie de leurs possessions coloniales. En 1895, le Sénégal fut déclaré colonie de la France, puis inclus dans l'Afrique occidentale française, dont le centre administratif était la ville de Dakar en 1902. Alors que la grande majorité de la population africaine du Sénégal était privée des droits humains fondamentaux, les habitants autochtones des villes de Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar, qui ont reçu le statut de communes, sont devenus l'objet de la politique française de « assimilation". La population de ces villes se voit accorder les droits des citoyens français, notamment le droit de participer aux élections d'un député au Parlement français, dont elle jouit en 1848-1852, puis de manière continue à partir de 1871. Le premier député africain du Parlement français L'Assemblée nationale était Blaise Diagne, qui en 1914-1852 1934 représentait les intérêts du Sénégal. En 1879, un conseil général élu est créé pour les villes municipales. Son importance diminue lorsque, en 1920, des dirigeants de l'intérieur du Sénégal entrent dans sa composition et qu'il est rebaptisé conseil colonial. Malgré sa subordination à l'administration coloniale française, cet organisme a joué pendant l'entre-deux-guerres un rôle important dans la formation des hommes politiques locaux. Ainsi, l'un des hommes politiques sénégalais, le Dakarien Lamine Gay, élu en 1945 au parlement français, a réussi à obtenir l'abolition du travail forcé et la différence de statut entre les habitants des villes communales et le reste de la population du pays. En 1946-1958, le Sénégal, comme les autres colonies françaises d'Afrique de l'Ouest, avait le statut de « territoire d'outre-mer » de la France avec sa propre assemblée territoriale et un député au parlement français, et progressivement de plus en plus de Sénégalais ont obtenu le droit de vote. À mesure que le nombre d'électeurs augmentait, Léopold Sédar Senghor commença à partir de 1948 un travail politique dans les zones rurales et créa un nouveau parti politique qui, à partir de 1951, sous divers noms, domina la vie politique du pays. Les positions d'une autre personnalité politique marquante de l'époque, Lamin Gay, qui s'appuyait principalement sur la population des villes communales, ont été mises à mal. En 1958, après l'arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle, Senghor a appelé le peuple sénégalais à voter par référendum en faveur de la constitution de DeGaulle et à voter pour le statut d'autonomie au sein de la Communauté française. Ses opposants de gauche ont incité sans succès ses concitoyens à voter contre l’autonomie et pour l’indépendance immédiate. Au début de 1959, le Sénégal et l'ancien Soudan français formèrent la Fédération du Mali, qui devint indépendante en juin 1960 au sein de la Communauté française. En août de la même année, le Sénégal quitte la fédération et est reconnu comme État souverain. En décembre 1962, après l'arrestation du Premier ministre Mamadou Dia pour préparation de coup d'État, L. Senghor introduit une forme de gouvernement présidentiel dans le pays. Durant sa présidence, Senghor a rarement eu affaire à des forces d’opposition organisées. En 1968, il parvient à neutraliser une grève générale menée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. Plus tard, cette plus grande association syndicale a été placée sous le contrôle du parti au pouvoir. Le 31 décembre 1980, Senghor démissionne. Son successeur à la présidence fut Abdou Diouf, Premier ministre depuis 1970. En juillet 1981, Diouf envoie des troupes sénégalaises en Gambie pour réprimer une tentative de coup d’État. Peu de temps après, un accord fut conclu entre les deux États pour créer la confédération sénégambie, qui entra en vigueur en février 1982. En 1989, cet accord prit fin. Bien qu'A. Diouf et le Parti Socialiste du Sénégal aient obtenu des succès significatifs aux élections présidentielles et parlementaires de 1983 et 1988, les groupes d'opposition ont dénoncé des abus de la part de leurs rivaux pendant la campagne électorale, et les élections de 1988 ont été accompagnées de troubles majeurs. En 1989, le parti au pouvoir a fait un certain nombre de concessions à l'opposition, mais les opposants au régime au pouvoir ont continué à se battre pour le droit d'accès aux médias d'État. Bien que la Constitution ait été amendée en 1991 et que la loi électorale ait été révisée, les élections présidentielles de 1993 ont été à nouveau accompagnées de troubles civils. Néanmoins, A. Diouf a été réélu président pour un nouveau mandat de sept ans. Lors des élections législatives de 1998, le Parti socialiste du Sénégal au pouvoir a remporté la majorité des sièges (93 sièges), suivi par le Parti démocratique du Sénégal (23 sièges) et le Mouvement pour le renouveau démocratique (11 sièges). D'une manière générale, le Sénégal mène une politique interétatique et intérieure apaisée et déploie des efforts visant au redressement financier du pays et à l'élimination de la dette extérieure et intérieure.
LITTÉRATURE
Kashin Yu.S. Sénégal. M., 1973 Kuznetsov L.M. Au point le plus occidental de l'Afrique. Dakar. M., 1980
Encyclopédie de Collier. - Société ouverte. 2000 .
Synonymes:Voyez ce qu'est « SÉNÉGAL » dans d'autres dictionnaires :
République du Sénégal, état en 3. Afrique. Moderne le nom de l'État du Sénégal et du fleuve du même nom qui coule à son nord. frontière remonterait apparemment au nom du royaume de Sangana, mentionné par un géographe arabe du XIe siècle. Al-Bakri. Au coeur... ... Encyclopédie géographique
Sénégal- Le Sénégal. Des écoliers de Dakar, 1976. SÉNÉGAL (République du Sénégal), État d'Afrique de l'Ouest, baigné à l'ouest par l'océan Atlantique. Superficie 196,2 mille km2. Population 7,9 millions d'habitants, principalement Wolof, Fulbé, Sérère, Toucouleur, Diola et... Dictionnaire encyclopédique illustré
Nature et géographie du Sénégal
Le Sénégal est un pays situé en Afrique de l’Ouest et bordé respectivement au nord, à l’est et au sud par la Mauritanie, le Mali, la Guinée et la Guinée-Bissau. À l'ouest, ce pays est baigné par l'océan Atlantique. La majeure partie du territoire du pays est constituée de plaines ; il y a des collines importantes uniquement dans le sud-est et le sud-ouest du pays, et même celles-ci ne dépassent pas 500 mètres. Au nord du pays se trouve le Sahel semi-désertique, avec une végétation clairsemée sous forme d'arbustes et de graminées.
La superficie totale du Sénégal est de 196 200 km2. Il n'existe que trois grandes villes : Khaolack, Thiès et Dakar, cette dernière étant la capitale du Sénégal.
Population du Sénégal
Le pays compte 9,4 millions d'habitants, dont 98% sont membres du groupe Niger-Congo. Il y a aussi environ 50 000 Arabes, 20 000 Français et 15 000 Libanais vivant dans le pays.
Religion du Sénégal
En termes de religion, la majorité absolue (90 %) est occupée par des musulmans sunnites, les 10 % restants étant répartis entre païens et chrétiens dans un rapport de 6 : 4, respectivement.
Langues du Sénégal
Quant à la langue, la langue officielle est Français, mais dans le secteur du tourisme, l'anglais est plus courant. Un grand nombre de résidents parlent français, allemand et Langues anglaises; Également dans certaines régions, les langues pular, wolof, tukuler et quelques autres sont courantes.
Monnaie du Sénégal
La monnaie principale ici est le franc CFA, qui équivaut à environ un franc français.
Climat du Sénégal
La température de l'air dans toutes les régions est à peu près la même et varie de +23° à +28°. La saison des pluies dure généralement de juillet à octobre. Le sud de la côte atlantique est la zone la plus humide, avec jusqu'à 2 000 mm de précipitations par an. Précipitation
Fêtes nationales du Sénégal
La principale fête nationale du pays est le Jour de l'Indépendance, célébré le 4 avril.
Sites touristiques du Sénégal
Le Sénégal, selon les normes africaines, est un pays très calme. Le symbole national de ce pays est le baobab (ces arbres sont protégés par la loi ; il est interdit de les abattre et de grimper dessus sans autorisation particulière). Il existe un grand nombre de plats à base de cette plante, mais son jus est considéré comme le plus délicieux. La capitale du pays (Dakar) jouit d'un climat frais et stable et constitue l'un des meilleurs centres touristiques d'Afrique. Le centre-ville est limité à trois rues et regorge de restaurants, de boutiques et de clubs, ce qui en fait un bon endroit pour flâner. Les principales attractions de la capitale sont les musées : Musée historique, d'art, maritime et IFAN, qui possèdent une grande collection de sculptures et d'instruments de musique, ainsi qu'une étonnante collection de masques. Le palais présidentiel, construit en 1906, est entouré d'un magnifique parc. Également à proximité du centre-ville se trouve la Grande Mosquée, qui est éclairée la nuit, mais dont l'entrée est strictement interdite aux non-musulmans. Les Almandies est probablement la meilleure station balnéaire du pays, située à vingt minutes en voiture de Dakar. Ici, le long de la plage, s'élèvent des hôtels prestigieux, dont beaucoup sont occupés par des demeures construites dans le style colonial.