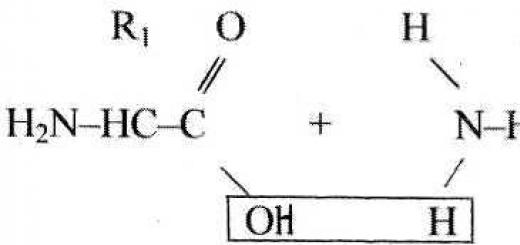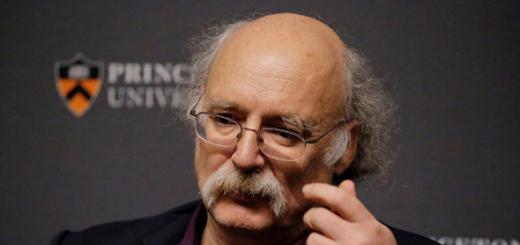Opinions politiques de N.M. Karamzin, basé sur les théories des éclaireurs français, s'est formé au début du XIXe siècle et s'est reflété dans les « Lettres d'un voyageur russe ». Par la suite, ils ont été affinés, complétés de nouvelles facettes, mais n'ont pas subi de changements significatifs, comme en témoignent ses écrits ultérieurs.
N.M. Karamzine a partagé des idées pédagogiques sur le progrès moral de la société, sur l’unité du chemin de l’homme vers l’amélioration spirituelle, sur l’illumination comme base du progrès et outil pour guérir les maux sociaux. Il était proche des idées de Montesquieu et de Condorcet sur les voies du développement social. N.M. Karamzine était convaincu que « le chemin de l'éducation et de l'illumination est le même pour les peuples ; ils les suivent tous les uns après les autres.
La philosophie des Lumières, avec son culte de l’ordre social rationnel, se caractérisait par l’opposition de l’harmonie sociale sous les auspices de l’État à l’anarchie sauvage dans laquelle se trouvait l’humanité aux premiers stades de son développement. Dans l'antithèse « anarchie - État », cette dernière était considérée par N.M. Karamzin comme force créatrice et positive. Ils condamnaient l’anarchie dans toutes ses manifestations, qu’il s’agisse de l’Antiquité ou des temps modernes. Si l’on considère les motivations traditionalistes que l’on peut voir dans N.M. dans cette veine. Karamzine, leur caractère éducatif devient évident : « Chaque société civile, établie depuis des siècles, est un sanctuaire pour les bons citoyens, et dans la plus imparfaite, il faut s'étonner de l'harmonie, de l'amélioration et de l'ordre merveilleux ». L'humanisme inhérent à la philosophie du Nouvel Âge et l'attitude envers la guerre civile et l'anarchie, issues de la tradition ancienne, comme le pire mal par rapport à toute tyrannie, ont déterminé le rejet de N.M. Révolutions de Karamzine et autres bouleversements politiques qui menacent en principe la destruction de l'ordre social. Donc N.M. Karamzine, comme beaucoup de ses contemporains en Russie et en Europe, n'a pas accepté la dictature et la terreur jacobines, l'exécution de Louis XVI, qui semblaient si éloignées des idéaux humanistes des Lumières. Dans les pages des « Lettres d'un voyageur russe », des tons négatifs prédominaient dans la description de la Révolution française. N.M. Karamzine était perplexe quant à la façon dont on pouvait s'attendre à « de telles scènes à notre époque de la part des Français éthérés », et a noté que dans les rues de Paris « tout le monde parle d'aristocrates et de démocrates, se loue et se gronde avec ces mots, pour la plupart , sans en connaître la signification. Karamzine, critique de la Révolution française dans « Lettres d’un voyageur russe », est un critique du point de vue de l’humanisme des Lumières.
À évaluer par N.M. Karamzin de certaines formes de gouvernement a sans aucun doute été influencé par les idées de Montesquieu sur la nécessité de corréler la forme du système politique avec les conditions géographiques, l'histoire et le degré d'éducation de la population du pays. À la suite de Montesquieu et Rousseau, il croyait que les principaux garants de la stabilité du système républicain étaient le haut niveau d'éducation et de moralité des citoyens, ainsi que la simplicité des mœurs et même la pauvreté, qui, à leur tour, soutenaient la vertu dans la société. À propos de la République de Saint-Marin, dont les mœurs sont « simples et intactes », il écrit par exemple : « Les principales raisons de cette longévité me semblent être sa position sur une montagne inaccessible, la pauvreté des habitants et leur éloignement constant des plans d’ambition.
Néanmoins, selon le conservateur russe, la forme républicaine de gouvernement n’était en principe pas stable. Il en voyait la raison principalement dans la difficulté de maintenir la vertu civique dans la société à un niveau approprié. Dans un article éloquemment intitulé « La chute de la Suisse », N.M. Karamzine a soutenu : « …sans une haute vertu populaire, la république ne peut pas subsister. Ici
pourquoi le gouvernement monarchique est beaucoup plus heureux et plus fiable : il n’exige pas de choses extraordinaires de la part des citoyens et peut s’élever jusqu’au niveau de moralité auquel les républiques tombent.
La présence de sympathies républicaines à N.M. Karamzine, sans aucun doute ; ce qui compte, c'est dans quel plan il faut les interpréter. N.M. Karamzine était proche des vertus civiques, dont les célèbres républicains de la Rome antique et de la Grèce étaient considérés comme l'incarnation. Mais ce qui est plus significatif est son attitude envers la république en tant que véritable forme de gouvernement. Malgré toutes ses sympathies pour les idéaux de citoyenneté républicaine, il a reconnu l'inadaptation de cette forme de gouvernement pour des États comme la Russie. Dans une lettre à I.I. Dmitriev N.M. Karamzine a écrit : « Je ne réclame ni constitution ni représentants, mais dans mes sentiments, je reste républicain et en même temps sujet fidèle du tsar russe : c'est une contradiction, mais seulement imaginaire ! Karamzine a qualifié cette contradiction d'imaginaire, car il a clairement séparé la reconnaissance théorique des mérites du système républicain et son applicabilité réelle dans les conditions de pays spécifiques.
Dans le même temps, il y a eu, à notre avis, un changement significatif dans sa position sur ce problème n'a pas duré. Déjà dans « Lettres d'un voyageur russe » N.M. Karamzine a écrit à propos des Britanniques : ils « sont éclairés, ils connaissent leurs véritables avantages… Ce n'est donc pas la constitution, mais l'illumination des Britanniques qui est leur véritable palladium. Toutes les institutions civiles doivent être conformes au caractère du peuple ; ce qui est bon en Angleterre sera mauvais dans un autre pays. Dans cette déclaration de l’auteur, deux points méritent d’être soulignés. Premièrement, pour l’auteur, il n’existait pas de forme idéale abstraite de gouvernement qui soit également acceptable pour tous les États et tous les peuples ; deuxièmement, il considérait l'éducation des citoyens plus importante que la constitution, car il y voyait la plus haute garantie de stabilité et de durabilité du système politique. Ainsi, N.M. Karamzine croyait que chaque nation, en fonction des conditions spécifiques de son existence historique, avait sa propre forme de gouvernement.
Dans ce contexte, son raisonnement en 1802 sur la France pendant la période consulaire est très révélateur : « La France, écrit-il, malgré le nom et certaines formes républicaines de son gouvernement, n'est plus, en fait, qu'une véritable monarchie. » N.M. Karamzine était convaincu que la France (en tant que grand État) « devrait, par nature, être une monarchie ». Il considérait la forme de gouvernement comme un phénomène historiquement déterminé, l'évaluant non pas formellement - selon des critères juridiques, mais spécifiquement - selon des critères historiques, faisant même abstraction des préférences personnelles.
Tant les philosophes des Lumières que N.M. lui-même. Karamzine, à leur suite, fut influencé par des théories politiques remontant à l'ancienne tradition. Montesquieu, comme vous le savez, considérait que la forme de gouvernement la plus optimale de toutes les formes de gouvernement existantes était une monarchie vraie ou « correcte », dans laquelle règne un monarque éclairé, guidé par des lois qui limitent son arbitraire. Les philosophes des Lumières ont adopté de la tradition ancienne la division des formes de gouvernement en « bonne » et « mauvaise ». Ils considéraient la tyrannie comme une forme perverse de monarchie. La démocratie et l'oligarchie ont été évaluées tout aussi négativement par rapport à la république aristocratique. Dans le discours de l'envoyé d'Ivan III aux Novgorodiens dans le drame historique « Marthe la Posadnitsa », N.M. Karamzine a mis dans la bouche de l'ambassadeur une dénonciation de l'oligarchie : « Liberté ! Mais vous asservissez aussi... Les boyards ambitieux, après avoir détruit le pouvoir des souverains, en prirent eux-mêmes possession. Vous obéissez - car le peuple doit toujours obéir - mais pas au sang sacré de Rurik, mais aux riches marchands. En même temps, ces paroles de l'auteur du drame contiennent une idée importante pour comprendre sa conception de l'État selon laquelle la nécessité d'obéir aux autorités et l'inégalité de propriété unissent toutes les formes de gouvernement. Sous toute forme de gouvernement, selon Karamzine, le peuple doit obéir aux autorités. La « volonté », selon lui, est toujours le privilège des « sommets », mais pas du peuple dans son ensemble.
La seule forme de gouvernement acceptable pour la Russie est N.M. Karamzin considérait l'autocratie. « La Russie a été fondée par les victoires et l’unité de commandement, a péri de la discorde et a été sauvée par une sage autocratie. » Dans cette formule (incarnée dans sa « Note sur l’ancienne et la nouvelle Russie »), le conservateur russe semblait résumer le contenu de « l’Histoire de l’État russe ». Parlant déjà des premières étapes de l'histoire russe, il a attiré l'attention sur le pouvoir fort des premiers princes et a donné son explication : « La démocratie n'est établie que par le pouvoir de l'État, et dans les petites républiques, nous trouvons rarement des monarques illimités. » Le joug tatar, selon N.M. Karamzine, a contribué au renforcement du caractère illimité du pouvoir princier. L'historien associe l'établissement définitif de l'autocratie au règne d'Ivan III et d'Ivan IV, lorsque, grâce à la politique active du pouvoir suprême, qui établit l'ordre dans le pays et protège les frontières, « le peuple, délivré par les princes de Moscou n'a pas regretté les désastres de la guerre civile intérieure et du joug extérieur de ses anciens conseils et dignitaires qui modéraient le pouvoir du souverain. Compte tenu de ce caractère « salvateur » de l’autocratie russe, N.M. Karamzine a évalué positivement la longue souffrance des Russes sous le règne d'Ivan le Terrible, « qui a péri, mais nous a sauvé le pouvoir de la Russie ». La pensée de cet historien ne doit pas être comprise comme une approbation de l’arbitraire despotique. Mais elle démontre une fois de plus le rôle exceptionnel que N.M. a joué dans sa conception de l’État russe. Karamzine a donné la priorité à la stabilité politique.
L'autocratie dans l'interprétation de N.M. Karamzin a été présenté sous la forme d'un système en développement. Il voyait la ligne principale de cette évolution dans le passage de l'arbitraire illimité de l'autocrate, qui se transformait parfois en tyrannie, à une monarchie « correcte » éclairée. À cet égard, l'auteur de la « Note » a évalué très favorablement le règne de Catherine II, qui, selon ses propres mots, « a purifié l'autocratie des impuretés de la tyrannie ». Ce n’est pas un hasard si, partant des discussions sur l’Empire ottoman, N.M. Karamzine a écrit : « ... les grands empires fondés sur la conquête doivent soit s'éclairer, soit constamment gagner : sinon leur chute est inévitable. » Sur cette base, il a préconisé une politique d'amélioration progressive (mais très prudente) du système étatique et de la législation, estimant que l'autocratie russe pourrait répondre aux exigences de l'idéologie des Lumières.
Il n'est donc pas surprenant que dans les travaux de N.M. Karamzine revient à plusieurs reprises sur l'idée de la primauté du bien public sur la souveraineté du monarque : « Le pouvoir et l'autorité du porteur de la couronne doivent être subordonnés au bien du peuple ». L'idée même de subordonner le monarque au service du bien public n'était pas nouvelle : en Russie, elle a été promue par Pierre Ier et Catherine II.
Il est important de souligner que les caractéristiques de l'État russe dans la compréhension de N.M. Karamzin n'est pas associé à l'idée d'un chemin historique particulier ou à l'originalité de la culture russe par rapport à l'Occident, mais à l'idée dela diversité des destins historiques et des traditions politiques, se développant cependant le long du chemin commun d’illumination et d’amélioration morale. En général, les conservateurs ont reconnu le point commun développement historique La Russie et les pays européens sont partis d’idées essentiellement éducatives, en les soutenant par une argumentation historique. Par conséquent, il a souligné la validité générale des réformes de Pierre Ier (à l'exception de ses tentatives pour changer la vie et la morale), qui, tout en restant dans le cadre de l'ancien système étatique, ont poussé la Russie sur la voie de la politique et de la moralité. progrès commun à tous les peuples.
La justification du pouvoir par N.M. Karamzine était dépourvu de connotations légitimistes et mystiques dans l’esprit de Joseph de Maistre. Cette conclusion découle notamment de ses appréciations sur l’accession au pouvoir de Napoléon en France, qui éclairent largement sa vision du problème de la légitimité du pouvoir en Russie. En 1802 N.M. Karamzine a écrit : « Les nombreuses personnes sur les ruines du trône voulaient régner sur elles-mêmes ; un bel édifice d'amélioration publique fut détruit ; et ce peuple fier... pour le salut
confie son existence politique avec autocratie au vaniteux guerrier corse. Il est facile de voir que l’auteur relie l’accession au pouvoir de Napoléon à la volonté du peuple, ce qui en soi, conformément à la théorie du contrat social, confère au pouvoir un caractère légitime. En revanche, pour comprendre N.M. Le rôle du peuple dans la vie politique de Karamzine se caractérise par l’attitude sceptique à l’égard de la capacité des « nombreux » gens à « se commander eux-mêmes », qui se reflète dans ce passage. De la reconnaissance du caractère inacceptable du système républicain pour les grands États a suivi la reconnaissance de l’incapacité du peuple à être le créateur de son propre destin, la reconnaissance du caractère inévitable de sa subordination à la volonté autocratique de quelqu’un.
La proclamation de Napoléon comme premier consul doté de pouvoirs aussi étendus a été perçue par N.M. Karamzine en 1803 comme le retour de la France, pays monarchique « par nature », à une forme de gouvernement monarchique, et fut donc bien accueilli par lui. En 1802 N.M. Karamzine a évalué le régime de pouvoir du premier consul comme une « vraie » monarchie : « La domination française est véritablement monarchique, et bien plus éloignée du républicain que l'anglaise... Bonaparte sait gouverner ; s’il assure la sécurité personnelle, la propriété et la liberté de vie dans son État, alors l’histoire bénira son amour du pouvoir. Estimant que la continuité du pouvoir suprême en France était rompue, N.M. Karamzine préférait le pouvoir de Napoléon à l'anarchie révolutionnaire. Ses sympathies déterminées reconnaissance populaire et espère l'établissement de la légalité et du mécénat de l'éducation associés à Bonaparte à cette époque. Dans les lettres ultérieures du conservateur, il y a des critiques négatives sur Napoléon, mais elles sont associées à une évaluation non pas de sa politique intérieure, mais de sa politique étrangère, surtout après 1805, lorsque la France napoléonienne est devenue une menace réelle pour la Russie.
Dans divers ouvrages (notamment sur la personnalité de Napoléon) N.M. Karamzine a abordé les problèmes du changement et de l'héritage du pouvoir. Il avait une attitude négative à l'égard de toute méthode violente visant à changer le pouvoir, qu'il s'agisse d'un soulèvement populaire ou d'un coup d'État de palais. Le conservateur russe a reconnu Ivan le Terrible et Paul Ier comme des tyrans. De plus, son poème « Tacite » de l’époque pavlovienne contenait des motifs de lutte contre les tyrans. Les méthodes de gouvernement despotiques de Paul ont suscité le mécontentement au sein de la société noble face au caractère arbitraire du pouvoir suprême. Pas étonnant que N.M. Karamzine a écrit : « …ce que les jacobins ont fait à l'égard des républiques, Paul l'a fait à l'égard de l'autocratie : il leur a fait haïr ses abus. » Cependant, N.M. Karamzin considérait tout système politique existant comme la base du développement de la société dans le sens du bien public et de l'illumination ; la manière violente de changer de pouvoir sape les fondements mêmes de la société, l'idée de légalité, de moralité publique et de vertu : « Le gouvernement autocratique du peuple est plus nocif pour les sociétés civiles que les injustices personnelles ou les erreurs du souverain. Il faut la sagesse de siècles entiers pour établir le pouvoir : une heure de frénésie populaire détruit son fondement, qui est le respect moral de la dignité des dirigeants. »[i] Le fait que dans le poème « Tacite » N.M. Karamzine a condamné les Romains pour leur longue souffrance, et dans "Histoire", il a remercié les sujets d'Ivan IV pour la même chose, ce qui s'explique par sa conviction de la différence de tradition politique et de niveau d'illumination de ces peuples : "... car la Grèce et Rome, affirmait-il, étaient des puissances populaires et plus éclairées que la Russie.
Revenant à l'attitude de N.M. Karamzin au problème du changement de pouvoir, notons que dans les « Lettres d'un voyageur russe », les transformations révolutionnaires en France sont présentées non comme à l'échelle nationale et donc justifiées par le droit à la souveraineté populaire, mais comme des actions d'une minorité avec la passivité du pouvoir. majoritaire, et n'ayant donc aucune base légale : « Ne réfléchissez pas, pour que la nation tout entière participe à la tragédie qui se joue actuellement en France. A peine une centième partie est efficace ; tout le monde regarde, juge, argumente... Une guerre défensive contre un ennemi insolent est rarement heureuse.» Les conservateurs ne voient donc pas la mise en œuvre du principe de souveraineté populaire comme une conséquence de la Révolution française.
Comprendre N.M. Les problèmes de souveraineté de Karamzine, l'origine du pouvoir et son évolution mettent en lumière son attitude à l'égard de l'autocratie russe contemporaine. Il semble tout à fait juste que l'opinion exprimée dans la littérature soit que dans son interprétation des éclaireurs français N.M. Karamzine était enclin à suivre « l'Ordre » de Catherine II : à la suite de l'impératrice, il représentait l'autocratie russe comme la monarchie « correcte » de Montesquieu. De nombreuses thèses trouvées dans les écrits de Karamzine coïncident avec les dispositions de « l’Ordre », qui remontent aux idées de Montesquieu. Il suffit de donner l'exemple suivant : dans « Nakaz », Catherine, justifiant la nécessité de l'existence du pouvoir autocrate en Russie, écrivait : « …aucun autre pouvoir, dès que le pouvoir uni en sa personne, ne peut agissez de la même manière dans l’espace d’un si grand État. Dans la « Note sur l'ancienne et la nouvelle Russie », la même idée est exprimée comme suit : « L'autocratie a fondé et ressuscité la Russie : avec le changement de sa charte d'État, elle a péri et doit périr, composée de parties si nombreuses et si petites que, en plus d'une autocratie illimitée, dans ce colosse pour mener des actions unifiées ?
De ces positions générales N.M. Karamzine a critiqué la politique et les projets de réforme du gouvernement d'Alexandre Ier. Les événements de la Révolution française et la menace que la France révolutionnaire et napoléonienne représentait pour la paix des monarchies européennes ont déçu une partie importante de la société russe face aux transformations politiques fondées sur l'universalité. théories sociales comme une voie de progrès. La « Note sur l’ancienne et la nouvelle Russie » était en fait une réponse directe et une critique des projets de réforme d’Alexandre Ier et, en particulier, des projets de Speransky.
Karamzine considérait l'autocratie russe comme une monarchie, qui se distinguait du despotisme, selon les enseignements des Lumières, par la présence de lois fermes. Il croyait qu'au moins depuis l'époque de Catherine II, « qui a purifié l'autocratie des impuretés de la tyrannie », l'autocratie s'est rapprochée de la monarchie correcte de Montesquieu. Sans aucun doute, N.M. Karamzin ne considérait pas l'autocratie de l'époque d'Ivan III comme aussi éclairée que le règne de Catherine. Cependant, dans toute l'histoire de l'autocratie russe, l'historien n'a compté que deux tyrans : Ivan le Terrible et Paul I. En principe, l'autocratie , du moins contemporain, il ne considérait pas le despotisme : « L’autocratie n’est pas l’absence de lois, car là où il y a le devoir, il y a la loi : personne n’a jamais douté du devoir des monarques de veiller au bonheur du peuple. » L'auteur a parlé des lois comme d'une caractéristique qui distingue le régime monarchique de la tyrannie despotique.
Au même moment, N.M. Karamzine a condamné sans équivoque la tyrannie et le despotisme, sans le relier uniquement à l'abus du pouvoir monarchique : "... la tyrannie n'est qu'un abus de l'autocratie, apparaissant dans les républiques lorsque des citoyens ou des dignitaires forts oppriment la société." Par conséquent, les conservateurs reconnaissaient la possibilité de manifestations despotiques dans l’autocratie, sans pour autant la considérer comme un despotisme en principe.
Justifiant le caractère autocratique du pouvoir monarchique en Russie et s'appuyant sur l'interprétation des théories du contrat social et de la souveraineté populaire dans l'esprit de l'idéologie de l'absolutisme éclairé, N.M. Karamzine croyait que le peuple avait autrefois délégué tout le pouvoir à l'autocrate. En ce sens, il était un partisan constant de la concentration de tout le pouvoir législatif entre les mains de l'autocrate, y compris la publication des lois fondamentales fondamentales.
N.M. Karamzine a cherché à souligner et à justifier précisément le caractère illimité du pouvoir autocratique en Russie. Parfois, il évoque aussi des motifs patrimoniaux dans sa description : « Dans le monarque russe, tous les pouvoirs sont unis : notre règne est paternel, patriarcal. Le père de famille juge sans protocole ; ainsi, dans les autres cas, le monarque doit agir selon une seule conscience. L'idée de priorité politique
la tradition était un élément important Opinions politiques Conservateur russe : « …les institutions de l’Antiquité possèdent une force politique qui ne peut être remplacée par aucune puissance mentale ; une fois et la bonne volonté des gouvernements légitimes doivent corriger les imperfections des sociétés civiles », écrivait-il dans le « Bulletin de l’Europe » en 1802.
Plus que prudent quant à toute innovation dans structure de l'État, N.M. Karamzin a cherché à s'appuyer dans ses vues théoriques sur l'autorité de la tradition, à faire appel aux normes juridiques de l'État historiquement établies : « … toute nouvelle dans l'ordre étatique est un mal auquel il ne faut recourir qu'en cas de besoin : pour une fois donne une fermeté appropriée aux statuts. Mais ces motivations traditionnelles ne constituaient pas l’essence de sa justification du pouvoir suprême en Russie et ne faisaient que compléter la description du pouvoir autocratique, construit principalement sur une base éducative (dans son interprétation conservatrice) et sur la base d’une argumentation historique. Donc N.M. Karamzine a clairement séparé la personnalité du monarque et l'institution du pouvoir autocratique en elle-même : "... vous pouvez tout faire, mais vous ne pouvez pas le limiter légalement !", s'est adressé l'historien à Alexandre Ier. Reconnaissant la légalité du seul caractère illimité du pouvoir du monarque en Russie, N.M. Karamzin considérait ce postulat comme l'une de ces lois « indispensables » ou « radicales » dont parlait Montesquieu et qui, conformément aux vues des Lumières, devraient se placer au-dessus du monarque, limitant son arbitraire. N.M. Karamzine, à la suite de « l'Ordre » de Catherine II, a reconnu le caractère illimité du pouvoir autocratique comme inébranlable, déformant ainsi l'idée des Lumières.
Sur cette base, il a en principe évalué négativement la possibilité d'une véritable limitation du pouvoir autocratique sans détruire les fondements mêmes de l'État : « En effet, est-il possible et de quelles manières limiter l'autocratie en Russie sans affaiblir le pouvoir tsariste salvateur. ?" - Il a demandé. Si nous plaçons la loi au-dessus du trône, raisonnait-il, alors « à qui donnerons-nous le droit de maintenir l’inviolabilité de cette loi ? Est-ce le Sénat ? Est-ce conseillé ? Quels seront leurs membres ? Choisi par le souverain ou l'État ? Dans le premier cas, ils plaisent au tsar, dans le second, ils voudront discuter avec lui du pouvoir - je vois une aristocratie, pas une monarchie.» Ces arguments constituaient en fait une critique directe des projets de Speransky, que N.M. Karamzine y voyait une intention de limiter le pouvoir autocratique par la loi. Selon lui, toute réforme de l’État « ébranle les fondements de l’empire ». Ainsi, en raison de la réelle limitation du pouvoir autocratique de N.M. Karamzine a vu un changement dans la forme de gouvernement : la transformation d'une monarchie en aristocratie ; et dans les conditions russes, l’historien évaluait négativement le régime aristocratique.
N.M. Karamzine considérait l’Empire russe contemporain comme étant au sommet de sa puissance, alors que tout changement dans son système politique ne pouvait qu’affaiblir l’État. Il considérait l'expérience des pays d'Europe occidentale comme inacceptable pour la Russie. Il introduit ainsi une certaine originalité dans l’interprétation du pouvoir suprême russe. Dans l'une de ses dernières lettres à P.A. Viazemski N.M. Karamzine a non seulement développé ces réflexions, mais a encore une fois confirmé que pour lui cela ne signifie pas nier en principe les avantages du système républicain (sans égard à la Russie) : « Donner à la Russie une constitution au sens à la mode du terme, c'est habiller quelqu'un d'un costume gay. s'habiller... La Russie n'est pas l'Angleterre, pas même le royaume de Pologne : elle a son propre destin d'État, grand, étonnant, et est plus susceptible de tomber que de s'élever encore plus. L'autocratie est l'âme, sa vie, tout comme le régime républicain était la vie de Rome... Pour moi, en tant que vieil homme, il est plus agréable d'aller à une comédie qu'à la salle de l'Assemblée nationale ou à la chambre des députés. députés, bien que je sois républicain dans l’âme et que je mourrai comme tel.
Notons que parmi les arguments contre la tentative de réforme de l’autocratie et, plus particulièrement, contre les projets de Speransky, la « Note » de N.M. Karamzine souligne la similitude de ces projets avec la législation
La France napoléonienne, hostile à la Russie. « Projet de code » de Speransky N.M. Karamzine l'a directement appelé « une traduction du Code Napoléon ». En 1811, l’historien écrivait sur l’impossibilité d’imiter l’ennemi de la patrie : « Est-il temps maintenant d’offrir aux Russes les lois françaises, même si elles pouvaient s’appliquer commodément à notre condition civile ? Nous - nous tous qui aimons la Russie, le Souverain, sa gloire, sa prospérité - nous haïssons tous ce peuple taché du sang de l'Europe... - et à l'heure où le nom de Napoléon fait frémir les cœurs, nous mettrons son code sur le saint autel de la patrie !
En conséquence, le conservateur est arrivé à l'idée que le problème de l'arbitraire du pouvoir illimité pourrait être résolu non pas en le limitant par voie législative, mais en formant une certaine opinion publique, instillant progressivement dans la société un rejet du despotisme : « … notre Le souverain n'a qu'un moyen de freiner ses héritiers dans les abus des autorités : qu'il règne vertueusement ! Puisse-t-il enseigner le bien à ses sujets ! Alors naîtront les coutumes salvatrices ; des règles, des pensées populaires qui, mieux que toutes les formes mortelles, maintiendront les futurs souverains dans les limites du pouvoir légitime. Un tyran peut parfois régner en toute sécurité après un tyran, mais jamais après un souverain sage ! Cette approche reflétait bien sûr l'idée des philosophes français des Lumières sur le rôle décisif de l'éducation et de l'opinion publique dans l'évolution politique de la société, ainsi que l'idée d'un « sage sur le trône » caractéristique de l'absolutisme éclairé. .
Ainsi, dans le domaine politique, N.M. Karamzine n'a fondamentalement fixé aucune limite au pouvoir autocratique. Cependant, si l'on se tourne vers le problème des relations entre les autorités et le peuple dans ses écrits, on peut remarquer la volonté de protéger les sphères sociales et culturelles de la vie de l'intervention directe du pouvoir suprême. Cela se voit facilement dans l’évaluation que Karamzine fait des réformes de Pierre. L'historien a condamné Pierre pour son désir de changer les coutumes et les mœurs des Russes. Considérant l'autocratie non comme une tyrannie, mais comme une monarchie légale, les conservateurs considéraient l'ingérence injustifiée dans l'ordre social comme un abus de pouvoir de la part du monarque.
Les concepts de « citoyen » et de « société civile » ont été utilisés par N.M. Karamzin dans les cas où nous parlions de presque n'importe quel État, et si l'on entendait la monarchie, alors le mot « citoyen » devenait synonyme de « sujet ». Par « société civile », il entendait une société où existent une sorte d’État et d’institutions juridiques. Dans une telle utilisation libre du terme « citoyen » en relation avec un sujet, N.M. Karamzine avait un prédécesseur en la personne de la même Catherine II. Un indicateur important de l’état civil d’une personne était pour elle l’extension de la compétence de la législation étatique à l’individu. Ainsi, il l'a noté déjà au XVIe siècle. en Russie, « ... un pouvoir d'État a exécuté un esclave, donc déjà une personne, déjà un citoyen, protégé par la loi. »
N.M. Karamzine attaché grande importance caractère de classe de la société russe. Il a fait valoir que les droits civils en Russie « n'existaient pas au vrai sens du terme et n'existent pas », qu'il existe « des droits politiques ou spéciaux de différents États ». Sur cette base, les conservateurs considéraient différemment les relations entre les classes individuelles et l’État. Le rôle le plus important dans l'État parmi les domaines de N.M. Karamzine, bien sûr, a attribué à la noblesse : « L'autocratie est le palladium de la Russie, d'où il ne s'ensuit pas que le souverain, seule source de pouvoir, ait des raisons d'humilier la noblesse, qui est aussi ancienne que la Russie. Les droits des nobles ne sont pas un élément de la volonté du monarque, mais son principal instrument nécessaire, la force motrice de l’État. Considérant la noblesse comme le principal soutien du pouvoir autocratique, N.M. Karamzine lui a imposé des exigences élevées en matière de service civil pour le bien de la patrie, et pas seulement sur le terrain. service civil. Quant aux paysans,
puis il a estimé qu'il fallait d'abord éduquer, et ensuite seulement essayer de changer de statut : « … pour la fermeté de l'existence de l'État, il est plus sûr d'asservir les gens que de leur donner la liberté au mauvais moment, pour laquelle il est nécessaire de préparer une personne par une correction morale. Les principaux arguments de N.M. Karamzine considère la sécurité et la stabilité de l'État.
Le conservateur russe considérait le clergé et l’Église comme un autre pilier du pouvoir d’État : « Les fondateurs des empires ont toujours affirmé leur gloire dans la religion ; mais bientôt les puissances fondées sur une seule raison disparurent. Mais afin d'élever l'autorité de l'Église, en fin de compte dans l'intérêt de l'État, Karamzine a proposé d'affaiblir sa dépendance à l'égard du pouvoir laïc, afin que l'Église ne perde pas « son caractère sacré », car « avec l'affaiblissement de la foi, le le souverain est privé du moyen de contrôler le cœur du peuple en cas d’urgence.
C'est tout naturellement que N.M. Karamzine était partisan de la structure unitaire de l'État. Il a subordonné les problèmes des périphéries nationales et des frontières nationales aux intérêts de la sécurité de l’État. Dans les « Éloges historiques de Catherine II », l'historien lie la sécurité de l'État à son pouvoir et justifie ainsi les conquêtes de Pierre Ier et de Catherine II. Selon lui, leurs acquisitions au profit de la Russie ont contribué à l'établissement de sa puissance et de sa sécurité extérieure, "sans lesquelles tout bien intérieur n'est pas fiable". Division de la Pologne N.M. Karamzine a également justifié cela par l'état instable de la république polonaise elle-même, qui, à son avis, « a toujours été un terrain de jeu pour de fiers nobles, un théâtre de leur obstination et de leur humiliation populaire ». Il avait une attitude extrêmement négative envers toute forme de restauration de la Pologne, parce que... y voyait une menace directe pour l'intégrité de l'Empire russe : « … La Pologne n'existera sous aucune forme, sous aucun nom. La sécurité de chacun est la loi la plus élevée en politique.»
Ainsi, l'autocratie russe a été vue par N.M. Karamzin en tant que système en développement dans le cadre du progrès général de l'humanité basé sur l'illumination. Dans le même temps, il rejetait toute forme violente de changement de pouvoir. S'appuyant sur l'idée de l'origine contractuelle du pouvoir monarchique en Russie, ainsi que sur la conditionnalité historique et géographique de son caractère illimité, l'historien n'a reconnu comme légitime que le pouvoir autocratique absolu dans les conditions de la Russie contemporaine. L’origine contractuelle du pouvoir et la présence d’une législation forte (émanant du monarque) étaient pour les conservateurs les principaux critères caractérisant l’autocratie russe comme une monarchie et non une tyrannie.
Concept de N.M. Karamzine était conservatrice dans le sens où elle ne prévoyait pas de changements significatifs dans le caractère autocratique de la monarchie russe et du système de classes dans un avenir proche. L’auteur des « Notes sur l’ancienne et la nouvelle Russie » a rejeté la possibilité même d’une limitation législative de l’autocratie par l’institution de la représentation sans ébranler les fondements de la monarchie russe. N.M. Karamzine a condamné le despotisme et l'ingérence du pouvoir suprême dans le domaine de la morale et de la vie quotidienne. Il considérait la noblesse russe comme le principal soutien de l'autocratie, tandis qu'un changement non préparé du statut social des paysans était considéré comme dangereux pour la stabilité du système étatique. Il était partisan de la forme unitaire structure administrative, subordonnant la question des frontières nationales aux intérêts nationaux d’intégrité et de sécurité.
On peut parler d'un concept assez holistique de l'État russe selon N.M. Karamzine. Objectivement, de nombreuses dispositions de ce concept reflétaient les intérêts de larges couches de la noblesse russe. Cependant, le concept de N.M. Karamzine le caractérise comme un représentant du cercle le plus instruit de la société russe et se distingue par son originalité, exprimée notamment dans le désir de combiner les théories éducatives et juridiques de l'État et la justification du caractère autocratique de la Russie.
la monarchie. Cette fonctionnalité rend le concept de N.M. similaire. Karamzine avec les idées du « Nakaz » de Catherine II, auxquelles elle revient en grande partie.
Les opinions politiques du conservateur russe incluent l’idée que la Russie est différente des autres États (ce qui est bon pour l’Angleterre est mauvais pour la Russie). Cependant, il était très loin de l’idée d’opposer la Russie et l’Europe.
Remarques
Karamzine N.M. Lettres d'un voyageur russe. – M., 1983. – P. 522.
Bulletin de l'Europe. – 1802. – N° 21. – P. 69.
Bulletin de l'Europe. – 1802. – N° 20. – P. 233.
Karamzine N.M. Lettres de N.M. Karamzine à I.I. Dmitriev. – Saint-Pétersbourg, 1866. – P. 249.
Karamzine N.M. Lettres d'un voyageur russe. – P. 477.
Bulletin de l'Europe. – 1802. – N° 1. – P. 209.
Bulletin de l'Europe. – 1802. – N° 17. – P. 78.
Karamzine N.M. Marthe la Posadnitsa // Lui. Ouvrages en 2 volumes. T. 2. – L., 1984. – P. 547.
Karamzine N.M. Note sur l'ancienne et la nouvelle Russie. – M., 1991. – P. 22.
Karamzine N.M. Histoire du gouvernement russe. En 3 livres. T. 3. – M., 1997. – P. 414.
Karamzine N.M. Histoire... Tome 5. – P. 197.
Karamzine N.M. Attention... – P. 24.
Karamzine N.M. Histoire... Tome 9. – P. 87.
Bulletin de l'Europe. – 1803. – N° 9. – P. 69.
Karamzine N.M. Mots d'éloge historiques à Catherine II. – M., 1802. – P. 67.
Lotman Yu.M. La création de Karamzin // Lui. Karamzine. – M., 1997. – P. 272.
Karamzine N.M. Mot d'éloge historique... - P. 67.
Bulletin de l'Europe. – 1802. – N° 17. – P. 77-78.
Athénée. – 1858. – Partie III. – P. 341. etc.
Kisliagina L.G. Formation des opinions socio-politiques de N.M. Karamzine. – M., 1976. – P. 171.
Karamzine N.M. Attention... – P. 45.
Karamzine N.M. Attention... – P. 27
Karamzine N.M. Histoire... T. 1. – P. 31.
Karamzine. N.M. Lettres d'un voyageur russe. – P. 291.
Voir : Druzhinin N.M. Absolutisme éclairé en Russie // Absolutisme en Russie aux XVIIe et XVIIIe siècles. – M., 1964.
Catherine II. L'ordre de Sa Majesté Impériale. – Saint-Pétersbourg, 1893. – P. 4.
Karamzine N.M. Remarque... - P. 41.
Karamzine N.M. Histoire... T. 7. – P. 523.
Juste là. – P. 523.
Karamzine N.M. Histoire... T. 7. – P. 102.
Karamzine N.M. Noter... - P. 56.
Juste là. – P. 49.
Karamzine N.M. Attention... – P. 48.
Juste là. – P. 28.
Karamzine N.M. Lettres de N.M. Karamzine à P.A. Viazemski 1810-1826. Des archives Astafievsky. – Saint-Pétersbourg 1897. – P. 65.
Karamzine N.M. Remarque... – P. 90.
Juste là. – P. 93.
Juste là. – P. 49.
Karamzine N.M. Attention... – P. 33.
Catherine II. Décret op. – P. 10.
Karamzine N.M. Histoire... T. 7. – P. 530.
Karamzine N.M. Remarque... – P. 91.
Karamzine N.M. Remarque... – P. 105.
Juste là. – P. 74.
Bulletin de l'Europe. – 1802. – N° 9. – P. 79.
Karamzine N.M. Attention... – P. 38.
Karamzine N.M. Mot d'éloge historique... - P. 106.
Juste là. – P. 41.
Karamzine N.M. Attention... – P. 54.
Le 12 décembre (1er décembre, style ancien) 1766, est né Nikolaï Mikhaïlovitch Karamzine - écrivain, poète russe, rédacteur en chef du Journal de Moscou (1791-1792) et du magazine Vestnik Evropy (1802-1803), membre honoraire Académie Impériale Sciences (1818), membre titulaire de l'Académie impériale russe, historien, premier et unique historiographe de la cour, l'un des premiers réformateurs russes langue littéraire, le père fondateur de l’historiographie russe et du sentimentalisme russe.
|
|
Contribution de N.M. Il est difficile de surestimer la contribution de Karamzine à la culture russe. En se souvenant de tout ce que cet homme a réussi à faire au cours des 59 courtes années de son existence terrestre, il est impossible d'ignorer le fait que c'est Karamzine qui a largement déterminé l'homme. Russe XIXème siècle - l'âge « d'or » de la poésie, de la littérature, de l'historiographie, des études de sources et d'autres domaines humanitaires russes savoir scientifique. Grâce à des recherches linguistiques visant à vulgariser le langage littéraire de la poésie et de la prose, Karamzine a offert la littérature russe à ses contemporains. Et si Pouchkine est « notre tout », alors Karamzine peut être appelé en toute sécurité « notre tout » avec une majuscule. Sans lui, Viazemsky, Pouchkine, Baratynsky, Batyushkov et d'autres poètes de la soi-disant « galaxie Pouchkine » n'auraient guère été possibles.
"Peu importe ce vers quoi vous vous tournez dans notre littérature, tout a commencé avec Karamzine : le journalisme, la critique, les histoires, les romans, les histoires historiques, le journalisme, l'étude de l'histoire", a noté à juste titre plus tard V.G. Belinsky.
"Histoire de l'État russe" N.M. Karamzine n'est pas seulement devenu le premier livre en langue russe sur l'histoire de la Russie, accessible à un large public. Karamzine a donné au peuple russe la Patrie au sens plein du terme. On raconte qu'après avoir clôturé le huitième et dernier volume, le comte Fiodor Tolstoï, surnommé l'Américain, s'est exclamé : « Il s'avère que j'ai une patrie ! Et il n'était pas seul. Tous ses contemporains ont soudain appris qu'ils vivaient dans un pays avec une histoire millénaire et qu'ils avaient de quoi être fiers. Avant cela, on croyait qu'avant Pierre Ier, qui avait ouvert une « fenêtre sur l'Europe », il n'y avait rien en Russie, même de loin, digne d'attention : les âges sombres du retard et de la barbarie, l'autocratie des boyards, la paresse primordialement russe et les ours dans les rues. ...
L’ouvrage en plusieurs volumes de Karamzine n’était pas achevé, mais, publié dans le premier quart du XIXe siècle, il a complètement déterminé l’identité historique de la nation pour de nombreuses années à venir. Toute historiographie ultérieure n’a jamais pu générer quelque chose de plus cohérent avec la conscience de soi « impériale » qui s’est développée sous l’influence de Karamzine. Les opinions de Karamzine ont laissé une marque profonde et indélébile dans tous les domaines de la culture russe aux XIXe et XXe siècles, constituant les fondements de la mentalité nationale, qui a finalement déterminé la voie du développement de la société russe et de l’État dans son ensemble.
Il est significatif qu’au XXe siècle, l’édifice de la grande puissance russe, qui s’était effondré sous les attaques des internationalistes révolutionnaires, ait été relancé dans les années 1930 – sous des slogans différents, avec des dirigeants différents, dans un ensemble idéologique différent. mais... L'approche même de l'historiographie de l'histoire russe, tant avant qu'après 1917, est restée largement chauvine et sentimentale dans le style de Karamzine.
N.M. Karamzine - premières années
N.M. Karamzin est né le 12 décembre (1er siècle) 1766 dans le village de Mikhailovka, district de Buzuluk, province de Kazan (selon d'autres sources, dans le domaine familial de Znamenskoye, district de Simbirsk, province de Kazan). On sait peu de choses sur ses premières années : il n'y a pas de lettres, de journaux intimes ou de souvenirs de Karamzine lui-même sur son enfance. Il ne connaissait même pas exactement son année de naissance et presque toute sa vie il a cru qu'il était né en 1765. Ce n'est qu'à un âge avancé, après avoir découvert les documents, qu'il est devenu « plus jeune » d'un an.
Le futur historiographe a grandi sur le domaine de son père, le capitaine à la retraite Mikhaïl Egorovitch Karamzine (1724-1783), un noble moyen de Simbirsk. A reçu une bonne éducation à la maison. En 1778, il fut envoyé à Moscou dans l'internat du professeur de l'Université de Moscou I.M. Shadena. Parallèlement, il suit des cours à l'université en 1781-1782.
Après avoir obtenu son diplôme d'internat, Karamzine entre en 1783 au service du régiment Preobrazhensky à Saint-Pétersbourg, où il rencontre le jeune poète et futur employé de son « Journal de Moscou » Dmitriev. Parallèlement, il publie sa première traduction de l'idylle de S. Gesner « La jambe de bois ».
En 1784, Karamzine prit sa retraite en tant que lieutenant et ne servit plus jamais, ce qui était perçu dans la société de l'époque comme un défi. Après un court séjour à Simbirsk, où il rejoint la loge maçonnique de la Couronne d'Or, Karamzine s'installe à Moscou et est introduit dans le cercle de N. I. Novikov. Il s'installe dans une maison appartenant à la « Société scientifique amicale » de Novikov et devient l'auteur et l'un des éditeurs du premier magazine pour enfants « Lecture pour le cœur et l'esprit des enfants » (1787-1789), fondé par Novikov. Dans le même temps, Karamzine se rapproche de la famille Pleshcheev. Pendant de nombreuses années, il a entretenu une tendre amitié platonique avec N.I. Pleshcheeva. À Moscou, Karamzine publie ses premières traductions, dans lesquelles son intérêt pour l'histoire européenne et russe est clairement visible : Les Saisons de Thomson, Les Soirées champêtres de Zhanlis, la tragédie de W. Shakespeare « Jules César », la tragédie de Lessing « Emilia Galotti ».
En 1789, la première histoire originale de Karamzine, « Eugène et Yulia », parut dans la revue « Lectures pour enfants… ». Le lecteur ne l’a pratiquement pas remarqué.
Voyage en Europe
Selon de nombreux biographes, Karamzine n'était pas enclin au côté mystique de la franc-maçonnerie, restant partisan de son orientation active et éducative. Pour être plus précis, à la fin des années 1780, Karamzine était déjà « tombé malade » du mysticisme maçonnique dans sa version russe. Peut-être que le refroidissement envers la franc-maçonnerie fut l'une des raisons de son départ pour l'Europe, où il passa plus d'un an (1789-90), visitant l'Allemagne, la Suisse, la France et l'Angleterre. En Europe, il rencontre et discute (à l'exception des francs-maçons influents) avec les « maîtres de l'esprit » européens : I. Kant, I. G. Herder, C. Bonnet, I. K. Lavater, J. F. Marmontel, visite des musées, des théâtres, des salons laïques. A Paris, Karamzine a écouté O. G. Mirabeau, M. Robespierre et d'autres révolutionnaires à l'Assemblée nationale, a vu de nombreuses personnalités politiques marquantes et en connaissait beaucoup. Apparemment, le Paris révolutionnaire de 1789 a montré à Karamzine à quel point un mot peut influencer une personne : sur papier, lorsque les Parisiens lisent des brochures et des tracts avec un vif intérêt ; oral, lorsque des orateurs révolutionnaires parlaient et que des controverses surgissaient (une expérience qui ne pouvait pas être acquise en Russie à cette époque).
Karamzine n'avait pas une opinion très enthousiaste du parlementarisme anglais (suivant peut-être les traces de Rousseau), mais il appréciait très hautement le niveau de civilisation auquel se trouvait la société anglaise dans son ensemble.
Karamzine – journaliste, éditeur
À l'automne 1790, Karamzine retourna à Moscou et organisa bientôt la publication du mensuel « Journal de Moscou » (1790-1792), dans lequel furent publiées la plupart des « Lettres d'un voyageur russe », racontant les événements révolutionnaires en France. , les histoires « Liodor », « Pauvre Lisa », « Natalia, la fille du boyard », « Flor Silin », des essais, des récits, des articles critiques et des poèmes. Karamzine a attiré toute l'élite littéraire de l'époque pour collaborer à la revue : ses amis Dmitriev et Petrov, Kheraskov et Derjavin, Lvov, Neledinsky-Meletsky et d'autres. Les articles de Karamzin affirmaient une nouvelle direction littéraire- le sentimentalisme.
Le Journal de Moscou ne comptait que 210 abonnés réguliers, mais pour la fin du XVIIIe siècle, cela équivaut à cent mille exemplaires à la fin du XIXe siècle. De plus, le magazine était lu précisément par ceux qui « faisaient la différence » dans la vie littéraire du pays : étudiants, fonctionnaires, jeunes officiers, employés mineurs de diverses agences gouvernementales (« jeunes des archives »).
Après l’arrestation de Novikov, les autorités se sont sérieusement intéressées à l’éditeur du Journal de Moscou. Lors des interrogatoires de l'expédition secrète, ils demandent : est-ce Novikov qui a envoyé le « voyageur russe » à l'étranger en « mission spéciale » ? Les Novikovites étaient des gens d'une grande intégrité et, bien sûr, Karamzine était protégé, mais à cause de ces soupçons, le magazine a dû être arrêté.
Dans les années 1790, Karamzine publia les premiers almanachs russes : « Aglaya » (1794-1795) et « Aonides » (1796-1799). En 1793, lorsque la dictature jacobine fut établie lors de la troisième étape de la Révolution française, ce qui choqua Karamzine par sa cruauté, Nikolaï Mikhaïlovitch abandonna certaines de ses vues antérieures. La dictature a suscité chez lui de sérieux doutes quant à la possibilité pour l’humanité de parvenir à la prospérité. Il a fermement condamné la révolution et toutes les méthodes violentes de transformation de la société. La philosophie du désespoir et du fatalisme imprègne ses nouvelles œuvres : le conte « L'île de Bornholm » (1793) ; "Sierra Morena" (1795); poèmes « Mélancolie », « Message à A. A. Pleshcheev », etc.
Durant cette période, Karamzine connut une véritable renommée littéraire.
Fiodor Glinka : « Sur 1 200 cadets, il était rare qu'il ne répétait pas par cœur une page de L'Île de Bornholm. ».
Le nom Erast, auparavant totalement impopulaire, se retrouve de plus en plus dans les listes de noblesse. Il y a des rumeurs de suicides réussis et infructueux dans l'esprit de la pauvre Lisa. Le mémorialiste venimeux Vigel rappelle que d'importants nobles de Moscou avaient déjà commencé à se contenter de «presque à égalité avec un lieutenant à la retraite de trente ans».
En juillet 1794, la vie de Karamzine faillit prendre fin : sur le chemin du domaine, dans la steppe sauvage, il fut attaqué par des voleurs. Karamzine s'est miraculeusement échappé, recevant deux blessures mineures.
En 1801, il épousa Elizaveta Protasova, une voisine du domaine, qu'il connaissait depuis son enfance - au moment du mariage, ils se connaissaient depuis près de 13 ans.
Réformateur de la langue littéraire russe
Déjà au début des années 1790, Karamzine réfléchissait sérieusement au présent et à l’avenir de la littérature russe. Il écrit à un ami : « Je suis privé du plaisir de lire beaucoup dans ma langue maternelle. Nous sommes encore pauvres en écrivains. Nous avons plusieurs poètes qui méritent d’être lus. Bien sûr, il y avait et il y a des écrivains russes : Lomonosov, Sumarokov, Fonvizin, Derzhavin, mais il n'y a pas plus d'une douzaine de noms significatifs. Karamzine est l'un des premiers à comprendre que ce n'est pas une question de talent : il n'y a pas moins de talents en Russie que dans n'importe quel autre pays. C'est juste que la littérature russe ne peut pas s'éloigner des traditions dépassées depuis longtemps du classicisme, fondées au milieu du XVIIIe siècle par le seul théoricien M.V. Lomonossov.
La réforme de la langue littéraire menée par Lomonossov, ainsi que la théorie des « trois calmes » qu'il a créée, ont répondu aux tâches de la période de transition de la littérature ancienne à la littérature moderne. Le rejet total de l'utilisation des slavonicismes d'Église familiers dans la langue était alors encore prématuré et inapproprié. Mais l'évolution de la langue, amorcée sous Catherine II, se poursuit activement. Les «Trois calmes» proposés par Lomonossov n'étaient pas basés sur un discours familier animé, mais sur la pensée spirituelle d'un écrivain théoricien. Et cette théorie mettait souvent les auteurs dans une position difficile : ils devaient utiliser des expressions slaves lourdes et dépassées où langue parlée ils ont longtemps été remplacés par d'autres, plus doux et plus gracieux. Le lecteur ne pouvait parfois pas « parcourir » les tas de slavismes obsolètes utilisés dans les livres et registres paroissiaux afin de comprendre l'essence de telle ou telle œuvre laïque.
Karamzin a décidé de rapprocher la langue littéraire de la langue parlée. Par conséquent, l'un de ses principaux objectifs était la libération ultérieure de la littérature des slavonicismes de l'Église. Dans la préface du deuxième livre de l’almanach « Aonida », il écrit : « Le tonnerre des mots à lui seul ne fait que nous assourdir et n’atteint jamais notre cœur. »
La deuxième caractéristique de la « nouvelle syllabe » de Karamzine était la simplification des structures syntaxiques. L'écrivain abandonne les longues périodes. Dans le « Panthéon des écrivains russes », il déclara de manière décisive : « La prose de Lomonossov ne peut pas du tout nous servir de modèle : ses longues périodes sont fastidieuses, la disposition des mots n'est pas toujours cohérente avec le flux des pensées. »
Contrairement à Lomonossov, Karamzine s'efforçait d'écrire des phrases courtes et facilement compréhensibles. Cela reste encore un modèle de bon style et un exemple à suivre en littérature.
Le troisième mérite de Karamzine était l’enrichissement de la langue russe avec un certain nombre de néologismes à succès, qui sont fermement entrés dans le courant dominant. vocabulaire. Parmi les innovations proposées par Karamzine figurent des mots aussi connus à notre époque que « industrie », « développement », « sophistication », « concentré », « toucher », « divertissement », « humanité », « public », « généralement utile », « influence » et plusieurs autres.
Lors de la création de néologismes, Karamzine a principalement utilisé la méthode de traçage des mots français : « intéressant » de « intéressant », « raffiné » de « raffine », « développement » de « développement », « touchant » de « touchant ».
Nous savons que même à l'époque de Pierre le Grand, de nombreux mots étrangers sont apparus dans la langue russe, mais ils ont pour la plupart remplacé des mots qui existaient déjà dans la langue slave et n'étaient pas une nécessité. De plus, ces mots étaient souvent pris sous leur forme brute, donc très lourds et maladroits (« fortecia » au lieu de « forteresse », « victoire » au lieu de « victoire », etc.). Karamzine, au contraire, a essayé de donner des mots étrangers Fin russe, en les adaptant aux exigences de la grammaire russe : « sérieux », « moral », « esthétique », « public », « harmonie », « enthousiasme », etc.
Dans ses activités de réforme, Karamzine s'est concentré sur la langue vivante Des gens éduqués. Et ce fut la clé du succès de son travail - il n'écrit pas des traités savants, mais des notes de voyage (« Lettres d'un voyageur russe »), des histoires sentimentales (« Île de Bornholm », « Pauvre Lisa »), des poèmes, des articles, des traductions. du français, de l'anglais et de l'allemand.
"Arzamas" et "Conversation"
Il n'est pas surprenant que la plupart des jeunes écrivains contemporains de Karamzine aient accepté avec brio ses transformations et l'aient volontiers suivi. Mais, comme tout réformateur, Karamzine avait des opposants fidèles et de valeur.
A.S. était à la tête des opposants idéologiques de Karamzine. Shishkov (1774-1841) – amiral, patriote, célèbre homme d'État ce temps. Vieux croyant, admirateur de la langue de Lomonossov, Shishkov, à première vue, était un classique. Mais ce point de vue nécessite d’importantes réserves. Contrairement à l'européanisme de Karamzine, Shishkov a avancé l'idée de nationalité dans la littérature - le signe le plus important d'une vision romantique du monde, loin du classicisme. Il s'avère que Shishkov a également rejoint pour les romantiques, mais pas d'une direction progressiste, mais d'une direction conservatrice. Ses opinions peuvent être reconnues comme une sorte de précurseur du slavophilisme et du pochvénisme ultérieurs.
En 1803, Chichkov présenta son « Discours sur les syllabes anciennes et nouvelles de la langue russe ». Il a reproché aux « karamzinistes » de succomber à la tentation des faux enseignements révolutionnaires européens et a plaidé pour le retour de la littérature à l'art populaire oral, à la langue vernaculaire et aux livres slaves de l'Église orthodoxe.
Shishkov n'était pas philologue. Il traitait plutôt des problèmes de la littérature et de la langue russe en tant qu'amateur, de sorte que les attaques de l'amiral Shishkov contre Karamzin et ses partisans littéraires semblaient parfois moins fondées scientifiquement que idéologiques sans fondement. La réforme linguistique de Karamzine a semblé à Chichkov, guerrier et défenseur de la patrie, antipatriotique et antireligieux : « La langue est l'âme du peuple, le miroir de la morale, un véritable indicateur d'illumination, un témoin incessant des actes. Là où il n’y a pas de foi dans les cœurs, il n’y a pas de piété dans la langue. Là où il n’y a pas d’amour pour la patrie, là la langue n’exprime pas les sentiments domestiques. ».
Chichkov a reproché à Karamzine l'usage excessif des barbarismes (« époque », « harmonie », « catastrophe »), il était dégoûté par les néologismes (« coup d'État » comme traduction du mot « révolution »), les mots artificiels lui faisaient mal à l'oreille : « futur », « bien lu » et etc.
Et nous devons admettre que ses critiques étaient parfois pointues et précises.
Le caractère évasif et esthétique du discours des « karamzinistes » est très vite devenu obsolète et est tombé en désuétude littéraire. C'est précisément l'avenir que leur prédisait Chichkov, estimant qu'au lieu de l'expression « quand le voyage est devenu un besoin de mon âme », on pouvait simplement dire : « quand je suis tombé amoureux du voyage » ; le discours raffiné et périphrasé « des foules hétéroclites de villages ruraux rencontrent des bandes sombres de pharaons reptiles » peut être remplacé par l'expression compréhensible « les gitans viennent à la rencontre des filles du village », etc.
Shishkov et ses partisans ont fait les premiers pas dans l'étude des monuments de l'écriture russe ancienne, ont étudié avec enthousiasme « Le conte de la campagne d'Igor », ont étudié le folklore, ont préconisé le rapprochement de la Russie avec le monde slave et ont reconnu la nécessité d'apporter le style « slovène » plus proche de la langue commune.
Dans un différend avec le traducteur Karamzine, Shishkov a avancé un argument convaincant sur la « nature idiomatique » de chaque langue, sur l'originalité unique de ses systèmes phraséologiques, qui rendent impossible la traduction littérale d'une pensée ou d'un véritable sens sémantique d'une langue à l'autre. un autre. Par exemple, traduite littéralement en français, l’expression « vieux raifort » perd son sens figuré et « ne désigne que la chose elle-même, mais au sens métaphysique elle n’a pas de cercle de signification ».
Au mépris de Karamzine, Chichkov proposa sa propre réforme de la langue russe. Il a proposé de désigner les concepts et les sentiments manquant dans notre vie quotidienne avec de nouveaux mots formés à partir des racines non pas du français, mais du russe et du vieux slave de l'Église. Au lieu de « l'influence » de Karamzine, il a suggéré « l'afflux », au lieu de « développement » - « végétation », au lieu de « acteur » - « acteur », au lieu de « individualité » - « intelligence », « pieds mouillés » au lieu de « galoches » » et « errant » au lieu de « labyrinthe ». La plupart de ses innovations n’ont pas pris racine dans la langue russe.
Il est impossible de ne pas reconnaître l’amour ardent de Chichkov pour la langue russe ; On ne peut s'empêcher d'admettre que la passion pour tout ce qui est étranger, notamment français, est allée trop loin en Russie. En fin de compte, cela a conduit au fait que la langue du peuple, du paysan, est devenue très différente de la langue des classes culturelles. Mais nous ne pouvons ignorer le fait que le processus naturel d’évolution du langage qui avait commencé ne pouvait être arrêté. Il était impossible de remettre en service de force les expressions déjà dépassées à l'époque, proposées par Shishkov : « zane », « laid », « izhe », « yako » et autres.
Karamzine n'a même pas répondu aux accusations de Chichkov et de ses partisans, sachant fermement qu'ils étaient guidés exclusivement par des sentiments pieux et patriotiques. Par la suite, Karamzine lui-même et ses partisans les plus talentueux (Vyazemsky, Pouchkine, Batyushkov) ont suivi les instructions très précieuses des « Chichkovites » sur la nécessité de « retourner à leurs racines » et aux exemples de leur propre histoire. Mais ensuite, ils ne parvenaient pas à se comprendre.
Le pathos et le patriotisme ardent des articles d’A.S. Shishkova a suscité une attitude sympathique parmi de nombreux écrivains. Et lorsque Shishkov, avec G. R. Derzhavin, fonda la société littéraire « Conversation des amoureux de la parole russe » (1811) avec une charte et son propre magazine, P. A. Katenin, I. A. Krylov et plus tard V. K rejoignirent immédiatement cette société. Kuchelbecker et A. S. Griboïedov. L'un des participants actifs à "Conversation...", le prolifique dramaturge A. A. Shakhovskoy, a vicieusement ridiculisé Karamzine dans la comédie "La Nouvelle Stern", et dans la comédie "Une leçon pour les coquettes ou les eaux de Lipetsk" en la personne du Le "balladeer" Fialkin a créé une image parodique de V. A Zhukovsky.
Cela a provoqué une rebuffade unanime de la part des jeunes qui soutenaient l’autorité littéraire de Karamzine. D. V. Dashkov, P. A. Vyazemsky, D. N. Bludov ont composé plusieurs pamphlets pleins d'esprit adressés à Shakhovsky et à d'autres membres de la « Conversation… ». Dans "Vision dans la taverne d'Arzamas", Bludov a donné au cercle des jeunes défenseurs de Karamzine et de Joukovski le nom de "Société des écrivains inconnus d'Arzamas" ou simplement "Arzamas".
La structure organisationnelle de cette société, fondée à l'automne 1815, était dominée par un joyeux esprit parodiant la sérieuse « Conversation... ». Contrairement au faste officiel, la simplicité, le naturel et l'ouverture prévalaient ici ; une grande place était accordée aux plaisanteries et aux jeux.
Parodiant le rituel officiel de la « Conversation… », chacun, en rejoignant Arzamas, devait lire un « discours funéraire » à son prédécesseur « décédé » parmi les membres vivants de la « Conversation… » ou Académie russe sciences (le comte D.I. Khvostov, S.A. Shirinsky-Shikhmatov, A.S. Shishkov lui-même, etc.). Les « discours funéraires » étaient une forme de lutte littéraire : ils parodiaient les grands genres et ridiculisaient l'archaïsme stylistique des œuvres poétiques des « causeurs ». Lors des réunions de la société, les genres humoristiques de la poésie russe ont été perfectionnés, une lutte audacieuse et décisive a été menée contre toutes sortes de bureaucraties et une sorte d'écrivain russe indépendant, libre de la pression de toute convention idéologique, s'est formée. Et bien que P. A. Vyazemsky, l'un des organisateurs et des participants actifs de la société, ait condamné dans ses années de maturité les méfaits de la jeunesse et l'intransigeance de ceux qui partageaient les mêmes idées (en particulier les rituels des « services funéraires » pour les opposants littéraires vivants), il a appelé à juste titre « Arzamas » une école de « camaraderie littéraire » et d’apprentissage créatif mutuel. Les sociétés Arzamas et Beseda devinrent rapidement des centres de vie littéraire et de lutte sociale dans le premier quart du XIXe siècle. «Arzamas» comprenait des personnages célèbres tels que Joukovski (pseudonyme Svetlana), Vyazemsky (Asmodée), Pouchkine (Cricket), Batyushkov (Achille) et d'autres.
« Conversation » a été dissoute après la mort de Derjavin en 1816 ; "Arzamas", ayant perdu son principal adversaire, cessa d'exister en 1818.
Ainsi, au milieu des années 1790, Karamzine devint le chef reconnu du sentimentalisme russe, ouvrant non seulement une nouvelle page dans la littérature russe, mais aussi dans la fiction russe en général. Les lecteurs russes, qui n'avaient auparavant dévoré que des romans français et des œuvres d'éclaireurs, ont accepté avec enthousiasme « Lettres d'un voyageur russe » et « Pauvre Liza », et les écrivains et poètes russes (à la fois « besedchiki » et « Arzamasites ») ont compris que c'était possible doivent écrire dans leur langue maternelle.
Karamzine et Alexandre Ier : une symphonie avec puissance ?
En 1802-1803, Karamzine publie la revue « Bulletin de l'Europe », dans laquelle prédominent la littérature et la politique. En grande partie grâce à la confrontation avec Chichkov, un nouveau programme esthétique pour la formation d’une littérature russe comme nationalement distinctive est apparu dans les articles critiques de Karamzine. Karamzine, contrairement à Shishkov, voyait la clé du caractère unique de la culture russe non pas tant dans l'adhésion aux rituels de l'antiquité et de la religiosité, mais dans les événements de l'histoire russe. L’illustration la plus frappante de ses vues est l’histoire « Marthe la Posadnitsa ou la conquête de Novagorod ».
Dans ses articles politiques de 1802-1803, Karamzine faisait généralement des recommandations au gouvernement, dont la principale était d'éduquer la nation pour la prospérité de l'État autocratique.
Ces idées étaient généralement proches de l'empereur Alexandre Ier, petit-fils de Catherine la Grande, qui rêvait aussi à une époque d'une « monarchie éclairée » et d'une symphonie complète entre les autorités et une société européenne instruite. La réponse de Karamzine au coup d'État du 11 mars 1801 et à l'accession au trône d'Alexandre Ier fut « L'éloge historique de Catherine II » (1802), dans lequel Karamzine exprima son point de vue sur l'essence de la monarchie en Russie, ainsi que sur la devoirs du monarque et de ses sujets. L'« éloge funèbre » fut approuvé par le souverain comme un recueil d'exemples pour le jeune monarque et fut accueilli favorablement par lui. Alexandre Ier était évidemment intéressé par les recherches historiques de Karamzine, et l'empereur a décidé à juste titre que le grand pays avait simplement besoin de se souvenir de son passé non moins grand. Et si vous ne vous en souvenez pas, créez-le au moins à nouveau...
En 1803, grâce à la médiation de l'éducateur du tsar M.N. Muravyov - poète, historien, enseignant, l'une des personnes les plus instruites de l'époque - N.M. Karamzine a reçu le titre officiel d'historiographe de la cour avec une pension de 2 000 roubles. (Une pension de 2 000 roubles par an était alors attribuée aux fonctionnaires qui, selon le tableau des grades, n'avaient pas un grade inférieur à celui de général). Plus tard, I.V. Kireevsky, se référant à Karamzin lui-même, a écrit à propos de Mouravyov : « Qui sait, peut-être que sans son aide réfléchie et chaleureuse, Karamzine n'aurait pas eu les moyens d'accomplir sa grande action. »
En 1804, Karamzine se retira pratiquement des activités littéraires et éditoriales et commença à créer « l'Histoire de l'État russe », sur laquelle il travailla jusqu'à la fin de ses jours. Avec son influence M.N. Mouravyov a mis à la disposition de l'historien de nombreux documents jusqu'alors inconnus, voire « secrets », et a ouvert pour lui des bibliothèques et des archives. Les historiens modernes ne peuvent que rêver de conditions de travail aussi favorables. Par conséquent, à notre avis, parler de « L’histoire de l’État russe » comme d’une « prouesse scientifique » de N.M. Karamzin, pas tout à fait juste. L'historiographe de la cour était de service et accomplissait consciencieusement le travail pour lequel il était payé. En conséquence, il devait écrire une histoire qui était en ce moment nécessaire pour le client, à savoir l'empereur Alexandre Ier, qui, au début de son règne, montra de la sympathie pour le libéralisme européen.
Cependant, sous l'influence des études sur l'histoire de la Russie, Karamzine était devenu en 1810 un conservateur constant. Durant cette période, le système de ses opinions politiques s'est finalement formé. Les déclarations de Karamzine selon lesquelles il est un « républicain dans l’âme » ne peuvent être interprétées de manière adéquate que si l’on considère qu’il s’agit de la « République des Sages de Platon », un ordre social idéal fondé sur la vertu de l’État, une réglementation stricte et le renoncement à la liberté personnelle. . Au début de 1810, Karamzine, par l'intermédiaire de son parent, le comte F.V. Rostopchin, rencontra à Moscou le chef du « parti conservateur » à la cour - la grande-duchesse Ekaterina Pavlovna (sœur d'Alexandre Ier) et commença à visiter constamment sa résidence à Tver. Le salon de la Grande-Duchesse représentait le centre de l'opposition conservatrice au cours libéral-occidental, personnifié par la figure de M. M. Speransky. Dans ce salon, Karamzine a lu des extraits de son «Histoire…», puis il a rencontré l'impératrice douairière Maria Feodorovna, qui est devenue l'une de ses mécènes.
En 1811, à la demande de la grande-duchesse Ekaterina Pavlovna, Karamzine écrivit une note « Sur l'ancienne et la nouvelle Russie dans ses relations politiques et civiles », dans laquelle il expose ses idées sur la structure idéale de l'État russe et critique vivement la politique de Alexandre Ier et ses prédécesseurs immédiats : Paul Ier, Catherine II et Pierre Ier. Au XIXe siècle, la note n'a jamais été publiée dans son intégralité et n'a été diffusée que sous forme de copies manuscrites. À l'époque soviétique, les pensées exprimées par Karamzine dans son message étaient perçues comme une réaction de la noblesse extrêmement conservatrice aux réformes de M. M. Speransky. L’auteur lui-même a été qualifié de « réactionnaire », d’opposant à la libération de la paysannerie et aux autres mesures libérales du gouvernement d’Alexandre Ier.
Cependant, lors de la première publication complète de la note en 1988, Yu. M. Lotman en révéla le contenu plus profond. Dans ce document, Karamzine a formulé une critique justifiée des réformes bureaucratiques non préparées et menées d'en haut. Faisant l'éloge d'Alexandre Ier, l'auteur de la note attaque en même temps ses conseillers, à savoir, bien sûr, Speransky, partisan des réformes constitutionnelles. Karamzine se charge de prouver en détail au tsar, en se référant à des exemples historiques, que la Russie n'est pas prête, ni historiquement ni politiquement, à l'abolition du servage et à la limitation de la monarchie autocratique par la constitution (à l'instar de les puissances européennes). Certains de ses arguments (par exemple, sur la futilité de la libération des paysans sans terre, sur l'impossibilité d'une démocratie constitutionnelle en Russie) semblent encore aujourd'hui tout à fait convaincants et historiquement corrects.
Outre une revue de l'histoire de la Russie et une critique du cours politique de l'empereur Alexandre Ier, la note contenait un concept complet, original et très complexe dans son contenu théorique de l'autocratie en tant que type de pouvoir spécial, typiquement russe, étroitement associé à l'orthodoxie.
Dans le même temps, Karamzine a refusé d’identifier la « véritable autocratie » avec le despotisme, la tyrannie ou l’arbitraire. Il croyait que de tels écarts par rapport aux normes étaient dus au hasard (Ivan IV le Terrible, Paul Ier) et étaient rapidement éliminés par l'inertie de la tradition d'un gouvernement monarchique « sage » et « vertueux ». En cas d'affaiblissement brutal, voire d'absence totale du pouvoir suprême de l'État et de l'Église (par exemple, pendant la période des troubles), cette puissante tradition a conduit, dans un court laps de temps historique, à la restauration de l'autocratie. L’autocratie était le « palladium de la Russie », la principale raison de sa puissance et de sa prospérité. Par conséquent, selon Karamzine, les principes fondamentaux du régime monarchique en Russie auraient dû être préservés à l’avenir. Elles n'auraient dû être complétées que par des politiques appropriées dans le domaine de la législation et de l'éducation, qui ne conduiraient pas à l'affaiblissement de l'autocratie, mais à son renforcement maximum. Avec une telle compréhension de l’autocratie, toute tentative de la limiter serait un crime contre l’histoire et le peuple russes.
Au départ, la note de Karamzine ne faisait qu’irriter le jeune empereur, qui n’aimait pas la critique de ses actions. Dans cette note, l'historiographe se montre plus royaliste que le roi. Cependant, par la suite, le brillant « hymne à l’autocratie russe » présenté par Karamzine a sans aucun doute eu son effet. Après la guerre de 1812, Alexandre Ier, vainqueur de Napoléon, a réduit bon nombre de ses projets libéraux : les réformes de Speransky n'ont pas été achevées, la constitution et l'idée même de limiter l'autocratie ne sont restées que dans l'esprit des futurs décembristes. Et déjà dans les années 1830, le concept de Karamzine constituait effectivement la base de l’idéologie de l’Empire russe, désignée par la « théorie de la nationalité officielle » du comte S. Ouvarov (Orthodoxie-Autocratie-Nationalisme).
Avant la publication des 8 premiers volumes de "Histoire..." Karamzine vivait à Moscou, d'où il se rendait uniquement à Tver pour rendre visite à la grande-duchesse Ekaterina Pavlovna et à Nijni Novgorod, pendant l'occupation de Moscou par les Français. Il passait habituellement l'été à Ostafyevo, la propriété du prince Andrei Ivanovich Viazemsky, dont Karamzin s'est marié en 1804 avec la fille illégitime, Ekaterina Andreevna. (La première épouse de Karamzine, Elizaveta Ivanovna Protasova, est décédée en 1802).
Au cours des dix dernières années de sa vie, que Karamzine a passées à Saint-Pétersbourg, il est devenu très proche de famille royale. Bien que l'empereur Alexandre Ier ait eu une attitude réservée envers Karamzine depuis la soumission de la note, Karamzine passait souvent l'été à Tsarskoïe Selo. À la demande des impératrices (Maria Feodorovna et Elizaveta Alekseevna), il eut plus d'une fois des conversations politiques franches avec l'empereur Alexandre, au cours desquelles il se fit le porte-parole des opinions des opposants aux réformes libérales drastiques. En 1819-1825, Karamzine s'est passionnément rebellé contre les intentions du souverain concernant la Pologne (a soumis une note « Opinion d'un citoyen russe »), a condamné l'augmentation des impôts de l'État en temps de paix, a parlé du système financier provincial absurde, a critiqué le système militaire colonies, les activités du ministère de l'Éducation, ont souligné le choix étrange par le souverain de certains des dignitaires les plus importants (par exemple, Arakcheev), ont évoqué la nécessité de réduire troupes internes, sur la correction imaginaire des routes, si douloureuse pour le peuple, et a constamment souligné la nécessité d'avoir des lois fermes, civiles et étatiques.
Bien sûr, derrière des intercesseurs tels que l'impératrice et la grande-duchesse Ekaterina Pavlovna, il était possible de critiquer, d'argumenter, de faire preuve de courage civique et d'essayer de guider le monarque « sur le vrai chemin ». Ce n'est pas pour rien que l'empereur Alexandre Ier a été surnommé le « sphinx mystérieux » tant par ses contemporains que par les historiens ultérieurs de son règne. En paroles, le souverain était d'accord avec les remarques critiques de Karamzine concernant les colonies militaires, a reconnu la nécessité de « donner des lois fondamentales à la Russie », ainsi que de réviser certains aspects de la politique intérieure, mais il s'est passé dans notre pays qu'en réalité, tous les sages les conseils des responsables gouvernementaux restent « inutiles pour la chère Patrie »...
Karamzine en tant qu'historien
Karamzine est notre premier historien et notre dernier chroniqueur.
Avec sa critique, il appartient à l'histoire,
simplicité et apothegmes - la chronique.
COMME. Pouchkine
Même du point de vue de la science historique contemporaine de Karamzine, personne n’osait qualifier les 12 volumes de son « Histoire de l’État russe » d’ouvrage scientifique. Même alors, il était clair pour tout le monde que le titre honorifique d'historiographe de la cour ne pouvait pas faire d'un écrivain un historien, lui donner les connaissances et la formation appropriées.
Mais, d’un autre côté, Karamzine ne s’est pas initialement fixé pour tâche d’assumer le rôle de chercheur. Le nouvel historiographe n'avait pas l'intention d'écrire un traité scientifique et de s'approprier les lauriers de ses illustres prédécesseurs - Schlözer, Miller, Tatishchev, Shcherbatov, Boltin, etc.
Le travail critique préliminaire sur les sources de Karamzine n’est qu’un « lourd hommage à la fiabilité ». Il était avant tout écrivain, et voulait donc appliquer son talent littéraire à du matériel tout fait : « sélectionner, animer, colorer » et ainsi faire de l'histoire russe « quelque chose d'attrayant, de fort, digne de l'attention des gens ». seulement des Russes, mais aussi des étrangers. » Et il a accompli cette tâche avec brio.
Aujourd'hui, il est impossible de ne pas convenir qu'au début du XIXe siècle, les études des sources, la paléographie et d'autres disciplines historiques auxiliaires en étaient à leurs balbutiements. Par conséquent, exiger de l'écrivain Karamzin une critique professionnelle, ainsi que le strict respect de l'une ou l'autre méthodologie de travail avec des sources historiques, est tout simplement ridicule.
On entend souvent l'opinion selon laquelle Karamzine a simplement magnifiquement réécrit « L'histoire de la Russie depuis l'Antiquité », écrite dans un style obsolète et difficile à lire par le prince M.M. Shcherbatov, y a introduit certaines de ses propres pensées et a ainsi créé un livre pour les amateurs de lectures passionnantes en famille. C'est faux.
Naturellement, en écrivant son «Histoire…», Karamzine a activement utilisé l'expérience et les travaux de ses prédécesseurs - Schlozer et Shcherbatov. Shcherbatov a aidé Karamzine à naviguer dans les sources de l'histoire russe, influençant de manière significative à la fois le choix du matériel et sa disposition dans le texte. Que ce soit par hasard ou non, Karamzine a placé « l’Histoire de l’État russe » exactement au même endroit que « l’Histoire » de Chtcherbatov. Cependant, en plus de suivre le schéma déjà élaboré par ses prédécesseurs, Karamzine fournit dans son ouvrage de nombreuses références à une vaste historiographie étrangère, presque inconnue du lecteur russe. En travaillant sur son « Histoire... », il introduisit pour la première fois dans la circulation scientifique une masse de sources inconnues et jusqu'alors inexplorées. Il s'agit de chroniques byzantines et livoniennes, d'informations provenant d'étrangers sur la population de l'ancienne Rus', ainsi que un grand nombre de Des chroniques russes, qui n'ont pas encore été touchées par la main d'un historien. A titre de comparaison : M.M. Shcherbatov n'a utilisé que 21 chroniques russes pour écrire son œuvre, Karamzine en a activement cité plus de 40. En plus des chroniques, Karamzine a participé à l'étude des monuments du droit russe ancien et de la fiction russe ancienne. Un chapitre spécial de « l’Histoire… » est consacré à la « Vérité russe », et un certain nombre de pages sont consacrées au « Conte de la campagne d’Igor » qui vient d’être découvert.
Grâce à l'aide diligente des directeurs des archives de Moscou du ministère (Collegium) des Affaires étrangères N. N. Bantysh-Kamensky et A. F. Malinovsky, Karamzine a pu utiliser les documents et matériaux qui n'étaient pas disponibles pour ses prédécesseurs. De nombreux manuscrits précieux ont été fournis par le dépôt synodal, les bibliothèques des monastères (Laure de la Trinité, monastère de Volokolamsk et autres), ainsi que par les collections privées de manuscrits de Musin-Pouchkine et de N.P. Roumiantseva. Karamzine a reçu surtout de nombreux documents du chancelier Rumyantsev, qui a rassemblé des documents historiques en Russie et à l'étranger par l'intermédiaire de ses nombreux agents, ainsi que de A.I. Tourgueniev, qui a compilé une collection de documents des archives papales.
De nombreuses sources utilisées par Karamzine ont été perdues lors de l'incendie de Moscou en 1812 et n'ont été conservées que dans son « Histoire... » et ses nombreuses « Notes » accompagnant son texte. Ainsi, l’œuvre de Karamzine elle-même a, dans une certaine mesure, acquis le statut de source historique à laquelle les historiens professionnels ont parfaitement le droit de se référer.
Parmi les principales lacunes de « l’Histoire de l’État russe », on note traditionnellement la vision particulière de l’auteur sur les tâches de l’historien. Selon Karamzine, la « connaissance » et l’« apprentissage » chez un historien « ne remplacent pas le talent pour décrire les actions ». Devant la tâche artistique de l’histoire, même la tâche morale que le mécène de Karamzine, M.N., s’est fixée, passe au second plan. Mouravyov. Les caractéristiques des personnages historiques sont données par Karamzine exclusivement dans une veine littéraire et romantique, caractéristique de l'orientation du sentimentalisme russe qu'il a créée. Les premiers princes russes de Karamzine se distinguent par leur « ardente passion romantique » pour la conquête, leur escouade se distingue par leur noblesse et leur esprit loyal, la « canaille » fait parfois preuve d'insatisfaction, soulevant des rébellions, mais finit par être d'accord avec la sagesse des nobles dirigeants, etc. ., etc. P.
Pendant ce temps, la génération précédente d'historiens, sous l'influence de Schlözer, avait depuis longtemps développé l'idée d'histoire critique, et parmi les contemporains de Karamzine, les exigences de critique des sources historiques, malgré l'absence d'une méthodologie claire, étaient généralement acceptées. . Et la prochaine génération a déjà présenté une demande d'histoire philosophique - avec l'identification des lois du développement de l'État et de la société, la reconnaissance des principales forces motrices et lois du processus historique. Par conséquent, la création trop « littéraire » de Karamzine a immédiatement fait l’objet de critiques fondées.
Selon l'idée, fermement ancrée dans l'historiographie russe et étrangère des XVIIe et XVIIIe siècles, le développement du processus historique dépend du développement du pouvoir monarchique. Karamzine ne s'écarte pas d'un iota de cette idée : le pouvoir monarchique exaltait la Russie sous la période de Kiev ; la division du pouvoir entre les princes était une erreur politique, qui fut corrigée par le sens politique des princes de Moscou - les collectionneurs de la Russie. Dans le même temps, ce sont les princes qui en corrigent les conséquences : la fragmentation de la Russie et le joug tatare.
Mais avant de reprocher à Karamzine de ne rien apporter de nouveau dans le développement de l'historiographie russe, il faut rappeler que l'auteur de « L'Histoire de l'État russe » ne s'est pas du tout fixé pour tâche de comprendre philosophiquement le processus historique ou d'imiter aveuglément les idées des romantiques d'Europe occidentale (F. Guizot, F. Mignet, J. Meschlet), qui commençaient déjà à parler de la « lutte des classes » et de « l'esprit du peuple » comme principal moteur de l'histoire. Critique historique Karamzine n’était pas du tout intéressé et niait délibérément la direction « philosophique » de l’histoire. Les conclusions du chercheur à partir du matériel historique, ainsi que ses fabrications subjectives, semblent à Karamzine être une « métaphysique », qui n'est pas adaptée « pour décrire l'action et le caractère ».
Ainsi, avec ses vues uniques sur les tâches d'un historien, Karamzine est resté, dans l'ensemble, en dehors des tendances dominantes de l'historiographie russe et européenne des XIXe et XXe siècles. Bien sûr, il a participé à son développement constant, mais uniquement en tant qu'objet de critiques constantes et l'exemple le plus brillant il n’est pas nécessaire d’écrire comment l’histoire doit être écrite.
Réaction des contemporains
Les contemporains de Karamzine - lecteurs et fans - ont accepté avec enthousiasme sa nouvelle œuvre « historique ». Les huit premiers volumes de « l’Histoire de l’État russe » furent imprimés en 1816-1817 et mis en vente en février 1818. Un énorme tirage de trois mille exemplaires pour l'époque a été épuisé en 25 jours. (Et ceci malgré le prix élevé de 50 roubles). Une deuxième édition fut immédiatement nécessaire, réalisée en 1818-1819 par I.V. Slenin. En 1821, un nouveau neuvième volume fut publié, et en 1824 les deux suivants. L'auteur n'a pas eu le temps de terminer le douzième volume de son ouvrage, publié en 1829, près de trois ans après sa mort.
"Histoire..." était admiré par les amis littéraires de Karamzine et par le vaste public de lecteurs non spécialisés qui découvraient soudain, comme le comte Tolstoï l'Américain, que leur patrie avait une histoire. Selon A.S. Pouchkine, « tout le monde, même les femmes laïques, s'est précipité pour lire l'histoire de leur patrie, jusqu'alors inconnue d'eux. Elle était une nouvelle découverte pour eux. La Russie antique semblait avoir été découverte par Karamzine, comme l'Amérique par Colomb.
Les cercles intellectuels libéraux des années 1820 trouvèrent « l’Histoire… » de Karamzine arriérée dans ses vues générales et trop tendancieuse :
Les spécialistes de la recherche, comme déjà mentionné, ont traité l’œuvre de Karamzine précisément comme une œuvre, la dévalorisant parfois même. signification historique. Pour beaucoup, l’entreprise de Karamzine elle-même semblait trop risquée : entreprendre d’écrire un ouvrage aussi vaste, compte tenu de l’état de la science historique russe à l’époque.
Déjà du vivant de Karamzine, des analyses critiques de son « Histoire… » parurent et, peu après la mort de l’auteur, des tentatives furent faites pour déterminer sens général ce travail en historiographie. Lelevel a souligné une déformation involontaire de la vérité due aux passe-temps patriotiques, religieux et politiques de Karamzine. Artsybashev a montré à quel point les techniques littéraires d’un historien profane nuisent à l’écriture de « l’histoire ». Pogodine a résumé toutes les lacunes de l'Histoire, et N.A. Polevoy voyait la raison générale de ces défauts dans le fait que « Karamzine n'est pas un écrivain de notre temps ». Tous ses points de vue, tant littéraires que philosophiques, politiques et historiques, sont devenus obsolètes avec l'avènement de nouvelles influences du romantisme européen en Russie. Contrairement à Karamzine, Polevoy écrivit bientôt son « Histoire du peuple russe » en six volumes, dans lequel il s'abandonna complètement aux idées de Guizot et d'autres romantiques d'Europe occidentale. Les contemporains ont évalué cette œuvre comme une « parodie indigne » de Karamzine, soumettant l'auteur à des attaques plutôt vicieuses et pas toujours méritées.
Dans les années 1830, « l’Histoire… » de Karamzine devint l’étendard du mouvement officiellement « russe ». Avec l’aide du même Pogodin, sa réhabilitation scientifique est en cours, ce qui est pleinement conforme à l’esprit de la « théorie de la nationalité officielle » d’Uvarov.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, de nombreux articles de vulgarisation scientifique et d'autres textes ont été rédigés sur la base de «l'Histoire…», qui ont servi de base à des supports pédagogiques et pédagogiques bien connus. Sur la base des récits historiques de Karamzine, de nombreuses œuvres ont été créées pour les enfants et les jeunes, dont le but a été pendant de nombreuses années d'éduquer le patriotisme, la loyauté envers le devoir civique et la responsabilité de la jeune génération quant au sort de sa patrie. Ce livre, à notre avis, a joué un rôle décisif dans la formation des opinions de plus d'une génération du peuple russe, ayant un impact significatif sur les fondements de l'éducation patriotique de la jeunesse à la fin du XIXe et au début du XXe siècle.
14 décembre. La finale de Karamzine.
La mort de l'empereur Alexandre Ier et les événements de décembre 1925 ont profondément choqué N.M. Karamzin et a eu un impact négatif sur sa santé.
Le 14 décembre 1825, ayant reçu la nouvelle du soulèvement, l'historien sort dans la rue : « J'ai vu des visages terribles, entendu des paroles terribles, cinq ou six pierres sont tombées à mes pieds. »
Karamzine, bien entendu, considérait l'action de la noblesse contre son souverain comme une rébellion et un crime grave. Mais parmi les rebelles, il y avait tant de connaissances : les frères Mouravyov, Nikolaï Tourgueniev, Bestoujev, Ryleev, Kuchelbecker (il a traduit « l'Histoire » de Karamzine en allemand).
Quelques jours plus tard, Karamzine dira à propos des décembristes : « Les illusions et les crimes de ces jeunes sont les illusions et les crimes de notre siècle. »
Le 14 décembre, lors de ses déplacements à Saint-Pétersbourg, Karamzine a attrapé un grave rhume et contracté une pneumonie. Aux yeux de ses contemporains, il fut une autre victime de cette époque : sa conception du monde s'effondra, sa foi en l'avenir se perdit et un nouveau roi monta sur le trône, très loin de l'image idéale d'un homme éclairé. monarque. À moitié malade, Karamzine visitait le palais tous les jours, où il s'entretenait avec l'impératrice Maria Feodorovna, passant des souvenirs du défunt empereur Alexandre aux discussions sur les tâches du futur règne.
Karamzine ne pouvait plus écrire. Le XIIe volume de « l’Histoire… » se figea pendant l’interrègne de 1611-1612. Les derniers mots du dernier volume parlent d’une petite forteresse russe : « Nout n’a pas abandonné ». La dernière chose que Karamzine réussit réellement à faire au printemps 1826 fut de persuader Nicolas Ier, avec Joukovski, de ramener Pouchkine d'exil. Quelques années plus tard, l'empereur tenta de passer le relais du premier historiographe de Russie au poète, mais le « soleil de la poésie russe » ne rentrait pas dans le rôle d'idéologue et de théoricien d'État...
Au printemps 1826 N.M. Karamzine, sur les conseils des médecins, a décidé de se rendre dans le sud de la France ou en Italie pour se faire soigner. Nicolas Ier a accepté de parrainer son voyage et a aimablement mis une frégate de la Marine Impériale à la disposition de l'historiographe. Mais Karamzine était déjà trop faible pour voyager. Il décède le 22 mai (3 juin 1826) à Saint-Pétersbourg. Il a été enterré au cimetière Tikhvine de la Laure Alexandre Nevski.
« ...Un peuple qui méprisait son
histoire, méprisant : pour
frivole - les ancêtres étaient
pas pire que lui"
N.M. Karamzine /13, p.160/
Nikolaï Mikhaïlovitch Karamzine est le maître des esprits de la Russie de la fin du XVIIe et du début du XIXe siècle. Le rôle de Karamzine dans la culture russe est grand et ce qu’il a fait pour le bien de la patrie suffirait à plus d’une vie. Il incarnait bon nombre des meilleurs traits de son siècle, apparaissant devant ses contemporains comme un maître littéraire de premier ordre (poète, dramaturge, critique, traducteur), un réformateur qui a posé les bases du langage littéraire moderne, un grand journaliste, un organisateur d'édition et fondateur de merveilleux magazines. Un maître de l’expression artistique et un historien talentueux se fondent dans la personnalité de Karamzine. Il a laissé une marque notable dans les domaines scientifique, journalistique et artistique. Karamzine a largement préparé le succès de ses jeunes contemporains et disciples, figures de la période Pouchkine, l'âge d'or de la littérature russe. N.M. Karamzine est né le 1er décembre 1766. Et pendant ses cinquante-neuf ans, il a vécu une vie intéressante et mouvementée, pleine de dynamisme et de créativité. Il a fait ses études dans un internat privé à Simbirsk, puis à l'internat de Moscou du professeur M.P. Shaden, puis s'est présenté à Saint-Pétersbourg pour le service et a reçu le grade de sous-officier. Il travaille ensuite comme traducteur et rédacteur dans diverses revues, se rapprochant de nombreux des personnes célèbres de cette époque (M.M. Novikov, M.T. Tourgueniev). Puis il voyage à travers l'Europe pendant plus d'un an (de mai 1789 à septembre 1790) ; Pendant le voyage, il prend des notes, après traitement desquelles apparaissent les fameuses « Lettres d'un voyageur russe ».
La connaissance du passé et du présent a conduit Karamzine à rompre avec les francs-maçons, qui étaient très influents en Russie en fin XVIII V. Il retourne dans son pays natal avec un vaste programme d'activités d'édition et de magazine, dans l'espoir de contribuer à l'éducation du peuple. Il crée le « Journal de Moscou » (1791-1792) et le « Bulletin de l'Europe » (1802-1803), publie deux volumes de l'almanach « Aglaya » (1794-1795) et de l'almanach poétique « Aonides ». Son chemin créatif se poursuit et se termine avec l'ouvrage «Histoire de l'État russe», qui a duré de nombreuses années et qui est devenu le principal résultat de son travail.
Karamzine envisageait depuis longtemps l'idée de créer une grande toile historique. Comme preuve de l'existence de tels projets, on cite le message de Karamzine dans les « Lettres d'un voyageur russe » concernant une rencontre en 1790 à Paris avec P.-S. Level, auteur de « Histoire de Russie, triée des chroniques originales, des pièces extérieures et des meilleurs historiens de la nation » (un seul volume fut traduit en Russie en 1797) /25, p.515/. En réfléchissant aux mérites et aux inconvénients de ce travail, l'écrivain est arrivé à une conclusion décevante : « Cela fait mal, mais il faut dire en toute honnêteté que nous n'avons toujours pas une bonne histoire russe » /16, p.252/. Il a compris qu’un tel ouvrage ne pouvait être écrit sans le libre accès aux manuscrits et aux documents présents dans les dépôts officiels. Il se tourna vers l'empereur Alexandre Ier par l'intermédiaire de M.M. Muravyova (administratrice du district éducatif de Moscou). « L'appel fut couronné de succès et le 31 octobre 1803, Karamzine fut nommé historiographe et reçut une pension annuelle et un accès aux archives » /14, p.251/. Les décrets impériaux offrent à l’historiographe des conditions optimales pour travailler sur « l’Histoire… ».
Le travail sur « L’histoire de l’État russe » a nécessité le renoncement à soi-même, l’abandon de l’image et du mode de vie habituels. Dans l'expression figurative de P.A. Viazemsky, Karamzine « s'est coiffé en tant qu'historien ». Et au printemps 1818, les huit premiers volumes d’histoire parurent sur les étagères des livres. Trois mille exemplaires de « Histoire… » furent vendus en vingt-cinq jours. La reconnaissance de ses compatriotes a inspiré et encouragé l'écrivain, surtout après la détérioration des relations de l'historiographe avec Alexandre Ier (après la publication de la note «Sur l'ancienne et la nouvelle Russie», dans laquelle Karamzine, en un sens, critiquait Alexandre Ier). La résonance publique et littéraire des huit premiers volumes de « Histoire... » en Russie et à l’étranger fut si grande que même l’Académie russe, un bastion de longue date des opposants de Karamzine, fut obligée de reconnaître ses mérites.
Le succès auprès des lecteurs des huit premiers volumes de «Histoire…» a donné à l'écrivain une nouvelle force pour poursuivre ses travaux. En 1821, le neuvième volume de son ouvrage voit le jour. La mort d'Alexandre Ier et le soulèvement des décembristes ont retardé les travaux sur « l'Histoire… ». Ayant attrapé froid dans la rue le jour du soulèvement, l'historiographe ne poursuit son travail qu'en janvier 1826. Mais les médecins ont assuré que seule l'Italie pourrait se rétablir complètement. Se rendant en Italie et espérant y terminer l'écriture des deux derniers chapitres du dernier volume, Karamzine chargea D.N. Bludov a tout à voir avec la future édition du douzième volume. Mais le 22 mai 1826, sans quitter l'Italie, Karamzine mourut. Le douzième volume ne fut publié qu'en 1828.
Ayant repris le travail de N.M. Karamzin, on ne peut qu'imaginer à quel point le travail de l'historiographe a été difficile. Un écrivain, poète, historien amateur se lance dans une tâche d'une complexité incongrue, exigeant d'énormes entraînement spécial. S'il avait évité les sujets sérieux et purement intelligents, mais s'était contenté de raconter de manière vivante les temps passés, « d'animer et de colorer » - cela aurait encore été considéré comme naturel, mais dès le début le volume est divisé en deux moitiés : dans la première - une histoire vivante, et celle à qui cela suffit ; vous n'aurez peut-être pas besoin de regarder dans la deuxième section, où se trouvent des centaines de notes, des références à des chroniques, des sources latines, suédoises et allemandes. L'histoire est une science très dure, même si l'on suppose que l'historien connaît de nombreuses langues, mais en plus de cela apparaissent des sources arabes, hongroises, juives, caucasiennes... Et même au début du XIXe siècle. la science de l'histoire ne se démarquait pas nettement de la littérature, tout de même, l'écrivain Karamzin a dû se plonger dans la paléographie, la philosophie, la géographie, l'archéographie... Tatishchev et Shcherbatov ont cependant combiné l'histoire avec des activités gouvernementales sérieuses, mais le professionnalisme est constamment en augmentant; de l'Occident viennent les travaux sérieux de scientifiques allemands et anglais ; Les anciennes méthodes naïves d'écriture historique sont clairement en train de disparaître, et la question elle-même se pose : quand Karamzine, un écrivain de quarante ans, maîtrisera-t-il toute l'ancienne et la nouvelle sagesse ? La réponse à cette question nous est donnée par N. Eidelman, qui rapporte que « ce n'est qu'au cours de la troisième année que Karamzine avoue à des amis proches qu'il cesse d'avoir peur de la « férule de Schletser », c'est-à-dire du bâton avec lequel un vénérable Un académicien allemand pouvait fouetter un étudiant imprudent » / 70, p. 55/.
Un seul historien ne peut pas trouver et traiter une telle quantité de matériaux sur la base desquels « l’Histoire de l’État russe » a été écrite. Il s'ensuit que N.M. Karamzin a été aidé par ses nombreux amis. Bien sûr, il s'est rendu aux archives, mais pas trop souvent : plusieurs employés spéciaux, dirigés par le chef des archives de Moscou du ministère des Affaires étrangères et un excellent expert en antiquité, Alexei Fedorovich Malinovsky, ont fouillé, sélectionné et livré manuscrits anciens directement au bureau de l'historiographe. Archives et collections de livres du collège étranger du Synode, de l'Ermitage, de la Bibliothèque publique impériale, de l'Université de Moscou, de la Laure de la Trinité-Serge et d'Alexandre Nevski, de Volokolamsk, des monastères de la Résurrection ; à cela s'ajoutent des dizaines de collections privées, enfin des archives et bibliothèques d'Oxford, Paris, Copenhague et autres centres étrangers. Parmi ceux qui ont travaillé pour Karamzine (dès le début et plus tard), il y avait plusieurs scientifiques remarquables à l'avenir, par exemple Stroev, Kalaidovich... Ils ont envoyé plus de commentaires que d'autres sur les volumes déjà publiés.
Dans certaines œuvres modernes, on reproche à Karamzine de ne pas avoir travaillé « seul » /70, p.55/. Mais autrement, il ne lui aurait pas fallu 25 ans pour écrire « L’Histoire… », mais bien plus. Eidelman s’y oppose à juste titre : « il est dangereux pour l’un de juger une époque selon les règles d’une autre » /70, p.55/.
Plus tard, lorsque la personnalité d'auteur de Karamzine se développera, une combinaison d'historiographe et de jeunes collaborateurs émergera, ce qui peut sembler délicat... Cependant, dans les premières années du XIXe siècle. dans une telle combinaison, cela semblait tout à fait normal, et les portes des archives n'auraient guère été ouvertes aux plus jeunes s'il n'y avait pas eu un décret impérial concernant l'aîné. Karamzine lui-même, altruiste et doté d'un sens aigu de l'honneur, ne se permettrait jamais de devenir célèbre aux dépens de ses employés. D'ailleurs, est-ce que seuls « les régiments d'archives travaillaient pour le Comte de l'Histoire » ? /70, p.56/. Il s'avère que non. « Des gens aussi formidables que Derjavin lui envoient leurs réflexions sur l'ancienne Novgorod, le jeune Alexandre Tourgueniev apporte les livres nécessaires de Göttingen, promet d'envoyer des manuscrits anciens à D.I. Yazykov, A.R. Vorontsov. Plus importante encore est la participation des principaux collectionneurs : A.N. Musina-Pouchkina, N.P. Roumiantseva ; l'un des futurs présidents de l'Académie des sciences A.N. Olénine envoya à Karamzine le 12 juillet 1806 l'Évangile d'Ostromir de 1057. » /70, p.56/. Mais cela ne signifie pas que tout le travail de Karamzine a été réalisé par ses amis : il l’a découvert lui-même et a stimulé les autres avec son travail pour le trouver. Karamzine lui-même a trouvé les Chroniques d'Ipatiev et de la Trinité, le Code de loi d'Ivan le Terrible et « La Prière de Daniel le Prisonnier ». Pour son «Histoire…» Karamzine a utilisé une quarantaine de chroniques (à titre de comparaison, disons que Chtcherbatov a étudié vingt et une chroniques). Aussi, le grand mérite de l'historiographe est d'avoir su non seulement rassembler tout ce matériel, mais aussi organiser de facto le travail d'un véritable laboratoire de création.
Le travail sur «l’Histoire…» est en quelque sorte un tournant qui a influencé la vision du monde et la méthodologie de l’auteur. Dans le dernier quart du XVIII. En Russie, les caractéristiques de la décomposition du système économique féodal et servage sont devenues de plus en plus visibles. Les changements dans la vie économique et sociale de la Russie et le développement des relations bourgeoises en Europe ont influencé la politique intérieure de l'autocratie. Le temps a confronté la classe dirigeante russe à la nécessité de développer des réformes sociopolitiques qui garantiraient la préservation de la position dominante de la classe des propriétaires terriens et du pouvoir de l'autocratie.
« C’est à cette époque que l’on peut attribuer la fin de la quête idéologique de Karamzine. Il est devenu l'idéologue de la partie conservatrice de la noblesse russe » /36, p.141/. La formulation finale de son programme socio-politique, dont le contenu objectif était la préservation du système autocratique-servage, tombe dans la deuxième décennie du XIXe siècle, c'est-à-dire au moment de la création des « Notes sur l'Antiquité et le servage ». Nouvelle Russie. » La révolution en France et le développement post-révolutionnaire de la France ont joué un rôle décisif dans la conception du programme politique conservateur de Karamzine. « Il semblait à Karamzine que les événements survenus en France à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. a historiquement confirmé ses conclusions théoriques sur les voies du développement humain. Il considérait comme la seule voie acceptable et correcte de développement évolutif progressif, sans aucune explosion révolutionnaire et dans le cadre de ces relations sociales, la structure étatique caractéristique d'un peuple donné » /36, p.145/. Laissant en vigueur la théorie de l'origine contractuelle du pouvoir, Karamzine place désormais ses formes en stricte dépendance des traditions anciennes et du caractère national. De plus, les croyances et les coutumes sont élevées au rang d’une sorte d’absolu qui détermine le destin historique des peuples. « Les institutions de l’Antiquité », écrit-il dans l’article « Points de vue, espoirs et désirs notables du temps présent », « ont pouvoir magique, qui ne peut être remplacé par aucun pouvoir de l’esprit » /17, p.215/. Ainsi, la tradition historique s’opposait aux transformations révolutionnaires. Le système sociopolitique en est devenu directement dépendant : les anciennes coutumes et institutions traditionnelles ont finalement déterminé la forme politique de l'État. Cela transparaît très clairement dans l’attitude de Karamzine à l’égard de la république. Idéologue de l'autocratie, Karamzine a néanmoins déclaré ses sympathies pour le système républicain. Sa lettre à P.A. est connue. Viazemsky de 1820, dans lequel il écrit : « Je suis républicain dans l'âme et je mourrai comme ça » /12, p.209/. Théoriquement, Karamzine croyait qu'une république était une forme de gouvernement plus moderne qu'une monarchie. Mais elle ne peut exister que si un certain nombre de conditions sont réunies, et en leur absence, la république perd tout sens et tout droit d’exister. Karamzin a reconnu les républiques comme une forme humaine d'organisation de la société, mais a fait dépendre la possibilité de l'existence d'une république des anciennes coutumes et traditions, ainsi que de l'état moral de la société /36, p.151/.
Karamzine était une figure complexe et contradictoire. Comme tous ceux qui l’ont connu l’ont remarqué, c’était un homme très exigeant envers lui-même et envers son entourage. Comme l’ont noté ses contemporains, il était sincère dans ses actions et ses convictions et avait une façon de penser indépendante. Compte tenu de ces qualités de l'historiographe, l'incohérence de son caractère peut s'expliquer par le fait qu'il comprenait l'antiquité de l'ordre existant en Russie, mais la peur de la révolution, du soulèvement paysan l'a contraint à s'accrocher à l'ancien : à l'autocratie. , au système de servage qui, selon lui, a assuré pendant plusieurs siècles le développement progressif de la Russie.
Vers la fin du XVIIIe siècle. Karamzine avait la ferme conviction que la forme monarchique de gouvernement correspond le mieux au niveau actuel de développement de la moralité et de l'éducation en Russie. La situation historique en Russie au début du XIXe siècle, l'exacerbation des contradictions de classe dans le pays, la prise de conscience croissante dans la société russe de la nécessité d'une transformation sociale - tout cela a amené Karamzine à s'efforcer de contrer l'influence du nouveau avec quelque chose qui pourrait résister à cette pression. Dans ces conditions, un pouvoir autocratique ferme lui semblait une garantie fiable de silence et de sécurité. Fin du XVIIIe siècle. L’intérêt de Karamzine pour l’histoire de la Russie et la vie politique du pays augmente. La question de la nature du pouvoir autocratique, de ses relations avec le peuple et, surtout, avec la noblesse, de la personnalité du tsar et de son devoir envers la société est devenue le centre de son attention lors de l'écriture de « L'Histoire de l'État russe ».
Karamzine considérait l’autocratie comme « le pouvoir unique de l’autocrate, non limité par aucune institution ». Mais l’autocratie, selon Karamzine, ne signifie pas l’arbitraire du dirigeant. Cela présuppose l'existence de « statuts fermes » - des lois selon lesquelles l'autocrate gouverne l'État, car la société civile est le lieu où les lois existent et sont appliquées, c'est-à-dire en pleine conformité avec les lois du rationalisme du XVIIIe siècle. A Karamzine, l'autocrate agit comme un législateur : la loi qu'il a adoptée est obligatoire non seulement pour ses sujets, mais aussi pour l'autocrate lui-même /36, p.162/. Ayant reconnu la monarchie comme la seule forme de gouvernement acceptable pour la Russie, Karamzine a naturellement accepté la division de classe de la société, puisqu'elle réside dans le principe même du système monarchique. Karamzine considérait cette division de la société comme éternelle et naturelle : « chaque classe portait certaines responsabilités par rapport à l'État ». Reconnaissant l'importance et la nécessité des deux classes inférieures, Karamzine, dans l'esprit de la tradition noble, défendit le droit des nobles à des privilèges spéciaux par l'importance de leur service à l'État : « Il considérait la noblesse comme le principal soutien de le trône » /36, p.176/.
Ainsi, dans les conditions du début de la décomposition du système économique féodal-servage, Karamzine a proposé un programme pour sa préservation en Russie. Son programme sociopolitique comprenait également l'éducation et l'éducation de la noblesse. Il espérait que la noblesse du futur commencerait à s'engager dans l'art, la science, la littérature et en ferait sa profession. De cette manière, il renforcera sa position en prenant en main l’appareil des Lumières.
Karamzine a placé toutes ses opinions sociopolitiques dans « l'Histoire de l'État russe » et a tracé avec cet ouvrage la ligne de toutes ses activités.
Karamzine a joué un rôle important dans le développement de la culture russe. La complexité et l'incohérence de son idéologie reflètent la fausseté et l'incohérence de l'époque elle-même, la complexité de la position de la classe noble à une époque où le système féodal avait déjà perdu son potentiel et où la noblesse en tant que classe devenait conservatrice et force réactionnaire.
« L'Histoire de l'État russe » est la plus grande réalisation de la science historique russe et mondiale pour son époque, la première description monographique de l'histoire russe depuis l'Antiquité jusqu'au début du XVIIIe siècle.
L’œuvre de Karamzine a donné lieu à des discussions animées et fructueuses pour le développement de l’historiographie. Dans les différends avec son concept, ses points de vue sur le processus historique et les événements du passé, d'autres idées et études historiques généralisantes sont apparues - « L'histoire du peuple russe » de M.A. Polevoy, « L'histoire de la Russie depuis l'Antiquité » de S.M. Soloviev et autres œuvres. Perdant au fil des années sa propre signification scientifique, « l’Histoire… » de Karamzine a conservé sa signification culturelle et historiographique générale ; les dramaturges, les artistes et les musiciens en ont tiré des intrigues. Et par conséquent, cette œuvre de Karamzine est incluse « dans le corpus de ces textes classiques, sans la connaissance desquels l'histoire de la culture russe et de la science historique ne peut être pleinement comprise » /26, p.400/. Mais malheureusement, après la Révolution d’Octobre, la perception de « l’Histoire… » comme une œuvre monarchiste réactionnaire a fermé son chemin au lecteur pendant de nombreuses décennies. Depuis le milieu des années 80, lorsqu'une période de repensation du chemin historique et de destruction des stéréotypes idéologiques et des idées oppressives a commencé dans la société, un flux de nouvelles acquisitions humanistes, de découvertes et de retour à la vie de nombreuses créations de l'humanité a commencé à affluer. , et avec eux un flot de nouveaux espoirs et illusions. Parallèlement à ces changements, N.M. est revenu vers nous. Karamzine avec son immortelle «Histoire…». Quelle est la raison de ce phénomène socioculturel, dont la manifestation a été la publication répétée d'extraits de « l'Histoire… », sa reproduction en fac-similé, la lecture de ses parties individuelles à la radio, etc. UN. Sakharov a suggéré que « la raison en est l’énorme pouvoir d’influence spirituelle du talent véritablement scientifique et artistique de Karamzine sur les gens » /58, p.416/. L'auteur de cet ouvrage partage pleinement cet avis : après tout, les années passent, mais le talent reste jeune. "L'Histoire de l'État russe" a révélé chez Karamzine une véritable spiritualité, fondée sur le désir de répondre aux questions éternelles qui concernent l'homme et l'humanité - les questions de l'existence et du but de la vie, les modèles de développement des pays et des peuples, les relations entre l'individu, la famille et la société, etc. N.M. Karamzine n'était qu'un de ceux qui ont soulevé ces questions et ont essayé, au mieux de leurs capacités, de les résoudre en utilisant le matériel de l'histoire nationale. Autrement dit, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une combinaison de science et de vulgarisation journalistique dans l'esprit des ouvrages historiques à la mode qui conviennent au lecteur.
Depuis la publication de « L’Histoire de l’État russe », la science historique a beaucoup progressé. Déjà pour de nombreux contemporains de Karamzine, le concept monarchique de l'œuvre de l'historiographe de l'Empire russe, son désir, parfois avec des données objectives, de subordonner à ce concept l'histoire du processus historique russe depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, semblait tendu , non prouvé et même nocif. Et pourtant, l'intérêt pour cette œuvre immédiatement après sa sortie était énorme.
Alexandre Ier s'attendait à ce que Karamzine raconte l'histoire de l'Empire russe. Il voulait « que la plume d'un écrivain éclairé et reconnu raconte son empire et celui de ses ancêtres » /66, p.267/. Cela s’est passé différemment. Karamzine fut le premier dans l'historiographie russe à promettre avec son titre non pas l'histoire du « royaume », comme dans G.F. Miller, pas seulement " histoire russe", comme M.V. Lomonosov, V.N. Tatishcheva, M.M. Shcherbatov et l'histoire de l'État russe en tant que « domination de tribus russes hétérogènes » /39, p.17/. Cette différence purement externe entre le titre de Karamzine et les ouvrages historiques antérieurs n’était pas fortuite. La Russie n’appartient ni aux tsars ni aux empereurs. Retour au 18ème siècle. L'historiographie progressiste, dans la lutte contre l'approche théologique de l'étude du passé, défendant le développement progressif de l'humanité, a commencé à considérer l'histoire de la société comme l'histoire de l'État. L'État a été proclamé instrument du progrès et le progrès a été évalué du point de vue du principe étatique. En conséquence, le « sujet de l’histoire » devient des « repères d’État », des signes définis de l’État qui semblaient les plus importants pour assurer le bonheur humain /29, p. 7/. Pour Karamzine, le développement des attractions publiques est aussi une mesure de progrès. Il le compare aux idées d'un État idéal, dont les « attraits » les plus importants étaient : l'indépendance, la force interne, le développement de l'artisanat, du commerce, de la science, de l'art et, surtout, une organisation politique solide qui assure tout cela - un certaine forme de gouvernement déterminée par l'État du territoire, les traditions historiques, les droits, les coutumes. L'idée de repères étatiques, ainsi que l'importance que Karamzine attachait à chacun d'eux dans le développement progressif de l'État lui-même, se reflétaient déjà dans la structure de son œuvre, l'exhaustivité de sa couverture de divers aspects de l'histoire. passé. L'historiographe accorde la plus grande attention à l'histoire de l'organisation politique de l'État russe - l'autocratie, ainsi qu'aux événements de l'histoire politique en général : guerres, relations diplomatiques, amélioration de la législation. Il ne considère pas l'histoire dans des chapitres spéciaux, concluant la fin d'une période ou d'un règne historique important, de son point de vue, en tentant une sorte de synthèse du développement d'« attractions étatiques » assez stables : les limites de l'État. État, « lois civiles », « art martial », « succès de la raison » et autres.
Déjà les contemporains de Karamzine, parmi lesquels de nombreux critiques de son œuvre, attiraient l’attention sur la caractéristique déterminante de « l’Histoire… », incomparable avec aucune des œuvres historiques précédentes : son intégrité. « L'intégrité de l'œuvre de Karamzine a été donnée par un concept dans lequel l'idée de l'autocratie en tant que facteur principal du processus historique a joué un rôle décisif » /39, p.18/. Cette idée imprègne toutes les pages de « l’Histoire… », tantôt elle est irritante et agaçante, tantôt elle semble primitive. Mais même des critiques aussi irréconciliables de l'autocratie que les décembristes, en désaccord avec Karamzine et prouvant facilement son incohérence, ont rendu hommage à l'historiographe pour son dévouement sincère à cette idée, l'habileté avec laquelle il l'a mise en œuvre dans son travail. La base du concept de Karamzin remonte à la thèse de Montesquieu selon laquelle « un État immense ne peut avoir qu’une forme de gouvernement monarchique » /39, p.18/. Karamzine va plus loin : non seulement la monarchie, mais aussi l'autocratie, c'est-à-dire non seulement le gouvernement héréditaire individuel, mais aussi le pouvoir illimité d'une seule personne qui peut même être élue au trône. L'essentiel est qu'il existe une «véritable autocratie» - le pouvoir illimité d'une personne investie de pouvoirs élevés, observant strictement et strictement de nouvelles lois éprouvées ou adoptées de manière réfléchie, adhérant aux règles morales, soucieuse du bien-être de ses sujets. Cet autocrate idéal doit incarner la « véritable autocratie » en tant que facteur le plus important de l’ordre et de l’amélioration de l’État. Le processus historique russe, selon Karamzine, est un mouvement lent, parfois en zigzag, mais constant vers une « véritable autocratie ». Il s'est déroulé, d'une part, dans la lutte constante du principe autocratique avec des tendances et des forces oligarchiques et aristocratiques spécifiques. , et d’autre part, dans l’affaiblissement puis la liquidation par l’autocratie des traditions de l’ancien pouvoir populaire. Pour Karamzine, le pouvoir de l'aristocratie, de l'oligarchie, des princes apanages et le pouvoir du peuple sont non seulement deux forces inconciliables, mais aussi hostiles au bien-être de l'État. L’autocratie, dit-il, contient le pouvoir qui soumet le peuple, l’aristocratie et l’oligarchie dans l’intérêt de l’État.
Karamzine considère Vladimir Ier et Yaroslav le Sage comme des souverains autocratiques, c'est-à-dire des dirigeants dotés d'un pouvoir illimité. Mais après la mort du premier, le pouvoir autocratique s’affaiblit et l’État perdit son indépendance. L'histoire ultérieure de la Russie selon Karamzine est d'abord une lutte difficile avec les apanages, qui a abouti à leur liquidation sous Vasily III, le fils d'Ivan III Vasilyevich, puis l'autocratie a progressivement surmonté tous les empiétements sur le pouvoir, et donc sur le bien-être de l'État, de la part des boyards. Sous le règne de Vasily le Ténébreux, « le nombre de princes souverains diminua et le pouvoir du souverain devint illimité par rapport au peuple » /4, p.219/. Karamzine dépeint Ivan III comme le créateur de la véritable autocratie, qui a forcé les nobles et le peuple à le vénérer » /5, p.214/. Sous Vasily III, les princes, les boyards et le peuple sont devenus égaux face au pouvoir autocratique. Certes, sous le jeune Ivan IV, l'autocratie était menacée par une oligarchie - le conseil des boyards dirigé par Elena Glinskaya, et après sa mort - par « une aristocratie parfaite ou l'État des boyards » /7, p.29/. Aveuglés par des tentatives ambitieuses de pouvoir, les boyards oublièrent les intérêts de l'État, « ils ne se souciaient pas de rendre le pouvoir suprême bénéfique, mais de l'établir entre leurs propres mains » /7, p.52/. Ce n'est que lorsqu'il devint adulte qu'Ivan IV put mettre fin au règne des boyards. Une nouvelle menace pour le pouvoir autocratique est née des boyards lors de la maladie d'Ivan IV en 1553. Mais Ivan le Terrible s'est rétabli, mais la méfiance envers tous les dignitaires est restée dans son cœur. Du point de vue de Karamzine, l’histoire russe du XVe au début du XVIIe siècle est une période de véritable renouveau national, ralentie par les conséquences de la mauvaise politique économique des Rurikovich. Libération du joug de la Horde d'Or, renforcement des relations commerciales internationales et de l'autorité internationale de la Russie, sage législation de Vasily III et d'Ivan le Terrible, fourniture progressive par l'autocratie des garanties juridiques et patrimoniales fondamentales à ses sujets. Karamzine décrit généralement le chemin vers cette renaissance comme un processus progressif continu associé, tout d'abord, au développement d'une véritable autocratie, qui n'a été compliquée que par les qualités personnelles négatives des détenteurs du pouvoir autocratique : l'immoralité et la cruauté de Vasily III, Ivan le Terrible, Boris Godounov, Vasily Shuisky, la faible volonté de Fiodor Ivanovitch, la gentillesse excessive d'Ivan III.
N.M. Karamzine dans « Histoire de l'État russe » met l'accent sur trois forces politiques caractéristiques du chemin historique de la Russie : l'autocratie, basée sur l'armée, la bureaucratie et le clergé, l'aristocratie et l'oligarchie représentées par les boyards et le peuple. Qu'est-ce qu'un peuple au sens de N.M. Karamzine ?
Au sens traditionnel, le « peuple » – les habitants d’un pays, d’un État – apparaît assez souvent dans l’Histoire. Mais le plus souvent, Karamzine y donne un sens différent. En 1495, Ivan III arrive à Novgorod, où il est accueilli par « les hiérarques, le clergé, les fonctionnaires, le peuple » /5, p. 167/. En 1498, après la mort du fils aîné d'Ivan III, « la cour, les nobles et le peuple s'inquiétaient de la question de la succession au trône » /5, p.170/. « Les boyards, ainsi que le peuple, ont exprimé leur inquiétude après le départ d'Ivan le Terrible pour Alexandrova Sloboda » /8, p.188/. Boris Godounov est invité à devenir roi par « le clergé, le clergé, le peuple » /9, p.129/. À partir de ces exemples, il est clair que Karamzine a inclus dans le concept de « peuple » tout ce qui n'appartenait pas au clergé, aux boyards, à l'armée ou aux représentants du gouvernement. « Le peuple » est présent dans « l'Histoire… » en tant que spectateurs ou participants directs aux événements. Cependant, dans un certain nombre de cas, ce concept n'a pas satisfait Karamzine et celui-ci, essayant de transmettre ses idées de manière plus précise et plus profonde, a utilisé les termes « citoyens » et « Russes ».
L'historiographe introduit un autre concept de « canaille », non seulement en tant que gens ordinaires, mais aussi dans un sens ouvertement politique - en décrivant les mouvements de protestation de classe des masses opprimées : « la canaille de Nijni Novgorod, à la suite de la veche rebelle , a tué de nombreux boyards » /3, p.106/ en 1304, en 1584, lors du soulèvement de Moscou, « des personnes armées, des foules, des citoyens, des enfants boyards » se sont précipités au Kremlin /9, p.8/.
Dans un sens désobligeant, le concept de « canaille » reflète l’idée de Karamzine selon laquelle de puissants mouvements de protestation de classe dans la Russie féodale étaient des manifestations de tendances anarchistes. Karamzine croyait que le peuple avait toujours un désir inhérent de liberté, incompatible avec les intérêts de l'État. Mais, niant l'importance politique progressiste du peuple dans l'histoire russe, l'historiographe en fait le plus haut porteur d'évaluations des plans et des activités des représentants du gouvernement autocratique. Dans « l’Histoire de l’État russe », le peuple devient un arbitre impartial lorsque nous parlons de sur la lutte de l'autocratie avec l'aristocratie et l'oligarchie, puis spectateur passif mais intéressé et même participant, lorsque, par la volonté du destin historique, il se retrouve lui-même face à face avec l'autocratie. Dans ces cas-là, la présence des personnages dans "Histoire..." devient la technique créative la plus importante de Karamzine, un moyen d'exprimer l'attitude de l'auteur face aux événements décrits. La voix d’un historien semble faire irruption dans le récit de « l’Histoire… », se confondant avec « l’opinion populaire » /39, pp. 21-22/.
Dans « L’Histoire de l’État russe », Karamzine attache une large signification sémantique à l’opinion populaire. Tout d’abord, les sentiments populaires – de l’amour à la haine envers les autocrates. « Il n’y a pas de gouvernement qui n’ait besoin de l’amour du peuple pour réussir », clame l’historiographe /7, p. 12/. L'amour du peuple pour l'autocrate, en tant que critère le plus élevé pour évaluer ses actions et en même temps, force capable de décider du sort de l'autocrate, semble particulièrement fort dans les derniers volumes de l'Histoire de l'État russe. Puni pour son crime (le meurtre du tsarévitch Dmitry) par la Providence, Godounov, malgré tous ses efforts pour gagner l'amour du peuple, se retrouve finalement sans leur soutien à un moment difficile pour lui-même dans la lutte contre le Faux Dmitry. "Le peuple est toujours reconnaissant", écrit Karamzine, "laissant le ciel juger du secret du cœur de Boris, les Russes ont sincèrement loué le tsar, mais, le reconnaissant comme un tyran, ils l'ont naturellement détesté à la fois pour le présent et pour le passé. ... " /8, p.64/. Les situations dans l'imagination de l'historiographe se répètent à la fois avec Faux Dmitry, qui par son indiscrétion a contribué au refroidissement de l'amour du peuple pour lui, et avec Vasily Shuisky : « Les Moscovites, autrefois zélés pour Boyar Shuisky, n'aimaient plus la couronne. porteur en lui, attribuant les malheurs de l'État à son incompréhension ou à son malheur : accusation, tout aussi importante aux yeux du peuple » /11, p.85/.
Ainsi, Karamzine, avec l’aide de « L’Histoire de l’État russe », a fait part à toute la Russie de ses opinions, idées et déclarations.
Au moment où il écrivait « L’Histoire de l’État russe », Karamzine avait parcouru un long chemin de quêtes idéologiques, morales et littéraires, qui a laissé une empreinte profonde sur le plan et le processus de création de « l’Histoire… ». L'époque n'était pas imprégnée de la conviction que sans comprendre le passé, sans rechercher des modèles de développement social et culturel de l'humanité, il est impossible d'évaluer le présent et d'essayer de regarder vers l'avenir : « Karamzine faisait partie de ces penseurs qui ont commencé à développer de nouveaux principes pour comprendre l’histoire, l’identité nationale et l’idée de continuité dans le développement de la civilisation et des Lumières » /48, p.28/.
«N.M. Karamzine a véritablement écrit à un tournant pour la Russie et pour toute l'Europe, les temps » /58, p.421/, dont les principaux événements furent la Grande Révolution française, qui renversa les fondements de la féodalité et de l'absolutisme ; apparition de M.M. Speransky avec ses projets libéraux, la terreur jacobine, Napoléon et son œuvre même étaient la réponse aux questions posées par l'époque.
COMME. Pouchkine a qualifié Karamzine de « dernier chroniqueur ». Mais l'auteur lui-même « proteste » contre cela : « Le lecteur remarquera que je ne décris pas l'événement séparément, par années et par jours, mais que je les combine pour la perception la plus pratique. L'historien n'est pas un chroniqueur : celui-ci ne regarde que le temps, et celui-là la nature et l'enchaînement des actions : il peut se tromper dans la répartition des lieux, mais il doit montrer à chaque chose sa place » /1, p.V/. Ce n’est donc pas la description ponctuelle des événements qui l’intéresse en premier lieu, mais « leurs propriétés et leurs liens ». Et en ce sens, N.M. Karamzine ne devrait pas être appelé « le dernier chroniqueur », mais le premier chercheur véritablement authentique de sa patrie.
Un principe important lorsqu’on écrit « Histoire… » est le principe de suivre la vérité de l’histoire, telle qu’il la comprend, même si elle était parfois amère. « L’histoire n’est pas un roman et le monde n’est pas un jardin où tout devrait être agréable. Il représente le monde réel »/1, p. VIII/ Notes de Karamzine. Mais il comprend les capacités limitées de l'historien à atteindre la vérité historique, puisque dans l'histoire « comme dans les affaires humaines, il y a un mélange de mensonges, mais le caractère de la vérité est toujours plus ou moins préservé, et cela nous suffit pour former une idée générale sur les personnes et les actions" /1, p. VIII/. Par conséquent, l’historien peut créer à partir du matériau dont il dispose et il ne peut pas produire « de l’or à partir du cuivre, mais il doit purifier le cuivre, il doit connaître le prix et les propriétés de chaque chose ; découvrir le grand là où il est caché, et ne pas donner aux petits les droits des grands » / 1, p. XI/. La fiabilité scientifique est un leitmotiv qui résonne constamment tout au long de « l’Histoire… » de Karamzine.
Une autre réussite importante de « l’Histoire… » est qu’ici se révèle clairement une nouvelle philosophie de l’histoire : l’historicisme de « l’Histoire… » vient tout juste de commencer à prendre forme. L'historicisme a découvert les principes du changement, du développement et de l'amélioration constants de la société humaine. Cela a généré une compréhension de la place de chaque peuple dans l'histoire de l'humanité, du caractère unique de la culture de chaque science, des particularités du caractère national... Karamzine a proclamé l'un de ses principes pour créer l'histoire de la société dans toutes ses manifestations. , une description de tout ce qui est inclus dans la « composition » de l'existence civile des hommes : les succès de la raison, les arts, les coutumes, les lois. L'industrie, et Karamzine s'efforce « d'unir ce qui nous a été transmis au fil des siècles en un système clair par un rapprochement harmonieux des parties » /1, p. XI/. Cette approche globale de l’histoire, imprégnée du concept de l’unité du processus historique et de l’identification des relations de cause à effet des événements, constitue la base du concept historique de Karamzine.
Mais l'historien n'était pas en avance sur son temps en tout : « il était un fils de son temps tant dans l'humeur générale noble de son idéologie, bien qu'ennoblie par les idées pédagogiques, que dans l'approche providentialiste générale de l'histoire, malgré le désir d'en révéler la dimension. des schémas quotidiens et des tentatives parfois naïves d'évaluer le rôle de telle ou telle personne dans l'histoire. ce qui était pleinement conforme à l’esprit de cette époque » /58, p.452/.
Son providentialisme se ressent dans son appréciation des événements historiques majeurs. Ainsi, par exemple, il croit sincèrement que l'apparition du Faux Dmitri Ier dans l'histoire de la Russie était une ruse qui a puni Boris Godounov, à son avis, pour le meurtre du tsarévitch Dmitri.
Il est également impossible de ne pas dire que dans son « Histoire… » Karamzine a posé le problème de l’incarnation artistique de l’histoire du pays. « L'art de la présentation comme loi indispensable du récit historique a été consciemment proclamé par l'historien » /58, p..428/, qui croyait que : « voir l'action de ceux qui agissent », s'efforcer de personnages historiques vécu « plus d’un nom sec… » /1, p. III/. Dans la préface N.M. Karamzin énumère : « l'ordre, la clarté, la force, la peinture. Il crée à partir de cette substance… » /1, p. III/. Le «il» de Karamzine est un historien, et l'authenticité du matériau, l'ordre et la clarté de la présentation, la puissance picturale du langage - tels sont les moyens d'expression dont il dispose.
C’est précisément en raison de sa nature littéraire que « l’Histoire… » a été critiquée par les contemporains et les historiens des années suivantes. Ainsi, « le désir de Karamzine de transformer un récit historique en une histoire divertissante ayant un impact moral sur le lecteur ne correspondait pas aux idées de S.M. Soloviev sur les tâches de la science historique. Il écrit que Karamzine regarde son histoire du côté de l'art » /67, p.18/. N.M. Tikhomirov accuse N.M. La tendance de Karamzine à « même parfois s'éloigner quelque peu de la source, juste pour présenter des images lumineuses, des personnages brillants » /66, p.284/. Oui, nous disposons d’ouvrages fondamentaux créés par de puissantes équipes de recherche, mais il existe très peu de livres passionnants sur l’histoire russe. Un écrivain peut délibérément compliquer son style de présentation, compliquer le langage et créer une intrigue à multiples facettes. D'un autre côté, il peut rapprocher le lecteur de son œuvre, le faire participer aux événements, rendre l'image historique réelle, ce que Karamzin a fait et son « Histoire… » a été lue avec grand plaisir. Alors peut-on reprocher à un historien uniquement le fait que son style de présentation intéresse le lecteur ?
« Karamzine a eu l'occasion de tester dans la pratique sa compréhension des raisons du développement du processus historique et ses principes créatifs. Ceci est particulièrement intéressant pour nous, car du point de vue de la modernité méthodologie scientifique nous comprenons clairement les limites historiques des vues de Karamzine »/58, p.429/. Mais je pense qu’un historien doit être jugé non pas du point de vue du matérialisme historique et dialectique, mais du point de vue de ses capacités scientifiques.
Ainsi, Karamzine considérait le pouvoir, l'État, comme la force motrice du processus historique. Et l'ensemble du processus historique russe lui semblait être une lutte entre les principes autocratiques et d'autres manifestations du pouvoir - démocratie, régime oligarchique et aristocratique, tendances apanages. L'émergence de l'autocratie, puis de l'autocratie, est devenue le noyau sur lequel, selon Karamzine, toute la vie sociale de la Russie reposait. Dans le cadre de cette approche, Karamzine a créé une tradition de l’histoire russe entièrement dépendante de l’histoire de l’autocratie. La structure et le texte de « l'Histoire de l'État russe » permettent d'établir assez précisément la périodisation spécifique de l'histoire utilisée par Karamzine. En bref, cela ressemblera à ceci :
· La première période - depuis la vocation des princes varègues (du « premier autocrate russe » /2, p. 7/) jusqu'à Sviatopolk Vladimirovitch, qui divisa les États en apanages.
· La deuxième période - de Sviatopolk Vladimirovitch à Yaroslav II Vsevolodovitch, qui a restauré l'unité de l'État.
· Troisième période - de Yaroslav II Vsevolodovich à Ivan III (époque de la chute de l'État russe).
· Quatrième période - le règne d'Ivan III et Vasily III (le processus de liquidation est terminé fragmentation féodale).
· Cinquième période - le règne d'Ivan le Terrible et de Fiodor Ivanovitch (mode de gouvernement aristocratique)
· La sixième période couvre le Temps des Troubles, qui commence avec l'avènement de Boris Godounov
Ainsi, l’histoire de la Russie selon Karamzine est une lutte entre l’autocratie et la fragmentation. Le premier à avoir introduit l'autocratie en Russie fut le Varègue Rurik, et l'auteur de « Histoire... » est un partisan constant de la théorie normande sur l'origine de l'État russe. Karamzine écrit que les Varègues « auraient dû être plus instruits que les Slaves » /2, p.68/ et que les Varègues « étaient les législateurs de nos ancêtres, leurs mentors dans l'art de la guerre... dans l'art de la guerre ». navigation » /2, p.145-146/. L'auteur a qualifié la domination des Normands de « profitable et calme » /2, p.68/.
Dans le même temps, Karamzine soutient que l'histoire de l'humanité est l'histoire du progrès mondial, dont la base est l'amélioration spirituelle des hommes, et que l'histoire de l'humanité est faite par de grands personnages. Et, sur cette base, ce n'est pas un hasard si l'auteur a structuré son œuvre selon le principe suivant : chaque chapitre contient une description de la vie d'un prince individuel et porte le nom de ce souverain.
Dans notre historiographie, l'image de Karamzine en ardent monarchiste, partisan inconditionnel de l'autocratie est solidement ancrée depuis longtemps. On disait que son amour pour la patrie n’était qu’un amour pour l’autocratie. Mais aujourd’hui, nous pouvons dire que de telles évaluations constituent un stéréotype scientifique des années passées, l’une des idéologies sur lesquelles la science historique et l’historiographie se sont construites depuis si longtemps. Il n’est pas nécessaire de réhabiliter ou de justifier Karamzine de quelque manière que ce soit. Il était et reste un éminent représentant de l’autocratie en Russie, un noble historiographe. Mais l'autocratie n'était pas pour lui une compréhension primitive du pouvoir destinée à supprimer les « esclaves » et à élever la noblesse, mais était la personnification d'une haute idée humaine de l'ordre, de la sécurité des sujets, de leur prospérité, garante de la révélation de toutes les meilleures qualités humaines, civiles et personnelles ; arbitre public /58, p.434/. Et il a brossé une image idéale d’un tel gouvernement.
« L'objectif principal d'un gouvernement fort est de créer les conditions nécessaires au développement maximal des capacités humaines - un agriculteur, un écrivain, un scientifique ; C’est précisément cet état de société qui conduit au véritable progrès non seulement des nations individuelles, mais de l’humanité toute entière » /45, p.43/.
Et cela est possible si la société est dirigée par un monarque éclairé. Le grand mérite de Karamzine en tant qu’historien est qu’il a non seulement utilisé un corpus de sources magnifique pour son époque, mais aussi qu’il a découvert lui-même de nombreux documents historiques grâce à son travail dans les archives avec des manuscrits. L'étude des sources de son œuvre était sans précédent à l'époque. Il fut le premier à introduire dans la circulation scientifique les Chroniques de Laurentienne et de la Trinité, le Code des lois de 1497, les œuvres de Cyrille de Turov et de nombreux documents diplomatiques officiels. Il a largement utilisé les chroniques grecques et les rapports d'auteurs orientaux, les textes épistolaires nationaux et étrangers et littérature de mémoire. Son histoire est véritablement devenue une encyclopédie historique russe.
Dans le courant contradictoire des opinions des contemporains et des lecteurs ultérieurs de « l’Histoire de l’État russe », qui a finalement donné lieu à de nombreuses années de vives controverses. Vous pouvez facilement en trouver un fonctionnalité intéressante- aussi enthousiastes ou sévères que soient les critiques de l'œuvre de Karamzine, elles étaient dans l'ensemble unanimes Grandement apprécié cette partie de « l’Histoire de l’État russe », que Karamzine lui-même appelait « Notes ». Les « Notes », pour ainsi dire, étaient sorties du cadre du texte principal de « l'Histoire... » et dépassaient considérablement son volume, rendant déjà extérieurement le travail de l'historiographe différent des travaux historiques des époques antérieures et ultérieures. . A travers les « Notes », Karamzine propose à ses lecteurs un ouvrage historique à deux niveaux : artistique et scientifique. Ils ont ouvert au lecteur la possibilité d’une vision alternative de Karamzine sur les événements du passé. Les « notes » contiennent de nombreux extraits, des citations de sources, des récits de documents (souvent présentés dans leur intégralité) et des références à des œuvres historiques de prédécesseurs et de contemporains. Karamzine, à un degré ou à un autre, a attiré toutes les publications nationales sur les événements de l'histoire russe avant le début du XVIIe siècle. et un certain nombre de publications étrangères. Au fur et à mesure que de nouveaux volumes étaient préparés, le nombre et, surtout, la valeur de ces matériaux augmentaient. Et Karamzine décide de faire un pas audacieux: il étend leur publication dans "Notes". « Si tous les documents, écrit-il, étaient rassemblés, publiés et purifiés par la critique, alors je n'aurais qu'à m'y référer ; mais quand la plupart d’entre eux sont dans des manuscrits, dans le noir ; quand presque rien n’a été traité, expliqué, convenu, alors il faut s’armer de patience » /1, p. XIII/. Les « Notes » sont donc devenues une importante collection de sources introduites pour la première fois dans la circulation scientifique.
Essentiellement, « Notes » est la première et la plus complète anthologie de sources sur l’histoire de la Russie avant le début du XVIIe siècle. En même temps, il s'agit de la partie scientifique de « l'Histoire de l'État russe », dans laquelle Karamzine a cherché à confirmer l'histoire du passé de la patrie, a analysé les opinions de ses prédécesseurs, a discuté avec eux et a prouvé la sienne. justesse.
Karamzin, consciemment ou de force, a transformé ses « Notes » en une sorte de compromis entre les exigences de la connaissance scientifique du passé et l'utilisation par le consommateur du matériel historique, c'est-à-dire sélective, basée sur le désir de sélectionner des sources et des faits qui répondent à son dessein. Par exemple, lorsqu'il parle de l'avènement de Boris Godounov, l'historiographe ne cache pas moyens artistiques pour décrire la joie populaire générale, à la suite de la Charte approuvée du Zemsky Sobor de 1598. Mais Karamzine connaissait également une autre source, qu'il a placée dans les « Notes », qui raconte que la « joie » s'expliquait par une contrainte grossière de la part de Boris Les serviteurs de Godounov.
Cependant, lors de la publication des sources dans les « Notes », Karamzine n'a pas toujours reproduit fidèlement les textes : il y a ici une modernisation de l'orthographe, des ajouts sémantiques et l'omission de phrases entières. En conséquence, les « Notes » semblaient créer un texte qui n’a jamais existé. Un exemple en est la publication de « Le conte de la compréhension du prince Andrei Ivanovich Staritsky » /7, p.16/. Souvent, l'historiographe publiait dans des notes les parties des textes sources qui correspondaient à son récit et excluaient les endroits qui le contredisaient.
Tout ce qui précède nous amène à traiter avec prudence les textes inclus dans les « Notes ». Et ce n'est pas surprenant. Les « notes » de Karamzine sont non seulement une preuve de ce qui s'est passé, mais aussi une confirmation de son point de vue sur ce qui s'est passé. L'historiographe exprime ainsi la position de départ de cette approche : « Mais l'histoire, dit-on, est remplie de mensonges ; Disons mieux qu'il y a là, comme dans les affaires humaines, un mélange de mensonges, mais que le caractère de vérité est toujours plus ou moins conservé ; et cela nous suffit pour composer concept général sur les personnes et les actions » /1, p.12/. La satisfaction de l'historiographe quant au « caractère de vérité » du passé signifiait pour lui essentiellement suivre les sources qui correspondaient à sa conception historique.
L'ambiguïté des appréciations sur « l'Histoire de l'État russe », la créativité et la personnalité de N.M. Karamzine est caractéristique depuis la publication du premier volume de « l’Histoire de l’État russe » jusqu’à nos jours. Mais tout le monde est unanime sur le fait qu'il s'agit de l'exemple le plus rare dans l'histoire de la culture mondiale où un monument de la pensée historique serait perçu par les contemporains et les descendants comme l'œuvre suprême de la fiction.
L'histoire de Karamzine se caractérise par une stricte solennité, un rythme de présentation clair et apparemment lent et un langage plus livresque. Une qualité stylistique délibérée est perceptible dans les descriptions des actions et des personnages, une représentation claire des détails. Polémiques de scientifiques et de publicistes de la fin des années 1810 - début des années 1830. en relation avec la parution des volumes de « l'Histoire... » de Karamzine, les réflexions et les réponses des premiers lecteurs, en particulier les décembristes et Pouchkine, par rapport à l'héritage de Karamzine des générations suivantes, la connaissance de « l'Histoire de l'État russe » dans le développement de la science historique, de la littérature, de la langue russe - des sujets qui attirent depuis longtemps l'attention. Cependant, « l’Histoire… » de Karamzine en tant que phénomène vie scientifique n’a pas encore été suffisamment étudié. Entre-temps, cette œuvre a laissé une empreinte sensuelle sur les idées du peuple russe sur le passé de sa patrie, et même sur l'histoire en général. Pendant près d’un siècle, il n’y a eu aucun autre ouvrage historique en Russie. Et il n'y avait aucun autre travail historique qui, ayant perdu son ancienne signification aux yeux des scientifiques, resterait aussi longtemps dans l'usage de la soi-disant culture. le public général.
« L'histoire de l'État russe » a continué à être perçue comme un acquis de la culture russe, même lorsque les connaissances sur la Russie antique se sont considérablement enrichies et que de nouvelles conceptions du développement historique de la Russie et du processus historique dans son ensemble ont commencé à dominer. Sans connaissance de « l’Histoire » de Karamzine, il était impensable d’être considéré comme une personne instruite en Russie. Et probablement en V.O. Klyuchevsky a trouvé l'explication correcte à cela, notant que « la vision de l'histoire de Karamzine... était basée sur une esthétique morale et psychologique » /37, p.134/. La perception figurative précède la perception logique, et ces premières images restent dans la conscience plus longtemps que les constructions logiques, qui sont ensuite remplacées par des concepts plus solides.
La connaissance historique constitue la partie la plus importante de notre vie culturelle. L'éducation par l'histoire est indissociable de l'éducation morale, de la formation d'idées socio-politiques, voire d'idées esthétiques. La publication de « L’Histoire de l’État russe », dans son intégralité, permet de voir non seulement les origines les phénomènes les plus importants dans l'histoire de la science, de la littérature et de la langue russes, mais facilite également l'étude de la psychologie historique, de l'histoire conscience publique. Ainsi, les travaux de N.M. Karamzine est depuis longtemps devenu un modèle d'approche de l'étude des principaux sujets de l'histoire russe.
Les vues historiques de Nikolaï Mikhaïlovitch Karamzine ont été formées et améliorées conformément à toute la structure de sa vie, avec sa nature douée et équilibrée et son intuition historique colossale, son talent d'écrivain artistique, qui l'a aidé à pénétrer dans l'essence de l'époque et les personnages de personnages historiques.
Une fois déjà engagé sur la voie d'un scientifique, s'étant entièrement consacré à l'histoire de la Russie, Karamzine était guidé par un grand objectif : dévoiler sa propre grande histoire devant le peuple. C’est cette compréhension du grand objectif, d’un grand travail généralement utile, qui a constamment guidé N.M. Karamzine tout au long de la création de son « Histoire ». Il revient plus d'une fois sur cette pensée dans ses pages.
Et le sens même de son concept historique, exprimé dans douze volumes de « l'Histoire » et de la « Note sur l'ancienne et la nouvelle Russie », dans lesquels il expose de manière assez détaillée sa vision du processus historique, consiste dans le mouvement de la Russie de l'oubli historique à travers les épines jusqu'aux sommets de l'organisation du système étatique et, sur cette base, aux sommets de la civilisation, tels que N.M. les comprenait. Karamzine.
Le récit « des grands » est également visible dans sa maxime selon laquelle « rien de grand ne se fait pour de l’argent », exprimée dans la « Note ». Et l’ensemble de la « Note », avec son évaluation conceptuelle de l’histoire de la Russie, avec sa critique passionnée des imperfections, voire des violations criminelles, de la structure étatique russe de l’époque de N.M. Karamzine, témoigne clairement de la profondeur de l’intérêt civique de l’historien. dans le mouvement de la Russie sur la voie du progrès, toujours selon sa compréhension, celle de Karamzine.
N.M. Karamzine - ce monarchiste convaincu, partisan du pouvoir autocratique du tsar comme gage de la prospérité de la Russie, de ses sujets et de chacun individuellement, critique férocement les vices de gestion existants dans le pays, qui éloignent le pays de la vraie grandeur.
Il critique vivement Politique financière gouvernement, gaspillage du trésor, inflation associée aux problèmes de commerce extérieur après la conclusion de la paix de Tilsit.
N.M. Karamzin a accompli l'exploit d'un solitaire, mais cela ne veut pas du tout dire qu'il était seul dans son travail. Premièrement, l'œuvre qu'il a conçue avait un terrain fertile sous la forme de l'historiographie mondiale et des ouvrages historiques russes qui l'ont précédée, et deuxièmement, tous ceux qui aimaient purement et sincèrement l'histoire de la patrie, qui se consacraient à sa lecture scientifique, qui est ce que N.M. a réellement affirmé. Karamzine, lui a apporté un soutien moral et matériel, de la sympathie et l'a sincèrement aidé.
Et pourtant N.M. Karamzine n'a en aucun cas répété ses prédécesseurs. Il ne les a pas répétés principalement à cause de son propre plan, à cause du problème. Son « Histoire », bien qu'inachevée, écourtée par la maladie et la mort de l'historiographe due aux événements de « l'interrègne », les malheurs de la Russie pendant les « Troubles », couvre près de deux mille ans et commence par les premières mentions anciennes. d'écrivains romains et grecs sur les peuples vivant sur le territoire de la Russie. En combinaison avec la « Note », qui, bien que sous une forme condensée mais conceptuellement complète, ramène l'histoire de la Russie au début du XIXe siècle, N.M. Karamzine a donné à son lecteur l'occasion d'imaginer l'ensemble du parcours du pays dans son ensemble.
Il ne les a pas répétés quant à l'orientation historique et philosophique de son œuvre. N.M. Karamzine a vraiment écrit à un tournant décisif pour la Russie et pour toute l’Europe à la fois. Et son œuvre elle-même était une réponse aux questions posées par l’époque. Dans les premières phrases de la « Note », il en parle de manière très précise : « Le présent est une conséquence du passé. Pour juger le premier, il faut se souvenir du second. L’un est pour ainsi dire complété par l’autre et, en relation avec cela, apparaît plus clair aux pensées.".
Les mêmes pensées sont exprimées par lui dans les premières lignes de son « Histoire » ; " L'histoire, en un sens, est le livre sacré des peuples : le principal, nécessaire ; un miroir de leur existence et de leur activité ; la tablette des révélations et des règles ; l'alliance des ancêtres avec la postérité ; ajout, explication du présent et exemple du futur"; l'histoire, de l'avis de N.M. Karamzin, " imaginer une série de siècles avec leurs passions, leurs morales et leurs actions repousse les limites de notre propre existence ; par sa puissance créatrice nous vivons avec des gens de tous les temps, nous les voyons et les entendons, nous les aimons et les détestons, sans même penser aux bénéfices, nous jouissons déjà de la contemplation de divers cas et personnages qui occupent l'esprit et nourrissent la sensibilité".
C'était une époque dont l'événement principal fut la Grande Révolution française, qui renversa les fondements de la féodalité et de l'absolutisme et ouvrit la voie à de nouveaux mouvements bourgeois. relations publiques. Le mode de vie bourgeois en développement a eu un impact sur tous les aspects de la vie russe, y compris le domaine spirituel. Les vues des Lumières de Novikov, le radicalisme de Radichtchev et l’émergence de la future idéologie décembriste reflétaient indirectement ces changements, d’une part.
D'autre part, le gouvernement tsariste, renouvelé par la conspiration de 1801, dirigé par un monarque intelligent, également choqué par le meurtre de son père, tenta, comme cela arrive souvent au début de tout nouveau règne, de calmer les esprits avec quelques mesures libérales sans casser radicalement le système, pour amener une église autocratique en rapide détérioration dans une certaine conformité aux exigences socio-économiques de l'époque. Le gouvernement a été critiqué à gauche comme à droite. Il leur semblait que la vie était en train de changer, mais qu’elle allait « dans la mauvaise direction » et qu’eux seuls étaient destinés à lui donner la vraie direction.
N.M., très instruit et instruit, a parcouru la moitié de l’Europe. Karamzine s'est retrouvé dans le tourbillon de toutes ces nouvelles tendances européennes et russes. Il scrutait la vie avec vigilance, comparait les événements contemporains avec le mouvement de l’histoire mondiale, et ses héros modernes avec les héros du passé, réfléchissait douloureusement aux affaires actuelles et cherchait, à l’aide de l’expérience de l’histoire, à déterminer la voie à suivre par la Russie. années à venir. Cela se reflète en partie dans ses « Lettres d'un voyageur russe », mais pleinement dans « L'Histoire de l'État russe ».
Ayant commencé son œuvre monumentale, l'historien s'est efforcé de comprendre tout le cours de l'histoire russe, d'éclairer son cours du point de vue de son époque. Et en ce sens, le présent lui dictait les manières de comprendre le passé, tout comme le passé venait aider à comprendre le présent. Il s’agissait d’une histoire conceptuelle complètement nouvelle, dont des aperçus n’étaient visibles que dans les écrits des historiens précédents.
Mais il serait faux de penser que nous sommes face à un « propagandiste » ordinaire qui tente d’insérer ses idées dans le lit procustéen de l’histoire, de les séparer et de les adapter à ses propres manipulations idéologiques. C'est faux. L'époque et son propre talent de scientifique et d'artiste, capable de pénétrer l'essence d'un phénomène social, n'ont dicté que N.M. Pour Karamzine, la profondeur et l’ampleur des approches du passé historique l’ont aidé à envisager la rétrospective du processus.
Il a développé l'instrument de cette connaissance, l'a compris conformément au niveau de connaissance historique atteint à cette époque et l'a amélioré sans relâche, l'a recréé à bien des égards et, en ce sens, a véritablement enseigné aux générations futures de scientifiques. leçon de recherche, ce qui seul est capable de justifier un historien qui prend une plume savante. C'est en ce sens que sa vision historique était pertinente, moderne ; il évaluait l'histoire à la hauteur des tâches fixées par la société et créait les outils de connaissance qui correspondaient à ces tâches.
COMME. Pouchkine a appelé N.M. Karamzin "le dernier chroniqueur". Cette caractérisation figurative donnée par le génie s’est révélée aussi brillante qu’erronée. Elle ne l'était pas seulement dans le sens où N.M. Karamzine était véritablement le «dernier» de ces scientifiques qui tentaient de recréer l'histoire du pays. Mais l'auteur de «Histoire» et de «Note» mérite surtout le titre de chroniqueur archaïque et travailleur.
N.M. Karamzine lui-même proteste contre son identification avec le chroniqueur: "Le lecteur remarquera que je ne décris pas les actions séparément (italique de l’auteur - A.S.), par année et par jour, mais en les combinant pour l’impression la plus pratique en mémoire. L'historien n'est pas un Chroniqueur : celui-ci ne regarde que le temps, et celui-là la propriété et la connexion des actions ; peut se tromper dans la répartition des sièges, mais doit donner à chaque chose sa place". Ainsi, ce n'est pas la description ponctuelle des événements qui l'intéresse principalement, mais leur « propriété et leur lien ». Et en ce sens, N.M. Karamzine ne devrait pas être appelé le « dernier chroniqueur », mais le premier véritablement véritable chercheur de l'histoire de sa Patrie.
Il explique lui-même soigneusement au lecteur ce qu'il entend par les mots « propriété et connexion ». Il s'agit au fond de tout un programme scientifique, ce qui n'empêche parfois pas ceux qui revendiquent aujourd'hui le haut titre d'historien de leur peuple d'y regarder de plus près. . Bien sûr, nous n'y retrouverons pas ces hauteurs méthodologiques et logiques qui sont venues au monde avec les découvertes dans le domaine des sciences sociales de la seconde moitié du 19ème siècle- début du 20ème siècle
C'est d'autant plus surprenant qu'au début du XIXème siècle. N.M. Karamzin, s'appuyant sur le potentiel scientifique mondial atteint à cette époque, réfléchissant beaucoup à l'expérience du passé, guidé par ses recherches colossales et son intuition artistique, a formulé un certain nombre de principes de recherche qui sont parfois non résolus pour l'historien d'aujourd'hui.
Au premier plan N.M. Karamzine manifeste certainement de l'amour pour la Patrie, mais on peut difficilement le soupçonner d'un patriotisme au levain - ce n'était pas le même intellect, un mauvais goût artistique. Il comprend cet amour comme un vif intérêt pour l'histoire de son peuple, qui fait partie l'histoire du monde, comme une expérience tremblante pour tous les hauts et les bas qui ont frappé la Russie. Il n’oppose pas cet amour à l’intérêt pour l’histoire des autres peuples et États.
Au contraire, ils se complètent et s’enrichissent mutuellement. " Si toute histoire, écrit-il, même si elle est mal écrite, peut être agréable, comme le dit Pline, la histoire domestique l'est encore plus... Nous sommes tous citoyens, en Europe et en Inde, au Mexique et en Abyssinie ; La personnalité de chacun est étroitement liée à la patrie : on l’aime parce qu’on s’aime soi-même. Que les Grecs et les Romains captivent l'imagination ; ils appartiennent à la famille du genre humain, et ne nous sont pas étrangers dans leurs vertus et leurs faiblesses, leur gloire et leurs désastres ; mais le nom russe a pour nous un charme particulier : mon cœur bat encore plus fort pour Pojarski que pour Thémistocle ou Scipion"; pour l'historien, - N.M. Karamzin en est sûr, - " l'amour de la patrie donne à ses pinceaux chaleur, force et charme. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'âme".
Un autre de ses principes est de suivre la vérité de l’histoire, aussi amère soit-elle.. "L'histoire n'est pas un roman et le monde n'est pas un jardin où tout devrait être agréable, note N.M. Karamzin, - elle dépeint le monde réel" Que voit-on parfois dans l'histoire ? - demande l'auteur. - " Des conflits civils entre les villes grecques ", " Des foules commettent des crimes, sont massacrées pour l'honneur d'Athènes ou de Sparte, tout comme nous l'avons fait pour l'honneur de Monomakhov ou de la maison d'Oleg. " Ici et "la fête sanglante des Romains frénétiques", et "le monstre de la tyrannie", "les erreurs et les vols" - et tout cela n'est pas seulement un privilège désagréable Histoire occidentale. Nous lisons quelque chose de similaire sur les tablettes de notre Patrie. Il y a des « pages difficiles » dans l'histoire de chaque nation - c'est la pensée de N.M. Karamzine.
Un principe de recherche extrêmement important d'un historien est le désir de comprendre les événements de l'intérieur, de les regarder non pas du haut des siècles, de ne pas les regarder avec la supériorité détachée des descendants, mais de les voir à travers les yeux d'un contemporain. " Il faut voir nous-mêmes les actions et les acteurs : alors nous connaissons l'Histoire", écrit N.M. Karamzin.
N.M. Karamzine comprend les capacités limitées d'un historien à comprendre la vérité historique, car dans l'histoire, " comme dans les affaires humaines, c’est plus droit qu’un mensonge ; cependant le caractère de vérité est toujours plus ou moins conservé ; et cela nous suffit pour nous faire une idée générale des personnes et des actions. ». L'historien peut et doit créer à partir du matériau dont il dispose ; il ne peut pas produire « de l'or à partir du cuivre, mais il doit aussi purifier le cuivre ; il doit connaître le prix et les propriétés de chaque chose ; découvrir le grand, là où il est caché, et non donnez aux petits les droits des grands. » .
Il évalue donc de manière autocritique et plutôt modeste ses capacités de recherche, estimant que l'essentiel pour un historien est de saisir correctement le « concept général » et, si le matériel lui permet de compléter le reste, de décrire « ce qui est ou était, et pas ce qui pourrait être ». La clarté scientifique et le sérieux sont le leitmotiv qui résonne constamment tout au long de l’histoire de Karamzine.
N.M. Karamzine a proclamé comme l'un de ses principes la création d'une histoire de la société dans son ensemble, une description de tout ce qui est inclus « dans l'existence civile des gens : les succès de la raison, de l'art, des coutumes, des lois, de l'industrie », et il a cherché « combiner ce qui nous a été transmis au fil des siècles en un système clair par la convergence harmonieuse des parties ». Cette approche globale de l'histoire, imprégnée du concept de l'unité du processus historique, identifiant les causes et les causes. les relations d'effet des événements, constituent le noyau du concept historique de N.M. Karamzin.
Il avait une estime inhabituellement élevée pour N.M. La conscience de Karamzine dans son approche du matériel historique. Ses notes sont, comme l’auteur lui-même l’admet, un « douloureux sacrifice » d’authenticité.
Et enfin, on ne peut s'empêcher de dire que dans son « Histoire » N.M. Karamzine a également soulevé le problème de l'incarnation artistique de l'histoire du pays. La manière artistique d'écrire n'a pas été choisie par l'historien par hasard, et il ne s'agit pas ici que son talent littéraire l'y ait clairement prédisposé. La présentation artistique, en tant que loi indispensable de la narration historique, a été consciemment proclamée par l'historien, qui croyait que « pour voir les actions et les acteurs », s'efforcer de faire en sorte que les personnages historiques vivent dans la mémoire « non seulement avec un nom sec, mais avec une certaine morale ». physionomie » - cela signifie connaître et ressentir l'histoire.
Il considérait le pouvoir, l’État, comme la force motrice du processus historique., qui, d’une part, concentre les différents efforts de la société, et d’autre part, est elle-même un puissant stimulant pour le mouvement social. Et tout le processus historique russe, selon Karamzine, était essentiellement une lutte entre les principes autocratiques et d'autres manifestations du pouvoir - régime populaire, régime oligarchique ou aristocratique, tendances apanages. La formation d'abord de l'unité de pouvoir, puis de l'autocratie, est devenue le noyau sur lequel, selon l'historien, s'articulait toute la vie sociale de la Russie.
Selon lui, toute l'histoire de la Russie est divisée en « ancienne » (de Rurik à Ivan III), « moyenne » (d'Ivan III à Pierre Ier) et « nouvelle » (de Pierre Ier à Alexandre Ier). La caractéristique principale de la première période était le système des apanages, la seconde - l'autocratie et la troisième - les « changements dans les coutumes civiles ». Quelle est la raison d’une si grande persistance de l’approche « étatique » de l’histoire ? C'est très simple et réside dans le fait que c'est dans la sphère politique, en tant qu'expression la plus claire des intérêts socio-économiques et matériels des personnes, des classes, des classes, que le processus historique lui-même est sublimé. En apparence, reste le problème du pouvoir, reflet de ces intérêts matériels.
Karamzine a parfaitement saisi le contour extérieur et superficiel des événements.. Il a déterminé de manière convaincante que dans les périodes de son histoire où la Russie s'appuyait sur un gouvernement central fort, elle avait obtenu de grands succès tant dans l'organisation de la vie intérieure que dans le domaine de la politique étrangère.
La destruction de l'autocratie a conduit à l'anarchie, à des troubles civils, à des luttes sanglantes, à la destruction des forces populaires et, dans la sphère extérieure, à des défaites et à la perte de l'indépendance ; et seule une nouvelle renaissance de l'autocratie a apporté le salut au pays. Parmi les pays européens, aucun autre n'a peut-être survécu à une guerre civile aussi longue et aussi monstrueuse, qui s'est terminée par la perte de l'indépendance de la Russie, l'établissement de deux cent quarante ans de joug étranger et encore deux cents ans de pression constante de la part des Polonais. -État lituanien à l'ouest, raids constants des dirigeants hostiles de Kazan et de Crimée jusqu'aux frontières sud et sud-est du pays.
Ces événements, qui ont déterminé le cours du développement russe pendant des centaines d'années, ont émerveillé l'imagination de tout chercheur qui les a touchés. Ils ont frappé N.M. Karamzin par son lien avec le problème d'un État unifié. Le malheur du peuple pèse depuis trop longtemps sur la conscience de la Russie et cela a trouvé une expression indirecte dans le concept de N.M. Karamzine, pour qui, comme nous l'avons déjà vu, l'amour pour la patrie avec tous ses hauts et ses bas, ses succès et ses échecs , les joies et les tragédies étaient sacrés.
Et voici le résultat général résumé par N.M. Karamzine : « Quoi d’autre qu’une autocratie illimitée peut produire l’unité d’action dans ce colosse ? » "La Russie a été fondée par les victoires et l'unité de commandement, a péri à cause de la discorde, mais a été sauvée par l'autocratie."
Essentiellement Il a mené la ligne de lutte entre deux principes de l'histoire de la Russie - la centralisation et la décentralisation - l'a personnifié avec brio et vivacité, lui a donné une coloration artistique et psychologique, qui l'a rendue encore plus vitale et réelle. Nier cette ligne simplement parce qu’il n’y a aucune autre raison plus profonde derrière cela n’est peut-être pas recommandable. Et cette richesse de la palette de l’histoire politique du pays nous revient avec « Histoire » de N.M. Karamzine.
Dans notre esprit, comme nous l'avons déjà noté, l'image de Karamzine comme un ardent monarchiste, un partisan inconditionnel de l'autocratie, un homme qui prône, comme le dit l'épigramme de l'époque (avec plaisir répété aujourd'hui), « la nécessité de l'autocratie et de la charmes du fouet » (bien que, comme le montrent des recherches récentes, A. S. Pouchkine, à qui cette épigramme est attribuée, ne considérait pas du tout Karamzine comme un champion du servage). On a également dit que l'amour de la patrie signifiait pour lui avant tout l'amour de l'autocratie, qu'il n'était pas un véritable patriote, puisqu'il refusait à son peuple la liberté et la liberté.
Il me semble que ce genre d’évaluation fait partie de ces nombreux stéréotypes qui ne sont pas scientifiquement étayés, de ces « idéologismes » sur lesquels notre pensée sociale s’est fondée pendant si longtemps et de manière inconsidérée.
L'autocratie était pour N.M. Karamzine n'était pas une compréhension primitive du pouvoir, destinée à « traîner et ne pas lâcher prise », à supprimer les « esclaves » et à soutenir la noblesse, mais était la personnification de la haute idée humaine d'ordre, de sécurité des sujets, de leur prospérité, le garant de la révélation de toutes les meilleures qualités humaines, civiles et personnelles.
Dans les meilleures traditions des Lumières, dans l’esprit de l’absolutisme éclairé, il s’est peint l’image idéale d’un gouvernement qui n’était pratiquement jamais possible nulle part. Son autocratie est une merveilleuse utopie d'un noble intellectuel, qui a elle-même été brisée en mille morceaux par la cruauté de l'histoire passée du pays et de la vie réelle de son temps.
Tout d'abord, l'autocratie pour N.M. Karamzine est l'arbitre suprême de la société, la force qui agit entre les tendances du pouvoir populaire, de l'aristocratie et entre les différentes classes. L'objectif principal d'un gouvernement fort est de créer les conditions nécessaires au développement maximal des capacités humaines - un agriculteur, un écrivain, un scientifique ; C’est précisément cet état de société qui conduit au véritable progrès non seulement des nations individuelles, mais de l’humanité toute entière.
Cela n’est possible que si les Lumières règnent en maître dans la société, si le monarque conduit le peuple dans cette direction. N.M. Karamzin considérait la suppression de l'oligarchie, dont le « tourment » pour la Russie était « le plus dangereux et le plus intolérable », comme une tâche particulièrement importante de l'autocratie. « Il est plus facile de se cacher d’un seul, écrit-il sans idéaliser le véritable pouvoir monarchique, que de vingt persécuteurs. »
N.M. attache une importance particulière. Karamzine, le monarque remplissant ses hautes responsabilités de direction du pays ; Son devoir principal est de « préserver le bonheur du peuple », et là où il y a un devoir, il y a une loi, « l’autocratie n’est pas l’absence de lois ». «Le souverain doit remplir ses devoirs sacrés tout autant que ses sujets.» Pas Traits de personnalité L'autocrate se soucie de l'historien et de son expression des plans de l'État. Autocratie dans ce sens pour N.M. Karamzin est « l'image de la Patrie », puisque tous les pouvoirs y sont unis et que l'illumination est la base de la prospérité de la Patrie.
Défendant l'idée d'autocratie dans son expression humaniste et éclairée, prônant l'idéal, N.M. Karamzine n'a pas épargné les véritables porteurs de cette idée. Il a dénoncé Iaroslav le Sage pour avoir introduit le système des apanages, ne ménageant aucun effort contre les petits souverains amoureux d'eux-mêmes de la période « apanage ». Il a écrit ouvertement sur la trahison, la cruauté et l'envie de Youri Dolgoruky, et n'a pas épargné les premiers princes de Moscou, en particulier le fils d'Alexandre Nevski, Youri Alexandrovitch, pour de « viles intrigues » au sein de la Horde. Son héros préféré, Dmitry Donskoy, le tient également de lui.
Il lui reproche la lâcheté dont il a fait preuve en repoussant le raid de Tokhtamych en 1382. Parlant des qualités personnelles du souverain, appliqué à Dmitri Donskoï, il se permet de faire la remarque suivante : « Mais les vertus du souverain, contrairement à la force, la sécurité, la paix de l’État ne sont pas les vertus essentielles. » Appréciant hautement les capacités étatiques d'Ivan III, il dénonce néanmoins sa lâcheté lors de la période de lutte avec Akhmat, notamment l'envoi de la famille grand-ducale dans le nord du pays, où la suite de Sophie Vitovtovna maltraita les villageois.
Il écrit franchement sur la cruauté d'Ivan III, qui a jeté son petit-fils Dmitry en prison, où il est déjà mort à l'époque de Vasily III. Le malheureux Dmitry, selon N.M. Karamzine, est devenu « l'une des victimes touchantes d'une politique cruelle », et pourtant cette politique visait à établir un « pouvoir unique ». Et cela ne dit pas de certains dirigeants inconnus, mais des piliers de la Russie - Ivan III et Vasily III.
En prenant l'exemple d'Ivan le Terrible, l'historien montre ce qu'un monarque ne devrait pas être. La description de son règne après la mort d'Anastasia est essentiellement un terrible martyrologe, une chaîne sans fin d'atrocités contre toutes les couches de la société russe, une description de certains monstres. « La tyrannie n’est qu’un abus de l’autocratie », convainc-il. Mais nous parlions d'un éminent représentant de la maison Rurik, qui a beaucoup fait pour établir le pouvoir autocratique, si cher au cœur de N.M. Karamzine. Et ce n'est pas un hasard si le métropolite Filaret de Saint-Pétersbourg, après avoir assisté à une lecture publique à l'Académie des sciences de Russie d'extraits de « l'Histoire » consacrés à l'époque d'Ivan le Terrible, a déclaré qu'il lui était difficile de voir le « "des traits sombres" que l'historien "a mis" "au nom du tsar russe".
Karamzine donne une description désobligeante à la fois de Boris Godounov, qui a sacrifié les intérêts de l'État à son ambition, et de Shuisky. Et en cours de route, il dépeint de manière vivante, figurative et vivante les ulcères du régime autocratique, l'arbitraire despotique, le favoritisme, les abus de l'administration tsariste, le carriérisme, la bureaucratie émergente et les conséquences mortelles de ce processus pour la Russie, le luxe de ceux au pouvoir. .
Peter I N.M. L'évaluation de Karamzine est très contradictoire. D'une part, il s'agit d'un souverain qui a fait beaucoup pour la grandeur de la Russie et le renforcement de l'autocratie, et d'autre part, il a opté pour une telle « appropriation complète des coutumes européennes, qui a causé d'énormes dommages à le pays. La passion pour le nouveau dans ses actions a traversé toutes les frontières. Tout ce qui est russe et spécial a été éradiqué, « les supérieurs séparés des inférieurs » (cette observation, qui porte caractère social). "Nous sommes devenus citoyens du monde, mais dans certains cas, nous avons cessé d'être citoyens de Russie", est à blâmer Peter.
Comme vous le savez, dans son « Histoire » N.M. Karamzine a préfacé la « dédicace » à Alexandre Ier, qui, tant dans le passé qu'aujourd'hui, surprend les lecteurs par sa rhétorique fidèle. Au terme de ce monument du jeu de cour, qui a peut-être libéré « l’Histoire » de la censure et lui a donné le cachet du roi, N.M. Karamzine déclare même : « L’histoire du peuple appartient au tsar. »
À une certaine époque, l'historien M.P. Pogodin a appelé « Dévouement » « sous-portant ». Mais même ici, N.M. Karamzine a réussi à donner son évaluation du règne et à recommander à Alexandre Ier des mesures dans l'esprit du concept d'absolutisme éclairé. Notant qu'avec la victoire sur Napoléon, une « nouvelle ère » a commencé en Russie, comme le croyait alors la majorité de la société pensante, N.M. Karamzine souligne en outre que le souverain a besoin de paix pour « gouverner pour le bien du peuple, pour le succès de la moralité, de la vertu, de la science, des arts civils, du bien-être public et privé ». Le programme est esquissé ; encore une fois N.M. Karamzine revient à son idée préférée, mais, hélas, utopique, de l'autocratie en tant que pouvoir qui existe pour le bien de la prospérité de la société et du bien-être humain.
L'histoire nationale sous la plume de N.M. Karamzine évolue avec l'histoire de l'Europe et de l'Asie, elles sont indissociables l'une de l'autre. Il parle en détail, à partir de sources orientales, de la création du pouvoir de Gengis Khan et du début de ses entreprises militaires ; et passant à l'invasion des Tatars-Mongols sur les terres russes, il présente au lecteur non seulement leur situation intérieure, mais aussi l'état des frontières occidentales - les relations de la Russie avec la Hongrie, la Suède, l'Ordre et Lituanie.
Le lecteur se familiarise avec la découverte de l'Amérique, l'histoire du « schisme » de Luther, l'invention de l'imprimerie et d'autres événements remarquables de l'histoire du monde. À chaque période, la complexité et la nature multicouche de l’histoire russe telle que présentée par N.M. augmentent. Karamzin, de plus en plus de nouvelles lignes sont incluses, déterminées par le développement du pays et les événements se déroulant dans les pays voisins.
N.M. est une composante organique de l’histoire russe. Peuple Karamzin. Bien sûr, il ne se situe pas au premier plan de l’histoire comme les grands princes, les rois, les commandants célèbres, les hiérarques de l’Église, mais sa présence invisible se fait sentir partout. Cette présence du peuple dans l'histoire, semble-t-il, a été inscrite dans le récit de l'auteur de notre célèbre chronique « Le Conte des années passées » et depuis lors cette tradition, enrichie, est passée de chronique en chronique, d'un ouvrage historique à un autre.
Les gens sont vus et entendus dans les descriptions de la vie rurale et de l'artisanat ; l'historien transmet à son lecteur des images du dur travail d'un laboureur et d'un artisan, de l'exploit militaire des gens ordinaires dans de nombreuses guerres. Le peuple est visible sur les murs de la forteresse pendant la défense des villes russes contre les envahisseurs étrangers et pendant la période des combats intestines entre les princes russes. Sa voix menaçante a été entendue lors de nombreuses émeutes depuis l'époque de Russie kiévienne. N.M. Karamzine ne contourne pratiquement pas une seule représentation publique majeure de l'Antiquité.
De plus en plus, sa plume se tourne vers des pages décrivant les troubles populaires lors de la construction du royaume moscovite et son renforcement au XVIe siècle. "Moscou était inquiet", "le murmure du peuple" a commencé - ce refrain est très constant dans "l'Histoire", consacrée à la période de création de l'État centralisé russe. Nous ne pouvons pas refuser l'idée que toute la grande politique du palais royal, les intrigues des boyards, la lutte des anciens clans princiers et boyards se sont déroulées sur fond de l'activité infatigable des masses, de leur intérêt pour telle ou telle politique. entreprise.
Et à ce même peuple, comme le montre habilement N.M.. Karamzine, il faut souvent payer le prix fort pour la manifestation de certaines sympathies et antipathies politiques. Le sang du peuple coule comme une rivière dans les pages de « l’Histoire de l’État russe ».
Créer "l'Histoire", N.M. Karamzine examinait non seulement l’ensemble du mouvement de la société russe, mais il gardait également constamment à l’esprit l’histoire de la Russie, en tant que partie de l’histoire européenne et mondiale. Il ne s’agissait pas là d’un européisme artificiel d’Occidental ni d’un hommage à la méthode de présentation historique comparée. Pour lui, toute l’histoire du continent – et plus largement : toute l’histoire de l’Eurasie – était un tout, qui ne se manifestait que dans les spécificités de chaque pays. C’était aussi l’approche politique d’un esprit mûr et profond, libre des tendances du nihilisme pro-occidental et de l’isolationnisme russophile.
L'apparition même d'un grand État slave oriental à l'Est de l'Europe N.M. Karamzine le considère comme un phénomène naturel consécutif à la chute de l'Empire romain et à l'émergence de nouveaux États sur ses ruines. La Russie, écrit-il, est entrée dans le « système commun » des peuples européens après que Rome « s’est affaiblie dans la langueur et est tombée, écrasée par le bras des barbares du Nord ». Jusqu'au milieu du XIe siècle, selon l'historien, la Russie n'était en rien inférieure en force et éducation civique les premières puissances européennes..., ayant le même caractère, les mêmes lois, coutumes, statuts étatiques..., sont apparues dans le nouveau système politique de l'Europe avec des droits importants à la célébrité et avec l'avantage important d'être sous l'influence de la Grèce , la seule puissance, non testée par les barbares.
Ce que nous avons lentement abordé avec beaucoup d’hésitations, de débats et d’explosions de nihilisme seulement très récemment, N.M. Karamzine a déjà tenté de le justifier au début du XIXe siècle.
Dans une perspective paneuropéenne, N.M. évalue Karamzine et le début de la période de fragmentation féodale. La désintégration dans les destins, écrit-il, est un « ulcère commun » de cette époque, caractéristique de toute l’Europe. C’est là que la Russie a commencé à prendre du retard sur l’Occident. Durant la « division » et les « guerres intestines », « nous sommes restés debout ou avons avancé lentement tandis que l’Europe luttait pour l’illumination ». La Russie a subi un coup dur des hordes tatares-mongoles qui l'ont « renversée ». Lorsque l’Occident, s’étant débarrassé de « l’esclavage », développa l’éducation et ouvrit des universités, la Russie « n’a déployé ses forces que pour ne pas disparaître ».
La centralisation accrue de l'État russe sous Ivan III est considérée par lui de la même manière comme une manifestation de tendances paneuropéennes : Ivan III est apparu lorsqu'« un nouveau système étatique, ainsi que le nouveau pouvoir des souverains, sont apparus dans l'ensemble du pays ». L'Europe ." Selon lui, avec Ivan III, la Russie était de nouveau entrée dans la multitude des puissances européennes, dont elle avait été éliminée par l'invasion tatare-mongole. Le retour de la Russie en Europe s'est poursuivi activement au XVIIe siècle, mais a été particulièrement vigoureux sous Pierre Ier.
Même dans les caractéristiques personnelles, estimant qu'au fil des siècles « les gens n'ont pas changé dans leurs propriétés principales », il s'efforce de trouver des modèles communs. Ivan IV N.M. Karamzine se compare à Caligula, Néron, Louis XI, Godounov lui rappelle Cromwell dans son esprit.
C’est ainsi que N.M. l’imaginait. Le lien général de Karamzine entre la Russie et l'histoire européenne.
Il a déjà été noté à plusieurs reprises dans notre historiographie que N.M. Karamzine a non seulement utilisé un corpus de sources magnifique pour son époque, mais aussi qu'il a découvert lui-même de nombreux documents historiques grâce à son travail dans les archives, avec des manuscrits qui lui ont été envoyés pour travailler par des amis et des sympathisants. Ainsi, pour la première fois, il introduit dans la circulation scientifique les Chroniques de Laurentienne et de la Trinité, le Code de droit de 1497, les ouvrages de Cyrille de Tourov, de Daniil Zatochnik et de nombreux documents officiels et diplomatiques.
Il a largement utilisé les chroniques grecques, les rapports d'auteurs orientaux, les données des annales occidentales, les mémoires nationales et étrangères et la littérature épistolaire. Son «Histoire» est devenue une véritable encyclopédie russe de l'étude des sources; elle a représenté un sérieux pas en avant dans le développement de la base documentaire de recherche, a souligné les domaines controversés, les lacunes encore existantes et a appelé les scientifiques à progresser davantage dans ce domaine.
On reprochait tantôt à l'historien son approche consumériste de la source, tantôt sa « ruse textuelle », et le principe de suivre strictement le texte de la source et d'en vérifier l'exactitude était mis en avant contre lui. Il ne fait aucun doute que N.M. Karamzine n'a pas plus mal compris ces problèmes que ses détracteurs. En effet, il s’est parfois appuyé sur des données qui n’étaient pas suffisamment vérifiées par la critique, par exemple la Chronique de Stryikovsky, la Chronique de Nikon, un certain nombre de messages de Jordanes. On peut aussi lui reprocher d'être quelque peu préoccupé par un certain type de sources. Ainsi, pour décrire la tyrannie d'Ivan le Terrible et ses atrocités, l'historien s'est principalement appuyé sur les rapports étrangers donnés par A. Kurbsky, dont le caractère tendancieux est largement évident.
Quant à l’approche consommateur, il serait difficile d’attendre autre chose qu’un essai destiné au grand public. "Histoire" N.M. Karamzin, ainsi que « Histoire » de S.M. Soloviev, est une œuvre aussi scientifique que populaire – une combinaison rare, hélas, dans l’historiographie russe. Au même moment, N.M. Karamzine a parfaitement compris signification scientifique source, la nécessité d’une approche critique à son égard. On peut citer comme exemple son attitude à l'égard de la soi-disant Chronique de Joachim. Pour l’essentiel, il l’a désavoué, a transféré le différend sur sa fiabilité aux « Notes » et s’est prononcé contre l’utilisation de ses données. Il a fait la même chose dans d'autres cas. D’un autre côté, il a considéré un certain nombre de sources comme fiables, et ce n’est que plus tard que des critiques ont révélé leur incohérence.
Mais l'historien n'a pas tout anticipé sur son siècle : il était un fils de son temps tant dans l'ambiance générale noble de son idéologie, bien qu'ennoblie par les idées pédagogiques, que dans l'approche providentialiste générale de l'histoire, malgré la volonté d'en révéler le quotidien. des schémas, qui étaient parfois des appréciations naïves et purement idéalistes du rôle de tel ou tel individu dans l'histoire.
Son providentialisme se ressent dans son évaluation des grands tournants historiques. Il croit sincèrement que l'apparition du Faux Dmitri Ier dans l'histoire de la Russie était la main de la Providence, punissant Boris Godounov pour son terrible péché - organiser le meurtre du tsarévitch Dmitry. N.M. Karamzine ne doutait pas un instant que Godounov était le véritable coupable de la mort du prince et son système de preuves ne pouvait être écarté.
En tout cas, A.S. Il semble qu’elle ait complètement convaincu Pouchkine et que le sens historique de notre grand poète soit extrêmement développé. Une approche tout aussi providentialiste se fait sentir dans l’évaluation du rôle de Moscou dans l’unification des terres russes et dans l’organisation de la lutte contre la Horde d’Or. Le « pouvoir de la Providence » est constamment présent dans les pages de « l’Histoire », donnant un aperçu bizarre des processus de développement du pays qui sont en grande partie historiquement exacts, spontanément correctement compris par l’historien.
N.M. Karamzin dépeint magistralement la conditionnalité psychologique des actions de certains personnages historiques. Il montre l'abandon d'Oleg Riazansky à la veille de la bataille de Koulikovo, sa peur de Mamai et sa haine de Moscou, qui écrase les principautés russes les unes après les autres. Il pense beaucoup au personnage d'Ivan III, qui "n'étant pas un tyran comme son petit-fils", avait néanmoins une cruauté naturelle, "modérée en lui par le pouvoir de la raison".
N.M. Karamzine a très subtilement saisi le tournant psychologique de l'humeur d'Ivan IV après la maladie et un retard dans le serment d'allégeance d'un groupe de boyards à son fils Dmitry, mais surtout après la mort de la tsarine Anastasia ; a soigneusement évalué le rôle de l'entourage royal dans diverses sortes d'influences sur le jeune Ivan IV. Peut-être, seul parmi les historiens, a-t-il identifié les tournants psychologiques des différentes étapes de la vie de Boris Godounov et tenté d'interpréter sa politique en se basant en grande partie sur ces tournants.
Karamzine Nikolaï Mikhaïlovitch est né le 1er décembre 1766 et est décédé le 22 mai 1826. Au cours des 56 années de sa vie, ce bonne personne a fait beaucoup pour le développement de notre État. Plus tard, on le qualifiera d'écrivain remarquable, représentant de l'ère du sentimentalisme, journaliste et historiographe. Mais revenons au tout début de cette histoire.
Tout a commencé dès la petite enfance. Après la mort de sa mère, le garçon reçoit la clé d'un meuble contenant un grand nombre de livres, basés sur des romans moralisateurs. Même alors, Karamzin s'est immergé dans le monde de la littérature et a lu facilement des dizaines d'ouvrages en peu de temps.
Il reçoit une bonne formation en sciences humaines au pensionnat privé du professeur Schaden, docteur en philosophie, qui lui confère une excellente connaissance des langues anciennes et nouvelles. Plus tard, il entre au service militaire dans le régiment Preobrazhensky, mais après avoir servi un peu plus d'un an, Karamzin retourne en Malaisie Rodina. En tant que causeur facile et personnalité profonde, il attire l'attention de l'écrivain et traducteur Ivan Petrovich Tourgueniev, venu dans la province. Cette rencontre change toute sa vie. Il commence son parcours créatif par la traduction oeuvres étrangères, puis publie les siens, qui se distinguent par un style particulier, preuve de goût et de principes esthétiques. À partir de 1791, l’ouvrage « Lettre d’un voyageur russe » fut publié, motivé par les voyages de Karamzine en Europe occidentale. Ce sont les « lettres » qui ont valu à Karamzine une énorme renommée. Puis l'histoire « Pauvre Liza » est publiée, grâce à seulement deux ouvrages, toute une époque apparaît, l'ère du sentimentalisme. Sur la base de sa présentation, lexique L'État russe regorge d'un grand nombre de nouveaux mots d'application populaire. Il explore toutes les possibilités de la langue russe et se consacre à l'expressivité. L'enrichissement du vocabulaire a conduit à l'émergence de mots tels que « toucher », « science politique », « industrie » et des centaines d'autres non moins importants. Pour la première fois, c'est lui qui commence à utiliser des néologismes et des barbarismes, s'éloignant du vocabulaire ecclésiastique, en utilisant un échantillon de la grammaire française. De plus, l'écrivain essaie d'apprendre quelque chose de nouveau à l'étranger, mais n'oublie pas non plus les succès de la Russie, qu'il partage également avec les étrangers.
Une nouvelle période de sa vie commence lorsqu'en 1803 Alexandre Ier nomme le célèbre écrivain comme historiographe, dont la tâche est de réaliser un travail inestimable sur « l'Histoire de l'État russe » de 1816 à 1824 ; Karamzine consacre toute sa vie à ce. Malgré l'échec de Vasily Tatishchev et de M. Shcherbatov, Karamzine ne s'est pas écarté de son objectif et a construit une nouvelle base pour l'écriture de livres. Son talent d'écrivain et ses connaissances politiques l'ont conduit à un chef-d'œuvre grâce auquel les informations des années passées et oubliées depuis longtemps ont atteint le monde moderne. Lucien Febvre écrivait que l'historien n'est pas celui qui sait, mais celui qui cherche. C'était précisément cette qualité que possédait Karamzine, disparaissant pendant des jours entre les murs de la bibliothèque impériale. "Vous voulez être un auteur : lisez l'histoire des malheurs de la race humaine - et si votre cœur ne saigne pas, alors laissez la plume, sinon elle nous dépeindrea la froideur de votre âme", a déclaré Nikolaï Mikhaïlovitch. Sa sensualité et sa capacité à exprimer correctement ses pensées lui ont permis de créer 12 grands volumes (les 8 premiers ont été publiés en 1818, les 3 suivants ont été publiés d'autres années et le dernier a été publié après la mort de Nikolaï Mikhaïlovitch), qui ont été publiés dans d'énormes éditions, intéressaient la société et étaient même traduits en langues étrangères... « Tout », même les femmes laïques, se précipitèrent pour lire l'histoire de leur patrie, jusqu'alors inconnue d'elles. C'était une nouvelle découverte pour elles. La Russie antique , semble-t-il, a été découvert par Karamzine, comme l'Amérique - par Colomb."
Karamzine adhérait aux vues d'une monarchie absolue: la mort de l'empereur et le soulèvement des décembristes l'ont conduit à la perplexité. Au cours des dernières années de sa vie, sa santé s'est sensiblement détériorée en raison de dépressions nerveuses et du manque de ressources matérielles ; de plus, l'historiographe travaillait gratuitement pour Alexandre Ier et recevait un salaire minimum. Et ces incidents politiques ont complètement miné sa santé. En 1826, Karamzine mourut, nous laissant un immense héritage. La grande contribution apportée à l’histoire de notre patrie est inestimable.
Aïda Tormozova
Étudiant du gymnase n°30, Stavropol