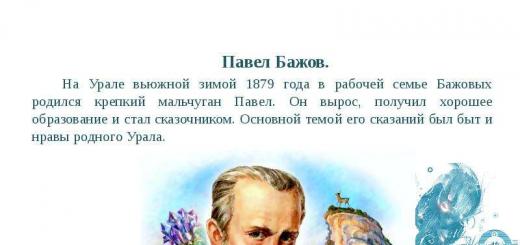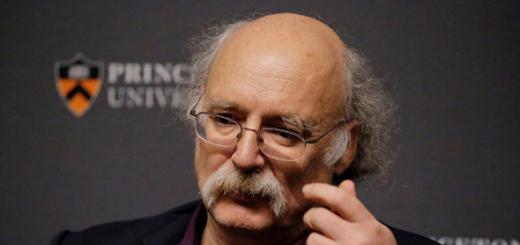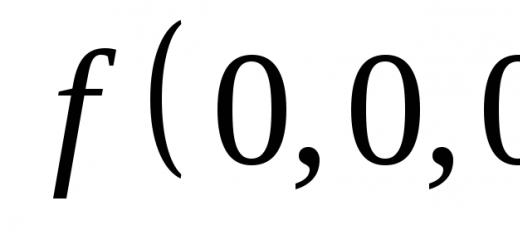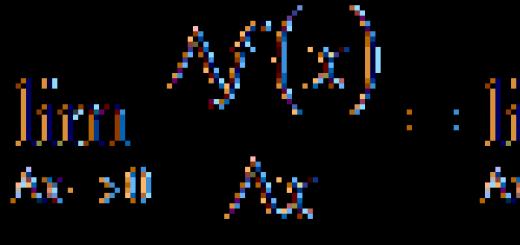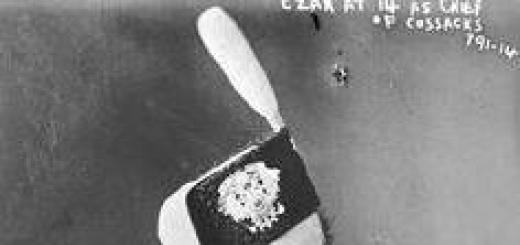Cette section a été créée pour publier des liens vers des articles sur les sujets : État, gouvernance et théorie des élites - qui peuvent être combinés sous le concept élite politique. Et . Le créateur de la science développe plusieurs thèmes en élitologie, qui pourront par la suite former un nouveau La théorie des élites de Grigoriev.
Élite de la société
Élite de la société est un groupe de personnes occupant les positions les plus élevées dans la hiérarchie sociale et poursuivant les objectifs suivants :
- - par rapport à la non-élite - maintenir sa position dominante ;
- - au sein de l’élite – accroître son statut par rapport aux autres membres de l’élite.
Actuellement, les enjeux de la formation d'un futur État qui devrait remplacer modèles modernes occupent le Centre NEOCONOMICS bien plus que l'analyse de l'état de l'économie. Le point ici est qu’en fait, qu’est-ce qui ne va pas dans le fait que Grigoriev, à la suite de Marx, ait ouvert l’économie capitaliste et en ait tiré la conclusion : le capitalisme dans sa forme moderne n’est pas durable. Dans une crise de changement de formations, personne ne peut être sauvé. Ce sera mauvais pour tous les peuples – la question concerne les élites des pays qui peuvent être démolies par les révolutions si elles ne commencent pas à se reconstruire aujourd’hui. Et depuis élite politique est directement liée à l'État, qui lui confère une position privilégiée, alors la question se déplace vers les principes de la réforme. Ici se pose la question principale : comment transformer l’État traditionnel afin de surmonter l’État actuel, qu’Oleg Grigoriev considère comme une crise structurelle du capitalisme. Les caractéristiques du nouvel État - les principes de sa structure et ses méthodes d'influence sur l'élite moderne de la société (pacifique, évolutionniste ou révolutionnaire ?) - sont devenues importantes pour le développement futur de l'humanité. Après tout, des conditions particulières doivent apparaître pour que l’élite puisse modifier son rôle et ses méthodes d’obtention du pouvoir. Je pense que la voie la plus probable pour la transition vers le socialisme est de changer d’État – comme les cantons en Suisse ou de déléguer l’autorité d’en bas, comme dans les kibboutzim israéliens.
Cela nous oblige à analyser l'expérience de construction du socialisme en URSS, qui est aujourd'hui plus correctement considérée comme un capitalisme d'État. économiste Grigoriev, dans la théorie duquel l'État joue un rôle de premier plan, considère le socialisme soviétique comme le modèle économique que dans la Russie post-révolutionnaire le nouvel État a adopté pour accomplir ses tâches, en ne retenant que la terminologie communiste.
L’expérience ne doit pas être considérée comme un échec : l’URSS s’est effondrée plutôt à cause de ressources humaines limitées (Khrouchtchev s’est aliéné la Chine avec son milliard d’habitants). Peut-être qu’à l’avenir, les gens considéreront la « reddition » du socialisme « de manière isolée » – uniquement comme un acte ayant empêché un conflit nucléaire (mais même cela n’est pas un fait, si l’on considère le comportement actuel des États-Unis). La « victoire » du capitalisme s'est produite grâce à l'expansion de la zone américaine dans une zone mondiale et à la compression de la zone soviétique dans une zone isolée - en raison de la petite population, ce qui entraîne un marché limité.
Le capitalisme classique lui-même a disparu depuis longtemps. UN le capitalisme moderne, sous l'influence d'une véritable crise structurelle, devient obsolète en tant que mécanisme de fonctionnement de l'économie, c’est pourquoi la question se pose : quel modèle reste-t-il encore pour l’auto-préservation des États ? Pendant que nous parlons du socialisme, et sous le communisme, comme on le sait, l'État s'éteint (il faut comprendre - sous la forme qui nous est familière).
Sur le site Crise mondiale Au chapitre :
Notion d'élite , qui développe le thème du pouvoir politique, fait partie intégrante de la science politique moderne. Les fondateurs de la théorie des élites sont des représentants de l'école italienne, les Italiens V. Pareto (1848-1923). G. Mosca (1858-1941) et l'Allemand R. Michels (1876-1936), qui ont quitté l'Allemagne pour l'Italie. Leurs opinions appartiennent à l’école « machiavélique », car on pense que l’élite en tant que groupe dirigeant de la société a été considérée pour la première fois dans les travaux de leur compatriote Machiavel.
G.Mosca - Chercheur italien, général, l'un des fondateurs de la science politique. Les principaux ouvrages de Gaetano Mosca sont « Théorie du gouvernement et gouvernement parlementaire », « Fondements de la science politique », « Histoire des doctrines politiques ».
Théories d'élite - ce sont des théories à propos de diviser les gens dans n'importe quelle société élites Et masses . Mosca a développé l’idée que « dans toutes les sociétés (depuis les sociétés sous-développées ou celles qui ont à peine atteint les fondements de la civilisation jusqu’aux plus développées et puissantes), il existe deux classes de personnes : la classe dirigeante et la classe gouvernée. La première, toujours moins nombreuse, remplit toutes les fonctions politiques, monopolise le pouvoir et bénéficie des avantages que procure le pouvoir, tandis que la seconde classe, plus nombreuse, est gérée et contrôlée par la première… » Mosca G. Classe dirigeante. // Anthologie de la pensée politique mondiale. En 5 tonnes T. 2. ? M., 1997. ? P. 118.. Mosca considérait l'élite du point de vue de sa structure, des lois de fonctionnement, de l'arrivée au pouvoir, de la dégénérescence et du déclin, du remplacement par une contre-élite. L’une des tendances et des dangers importants du développement des élites est leur transformation en un groupe héréditaire et fermé, ce qui conduit à leur dégénérescence et à leur remplacement par une contre-élite. « Les classes dirigeantes déclinent inévitablement si elles cessent d’améliorer les capacités avec lesquelles elles sont arrivées au pouvoir, lorsqu’elles ne peuvent plus remplir leurs fonctions sociales habituelles, et que leurs talents et leurs services perdent leur importance dans la société. » Mosca a joué pour l'ouverture Et continuité dans le fonctionnement des élites comme garant de la stabilité sociale et système politique.
En développant sa théorie, Mosca a développé " loi de la dichotomie sociale ", a donné le concept de classe politique, défini deux types d'organisation de la gouvernance politique, les qualités de la classe politique et les conditions d'accès à celle-ci, les modalités de consolidation du pouvoir de la classe politique et de son renouvellement, identifié deux tendances dans le développement de la classe politique, etc.
Indépendamment de Mosca, le concept d'élites s'est développé Vilfredo Pareto (1848-1923) - Sociologue italien et classique de l'élitologie. L'ouvrage le plus célèbre est le « Traité de sociologie générale ».
Dans le domaine des sciences politiques, Pareto est devenu célèbre pour son théories de l'idéologie Et théories des élites politiques . Dans L'Ascension et la Chute des Élites. «Traité de sociologie générale», il formule les principales dispositions de sa théorie. Points forts de Pareto deux couches de population : la couche inférieure, la non-élite et la couche supérieure, l'élite, divisée en deux parties - l'élite dirigeante et l'élite non dirigeante. L'auteur donne la définition désormais classique élite politique , dont l'essence est que c'est « la classe de ceux qui ont les indices les plus élevés dans leur domaine d'activité... qui jouent directement ou indirectement un rôle important dans la gestion de la société et constituent Élite dirigeante , le reste forme élite non gouvernementale » .
Circulation , c'est le cycle des élites, Pareto considère comment le principal moteur des processus politiques et les changements sociaux : « L’histoire de l’humanité est l’histoire d’un changement constant des élites ; certains augmentent, d’autres diminuent. Dans ce processus de changement révolutionnaire des élites, de nombreux représentants de l’ancienne élite (qui était tombée en déclin) sont tués, emprisonnés, exilés ou réduits au niveau social le plus bas. Cependant, certains d’entre eux se sauvent en trahissant leur classe et occupent souvent des postes de direction dans le monde. mouvement révolutionnaire. La conclusion de Pareto est que le principal résultat du changement révolutionnaire est l’émergence d’une nouvelle élite avec un certain mélange de l’ancienne.
Robert Michels (1876-1936) - Politologue et sociologue allemand. Exploré processus politiques, étant influencé par les travaux de M. Weber et des théoriciens de l'élite italienne G. Mosca et V. Pareto. Dans le domaine des processus sociopolitiques, Michels s'intéressait aux problèmes du socialisme, du fascisme et du nationalisme. Cependant, sa contribution significative à la science politique est associée avec recherche de partis politiques . Son ouvrage « La sociologie d'un parti politique dans une démocratie » est paru en Allemagne en 1911. En russe, des chapitres individuels commentés n'ont été publiés qu'en 1990-1991.
À son avis, partis politiques - un moyen nécessaire aux mouvements sociaux pour protéger leurs intérêts fondamentaux. Cependant, les partis politiques, comme toutes les grandes organisations, sont contraints de confier un pouvoir monopolistique à leurs dirigeants. Michels est arrivé à la conclusion que oligarchisation - une forme de vie incontournable pour les grandes structures sociales. La montée de l'oligarchie des partis sur les partis politiques et les mouvements sociaux est une conséquence d'un certain nombre de facteurs : l'incompétence des masses, le manque de connaissances et de compétences en matière de travail politique, la nécessité d'une direction efficace dans des conditions de lutte entre partis. L'oligarchie des partis, utilisant habilement diverses ressources, commence à exister non pas pour les mouvements sociaux, mais aux dépens de ces partis et mouvements. cela implique "La loi d'airain de l'oligarchisation" Michels : « Dans tous les partis, quel que soit leur type, la démocratie mène à l’oligarchie », selon lequel la démocratie, si elle était possible, dégénérerait inévitablement en oligarchie. » Cette conclusion contredit la conclusion de Platon, dans la classification duquel, au contraire, l'oligarchie se transforme en démocratie. Selon Michels, la démocratie en tant que système étatique est en principe impossible. L’humanité civilisée, selon Michels, ne peut exister sans une classe politique dirigeante. « La majorité de l’humanité, vouée par le fatalisme cruel de l’histoire à une éternelle « minorité », sera contrainte de reconnaître la domination d’une minorité insignifiante issue de son propre environnement et d’accepter le rôle de piédestal de la grandeur. de l'oligarchie » Michels R. Sociologie des partis politiques dans une démocratie. // Anthologie de la pensée politique mondiale. T. 2. ? p. 189-190.
La loi de l’oligarchisation présuppose le remplacement d’une couche dirigeante par une autre comme forme préétablie de coexistence humaine au sein des grands syndicats. « Les socialistes peuvent gagner, mais pas le socialisme, qui meurt au moment de la victoire de ses partisans... Les masses sont satisfaites de changer de maître, sans épargner leurs forces » Ibid. ? P.190..
La lutte des classes a lieu dans la société dans son ensemble et dans les partis individuels, même ouvriers, qui sont un mélange de classes. Chaque parti possède sa propre couche dirigeante, qui est elle aussi inévitablement soumise au processus d’oligarchisation. Michels cite un dicton parmi les ouvriers français : « Si vous êtes choisi, alors vous êtes perdu. » Plus un parti devient grand et hétérogène, plus le processus d’oligarchisation y est fort.
Il en va de même pour les syndicats. « Comme les différences entre les tendances de développement des oligarchies d'État (gouvernement, tribunaux, etc.) et des oligarchies prolétariennes sont insignifiantes » Ibid. ? P. 193.. Le « représentant », qui ressent sa totale indépendance, passe du statut de serviteur du peuple à celui de son maître - à la fois « serviteur » de l'État et du parti.
Conclusion générale de Michels : « La démocratie s'accommode très bien d'un certain degré de tyrannie pour d'autres raisons psychologiques et historiques : la masse tolère plus facilement la domination lorsque chaque individu a la possibilité de s'en rapprocher, voire de la rejoindre. » Ibid. P. 196.. Le mérite de Michels est d’avoir étendu le concept d’élite à tous les grands groupes sociaux et, en généralisant, de proclamer l’une des rares lois de la sociologie et des sciences politiques.
Dans le même temps, Michels a noté que sans partis, à l'ère moderne, il est impossible de réussir dans la lutte politique, la lutte des différentes couches sociales pour la répartition et la redistribution des ressources publiques. Malgré le fait que la lutte pour la démocratie prend des formes oligarchiques, la concurrence entre les partis, selon Michels, contribue à la sélection et à la promotion des plus dignes du pouvoir dans l'État.
Les théories de l’école machiavélique étaient répandues en Italie, en Allemagne et en France entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais ils se sont largement fait connaître sur le continent américain. Dans les années 30 Un séminaire sur l'étude de Pareto a eu lieu à l'Université Harvard (sa théorie de l'action sociale a ensuite été retravaillée par le fonctionnalisme structurel). Les idées de G. Mosca sur l'approche empirique de la connaissance phénomènes politiques, que l'objet de la recherche est la réalité vivante, a également contribué à la formation de la Chicago School of Political Science. Le Congrès mondial des politologues (Munich, 1970) a souligné le rôle particulier de l’école italienne, qui a servi de point de départ à de nombreuses études sur les élites politiques.
Début XXI Le siècle a été marqué par une crise de grande ampleur et multiforme dans le domaine social et humanitaire. L'une de ses composantes est le problème du développement de la science et des possibilités de connaissance de l'homme et de la société. Dans notre pays, après 1991, le vide théorique et méthodologique formé après l'effondrement du monopole du marxisme et de la théorie de la formation comme modèles explicatifs de l'histoire et développement moderne notre société.
Au cours des 20 à 25 dernières années, différentes théories et approches ont été utilisées. Certains continuent à utiliser la théorie de la formation. D'autres chercheurs développent une approche civilisationnelle. La théorie de la modernisation et un certain nombre d’autres approches se sont largement répandues. Mais malgré tout cela, à notre avis, aucune théorie n'a encore été trouvée ou proposée qui pourrait expliquer pleinement notre histoire et notre modernité, en utilisant des concepts et des disciplines qui seraient spécifiquement adaptés à la société russe (et soviétique) et qui seraient il ne s’agit pas d’une imitation de concepts et de disciplines occidentaux dont le champ d’application est limité.
Naturellement, dans le cadre d'un seul article, il est impossible de présenter pleinement une telle théorie, ou plutôt un ensemble de théories dans le domaine social et humanitaire. Nous n'aborderons qu'un seul des domaines. Nous parlerons d'une science aussi interdisciplinaire que l'élitologie. Apportons-le courte définition, qui a été donnée par le fondateur de l'élitologie russe, le professeur G.K. Ashin : « C'est la science des élites et de l'élite, la couche la plus élevée du système sociopolitique stratification..."
L'élitologie combine des sciences telles que la sociologie, les sciences politiques, la philosophie, les études culturelles, la psychologie et l'histoire. Habituellement, l'étude des élites s'effectue dans le cadre de la sociologie et, en particulier, des sciences politiques, moins souvent dans d'autres sciences. Des centaines d’articles et de monographies ont été rédigés dans ce sens. Le professeur G.K. déjà mentionné. Ashin considère l'élitologie principalement du point de vue de la sociologie et de la philosophie. Où science historique et sa place dans la structure de l’élitologie restent hors de vue de nombreux chercheurs.
À cet égard, le travail de P.L. Karabuschenko « Introduction à l'élitologie de l'histoire », dans laquelle l'auteur identifie les points de contact entre l'histoire et l'élitologie, et propose également la structure de l'élitologie de l'histoire. Parler de lien méthodologique histoire et élitologie, l'auteur note à juste titre que «ces deux disciplines scientifiques bénéficieront de l'élargissement du champ d'application de leur potentiel scientifique et du renforcement des moyens d'étude du rôle d'une personnalité marquante dans l'histoire».
PL. Karabuschenko identifie la structure suivante de l'élitologie de l'histoire : « L'élitologie de l'histoire est l'une des sections les plus importantes de la science élitologique moderne et est incluse dans la structure de sa section analytique. Elle fait partie intégrante de la science historique, qui, outre l'élitologie de l'histoire, comprend également l'histoire de l'élitologie (qui, à son tour, est divisée en : a) l'histoire des idées et des théories élitologiques et b) l'histoire de élites - l'histoire du développement de groupes d'élite spécifiques). Ces deux « histoires » sont Composantsélitologie historique et représentent un complexe unique de connaissances historiques et élitologiques.
Le chercheur identifie également l'objet, le sujet et les méthodes de l'élitologie de l'histoire : « comme objet, nous pourrions définir la pensée historique des élites ; en tant que sujet - l'influence de l'élite sur les processus historiques ainsi que la nature et le contenu mêmes de la science historique. Parmi les méthodes les plus populaires figurent la méthode dialectique, personnaliste (biographique), herméneutique, la méthode d’analyse du système et la méthode statistique.
Il nous semble que P.L. Karabuschenko a réussi à déterminer l'objet, le sujet, les méthodes et la structure de l'élitologie de l'histoire. Cependant, plus tard, l’auteur réduit l’élitologie de l’histoire à un « non-personnalisme historique ». De plus, l'article ne fournit pas de définition claire de l'élitologie de l'histoire ; ses composantes sont dispersées dans le texte.
À notre avis, le concept d'« élitologie historique » peut être utilisé, mais nous proposons d'utiliser le concept d'« élitologie historique ». Voici quelle pourrait être la structure de cette section de la science historique :
1) Histoire des enseignements élitologiques ;
2) Élitologie historique (étudie les modèles les plus généraux d'origine, de développement et d'effondrement des élites dans diverses sociétés) ;
3) L'histoire d'élites spécifiques (par exemple, l'histoire des élites russes et des élites d'autres pays à diverses périodes historiques ; l'histoire des structures supranationales, par exemple, l'histoire de diverses sociétés transnationales, des structures bancaires qui ont eu et continuent d'être influencer le cours de l’histoire).
4) Élitologie historique comparée (où des critères applicables pour comparer les élites de différentes sociétés doivent être développés).
On ne peut pas dire qu’aucune recherche n’est menée en Russie dans le cadre de l’élitologie historique. Les éminents historiens russes S.V. apportent une contribution significative à son développement. Kulikov et F.A. Seleznev. S.V. Kulikov a étudié en détail l'élite bureaucratique russe pendant la Première Guerre mondiale et a proposé sa théorie. F. Seleznev développe activement les problèmes des élites et des contre-élites en Russie pendant la Première Guerre mondiale, considérant également les vieux croyants à partir de ces positions. A noter également la thèse de doctorat de S.A. Kislitsyn, consacré à l'étude de l'élite politique bolchevique des années 1920-1930. Les résultats obtenus montrent la promesse et la pertinence des recherches en cours, car un regard sur les élites du point de vue de l'histoire permet de comprendre comment elles se sont formées, se sont développées et ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Par exemple, c’est l’élitologie historique qui pourrait expliquer pourquoi elle s’est effondrée en premier. Empire russe, puis l'URSS. Ceci est important non seulement pour étudier le passé, mais aussi pour comprendre la modernité et le développement futur.
La structure de l'élitologie historique que nous proposons peut être appliquée non seulement dans recherche scientifique, mais aussi dans le processus éducatif. L’élitologie historique pourrait devenir une discipline obligatoire pour les étudiants de toutes les spécialités sociales et humanitaires. Il faut dire que créer une élitologie historique ne suffit pas. Les chercheurs sont confrontés à la tâche de créer un nouveau science sociale, qui permettrait de surmonter la spécialisation étroite au sein du secteur social sciences humaines. À cet égard, l’élitologie en général et l’élitologie historique en particulier sont des éléments de la systémologie sociale et historique. Ces sciences doivent encore être créées. Comme l’historien et spécialiste des sciences sociales A.I. l’a noté à juste titre. Fursov, « l'une des tâches de l'étape actuelle de développement des connaissances rationnelles sur la société est le développement d'un champ de connaissances consacré aux structures fermées en tant que sujet historique particulier, la synthèse du champ épistémologique... la création d'un champ complet -une science multidimensionnelle à part entière, sans « points blancs » ni signes de handicap cognitif.
Une bonne base pour un tel domaine de connaissances sera une approche systématique, scientifique générale. Son utilisation permettrait d’aplanir les contradictions entre les soi-disant « techniciens » et les « sciences humaines », de créer une base pour une compréhension mutuelle d’une part et de souligner d’autre part la spécificité persistante de la recherche sociale, humanitaire et des sciences naturelles.
Ainsi, l'élitologie historique est une nouvelle branche de la science historique qui étudie l'histoire des doctrines élitologiques, les modèles les plus généraux d'origine, de développement et d'effondrement des élites dans diverses sociétés, ainsi que l'histoire d'élites spécifiques (nationales et supranationales). Sa définition reflète une structure à laquelle peut s'ajouter un aspect historique comparatif. À l'aide des exemples présentés, nous pouvons être convaincus que l'élitologie historique est une direction scientifique pertinente et prometteuse. C'est la science historique, avec l'aide de l'élitologie historique, qui peut donner impulsion puissante non seulement pour leur propre développement, mais aussi pour enrichir l'élitologie dans son ensemble.
L'homme est la mesure de toutes choses
Protagoras
La mesure de tout ce qui existe est
homme, mais pas tout le monde, mais seulement un sage
Démocrite
Dieu est la mesure de tout ce qui existe
Platon
Introduction
E la lithologie est la science de l’élite, ou plus précisément de qui est l’élite et qui se considère comme une élite, mais n’est en fait pas une élite. Ces deux hypostases reflètent l’essence même et en même temps la contradiction de l’élitologie en tant que science de l’élite, en tant qu’idéologie de l’élite et en tant que conscience de l’élite elle-même. Ainsi, nous avons devant nous une compréhension élargie de l'élite en tant que phénomène socioculturel, et pas seulement socio-politique, où la première place est accordée à l'étude du principe d'élitisme, principal critère pour déterminer la qualité et nature de l’élite elle-même.
E La lithologie est une discipline scientifique relativement jeune, mais qui a de profondes racines historiques. En tant que science, l’élitologie est apparue à la fin des années 80 et au milieu des années 90. XXe siècle en Russie et est lié aux activités scientifiques du patriarche de la pensée élitologique russe Gennady Konstantinovitch Ashin (21/10/1930, Nijni Novgorod). C'est lui qui est apparu pendant la période soviétique histoire nationale le premier vulgarisateur des théories occidentales des élites, et actuellement le principal idéologue de l'élitologie en tant que science complexe. Aujourd'hui, nous avons le droit de dire qu'il existe non seulement une « école russe » de théorie des élites, mais aussi que c'est la Russie dans les années 90 du XXe siècle qui est devenue le berceau de l'élitologie elle-même. Certes, nous devons également admettre en toute responsabilité que pour que l'élitologie devienne enfin une science indépendante, il faudra faire beaucoup plus d'efforts. Mais il est aujourd’hui évident que l’élitologie est la science la plus prometteuse de la fin du XXe siècle. Le rythme de son développement indique que le processus de sa formation en tant que discipline scientifique indépendante est nettement en avance sur des processus similaires dans l'histoire du développement d'autres sciences sociales populaires du siècle sortant (principalement la sociologie et les sciences politiques).
ET C’est dans les années 90 du XXe siècle que l’élitologie s’est ouvertement déclarée science. Ses prétentions à une existence scientifique indépendante sont directement liées à son désir d’échapper à la dépendance idéologique de l’idéologie politique, dans laquelle étaient captives presque toutes les théories élitistes précédentes. Parallèlement, l’élitologie se heurte à une forte résistance de la part des idéologues et des méthodologistes de la sociologie et des sciences politiques, qui s’interrogent sur l’opportunité même d’introduire le terme « élitologie » dans l’usage scientifique. Ces sentiments anti-élitologiques conservateurs s’expliquent facilement. Ces « objections » ne portent pas du tout sur les principes d’étude de l’élite et de l’élitisme, mais contiennent une tentative cachée de maintenir un monopole sur ces questions scientifiques. Il est bénéfique pour la sociologie et la science politique qu’il n’y ait pas d’élitologie, mais que soient préservées des théories dispersées sur les élites. Il leur est plus pratique de « prendre » le sujet élitologique dans leurs « appartements scientifiques » et de l'interpréter selon leurs principes et, surtout, leurs capacités. Cette position est non seulement égoïste (d’un point de vue éthique), mais aussi erronée (d’un point de vue méthodologique). Une élitologie unifiée, bien sûr, enlève à ces sciences et à bien d’autres « anciennes » un morceau de leur pain, mais elle ne l’enlève pas tout, mais seulement cette partie qui, par droit de naissance, leur appartient. En même temps, il est frappant que l’élitologie ne reçoive pas, pour l’essentiel, les meilleurs éléments de ces sciences. Il faudra longtemps qu'elle repose sur de la chapelure et de l'eau avant que cette matière première puisse devenir une discipline scientifique à branche unique. Mais dès maintenant, l’élitologie doit déclarer ses prétentions à la science et s’efforcer de la formuler théoriquement et méthodologiquement. Pour ce faire, il est nécessaire de développer à la fois les aspects méthodologiques généraux et sectoriels individuels de l'élitologie. Le plus large éventail de recherches est nécessaire. La diversité de ces études devrait amener les méthodologistes à clarifier les fondamentaux du statut scientifique de ce domaine.
N Cet ouvrage est consacré à l'étude d'une de ces sections de l'élitologie. Elle explore tout ce qu'il y a d'étonnant chez l'homme lui-même. Une analyse de ce qui fait qu'une personne à la fois admire et est horrifiée par sa nature, par elle-même. L'idée de l'élection humaine et du caractère unique d'une personne individuelle est le thème central de toute la philosophie, la littérature et la religion du monde. L'idée d'une personne est l'idée de son amélioration continue. Ce sont précisément ces problèmes qu’une branche de l’anthropologie et de l’élitologie comme élitologie anthropologique . Platon a également fait une observation très importante, qui peut devenir le slogan programme de toute l'élite anthropologique : « … Nous Nous considérons que la chose la plus précieuse pour les gens n'est pas le salut au nom de l'existence, comme le croit la majorité. [ceux. masse ], mais atteindre la perfection et la maintenir tout au long de votre vie "(Platon. "Lois", 707 d). C'est dans le processus d'amélioration que se révèle la véritable essence d'une personne, et c'est précisément ce problème que traite l'élitologie anthropologique.
UN L'anthropologie et l'élitologie sont deux disciplines scientifiques indépendantes qui, dans cet ouvrage, trouvent leur unité idéologique et leur point commun dans la recherche et la formulation des questions qui les intéressent. Dans quelle mesure une telle combinaison – « élitologie anthropologique » est-elle justifiée et légitime !? Nous aurons la réponse à cette question dans cet ouvrage lui-même, si, bien sûr, nous allons au fond du problème indiqué dans le titre même de ce livre.
AVEC Le stéréotype existant actuellement dans les sciences sociales classe facilement « l’élitologie » parmi les sciences politiques, de manière tout à fait injustifiable, je dirais même erronée, en la limitant à l’étude de la nature de l’élite politique. Pendant ce temps, l’élite politique n’est qu’un des types d’élites, qui sont en nombre extraordinaire, et où cette même élite politique joue parfois un rôle moins positif que négatif. Par conséquent, l’un des principaux objectifs de cette étude est de surmonter ce stéréotype incontestablement négatif, qui, à notre avis, interfère avec le développement général de l’élitologie en tant que discipline scientifique indépendante. À notre avis, ce n’est pas l’élitologie politique qui constitue la partie dominante de cette discipline scientifique, mais l’anthropologie en est le noyau. Il est nécessaire de changer radicalement notre attitude à l'égard de l'élitologie en tant que science exclusivement politique. L'élitologie est une discipline scientifique complexe qui doit commencer par sa partie anthropologique. L'élitologie anthropologique elle-même, bien entendu, doit être précédée d'un bloc historico-méthodologique qui décrit et explique à la fois son passé historique et les principes de base des méthodes de son étude. Mais la séquence d'étude de la nature de l'élitisme en général devrait aller de l'anthropologie à la sociologie et aux sciences politiques. C’est pourquoi c’est avantageux et différent élitologie depuis théories d'élite ce qu'elle étudie n'est pas tellement " élite ", Combien " élitisme " en général. Ainsi, le sujet de l’élitologie est d’abord « l’élite », et ensuite seulement son dérivé, « l’élite ». C'est l'élitologie anthropologique, à notre avis, qui révèle le plus l'essence de « l'élite », tandis que l'élitologie politique tente par tous les moyens de nous cacher cette essence. Donc le sujet élitologie politique et est «l'élite», le sujet élitologie anthropologique- « élite ». Puisque « élite » est un dérivé de « élite », la priorité de l’élitologie anthropologique sur l’élitologie politique ne devrait pas nous soulever d’objections particulières.
UN l'élitologie anthropologique étudie la nature de l'unicité humaine, c'est-à-dire choix. Elle s’intéresse à une seule question : pourquoi certaines personnes sont considérées comme formidables et d’autres non ; Pourquoi certaines personnes réussissent-elles et sont-elles reconnues dans la vie, tandis que d'autres (peut-être non moins douées) échouent ? Ainsi, nous parlons de l'étude des qualités de la personnalité humaine qui contribuent à la formation de la dignité humaine, et donc du choix anthropologique. C’est le problème de la « personnalité » qui est la question centrale de toute élitologie anthropologique.
H le choix humain est une conséquence de la prétention de l’individu à être reconnu par rapport à la réalité qui lui tient à cœur. L’affirmation de la conscience de soi de l’individu dans l’espace social et temporel est l’une des principales sources d’aliénation de l’individu, de son autodétermination, dans sa conscience de son originalité, de son originalité, de son unicité, de son choix…
À PROPOS la supériorité de l'homme sur tout le reste monde naturel nous le savons uniquement grâce aux efforts de la personne elle-même. Dès les premiers systèmes philosophiques, on n’entend parler que de la dignité de toute l’humanité et de l’indignité des sujets individuels qui discréditent cette dignité. Même le Dieu d’une personne lui dit qu’elle peut et doit être meilleure qu’elle ne l’est réellement. Apparemment, tout au long de son histoire, la conscience humaine a développé certaines mesures de protection, à l'aide desquelles elle sauve cette espèce biologique de la dégradation. Et le moyen le plus efficace de ce salut s'avère être environnement social, la culture et la religion.
DEGRÉ DE PERTINENCEAVEC Aujourd’hui, l’élitologie trouve pleinement sa place non seulement parmi les sciences sociales et politiques, mais aussi parmi les sciences humaines. Cela est devenu possible grâce à l'humanitarisation de cette science elle-même, à son appel au problème de l'homme. Le mouvement de développement général de l'humanité vers une société postindustrielle de l'information dotée de systèmes politiques et culturels ouverts oblige les sciences sociales à s'humaniser de plus en plus et à subordonner les intérêts sociaux et politiques aux valeurs humaines universelles.
DANS sorti en Dernièrement Les travaux dans le domaine de l'élitologie montrent de manière écrasante que l'élitologie reçoit son digne développement exclusivement en tant que science socio-politique. En principe, les thèses soutenues et les thèses de doctorat sont de même nature. Il convient de noter qu'il n'existe pratiquement aucun ouvrage qui aborderait l'étude de l'élitisme du point de vue des disciplines humaines non pas en tant que phénomène socio-politique ou économique, mais en tant que phénomène socioculturel universel. Ainsi, en élitologie, nous mettons au premier plan le problème de la conscience des élites, c'est-à-dire la question du sujet de l’élite. L'analyse de ce sujet de l'élite devrait déterminer dans une large mesure les qualités à la fois de l'élite elle-même et des critères selon lesquels le processus d'élitisation lui-même se déroule. Malheureusement, l'élitologie politique examine de manière très approfondie, mais en même temps, unilatérale le sujet de l'élitologie, y voyant des processus principalement sociopolitiques plutôt qu'anthropologiques. Notre tâche est de montrer toute la profondeur et le degré d'importance de sa section anthropologique pour l'élitologie générale. Attirer l’attention des élitologues sur problèmes existantsà savoir l'élitologie anthropologique, engagée dans l'étude du sujet de l'élite et du problème de l'élitisation de l'individu en particulier.
Z L’élitologie anthropologique peut remplir ces lagons. À la fin du XXe siècle, l’élitologie anthropologique est devenue la section dominante de toute élitologie. L'intérêt pour une personne que nous classons comme élite se transforme en un problème d'analyse monde spirituel un individu choisi, une élite en raison de sa singularité anthropologique, et non en raison de son statut socio-politique. Les critères d'identification d'un sujet d'élite basés sur des paramètres anthropologiques fournissent des indicateurs complètement différents de ceux actuellement utilisés dans la recherche appliquée par les politologues et les sociologues. Les critères anthropologiques sont plus stricts et totalement dépourvus de prédilections idéologiques et de sympathies politiques. Les critères anthropologiques de l'élitisme indiquent la dignité personnelle d'une personne en tant que sujet de l'élite. Dans le même temps, l'indicateur de statut social est toujours un facteur secondaire et non primaire par rapport à l'indicateur anthropologique.
UN L'élitologie anthropologique est conçue pour étudier le degré de révélation de la dignité humaine et le niveau de perfection atteint par celle-ci. Elle se penche également sur l'abîme de la chute humaine, mais ne fait que regarder, en fournissant la psychologie sociale et la philosophie pour étudier ce niveau d'existence anthropologique.
UN L’élitologie anthropologique offre une manière particulière de recruter les élites, excluant tout hasard et tout subjectivisme socio-politique. À notre avis, seuls des critères anthropologiques peuvent donner des définitions précises du contenu du concept de sujet d'élite. La détermination de ces critères permettra d’écarter de l’élite tous les éléments aléatoires (pseudo-élites), qui, par « mauvaise ironie », se sont inscrits dans cette strate sélectionnée. L’élimination de ces « déchets » aidera l’élite elle-même à éviter de discréditer ses idées et d’être accusée d’incompétence dans ses activités.
BUTS ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDE Aujourd’hui, l’élitologie anthropologique est un problème aussi peu étudié que l’élitologie elle-même en général. À cet égard (en termes d’études), l’élitologie sociopolitique a eu plus de chance que l’anthropologie. À notre avis, la formation définitive de l’élitologie moderne ne deviendra possible que lorsqu’elle décidera non seulement de son histoire et de sa méthodologie, mais aussi lorsque toutes ses composantes recevront un développement théorique et appliqué égal. Le développement de l’élitologie anthropologique est donc très pertinent pour le développement de cette science dans son ensemble, car il élimine l’inconvénient mentionné ci-dessus.
À Les principaux objectifs de cette étude incluent également le problème de l'identification de critères anthropologiques à l'aide desquels il est possible d'identifier plus raisonnablement un sujet d'élite, quel que soit son statut socio-politique. L’élitologie politique souffre justement du primitivisme des critères élitistes qu’elle propose, qui permet très souvent, dans des conditions favorables, à des éléments non élitistes de pénétrer dans la couche choisie. Actuellement, l’élitologie est dominée principalement par des critères politiques d’élitisme, ce qui rend très difficile l’analyse d’autres types d’élites.
Ce travail est confronté aux tâches suivantes : 1) identifier les fondements méthodologiques de l'élitologie ; 2) analyse de l'histoire du développement de l'élitologie anthropologique dans le cadre de la philosophie anthropologique ; 3) la tâche de montrer la place et le rôle de la « théorie du surhomme » dans le développement de la doctrine de l'élitologie anthropologique ; 4) la tâche de donner une description aussi adéquate que possible de la nature de la conscience des élites ; 5) sur la base de la théorie de la conscience d'élite, aborder le problème de l'élitologie de la personnalité (« personnalisme d'élite ») ; 6) montrer le lien entre la conscience d'élite et la théorie de la culture d'élite et, enfin, 7) donner une analyse systématique de la question de l'éducation d'élite et d'élite, en tant que processus éducatif visant à atteindre un niveau de conscience d'élite et à maîtriser les valeurs de la culture d’élite.
T Ainsi, la structure de l'élitologie anthropologique peut être définie par nous comme suit : a) Fondements historiques de l'élitologie anthropologique ; b) Élitologie et « théorie du surhomme » ; c) Élitologie de la conscience ; d) Élitologie de la personnalité (ou personnalisme élitologique) ; e) Élitologie de la culture ; f) Élitologie de l'éducation.
g La principale caractéristique de l'élitologie anthropologique est son apolitique (être en dehors de toute idéologie est son principe principal) et son antisocialité - « élite » car c'est un concept avant tout intellectuel (spirituel) et non social (propriété). Tous les esprits élitologiques, de Platon et Sénèque à F. Nietzsche et N. Berdiaev, ont écrit à ce sujet. L'élitologie anthropologique est dans une plus large mesure une philosophie personnaliste, voyant dans le sujet de l'élite d'abord la présence d'une conscience d'élite, et analysant ensuite seulement la position sociale qu'elle occupe.
T Ainsi, le sujet de cette section d’élitologie est stratification anthropologique, basé sur la différenciation mentale, spirituelle et intellectuelle. Les indicateurs hiérarchiques du facteur anthropologique devraient servir de justification aux hiérarchies sociales et politiques. Malheureusement, dans la pratique, cette solution de stratification équitable a toujours été le rêve utopique inaccessible de « Confucius » et de « Platons », qui proposaient à plusieurs reprises la réorganisation sociale de la société selon ce principe. À notre époque, l'élitologie anthropologique place de grands espoirs dans la prochaine société postindustrielle, dans laquelle les technologies de l'information et de l'éducation occuperont une position dominante et, par conséquent, le rôle du facteur humain dans l'influence du développement social va certainement augmenter.
DEGRÉ D'ÉTUDE DU SUJETDANS La philosophie antique a commencé à s’engager dans des enquêtes anthropologiques sur l’élitologie. À cet égard, nous disposons de bases historiques fiables avec lesquelles construire un modèle structure moderne type anthropologique d'élitologie. Fondamentalement, le problème de l'élection spirituelle est représenté par un thème favori de toute philosophie comme « sagesse » et « sage », « génie » et « génie », « perfection » et « parfait », « superconscience » et « surhomme ». L'élection dans le domaine de l'esprit et de la conscience a toujours été la Mecque de tous les esprits raffinés qui cherchaient à se démarquer des masses qui les entouraient. Par conséquent, nous pouvons trouver l’élitologie anthropologique dans n’importe quel système philosophique, dans n’importe quel livre de philosophie, de théologie ou d’éthique. Presque tous les esprits remarquables de l'humanité croient que la nature humaine est imparfaite, c'est une idée incomplète de Dieu. De plus, Dieu lui-même a donné à l’homme la possibilité d’accomplir cette tâche à volonté grâce à une créativité active. L’homme confronté au besoin de perfection est peut-être le thème principal de l’élitologie anthropologique.
N L'expression « élitologie anthropologique », que nous utilisons désormais activement, devrait nous obliger à impliquer dans l'analyse toute la littérature directement liée aux questions d'anthropologie et d'élitologie. Cependant, l'analyse de ces sources montre un espace d'information très maigre et limité, dans lequel il n'y a pratiquement aucun point commun de contact scientifique entre ces deux disciplines scientifiques. Ce vide d'information s'explique par le fait que l'intérêt scientifique de l'anthropologie et de l'élitologie n'a jamais visé à étudier des problèmes communs, elles ne se sont jamais considérées comme des partenaires potentiels pour résoudre des problèmes communs. Le processus de leur rapprochement scientifique a commencé littéralement en dernières années et n'a pas encore atteint le niveau où l'on peut parler d'une analyse théorique du problème posé. Il n'existe donc pas d'ouvrages particuliers sur l'élitologie anthropologique, et ceux qui existent transmettent le contenu de ce numéro de manière très schématique et superficielle.
M Nous avons des «résultats» distincts, généralement aléatoires, de l'anthropologie sur le thème de l'analyse de la transformation de l'élite en masse, et nous constatons pratiquement un manque total d'intérêt pour l'anthropologie de la part des principaux élitistes socio-politiques du XXe siècle. siècle (à cet égard, les spécialistes de la culture semblent préférables). L’analyse du psychisme d’un sujet d’élite, comme on le voit par exemple chez V. Pareto ou J. Ortega y Gasset, ne signifie pas que ces autorités des théories d’élite avaient un intérêt stable pour l’anthropologie élitologique. En ce sens, les vues élitologiques de N.A. Berdiaev et K. Mannheim sont plus anthropologiques, mais, en règle générale, ces auteurs ne sont le plus souvent pas classés comme élitologues, en raison de l'originalité de leur pensée.
P. les sources reconnues sur l'élitologie anthropologique peuvent être reconnues comme des œuvres individuelles de philosophes anciens tels que Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, Sénèque, Plotin, Proclus ; médiéval : Augustin, Alcuin, Thomas d'Aquin, Roger Bacon et autres ; Renaissance et temps modernes : Pic de la Mirandole, Erasme de Rotterdam, N. Machiavelli, F. Bacon, B. Spinoza, T. Hobbes, J. Locke et autres ; Temps modernes : I.G. Fichte, F.V.I. Schelling, L. Feuerbach, F.M. Dostoïevski, V.S. Solovyov, F. Nietzsche, Z. Freud, N.A. Berdiaev, P. Teilhard de Chardin, H. Ortega y Gasset...
UN l'analyse de chacune de ces sources primaires peut devenir un sujet distinct pour étudier l'étude des sources et la question historiographique de ce problème et occuper plus d'un volume. Dans notre cas, nous nous limiterons à énoncer ce fait lui-même, car une analyse plus détaillée nous éloignerait de l'essence du problème posé avant cette étude.
Novembre 1998
Chapitre I. Fondements méthodologiques de l'élitologie
P. oh" Élitologie« est traditionnellement compris comme une discipline sociologique indépendante qui étudie la couche qui fournit les dirigeants, révèle le processus de gestion socio-politique de la société, décrit la couche sociale qui effectue directement cette gestion. En fait, parmi les sociologues occidentaux, il existe une opinion largement répandue que toute sociologie s'occupe exclusivement de la description des activités des élites, " personnalités sélectionnées", "ingénieurs sociaux" ( hommes d'État, les organisateurs). L'élite sociale y est définie comme un groupe de personnes se situant au plus haut niveau de la hiérarchie, capables de créer des modèles de besoins et de comportement. Le rôle principal de l’élite est de fournir des modèles, des exemples sur la manière de vivre, de se comporter moralement dans des situations humaines, d’approfondir, d’élever et d’enrichir les besoins humains, c’est-à-dire créer de la culture. À cet égard, de nombreux sociologues occidentaux se prononcent contre la création d'une science spéciale (l'élitologie) qui étudierait de manière approfondie cette question. Nous nous permettons d’être en désaccord avec cette formulation de la question et attirons l’attention du lecteur sur le fait que les problèmes des élites ne se limitent pas aux seuls aspects sociologiques et dépassent largement le cadre de cette science. Si le problème de l’élite se limitait aux seules frontières sociales ou politiques, alors la question de la création d’une discipline scientifique intégrée unique serait en effet hors de propos. Mais le problème de l’élitisme est profondément ancré dans des sciences telles que la psychologie, les études culturelles, les études religieuses et, surtout, la philosophie. À cet égard, la sociologie est impuissante à proposer une alternative raisonnable à l’élitologie, ce qui démontre une fois de plus l’opportunité de créer une science unifiée de l’élite et de l’élitisme en général.
g La question principale de l'état actuel de l'élitologie est de savoir dans quelle mesure cette direction scientifique peut généralement compter sur une reconnaissance scientifique, c'est-à-dire Dans quelle mesure l’élitologie est-elle une science ? De nombreux critiques de l’élitologie continuent de la considérer comme une sorte d’idéologie d’une élite politique spécifique, avec laquelle nous sommes catégoriquement en désaccord. Nous avons affirmé à plusieurs reprises que l’élitologie n’est pas une idéologie (cette formulation est en effet la plus cohérente avec les vieilles théories des élites), mais une science. L’élitologie est en effet historiquement liée aux théories des élites, mais cette connexion s’inscrit dans la lignée de la « théorie » et non de l’idéologie. Si l’élitologie n’est pas encore pleinement développée en tant que science à l’époque moderne, c’est précisément à cause de l’idéologie. L'élitologie possède toutes les bases théoriques pour être une science. Mais il faut aussi admettre qu’à l’heure actuelle, elle reste encore une « science » en potentiel. G.K. Ashin, dans l'un de ses ouvrages sur l'élitologie, écrit qu'à notre époque différenciée et intégrée, « de nouvelles disciplines scientifiques se forment de plus en plus non seulement comme domaines spécialisés de sciences déjà établies, mais comme disciplines qui intègrent les réalisations de divers domaines, principalement liés. les sciences. C’est précisément une discipline scientifique aussi complexe, revendiquant de plus en plus un statut indépendant, qu’est l’élitologie, qui s’est développée comme un savoir interdisciplinaire complexe se situant à l’intersection de la science politique, de la philosophie sociale, de la sociologie, de l’histoire générale, de la psychologie sociale et des études culturelles. Il est possible que l’élitologie soit la toute dernière science du XXe siècle à se séparer de la philosophie et à se débarrasser de l’influence de l’idéologie politique. Quoi qu’il en soit, le siècle à venir devrait confirmer ou infirmer notre affirmation, mais nous disposons de toutes les bases morales pour faire une telle prévision. Ainsi, l’élitologie est une science potentielle qui développe son potentiel en ignorant toutes les considérations idéologiques.
P. Le sujet de l'élitologie est l'étude des processus de gestion socio-politique, l'identification et la description de la couche sociale qui réalise directement cette gestion, étant son sujet (ou, en tout cas, l'élément structurel le plus important de ce sujet) , autrement dit, l’étude de l’élite, de sa composition, des lois de son fonctionnement, de son arrivée au pouvoir et de son maintien, de son rôle dans le processus social, des raisons de sa dégradation et de sa sortie de l’arène historique.
D L’élitologie a longtemps existé sous une forme fragmentée, sous la forme de disciplines spécialisées sectorielles considérées dans le cadre des sciences sociales. Son émergence en tant que discipline scientifique indépendante n’a eu lieu qu’au XXe siècle, lorsque, ayant accumulé un matériel scientifique suffisamment riche, elle est devenue un leader potentiel parmi les autres sciences sociales. Le problème de l’élite peut être étudié par n’importe qui discipline publique, mais une solution globale à ce problème ne peut se faire que dans le cadre d'une science particulière, qui est l'élitologie. La structure de cette branche des sciences sociales peut être établie par nous à partir de son existence passée, lorsqu'elle appartenait à des disciplines scientifiques telles que l'histoire, la psychologie, les sciences politiques, les études culturelles, les études religieuses et, bien sûr, la philosophie.
DANS des moments différents et différentes nations l'élitologie portait des noms variés, mais restait toujours la même dans son essence. C’était à la fois le savoir parfait des initiés (l’élite) et le savoir de l’élite elle-même. Par conséquent, dans le développement de l'élitologie en tant que science, nous pouvons distinguer deux étapes : 1) lorsque l'élitologie existait principalement sous la forme de connaissances ésotériques, c'est-à-dire connaissance accessible uniquement à quelques privilégiés, ces quelques initiés que nous appelons l'élite, et 2) quand dans cette connaissance ésotérique a émergé un enseignement indépendant sur ses créateurs eux-mêmes, c'est-à-dire une personne de l'élite (saint, génie, prophète, sage, roi-homme politique, etc.), ainsi que l'élite elle-même. Au fil du temps, cet enseignement a créé le besoin de recherches pratiques sur cette strate, à la suite de quoi ont émergé les branches sociologiques et politiques de l'élitologie. Ainsi, au cours de l’évolution, l’élitologie peut être subdivisée en « élitologie de la connaissance », une forme antérieure et plus générale de science secrète spéciale, et en « élitologie de l’élite », c’est-à-dire directement la science même de l’élite. À cet égard, le sujet de l'élite est défini par l'élitologie non seulement comme le propriétaire d'une place socio-politique d'élite et l'accomplissement d'un rôle important dans la société, mais aussi comme le porteur de certains savoirs d'élite.
E la lithologie poursuit le seul objectif principal : donner une description aussi adéquate que possible des activités socioculturelles de l'élite. Les tâches auxquelles l’élitologie est confrontée peuvent être réduites à plusieurs points principaux, qui constituent ensemble le « cercle élitologique ». Ainsi, de notre point de vue, le problème élitologique le plus urgent est la recherche d'un ensemble assez stable de critères d'élite pour les groupes socioculturels les plus divers de la société. Deuxièmement, l'élitologie a toujours cherché à retracer l'histoire du développement de l'idée même de l'élection socioculturelle du sujet de cette couche (c'est-à-dire l'histoire même de l'élitologie en tant que science).
P. Avant l'élitologie, il y a aussi un problème assez important de l'analyse des fondements du monde spirituel d'une personne d'élite, c'est-à-dire conscience d'élite et un autre problème philosophique et psychologique étroitement lié à celui-ci - le problème de la personnalité (voir : « personnalisme d'élite » et « pédagogie d'élite » - l'ensemble de ces questions pourrait être attribué par nous au sujet de ce qu'on appelle « philosophie du choix »). Les problèmes sociopolitiques de l'élitologie, qui analysent les activités de l'élite sociale (science politique, sociologie, histoire), forment un monobloc assez important. L'élitologie est également confrontée au problème de la relation et de l'interaction entre l'élite et la culture de masse. Et, enfin, la tâche de surmonter les critiques de l’élitologie émanant des idéologies démocratiques égalitaires.
P. Le problème du leadership et du génie, ainsi que de la sainteté, peut être défini par nous comme un phénomène de « super-élite » ou « d’élite de l’élite », c’est-à-dire ce qui est un exemple (idéal, en tant que système de valeurs) pour l'élite elle-même. Tout cela est de l’élitologie dans sa forme, pour ainsi dire, pure et scientifique.
AVEC D’un autre côté, l’élitologie peut et doit être considérée comme une sorte de système interdisciplinaire qui cimente toutes les connaissances scientifiques importantes (c’est-à-dire sélectionnées, élitistes) pour l’ensemble de l’humanité. Par conséquent, le problème le plus important de l’élitologie réside en elle-même : étant une science d’une éternelle pertinence socio-anthropologique, elle est elle-même (sans fausse modestie) devenue la science la plus pertinente de « tous les temps et de tous les peuples ». D'un point de vue scientifique, l'élitologie (au sens large du terme) combine la pertinence de toutes les sciences, c'est-à-dire la partie la plus significative du savoir, sélectionnée en termes d'importance et de degré de nouveauté, reflétant l'essence même de tel ou tel phénomène (par exemple, tout manuel ou Dictionnaire encyclopédique). L'élitologie remplit tous les principes évoqués ci-dessus en tant que catégories par rapport à ces sciences. Et si la philosophie est la « science des sciences » et l’« art des arts », alors l’élitologie est le « dépositaire des connaissances secrètes ». Dans toute science dans sa forme la plus significative, c'est-à-dire Dans la partie ésotérique, il y a cette sorte d'« élitologie » et, à son tour, chaque science trouve sa place dans l'élitologie lorsque l'on commence à donner une certaine systématicité à ces types sectoriels d'élitologie, c'est-à-dire les réduire à une unité réelle et concrète.
D Pour confirmer cette thèse, ouvrons n’importe quel manuel de physique, d’histoire, de chimie ou toute autre discipline scientifique. Que voit-on là ? Tout d'abord, les œuvres, les découvertes, les actes et les lois des grands scientifiques, écrivains et artistes. Qui sont-ils? L’élite scientifique est l’élite du savoir. Mais cette personnalisation nous ouvre la voie non seulement à la connaissance en tant que telle, mais aussi au monde spirituel même de son auteur ; nous donne la clé avec laquelle nous pouvons pénétrer dans la sphère de sa conscience, élitiste par essence. Prenons n’importe quel concept philosophique ou scientifique là où il traite de l’idéal, et tôt ou tard, directement ou indirectement, nous arriverons au problème de cette conscience d’élite.
AVEC Aujourd’hui, je pense, le moment est déjà venu où l’élitologie peut déclarer publiquement son indépendance scientifique et revendiquer la place et le rôle qui lui appartiennent de droit dans la famille des sciences humaines et sociales. C’est le XXe siècle qui a ouvert l’élitologie en tant que science à la communauté scientifique. C'est Lui qui l'a fait sortir de sa cachette. Et surtout, cela est devenu possible grâce à des penseurs aussi remarquables que G. Lebon, V. Pareto, G. Mosca, N. Berdiaev, R. Michels, H. Ortega y Gasset, Z. Freud, E. Fromm et d'autres. si aujourd'hui nous soulevons le problème élitologique, nous le faisons dans un seul but : donner une nouvelle évaluation, plus significative, de cette même élite du savoir qui a montré à l'humanité un exemple de l'extraordinaire héroïsme de son esprit, car seule l'élite elle-même peut écrire le meilleur de l'élite. Même la critique de l'élitisme est menée à partir de la position d'une autre contre-élite, professant publiquement les principes de l'égalitarisme démocratique, mais restant en même temps une élite dans son esprit et, surtout, dans sa conscience (qui ne devrait cependant pas nous induire en erreur sur ce point).
X Bien qu'il soit extrêmement difficile d'analyser l'élite en adhérant à une position autre que le concept élitiste, puisque la théorie de l'élitisme est en fait devenue partie intégrante de la vision du monde de l'élite elle-même, il serait profondément erroné de considérer l'élitologie uniquement comme l'idéologie de l’élite socioculturelle dominante de la société. L'élitologie est une science, pas une idéologie . C’est là sa différence fondamentale avec les théories « classiques » des élites du début du milieu du XXe siècle. Notons seulement que les données scientifiques de l'élitologie ont été volontiers exploitées par divers concepts idéologiques, souvent politiquement et même spirituellement antagonistes les uns aux autres. Et ce n'est pas la faute, mais le malheur de l'élitologie : être à jamais à l'épicentre des batailles idéologiques, constamment sous la surveillance étroite de divers forces politiques, perdant la pureté de son sujet scientifique.
À Chaque science possède son propre arsenal spécifique et historiquement développé de moyens de pensée logiques, à l'aide desquels les propriétés et l'essence de leurs objets sont comprises. Bien entendu, toute science fonctionne en concepts divers degrés généralité et signification, mais sa « colonne vertébrale » est constituée Concepts fondamentaux- les catégories qui, prises dans un système, forment son système dit catégorique. Le cercle terminologique de l'élitologie comprend des concepts-problèmes tels que : la « différence » en tant qu'individualité ; « l'inégalité » comme qualité, « hiérarchie » ; « domination » en tant que domination ; "direction"; "pouvoir"; "contrôle"; "personnalité"; "génie"; "sagesse"; "sainteté"; "idéal"; "la perfection"; "supériorité"; "responsabilité"; "morale"; « choix » ; "pertinence"; "autorité"; "privilège"; « distance psychologique » ; « conscience d'élite » ; « connaissance d'élite » ou « ésotérisme » - c'est-à-dire ce sont précisément les signes qui caractérisent le plus souvent l’élite. L'appareil catégoriel de l'élitologie est en même temps une liste de ses principaux problèmes, dont l'essence est identifiée par rapport à l'élite et cette science sociale est engagée. Tout au long de l’histoire du développement de la pensée humaine, ces problèmes ont toujours été au centre de l’intérêt scientifique. Une telle activité s'explique tout d'abord par l'importance qu'ils jouaient dans la vie publique et par le fait que leur porteur était la partie la plus active de la société, son sommet - élite.
PRINCIPALES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉLITOLOGIE ET L'histoire de l'élitologie est une section spéciale de la « grande élitologie » et étudie le développement non seulement des idées élitologiques elles-mêmes dans le cadre de la philosophie et de diverses disciplines scientifiques, mais aussi l'histoire socio-politique de l'élite elle-même. Son objectif principal est de révéler les origines idéologiques de l'élitologie en tant que science, de montrer la variété des formes d'expression de cette pensée, d'établir les lois méthodologiques les plus logiques de son développement et de son fonctionnement.
R. L'élitologie considère traditionnellement le philosophe grec ancien de l'école athénienne Platon comme le fondateur de la théorie classique de l'élite, bien que caractéristiques individuelles On retrouve déjà cette discipline scientifique dans la philosophie de Confucius, Bouddha et Pythagore. Mais c’est Platon qui a jeté les bases de ce qu’on appelle la « philosophie de l’élection », qui deviendra plus tard la mère de l’élitologie. Déjà chez Platon, nous voyons une division claire du problème de « l’élection » selon des principes sociaux et anthropologiques. Ses doctrines élitologiques seront ensuite développées par des philosophes élitistes des époques ultérieures, comme Aristote, Plotin, Augustin, Alcuin, N. Machiavel, F. Bacon, T. Hobbes, etc. En fait, tout au long de cette période - de Platon à F. Nietzsche - nous pouvons l'appeler philosophique, puisque les problèmes élitologiques étaient traités exclusivement par les représentants de l'école philosophique. Mais c'était déjà la deuxième étape dans la formation de l'élitologie en tant que science. La première - la période pré-philosophique - était l'époque où l'élitologie existait dans le cadre de la connaissance ésotérique, ce que nous disions déjà au tout début de notre « Introduction ».
AVEC La troisième étape commence à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Il est associé aux noms des classiques de la science de l'élite - V. Pareto, G. Mosca, R. Michels, qui, en fait, ont transformé la « philosophie de l'élite » en élitologie. La naissance de l’élitologie s’est déroulée sous le signe de l’anti-démocratie, qui l’a longtemps séparée de l’attention des scientifiques du « courant social-démocrate ». L'élitologie de cette époque était exclusivement centrée sur la philosophie de l'aristocratie, dont les principaux idéologues au XXe siècle étaient N. Berdiaev et J. Ortega y Gasset. Sur le plan politique, l'élitisme adoptait une position anticommuniste assez stricte, ce qui était sans doute la raison de ses critiques de la part des sociologues prosoviétiques de l'époque, qui opposaient ses principes à leur doctrine de l'élitisme socialiste.
DANS Dans les années 1930, émerge le concept de « société de masse », dont l'idée principale était qu'avec l'avènement d'une société industrielle et hautement urbanisée, la structure des relations entre les individus et la société changeait radicalement. En conséquence, des changements radicaux se produisent dans la conscience publique elle-même. Elle est de plus en plus polarisée entre le « comportement intellectuel » de l’élite et l’état hallucinatoire (c’est-à-dire illusoire, incontrôlable) des masses. Ce n'est que dans les années 40 qu'apparaît le concept d'« élitisme démocratique » (J. Schumpeter, K. Mannheim, G. Lasswell), où la compétition entre diverses élites politiques pour le pouvoir était déjà autorisée. Dans ce cas, les masses influencent la politique par le choix d’élites concurrentes. Selon Lasswell, la démocratie diffère de l’oligarchie non pas par l’absence d’une élite, mais par le caractère « fermé » ou « ouvert », « représentatif » ou « non représentatif » de l’élite. Il a soutenu que « l’élite de la société occidentale moderne diffère de l’élite du passé dans la mesure où ses membres possèdent des connaissances et des compétences et sont donc mieux adaptés aux besoins du leadership que ne l’étaient les démocraties esclavagistes ou féodales à leur époque ».
U Dans les années 50 et 60, paraissent dans la sociologie occidentale des travaux critiquant les théories de l’élite dirigeante (R. Mills) et avançant la thèse selon laquelle il serait correct de parler non pas d’une seule élite dirigeante, mais de « dispersion du pouvoir ». Il a été proposé d'abandonner le concept d'une élite unique, adaptée uniquement aux sociétés relativement peu organisées, et de reconnaître la pluralité des élites, dont le nombre ne cesse de croître. Le processus politique est considéré comme une confrontation entre différentes élites. Le concept d’élite est si raffiné que cette version de la théorie de l’élite coïncide essentiellement avec le concept de pluralisme politique. Selon la théorie du pluralisme des élites, dans la société industrielle moderne, les distinctions entre l’élite et les masses sont effacées et les masses ont accès au leadership politique. Les partisans du pluralisme des élites soutiennent que de nombreuses élites exercent un leadership dans un domaine particulier ; il existe une compétition entre les élites et la politique consiste à parvenir à un compromis entre des groupes concurrents ; les masses font pression sur les élites en utilisant le mécanisme des élections.
THÉORIES D'ÉLITE. AVEC Nous pourrions diviser l'élitologie en tant que science générale sur les théories des élites en trois sections principales : a) l'élitologie classique, c'est-à-dire doctrines sociologiques et des sciences politiques (Platon - Pareto) ; b) l'élitologie de la conscience, basée principalement sur la « réflexion du grand philosophe » et, enfin, c) l'élitologie spécialisée, incluant des théories des élites (différentes par la méthode de justification) telles que : 1/ l'école historique (G. Vico , T. Carlyle) ; 2/ racial-anthropologique (J.A. Gobineau, J.V. Lapouge) ; 3/ concepts de l'art d'élite (T. Adorno, G. Marcuse, H. Ortega y Gasset) ; 4/ théorie sciencecratique (D. Bell) ; 5/ théories psychologiques (G. Gilbert, B. Skinner) ; 6/ psychanalytique (Z. Freud, E. Erikson) ; 7/ socio-psychologique (E. Fromm, G. Lasswell) ; 8/ personnalisation d'élite (N.A. Berdiaev, L. Chestov) ; 9/ théories technocratiques (J. Burnham, J. Galbraith) ; 10/ biologique (R. Williams, E. Bogardus).
N et sur la base de tout ce qui précède, nous pouvons construire la chaîne génétique suivante des classiques de l'élitologie : Platon (et avant lui Pythagore, Héraclite, Démocrite, Socrate) - Aristote - Platoniciens - Sénèque - Apôtre Paul - Plutarque - Denys l'Aréopagite - N Machiavel - T. Hobbes - J. Vico - Romantiques allemands - T. Carlyle - J.A. Gobineau - F.M. Dostoïevski - F. Nietzsche - G. Lebon - N.K. Mikhailovsky - V. Pareto - M. Weber - G. Mosca - R. Michels - H. Ortega y Gasset - N.A. Berdiaev - R. Mills - S. Freud - A. Toynbee - E. Fromm - K. Mannheim - K. Jaspers - M. Young, etc. Cette liste peut être complétée par des représentants de mouvements philosophiques et culturels, de doctrines religieuses et mystiques ( bouddhisme, confucianisme) et l'utopisme socio-politique (T. More, T. Campanella) nous peignent des images idéalistes d'une personne idéale, parfaite à tous égards.
« ELITIARISME" ET "ELITISME".E La lithologie, en tant que science qui étudie la couche socioculturelle qui fournit les dirigeants, décrit ce problème dans deux versions de son appareil conceptuel. On pourrait désigner la première option par le terme « élitisme », la seconde par « élitisme ». Précisons immédiatement notre position terminologique.
ÉLITIARISME- il s'agit d'un système de croyance qui justifie dans un premier temps le comportement tribal de l'élite ; il s'agit, parfois même pas d'une vision complètement critique, de l'élite du point de vue de l'élite elle-même - un jugement interne sur l'élite par un représentant de cette élite. L’élitarisme, en tant qu’idéologie de domination, est donc une vision ésotérique du monde de l’élite, reflétant adéquatement le type de comportement socioculturel aristocratique.
DANS différence avec l'élitisme ÉLITISME est une vision extérieure de l’élite ; il s’agit d’un jugement extérieur, le plus souvent critique. Par exemple, le point de vue d'un représentant de l'élite du savoir sur un représentant de l'élite du pouvoir, etc. Parmi les manifestations les plus frappantes de l’élitisme, on peut citer la théorie « platonicienne-machiavélique » de la justification idéologique du pouvoir de l’élite politique.
ET l'élitisme et l'élitisme, en tant que concepts idéologiques des élites, constituent un élément central de la vision du monde des représentants de cette couche. L'importance de l'étude de ces doctrines est due au rôle important joué par les détenteurs de ce système de connaissances dans la vie socioculturelle de toute société. C’est la pertinence croissante de l’élitologie à chaque nouveau siècle, qui s’occupe en fait de collecter et de traiter les connaissances stratégiques de la partie avancée de la société. Mais l’élitologie n’est pas seulement génératrice d’une pensée avancée sur l’humanité (à cet égard, toutes les sciences, dans leur part qui concerne la société, sont directement ou indirectement des « petites élites »), mais aussi une science qui étudie le fonctionnement même de l’humanité. « mécanisme » qui produit cette connaissance, c'est-à-dire . étudie la personne elle-même - sa position matérielle, socio-politique et spirituelle dans la société.
DANSà propos du rapport entre élitisme et élitisme, il est important de noter leur constante dans le domaine de la théorie et leur permanence dans le domaine de la conscience du sujet de l'élite. Le problème est que ces deux directions sont déterminées et il est souvent difficile pour un chercheur de déterminer quelle partie de l'élitisme est l'élitisme et laquelle est l'élitisme ? L'interpénétration de l'élitisme dans l'élitisme et vice versa est due au fait que tous deux sont des reflets qui ne diffèrent que par la finalité de leur action.
DANS A titre d'exemple, on peut citer le classique de l'élitologie, le sociologue italien Vilfredo Pareto : en tant que représentant de l'élite du savoir et théoricien de l'école sociologique de l'élitologie, il est un représentant de l'élitisme, mais comme issu de l'élite du sang (Pareto appartenait à une ancienne famille aristocratique d'Italie) et en tant que représentant de l'élite au pouvoir (sous Mussolini, il devint sénateur du Royaume d'Italie en 1923), ses opinions peuvent déjà être qualifiées d'élitisme. Presque la même chose, mais avec des réserves mineures, on peut dire de la genèse de la vision du monde de Confucius, Platon, T. More, N. Machiavel, F. Bacon et d'autres adeptes de cette tradition. Conclusion générale : l'élitisme se transforme à chaque fois en élitisme lorsque les représentants de l'élite du savoir commencent à faire partie de l'élite du pouvoir, et, à son tour, l'élitisme se transforme en élitisme lorsque les représentants de l'élite du pouvoir commencent à généraliser et à transférer à d'autres couches d'élite ce qu'ils avoir accumulé du matériel réel (principalement théorique).
E Le litisme peut aussi être appelé l'héritage spirituel des pères de l'Église - Antoine le Grand et Cie - qui ont laissé derrière eux des instructions spirituelles sur les moyens d'améliorer la nature humaine. Antoine le Grand et Cie y justifient (Voir : « Philokalia » en 5 volumes) l'ascétisme de l'âme et de la chair, par lequel une personne devient moralement parfaite et ressemble à un saint aux yeux d'un étranger, mais d'un observateur sympathique . Dans ce cas, toute la littérature hagiographique (vies des saints) est de l’élitisme – une réponse aux œuvres des pères de l’Église.
N Nous devrions également dire ici quelques mots sur l’élitisme dit « caché » ou historique, qui réside dans la méthode même de la narration historique. La grande majorité des historiens du passé ont préféré raconter les événements concernant l’élite du point de vue de l’élite elle-même. Des historiens élitistes tels que Gaius Suétone, Plutarque, Vasarius et autres se sont exclusivement engagés dans la biographie de grands personnages et d'événements de l'Antiquité et de leur époque. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont écrit sur rien d’autre. Mais nous ne les connaissons qu'à travers ces biographies. Littérature de mémoire dans l'esprit de Philippe de Comines était et reste aussi populaire auprès du public que l'hagiographique, traitant de la vie des saints, et l'épopée - sur les grandes actions héros légendaires. L'histoire, d'une manière ou d'une autre, « tourne » autour de son centre : l'élite culturelle et socio-politique de la société. Il est difficile de trouver un historien qui violerait cette ancienne tradition historiographique, car les masses ne peuvent être écrites qu’à travers les images de personnalités marquantes qui ont réussi à capter l’esprit et le cœur de la foule qu’elles dirigeaient. Robin des Bois et Rossignol le voleur, Wat Tyler et Stenka Razin, et K. Marx - F. Engels - V. Lénine - J. Staline et Cie, c'est aussi l'élite, pas les masses.
DANS Prenons, par exemple, le livre d’E.V. Fedorova « Le peuple de la Rome impériale » [Moscou 1990] et voyons comment les informations historiques sur ces mêmes « personnes » y sont distribuées. Le livre se compose de deux parties : 1) " Des gens simples Rome impériale" (P.13-40) et 2) "Les empereurs et leurs proches" (P.41-335). D'après les chiffres donnés, il est évident que l'auteur de ce livre s'intéresse surtout à l'Élite ! Bien que nulle part cela ne leur est directement mentionné. On pourrait donner des centaines d'autres exemples similaires, mais cela prendrait trop de temps. Notons seulement que ce type d'élitisme se manifeste le plus dans l'histoire des sciences - donc toutes les écoles et université cours de formation entièrement composé de récits des idées de grands scientifiques, aristocrates de l'esprit. C’est cette même élite qui nous a laissé un héritage sous forme de connaissances scientifiques avec des traces de leur extraordinaire conscience. En acquérant ces connaissances, nous nous familiarisons nous-mêmes avec la nature de la conscience d’élite. Et parfois, nous le faisons de manière complètement inconsciemment.
STRUCTURE DE L'ÉLITOLOGIE G Parlant de manière générale de la structure de l'élitologie en tant que science, nous devrons souligner au moins quatre des composantes les plus importantes de cette discipline, à savoir : 1) les types d'élitologie ; 2) les principales orientations élitologiques ; 3) les grandes sections de l'élitologie et 4) les blocs problématiques de l'élitologie, ainsi que les disciplines élitologiques dites « auxiliaires » (voir tableau n°1).
je Le noyau de la structure de l'élitologie est la théorie des élites elle-même, qui traite des problèmes de stratification, de recrutement et de fonctionnement des dominants socioculturels de la société. En plus de ce « noyau », des disciplines dites de branche sont adjacentes à l'élitologie, telles que : 1) l'élitologie anthropologique ; 2) l'élitologie sociologique ; 3) l'élitologie politique ; 4) l'élitologie de l'histoire ; 5) élitologie des études culturelles ; 6) philosophie de l'élitologie ; 7) élitologie psychologique ; 8) pédagogie d'élite ; 9) élitologie religieuse.
R. Il est entendu que les frontières structurelles entre ces disciplines élitologiques sectorielles sont conditionnelles, puisque de nombreux problèmes élitologiques (tels que des problèmes tels que la conscience d'élite, la personnalité, l'autorité, etc.) se situent à l'intersection de nombreuses disciplines élitologiques et nécessitent une méthode de recherche globale. Cependant, les branches de l'élitologie que nous avons indiquées concernent dans une plus large mesure moins sa structure que son histoire et sont souvent indépendantes par rapport aux orientations des autres disciplines des sciences sociales.
Tableau n°1 Structure de l'élitologie
I. TYPES D'ÉLITOLOGIE |
1) PRATIQUE 2) THÉORIQUE 3) APPLIQUÉ |
Je je. PRINCIPALES ORIENTATIONS ÉLITHOLOGIQUES |
1) ANTHROPOLOGIQUE 2) PUBLIC (SOCIAL) |
II I. PRINCIPALES SECTIONS DE L'ÉLITOLOGIE |
1) Élitologie de l'histoire ; 2) Élitologie de l'État et du droit ; 3) Élitologie de la politique ; 4) Élitologie de la religion ; 5) Élitologie de la culture ; 6) Élitopédagogie et psychologie ; 7) Élitopersonalisme ; 8) Philosophie du choix. |
IV. BLOCS PROBLÉMATIQUES DE L'ÉLITOLOGIE |
1/ Blocage socio-politique ; 2/ Blocage éthico-religieux ; 3/ Bloc philosophique et culturel. |
V. DISCIPLINES ELITOLOGIQUES AUXILIAIRES |
1/ Hagiographie et hagiologie ; 2/ Ascétisme ; 3/ Généalogie ; 4/ Herméneutique ; 5/ Eugénisme ; 6/ Idéologie ; 7/ Personnalisme ; 8/ Psychographologie ; 9/ Elitopsychologie ; 10/ Darwinisme social ; 11/ "Philosophie de la conscience de soi" 12/ Éthique de la perfection. |
I. Élitologie anthropologique.UN L'élitisme anthropologique proclame l'homme comme la forme la plus élevée de l'être, devenu leader grâce à la présence en lui d'un système auto-développé qui n'a pas d'analogue direct dans la nature vivante - la conscience (Genèse 2 : 7). Cette doctrine de vues repose sur l'idée de la supériorité de la race humaine sur le monde qui l'entoure, connue de presque toutes les nations (l'anthropocentrisme ou, selon la terminologie de F. Bacon, « l'idole de la race »). Nous pourrions également définir ces opinions comme « l’anthropoélitisme », c’est-à-dire reconnaissance de l'homme comme « couronne de la nature », dont les principales dispositions ont été formulées par la philosophie de la Renaissance.
II. Élitologie sociologique.DANS Cette élite sectorielle se concentre sur l’essence sociale de l’élite, le problème de sa stratification, de son recrutement, de sa gestion, de sa domination économique et politique et, enfin, le problème du comportement de l’élite. L’élite fait depuis longtemps l’objet d’études en micro et macro sociologie. Cela est particulièrement vrai de la « théorie du conflit » (les nantis et les démunis - K. Marx, R. Dahrendorf) et de la théorie sociologique des élites des classiques de l'élitologie du XXe siècle V. Pareto et G. Mosca. .
III. Élitologie politique.P. L'élitologie politique traite des questions de leadership politique, des questions de recrutement politique et de gestion de l'élite du pouvoir (gestion), ainsi que de l'idéologie de justification de la domination politique de l'élite dirigeante (Platon, N. Machiavelli, T. Hobbes, R. Michels, etc.).
IV. Élitologie de l'histoire.ET l'élitologie historique traite des problèmes liés au rôle d'une personnalité marquante dans l'histoire publique, aux questions d'un leader charismatique, au culte de la personnalité, à la hiérarchie sociale, à la généalogie des familles nobles (dynasties) et des célébrités, ainsi qu'à l'héritage spirituel historique de personnalités marquantes dans le domaine de la politique, de la science et de la culture (Plutarque, Suétone, D. Vico, T. Carlyle, etc.).
V. Élitologie culturologique. À l'élitologie culturologique est principalement associée à la nécessité d'étudier héritage culturel personnalité exceptionnelle; il s'agit de l'étude de la vision du monde d'un Génie à travers l'analyse de son monde personnalisé d'idées. L’élitologie culturelle a trouvé son expression la plus complète dans le concept dit d’« art d’élite », dont les fondateurs sont A. Schopenhauer, F. Nietzsche, H. Ortega y Gasset, T. Adorno, G. Marcuse et d’autres. La relation entre la dynamique du développement de la culture de masse et celle de l’élite est au centre de l’attention de cette branche de la discipline élitologique.
VI. Philosophie de l'élitologie (ou « Philosophie de l'élection »). F L'identification philosophique des problèmes élitologiques se résume à trois positions principales : 1) le problème éthique de l'être choisi ; 2) le problème de l'être choisi dans le cadre de la philosophie sociale et 3) le problème de la conscience de l'élite, où a) lorsqu'une analyse est donnée de la conscience générique de l'élite en tant que groupe (strate) et b) lorsque le reflet de la conscience individuelle des élites est analysée (le problème de la personnalité, du génie, de la sainteté, etc.).
g La thèse principale dont procède la philosophie de l'élection est associée à l'idée du fondateur de la théorie des élites, Platon, qui soutenait qu'« il n'est pas inhérent à la foule d'être philosophe » (« État » VI, 494a) et que les philosophes soient choisis, c'est le sort de quelques-uns, de « l'élite de l'esprit ». À travers le personnalisme d’élite, la philosophie de l’élection est la plus étroitement liée à l’élitologie psychologique et à la pédagogie d’élite.
VII. Élitologie psychologique. P. L'élitologie psychologique révèle l'essence des concepts associés au problème de la « distance psychologique » entre des personnes ayant des capacités psychophysiologiques et socioculturelles différentes. La psychologie traite des questions de conscience, de personnalité, de génie, etc. (C. Lombroso, Z. Freud, E. Fromm), en les dérivant du comportement motivationnel d'une personne appartenant à la couche élite de la société.
N Il faut aussi noter le lien étroit de l'élitologie psychologique avec la pédagogie de l'éducation d'élite, qui révèle la genèse de l'individu, les mécanismes de sa formation intellectuelle et spirituelle, les formes et les moyens de cette formation.
VIII. Élitopédagogie.DANS l'éducation est une explication de l'échelle des valeurs entre le bien et le mal. La pédagogie d’élite est donc avant tout une hiérarchie des connaissances. Et puisque toute hiérarchie est déjà une sorte d'élitisme, alors la conversation devrait donc porter sur les valeurs du monde spirituel de l'homme. Tout comme la philosophie de l'élection et l'élitologie psychologique, la pédagogie d'élite étudie la genèse d'une personnalité géniale, c'est-à-dire le processus de son auto-éducation, ainsi que l'analyse de ces systèmes pédagogiques qui lui permettent de révéler sa créativité.
IX. Élitologie religieuse. E la lithologie de type études religieuses révèle une couche assez originale d'éthique de perfection spirituelle des fondateurs de toutes les religions du monde, ainsi que des enseignements religieux ésotériques du passé, comme le pythagorisme, l'orphisme, l'hermétisme, etc. (E. Schure). En plus de cela, nous parlons également de « philosophie ascétique » (bouddhisme, christianisme), c'est-à-dire sur l'analyse hagiographique du monde spirituel du Saint et l'influence qu'il a eu avec son exploit pastoral sur la formation de la conscience religieuse publique.
TYPES D'ÉLITOLOGIEDANS dans un certain sens" élitologie pratique« combine la science politique appliquée et la sociologie dans l’étude de l’élite du pouvoir réel occupant des positions politiques de premier plan à l’heure actuelle. Ce qui distingue l’élitologie pratique de l’élitologie théorique est que la seconde considère l’élite comme un phénomène déjà historiquement établi, tandis que la première explore son état moderne, momentané et encore inachevé. Et ici, il convient de rappeler la célèbre phrase de l’historien anglais du XIXe siècle Edward Freeman selon laquelle « l’histoire est la politique du passé et la politique est l’histoire du présent ». Il est également important de noter la différence entre élitologie pratique et élitologie appliquée. Cette différence réside dans le fait que l'élitologie appliquée traite de la mise en pratique des données théoriques élitologiques (politique et culture) et constitue en quelque sorte le dernier maillon de la doctrine de l'élite (élitologie générale) : « élite pratique » - "Élitologie théorique" - "Élitologie appliquée" . En fait, la séquence indiquée des parties de l’élitologie reflète l’état actuel de leur degré de développement. L’élitologie pratique est de nature purement empirique et constitue en réalité une branche propédeutique de l’élitologie générale. L’importance du rôle de cette propédeutique se voit dans le nombre de publications sur ce sujet. Il existe en effet nettement moins d’ouvrages théoriques (analytiques) généraux sur l’élitologie que de publications sur l’élitologie pratique. Le rapport approximatif de ces travaux peut être défini comme étant de 1 à 100.
D Pour l’élitologie pratique, la question d’une classification et d’une identification précises des élites actuelles est importante. Il est donc nécessaire de s’attarder sur ces points importants et de leur donner une brève description. Base méthodologique L’élitologie pratique peut être réduite aux points suivants. En règle générale, l'élitologie pratique étudie le problème des relations entre l'élite au pouvoir et les contre-élites ; examine les questions de recrutement des élites et de développement de leurs idéologies de parti. Mais très souvent, l’élitologie pratique se trouve confrontée à un autre problème important et encore insoluble : celui de la « pseudo-élite ». La pseudo-élite est le fléau principal de toute élitologie : elle en est une sorte de mythe raté, le maillon le plus vulnérable de sa construction théorique.
P. Le problème de l’étude de l’élite réelle réside dans le « triangle noir » des questions suivantes : 1) que pense le sujet de l’élite de lui-même (c’est-à-dire s’identifie-t-il à l’élite ?) ; 2) comment l’élite elle-même le perçoit-elle ? 3) quelles associations cela évoque-t-il dans la conscience publique de masse ? Identifier les réponses à ces questions peut clarifier la première partie du problème de l'identification de la véritable élite : si un sujet donné appartient ou non à l'élite, c'est-à-dire Nous parlons de la composition personnelle d'une élite spécifique. Deuxième partie du problème : quel est le caractère de cette élite ? La typologisation des élites permettra de classer les sujets élitisés selon le principe de spécialisation de leurs mérites. Dans le même temps, la catégorie « dignité » elle-même devrait être clarifiée. L’élitologie reconnaît que la « dignité » peut être à la fois « réelle » et « formelle ». En outre, la « dignité » peut être « établie par l’État » (principalement n’importe quel poste administratif) et « acquise individuellement » (développée). De plus, la « dignité établie » n’est pas toujours honnêtement atteinte, c’est-à-dire Le principe de justice méritocratique n’est pas toujours respecté. Atteindre l'établi (le bon) dans le premier cas signifie entrer d'une manière ou d'une autre dans un pouvoir de nature administrative-politique, et dans le second - l'affirmation d'un pouvoir de nature purement personnaliste, c'est-à-dire affirmation de soi comme composante fondamentale de la personnalité.
T Ainsi, l'élite « idéale (« normale » d'un point de vue scientifique) est une telle élite lorsque la dignité de ce qui a été établi et de ce qui a été réalisé coïncide : l'« élite formelle » est celle où une seule de ces composantes est présente ou même leur apparence est créée. La limite ultime de l’élite formelle peut être la pseudo-élite, c’est-à-dire fausse identification à l'élite des porteurs de la culture et de l'idéologie de masse, uniquement sur la base de leur activité politique (ou autre) externe.
N Il est également nécessaire de clarifier des concepts tels que « l’élite de statut » (qui caractérise principalement l’élite politique) et « l’élite du savoir » (qui caractérise principalement l’élite intellectuelle). Cette classification précise et complète la typologie des élites de D. Bell, qui divisait l'élite en : « élite du sang », « élite de la richesse » et « élite du savoir ». Les publications disponibles aujourd'hui sur ces élites nous obligent à conclure que ces sujets sont isolés dans étude générale les élites en un bloc de recherche indépendant, comme les priorités qui ont un impact significatif sur le développement de l'élitologie. Si l’on compare le ratio entre l’élite de statut et l’élite du savoir, nous pouvons identifier les paramètres suivants :
Tableau n°2 Caractéristiques comparatives de l'élite du statut et de l'élite du savoir (mérites)
Possibilités |
||
statut d'élite |
élite du savoir |
|
L'idée des masses |
idéologique |
Théorique |
idée de l'élite |
pragmatique |
Épistémologique |
processus d'élitisation |
réussite en grade |
Éducation d'élite |
nature de la sélection |
Administratif |
|
caractère de leadership |
Formel-réel |
réel-formel |
caractère psychologique du sujet |
Dépendance au collectivisme |
la prédominance de l'individualisme |
principe de dignité personnelle |
basé sur l'image et l'activisme |
|
qualité de conscience |
connaissance du pouvoir |
pouvoir sur la connaissance |
AVEC L’élite du tatouage ne possède qu’une petite partie des qualités de l’élite du savoir, tout comme l’élite du savoir elle-même ne possède qu’une certaine partie des qualités de l’élite du statut. Cela s'explique par l'inégalité du processus de leur développement, ainsi que par la compétition qui a toujours eu lieu entre eux depuis l'époque de Confucius et de Platon.
P. L’élitologie raciste accorde incomparablement plus d’attention aux problèmes de l’élite politique. Les publications scientifiques sur cette question indiquent que le principal problème de l'élite politique concerne les questions liées à la politique du personnel. Le problème de la pseudo-élite est aussi le problème d’un sujet qui est tombé accidentellement dans le groupe d’élite et, de l’avis de tous, est porteur de la conscience et de la culture de masse. Le principe clientéliste de sélection des élites contribue à l’accumulation de substance anti-élite au sein de l’élite elle-même, ce qui la rend dysfonctionnelle et dépendante de la situation sociale. L’élite s’isole et l’afflux de nouveaux sujets véritablement élitistes s’arrête, ce qui entraîne, selon les mots de A. Toynbee, un « départ de la minorité créative » de l’arène du développement social. La question du personnel ne peut être résolue qu'en accordant une attention particulière au niveau d'éducation des individus promus à l'élite et à la qualité de ceux-ci. les établissements d'enseignement qu'ils terminaient.
N Malgré le fait que l'élitologie pratique soit principalement de nature descriptive, la banque de données qu'elle constitue sur l'état réel des élites politiques, financières et économiques crée des conditions préalables favorables au développement productif de l'élitologie théorique. Malheureusement, l'élitologie pratique n'accorde pas l'attention voulue aux questions d'élitologie anthropologique, laissant ces problèmes à la psychologie et à la philosophie. Compte tenu du récent tournant assez brutal des intérêts de l'élitologie des problèmes socio-sociaux vers le facteur humain, on peut supposer que le nombre de publications sur cette question devrait bientôt augmenter. Cette hypothèse est étayée par le fait que l'élitologie anthropologique révèle les mécanismes de motivation interne du sujet de l'élite et devrait, en théorie, précéder l'étude de son existence sociale. De plus, l'élitologie anthropologique a, là où grande histoire son étude pratique plutôt que l'élitologie sociale et son intérêt incontestable pour des sciences telles que la psychologie, la pédagogie, les études culturelles et la philosophie. L'élitologie pratique atteint ainsi un tout nouveau niveau de développement, qui devrait en général placer toute élitologie sur un pied d'égalité avec les principales sciences sociales.
« LA QUESTION PRINCIPALE DE L'ÉLITOLOGIE. AVEC du point de vue de la conscience de masse, l'élite est composée de tous les dirigeants formels et informels, de leur entourage immédiat et de ceux qui les aident activement à atteindre leurs objectifs. Du point de vue de la conscience élitiste, l'élite est un cercle plus étroit, d'où sont exclus tous les éléments pseudo-élites qui, dans le premier cas, tombaient dans la catégorie de cette strate.
P. La question la plus fondamentale de l’élitologie en tant que science des activités socioculturelles de l’élite est peut-être la question des critères et le problème qui en résulte de la typologisation de l’élite elle-même. Cette question peut en effet être reconnue comme la principale, puisque tous les autres problèmes élitologiques reposent sur elle, c'est-à-dire c'est le matériel initial et préparatoire à toute recherche élitologique.
P. La situation est encore compliquée par le fait que diverses sciences sociales (sciences politiques, sociologie, etc.) proposent leurs propres critères d'élitisme, de leur point de vue, les plus corrects et les plus acceptables, qui souvent ne fonctionnent pas, et parfois même des prémisses incorrectes pour d'autres disciplines ou même des directions élitologie elle-même. Ainsi, par exemple, les critères d'élitisme utilisés par l'élite politique pour déterminer l'élite politique sont totalement inadaptés aux critères de l'élite anthropologique. En raison de cette incohérence, ces deux types d’élites s’évaluent très souvent de manière critique et, dans certains cas, se nient même l’élitisme lui-même, arguant que telle ou telle élite n’est pas du tout une « élite », mais seulement son apparence. Ainsi, la question des critères d’élite est l’enjeu principal de l’élitologie dans son ensemble, puisqu’elle aborde directement les problèmes méthodologiques généraux de cette discipline scientifique.
THÉORIES CLASSIQUES DE L'ÉLITEDANS Sous leur forme moderne, les théories sociologiques des élites se sont formées au tournant des XIXe et XXe siècles. Les sociologues sont considérés comme leurs fondateurs Vilfredo Pareto (1848 - 1923), Gaetano Mosca(1858 - 1941) et Robert Michels(1876-1936). Le cœur de la sociologie de V. Pareto était le développement d'une « nouvelle logique » qui permet d'analyser, d'un point de vue formel, les manifestations verbales de l'activité des individus et, sur cette base, de construire des hypothèses qui permettent identifier les éléments permanents de l’action sociale. Il a déclaré que la loi la plus importante du développement de la société humaine était « la loi du mouvement circulaire, de la montée et de la chute des élites ». Dans son Traité de sociologie générale en quatre volumes (1916), il tente d'exposer la relation entre les sentiments et la pensée, puis la relation entre les sentiments et la pensée et la gestion et le contrôle de la vie sociale. Selon lui, le développement de la société suit une « loi de l’élite » strictement définie. Pareto divise la population entière en deux couches : la plus élevée et la plus basse : « Chaque peuple, explique-t-il, est gouverné par une élite, un élément sélectionné de la population ». V. Pareto part de deux positions : l’inégalité objective des personnes et l’idée subjective d’égalité d’une personne. Leur interprétation sert de catalyseur de changement dans la société. Selon Pareto, la partie « élite » sélectionnée de la société est constamment éliminée et remplie d'espace libre par les représentants des couches inférieures. C’est dans ce processus de « circulation des élites » qui surgit comme l’effet d’une combinaison des éléments de l’action sociale ci-dessus que naît un continuum de l’histoire. L’accumulation de qualités « supérieures » dans les couches inférieures et la dégradation des couches supérieures constituent une raison impérieuse de rupture de l’équilibre social. Les classes dirigeantes se renouvellent non seulement numériquement, mais aussi qualitativement, par sexe. La « décadence » des élites est directement dépendante de la mobilité sociale dont elles ont besoin pour se renouveler. La stabilité d’une propriété sociale tend à s’affaiblir dans le cas de l’élite.
T Ainsi, Pareto présente précisément la société comme une circulation d’élites. C’est hétérogène. L'inévitabilité de la division de la société entre l'élite et les masses et l'hétérogénéité de la société sont déterminées par l'inégalité psychologique initiale des individus, qui se manifeste dans toutes les sphères de la vie publique. La particularité d'un groupe social particulier dépend des caractéristiques naturelles et des talents de ses membres, ce qui détermine à son tour la position sociale du groupe à l'un ou l'autre niveau de l'échelle sociale.
ET la division hiérarchique des personnes peut être effectuée selon différents indicateurs(autorité, éducation, talent, carrière, etc.). Mais Pareto considérait la richesse comme le principal indicateur de l’élitisme. L'élite détermine la dynamique de la société et son équilibre. Si système social est déséquilibré, puis avec le temps il y revient. Les oscillations du système et son retour à sa forme normale forment un cycle. Pareto représentait le progrès historique comme une circulation éternelle des principaux types d'élites : "Les élites naissent des couches inférieures, montent au sommet, y prospèrent, mais, à la fin, dégénèrent, sont détruites et disparaissent. Les membres dégradants des élites descendent". dans les masses. » Pareto considérait ce cycle d’élites comme une loi universelle de l’histoire. Les qualités qui confèrent à l'élite la domination changent au cours du cycle de développement social, donc le type d'élites change, et l'histoire se révèle être le cimetière de l'aristocratie. En comparant l'élite aux masses, Pareto estime que la première se caractérise par la productivité, haut degré activités. Elle doit posséder au moins deux qualités essentielles : la capacité de persuader en manipulant les émotions humaines et la capacité de recourir à la force lorsque cela est nécessaire, en fonction de la situation historique spécifique. Si Pareto se concentre sur le remplacement d'un type d'élite par un autre, alors G. Mosca préconisait la pénétration progressive des « meilleurs » éléments de la masse dans l'élite ; Si Mosca a absolutisé le facteur politique, alors Pareto a donné la préférence au facteur psychologique. Par conséquent, l’interprétation des valeurs des élites vient de Pareto et le concept d’école d’élite politique vient de Musk.
g.Mosca a défendu l’inévitable division de toute société en deux sociétés inégales. statut social et les rôles du groupe. En 1896, dans « Fondements de la science politique », il écrivait : « Dans toutes les sociétés, depuis les sociétés les plus modérément développées et atteignant à peine les prémices de la civilisation jusqu'aux sociétés éclairées et puissantes, il existe deux classes de personnes : la classe des dirigeants et la classe des dirigeants. classe des gouvernés. Les premiers, toujours en nombre relativement restreint, exercent toutes les fonctions politiques, monopolisent le pouvoir et jouissent de ses avantages inhérents, tandis que les seconds, plus nombreux, sont contrôlés et régulés par le premier... et lui fournissent le matériel. moyens de soutien nécessaires à la viabilité du corps politique. Mosca a analysé le problème de la formation d'une élite politique et ses qualités spécifiques. Il pensait que le critère le plus important pour y entrer était la capacité de gérer d'autres personnes, c'est-à-dire capacité organisationnelle, ainsi que distinguer l'élite du reste de la société par une supériorité matérielle, morale et intellectuelle. Il existe deux tendances dans le développement de la classe dirigeante : aristocratique et démocratique. Le premier d’entre eux se manifeste dans la volonté de la classe politique de devenir héréditaire, sinon légalement, du moins dans les faits.
P. la prédominance de la tendance aristocratique conduit à la « fermeture et à la cristallisation » de la classe, à sa dégénérescence et, par conséquent, à la stagnation sociale. Cela implique en fin de compte une intensification de la lutte de nouvelles forces sociales pour occuper des positions dominantes dans la société. La deuxième tendance, démocratique, s'exprime dans le renouvellement de la classe politique aux dépens des plus capables de gouverner et des couches inférieures actives. Un tel renouveau évite la dégénérescence de l’élite et la rend capable de diriger efficacement la société. Un équilibre entre les tendances aristocratiques et démocratiques est le plus souhaitable pour la société, car il assure à la fois la continuité et la stabilité de la direction du pays, ainsi que son renouveau qualitatif.
À R. Michels a apporté une contribution majeure au développement de la théorie des élites politiques. Il a étudié les mécanismes sociaux qui donnent naissance à l'élitisme de la société. Fondamentalement, d'accord avec Mask dans son interprétation des causes de l'élitisme, Michels met particulièrement l'accent sur les capacités organisationnelles, ainsi que sur les structures organisationnelles de la société, qui renforcent l'élitisme et élèvent la couche dirigeante. Il conclut que l’organisation même de la société requiert l’élitisme et le reproduit naturellement.
DANS la société fonctionne sous la « loi d’airain des tendances oligarchiques ». Son essence est que le développement de grandes organisations, indissociables du progrès social, conduit inévitablement à l'oligarchisation de la gestion sociale et à la formation d'une élite, puisque la direction de telles associations ne peut être assurée par tous leurs membres. L’efficacité de leurs activités nécessite une spécialisation fonctionnelle et une rationalité, une pensée du noyau et de l’appareil dirigeant, qui échappent progressivement mais inévitablement au contrôle des membres ordinaires et subordonnent la politique à leurs propres intérêts, se souciant avant tout de maintenir leur position privilégiée. Les membres ordinaires des organisations sont plutôt passifs et font preuve d'indifférence à l'égard du quotidien. activité politique. En conséquence, toute organisation, même démocratique, est toujours virtuellement dirigée par un groupe oligarchique et élitiste. Ces groupes les plus influents, soucieux de préserver leur position privilégiée, établissent entre eux diverses sortes de contacts, s'unissent, oubliant les intérêts des masses.
DANS Dans les travaux de V. Pareto, G. Maschi et R. Michels, le concept d'élite politique a déjà reçu des contours assez clairs. Son les propriétés les plus importantes, paramètres qui nous permettent de distinguer et d’évaluer diverses théories élitistes de la modernité. Ceux-ci incluent : 1) les propriétés spéciales inhérentes aux représentants de l'élite ; 2) les relations qui existent au sein de la couche d'élite et caractérisent le degré de sa cohésion et de son intégration ; 3) les relations entre l'élite et la non-élite, les masses ; 4) recruter l'élite, c'est-à-dire comment et à partir de qui il est formé ; 5) le rôle de l'élite dans la société, ses fonctions et son influence.
AVEC Parmi les tendances modernes de la théorie des élites, il faut souligner telles que « l'école machiavélique », les « théories des valeurs », les théories de « l'élitisme démocratique », les « concepts de pluralisme des élites », les « concepts libéraux de gauche ». Une présentation détaillée des principaux points de ces théories d’élite dépasse le but de cette étude. Nous nous concentrerons donc sur l’une de ces positions, qui, à notre avis, est la plus proche de la théorie de l’éducation des élites. Les théories des valeurs de l'élite, comme les concepts machiavéliques, considèrent l'élite comme la principale force constructive de la société, mais elles adoucissent leur position par rapport à la démocratie et s'efforcent d'adapter la théorie de l'élite à vrai vieÉtats modernes. Les diverses conceptions de valeurs des élites diffèrent considérablement dans le degré de protection de l'aristocratie, l'attitude envers les masses, la démocratie, etc. Cependant, ils présentent également un certain nombre des paramètres communs suivants :
AVEC L’égalité sociale doit être comprise comme l’égalité des chances dans la vie, et non comme l’égalité des résultats et du statut social. Puisque les gens ne sont pas égaux physiquement, intellectuellement, dans leurs énergie vitale et l'activité, il est alors important qu'un État démocratique leur fournisse à peu près les mêmes conditions de départ. Ils atteindront la ligne d'arrivée à des moments différents et avec des résultats différents. Des « champions » sociaux et des outsiders émergeront inévitablement. Certains partisans de la théorie des valeurs des élites tentent de développer des indicateurs quantitatifs caractérisant son influence sur la société. Ainsi, N.A. Berdiaev, sur la base d'une analyse du développement de différents pays et peuples, a conclu " coefficient d'élite"comme l'attitude de la partie la plus intelligente de la population à l'égard nombre total alphabétisé. Un taux d’élite supérieur à 5 % signifie qu’une société possède un potentiel de développement élevé. Dès que ce coefficient descendit à environ 1%, l'empire cessa d'exister et la stagnation et l'ossification de la société furent observées. L’élite elle-même s’est transformée en caste, en sacerdoce. L'histoire du monde montre que la dégradation des élites coïncide toujours de la manière la plus étrange avec la dégradation de la société ou de l’État lui-même. Apparemment, ces processus sont étroitement liés les uns aux autres, mais ce problème relève de l'élitologie politique, bien que certaines de ces questions aient également été examinées par l'historien anglais A. Toynbee dans son célèbre livre "Comprehension of History".
C Les idées éthiques sur le rôle de l’élite dans la société prévalent parmi les néoconservateurs modernes, qui soutiennent que l’élitisme est nécessaire à la démocratie. Mais l’élite elle-même doit servir d’exemple moral aux autres citoyens et inspirer le respect d’elle-même, confirmé par des élections libres. Les principales dispositions de la théorie des valeurs des élites sous-tendent les concepts élitisme démocratique (démocratie d’élite), qui se sont répandues dans monde moderne. Ils partent de la compréhension de la démocratie proposée par J. Schumpeter comme une compétition entre dirigeants potentiels pour la confiance des électeurs. Les élections politiques elles-mêmes représentent un mécanisme d’élitisation et le suffrage est, par essence, le droit de l’élite. Comme l'écrit K. Mannheim, "la démocratie implique une tendance anti-élitiste, mais ne nécessite pas d'aller jusqu'à l'équation utopique de l'élite et des masses. Nous comprenons que la démocratie ne se caractérise pas par l'absence d'une couche d'élite, mais plutôt par une nouvelle méthode de recrutement et une nouvelle conscience de soi de l’élite.
AVEC Les partisans de l'élitisme démocratique, citant les résultats de recherches empiriques, soutiennent que la véritable démocratie a besoin à la fois des élites et de l'apathie politique des masses, car une participation politique excessive menace la stabilité de la démocratie. Les élites sont nécessaires avant tout comme garantes d’une composition de qualité de dirigeants élus par la population. La valeur sociale même de la démocratie dépend de manière décisive de la qualité de l’élite. La couche dirigeante possède non seulement les qualités nécessaires à la gouvernance, mais sert également de défenseur des valeurs démocratiques et est capable de contenir l'irrationalisme politique et idéologique, le déséquilibre émotionnel et le radicalisme souvent inhérents aux masses.
T Ainsi, les élitologues soutiennent que les « élus » acquièrent des positions de leadership en raison de leur qualités naturelles, « capacités innées à occuper une position privilégiée » (G. Lasswell), « désir de pouvoir » (M. Ginsberg), dus à « la perspicacité divine », qualités mystiques (L. Freund), etc. Dans toutes ces affirmations, les qualités personnelles du sujet de l'élite sont mises au premier plan, ce qui signifie qu'il s'agit spécifiquement des fondements anthropologiques de ce groupe socioculturel.
R. Après avoir examiné quelques caractéristiques méthodologiques de l'élitologie moderne, tournons maintenant notre attention vers l'histoire du développement de l'élitologie anthropologique dans le cadre de l'histoire de la philosophie.
Théories élitistes
élitologie société moyen âge
Introduction
Actuellement, il existe un grand nombre de théories différentes qui justifient la légitimité de la division de la société en une minorité gouvernante et une majorité gouvernante. Les idées sur le caractère inévitable d’une telle division de la société ont été exprimées dans l’Antiquité. À cet égard, il suffit de citer les noms de Confucius, Platon, Machiavel, même si à cette époque ils n'ont pas reçu justification scientifique. Les premiers concepts scientifiquement développés d’élites ont été proposés au début du XXe siècle.
L'élitologie est une discipline scientifique particulière qui traite de l'examen et de l'analyse de modèles spécifiques de formation et de développement des élites dans la société, de l'analyse de leur personnel à différents stades du développement social. En même temps, l’élitologie n’est pas une science homogène. Dans son cadre, il existe un certain nombre de paradigmes, parmi lesquels l'élitisme et l'élitisme
Il ne fait aucun doute que le paradigme élitiste semble très séduisant. Sa pertinence et son attractivité augmentent particulièrement dans conditions modernes, alors qu’il devient extrêmement à la mode de s’éloigner consciemment de soi et de sa vision du monde des limites de la « masse grise sans visage ».
Le concept d'élitisme
Au cours des dernières décennies, le terme « élite » est non seulement entré fermement dans le langage scientifique, sociologique et politique, mais a également largement dépassé ses limites, devenant couramment utilisé. Ce terme vient du latin eligere et élite française – meilleur, choisi, choisi. À partir du XVIIe siècle, il est utilisé pour désigner des biens de la plus haute qualité, puis pour désigner le « peuple élu », notamment la plus haute noblesse. En Angleterre, comme l'atteste le dictionnaire Oxford de 1823, ce terme commença à être appliqué aux groupes sociaux les plus élevés dans le système d'une société hiérarchique. Ensuite, le concept a commencé à être utilisé en génétique, en biologie et dans d’autres disciplines des sciences naturelles. Dans les sciences sociales, le terme « élite » n’a été largement utilisé qu’à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. (c'est-à-dire avant l'apparition des œuvres de V. Pareto), et aux USA - même jusqu'aux années 30 de notre siècle. Au fur et à mesure que la science s'institutionnalisait, les principales orientations de l'étude des élites ont été déterminées - l'histoire de la pensée politique, les théories des élites, la sociologie des élites, etc., et l'objet et le sujet de l'élitologie ont été formés.
Objet-élite : l'élite entière, certains types d'élites, un individu
Sujet : modèles de formation et de fonctionnement de l'élite
Élitisme - La croyance selon laquelle le gouvernement, dans la pratique, est le domaine des élites, et que, selon l'aphorisme de Hume, « le devoir implique l'opportunité », il ne sert à rien de parler de contrôle du gouvernement par le peuple si, dans la pratique, le peuple ne peut pas le faire, et que nous ferions mieux d'accepter ce à quoi nous sommes condamnés de toute façon. Le plus souvent, ces points de vue sont associés aux noms de Gaetano Mosca, Wilfred Pareto (début du XXe siècle) et Joseph Schumpeter (milieu du XXe siècle). Leurs travaux ont une teinte « d'élitisme », puisqu'ils justifient par tous les moyens la présence d'élites « au pouvoir » dans les États démocratiques, confirmant leurs arguments par des arguments de nature normative. Cependant, leur argument initial n’impliquait pas que le contrôle démocratique du gouvernement n’était pas souhaitable s’il pouvait être réalisé d’une manière ou d’une autre.
Étapes de formation de l'élitisme politique. Idées des philosophes anciens sur l'aristocratie comme règle du meilleur
Les premiers prototypes de théories élitistes se reflètent dans les travaux de Platon, qui fut l'un des premiers à exposer systématiquement ses idées. idées politiques dans les dialogues « État », « Homme politique » et « Lois ». Leur essence est la suivante :
1. Platon considérait l'État comme la forme d'existence la plus importante et la plus directe de la société. Le philosophe a cherché à dresser le tableau d’une société et d’un État idéaux.
· Vraie vertu - vraie connaissance- n'est possible que dans un état idéal. Platon considérait un tel État comme une aristocratie parfaite - le règne des meilleurs et nobles philosophes et sages. Il a qualifié d’imparfaites les quatre autres formes d’État – la timocratie (gouvernement militaire), l’oligarchie, la démocratie et la tyrannie.
3. Platon a été le premier à souligner la relation entre la politique et l'État avec les changements sociaux (division du travail, émergence de classes, inégalités).
4. Le philosophe a soutenu qu'une société idéale se compose de dirigeants philosophes, de gardes guerriers et d'artisans.
La hiérarchie des classes est basée sur leur correspondance avec les trois principes de l'âme humaine : raisonnable, furieux et pragmatique. Chaque classe est occupée de ses propres affaires : les philosophes sages exercent une règle juste, puisque seule la vraie connaissance leur est accessible ; les tuteurs protègent la société ; les artisans et les agriculteurs créent les moyens matériels de vie.
Aristote, étudiant de Platon, considérait l'État comme la meilleure forme d'État : le gouvernement de la majorité possédant la propriété et un diplôme. Politaya combine tout Meilleures caractéristiques aristocratie (vertu des dirigeants), oligarchie (richesse), démocratie (liberté). Traduire cette idée d'Aristote en langue moderne, on peut dire que c’est une règle dans l’intérêt de la classe moyenne.
Développement d'idées élitistes au Moyen Âge
Le développement des idées élitistes au Moyen Âge est associé à l'émergence des théories théologiques de Thomas d'Aquin et d'Augustin le Bienheureux, qui déifiaient la nature du pouvoir d'État. Malgré la nature divine du pouvoir d’État, son acquisition et son utilisation, croyait Thomas d’Aquin, dépendaient des personnes. Par conséquent, l'essence du pouvoir est divine, mais les formes de sa mise en œuvre sont déterminées par les hommes eux-mêmes. L'indignation du peuple contre le pouvoir du monarque était reconnue comme un péché mortel, puisqu'elle équivalait à dénoncer Dieu. Cependant, le gouvernement laïc lui-même doit suivre les commandements chrétiens et ne pas opprimer son peuple. Sinon, Thomas d'Aquin a reconnu le renversement du tyran comme légitime.
Contribution à la formation et au développement de l'élitisme N. Machiavel, F. Nietzsche
Nietzsche a déclaré que la volonté de puissance était le principe fondamental du processus mondial ; la force motrice de l’histoire est « le désir insatiable de manifestation du pouvoir et de l’usage du pouvoir, de l’usage du pouvoir comme instinct créateur ». La morale joue pour lui un rôle corrupteur : elle est « l’arme des faibles », « l’instinct de la foule », que les « surhommes » surmontent.
L'aristocratie dans l'enseignement de Nietzsche n'équivaut pas du tout à la domination de l'élite dirigeante sur les masses ; Ce qui compte avant tout, c'est la qualité de l'élite. Dans ses œuvres, la « noblesse » et la « foule » sont utilisées non pas comme des catégories socio-politiques, mais comme des catégories morales, sans lien avec la hiérarchie sociale existante. Les « nobles » et la « populace » ne sont pas définis par la richesse ou la pauvreté, mais par la grandeur et l’insignifiance. La grandeur de l'âme est le lot de quelques-uns, et c'est elle qui donne un sens à une personne, faisant d'elle un surhomme. Seule la vie a une valeur absolue, et la vraie vie apparaît lorsqu'une personne devient un dieu. Seule une personne devenue un dieu - un surhomme - est digne d'une vie réelle et brillante.
Le motif du surhomme constitue la partie la plus importante des vues élitologiques de Nietzsche. «Je vous parle du surhomme. L'homme est quelque chose qui doit se surpasser... Superman est le sens de la terre. Qualifiant l’homme de « ruisseau sale », Nietzsche écrit que le surhomme est par rapport à l’homme comme le singe l’est par rapport à l’homme. Le surhomme est l'aristocratie (la véritable élite) de la société. Le héros de Nietzsche est arrogant, dur, manquant de sympathie pour les faibles et les inférieurs.
La « caste dominante » de Nietzsche s’identifie. « Il y a un instinct de reconnaissance du rang, qui est avant tout un signe de rang élevé, il y a un plaisir qui découle des nuances de la vénération, et cela indique une naissance noble et les habitudes qui y sont associées. » Nietzsche définit les signes de la noblesse : "...ne pas vouloir transférer sa propre responsabilité à quelqu'un, ne pas vouloir la partager ; compter ses avantages et leur utilisation parmi ses devoirs." C'est ainsi que se formule franchement le credo de l'élitisme - le fort pouvoir de l'aristocratie, qui « doit croire fermement qu'elle n'existe pas pour la société, mais qu'elle (la société) n'est rien de plus qu'« un fondement et une plate-forme qui peut servir ». comme marchepied pour un certain type d'êtres choisis pour accomplir leur tâche la plus élevée et en général pour un être supérieur"
Nicolas Machiavel. Ses opinions sur le problème des relations entre dirigeants et sujets sont controversées. D'une part, il s'opposait aux seigneurs féodaux qui ralentissaient l'unification de l'Italie, d'autre part, il craignait surtout une révolte des masses devenues désobéissantes. Il recherche l’équilibre optimal entre les dirigeants et le peuple et le voit dans un pouvoir fort. En même temps, Machiavel condamne le pouvoir tyrannique, qui corrompt les dirigeants et les masses qui, habituées à tolérer un tyran, deviennent « serviles, hypocrites ». Bien que la personnalité du leader politique soit au centre de l'attention de Machiavel, contrairement à ses prédécesseurs, il ne réduit pas le processus politique aux seules actions des héros ; il est à ses yeux très coloré. Machiavel distingue les participants actifs et passifs du drame historique : c'est le monarque, la noblesse et le roturier, sortant sur la place de la ville et soutenant le souverain ou un officier rebelle contre lui, participant à un conflit militaire, un prêteur d'argent, subventionner un homme politique, un chef d’église, etc. Il dresse des portraits psychologiques saisissants des dirigeants ; leurs actions sont stimulées principalement par de mauvaises passions, innées, inhérentes aux personnes. Ils sont « ingrats, inconstants, hypocrites, lâches face au danger, avides de profit ». Machiavel est prêt à justifier les moyens immoraux par lesquels les dirigeants accèdent au pouvoir. De plus, le pouvoir n’est pas seulement une valeur en soi, mais aussi un moyen d’atteindre certains objectifs politiques. Pour gouverner, les dirigeants doivent connaître les principales motivations de l'activité humaine (et selon Machiavel, c'est la soif de pouvoir et de possession de propriété), étudier et tirer parti des goûts, des inclinations et des faiblesses de la foule et , grâce à cela, dominez-le.
Une typologie intéressante des méthodes de gouvernement proposées par Machiavel, qui assurent l'efficacité du pouvoir : ce sont les « lions » (dirigeants décisifs s'appuyant sur la force), et les « renards » (hommes politiques flexibles, caractérisés par la dextérité, la feinte, la ruse, ce sont des maîtres de négociations et d'intrigues en coulisses). Résolvant le dilemme de savoir sur qui le souverain doit s'appuyer entre deux forces opposées : le peuple ou la noblesse, Machiavel choisit clairement le peuple. Le souverain doit être ami avec le peuple, sinon temps dur il sera renversé : « il ne se laissera jamais tromper par le peuple et sera convaincu de la force d’un tel soutien ». Machiavel conclut que les intérêts du peuple sont bien plus cohérents avec les intérêts de l’État. Il n’idéalise nullement le peuple qui, comme le souverain et l’aristocratie, est soumis à l’influence des circonstances, bien que dans une moindre mesure que le premier, et écrit qu’« un peuple qui endure longtemps et humblement la tyrannie du pouvoir ou un joug étranger est un peuple corrompu qui a perdu le précieux don des dieux : l'amour de la liberté, l'indépendance, l'honnêteté, le courage. »
Formation de l'élitisme comme direction scientifique. Théories des élites par V. Pareto, G. Moschi, G. Tarde, R. Michels.
École macévialiste (G. Mosca, V. Pareto) - l'élitisme est inhérent à toute société. Ceci est basé sur le fait des différences naturelles entre les personnes : physiques, psychologiques, mentales, morales. L'élite se caractérise par des qualités politiques et organisationnelles particulières. Les masses reconnaissent le droit des élites au pouvoir. Les élites se remplacent lors de la lutte pour le pouvoir, puisque personne n’abandonne volontairement le pouvoir.
La théorie de la démocratie d'élite (R. Dahl, S. Lipset) - l'élite ne gouverne pas, mais dirige les masses avec leur consentement volontaire, par le biais d'élections libres.
Théories des valeurs (W. Ropke). L'élite est une couche de la société dotée de hautes capacités de gestion. L'élite est le résultat dans une plus grande mesure sélection naturelle des personnes dotées de qualités et de capacités exceptionnelles. La formation d’une élite ne contredit pas les principes de la démocratie. L'égalité sociale des personnes doit être comprise comme l'égalité des chances.
Concepts de pluralisme des élites (S. Keller, O. Stammer, D. Risman). l'élite est plurielle. Aucun groupe en son sein n’est capable d’exercer une influence décisive sur tous les domaines de la vie en même temps. Dans une démocratie, le pouvoir est réparti entre différents groupes d’élites qui influencent la prise de décision pour défendre leurs intérêts. La concurrence permet le contrôle des masses.
Concepts libéraux de gauche (R. Mills). la société est gouvernée exclusivement par une seule élite dirigeante. Les possibilités des institutions démocratiques (élections, référendums) sont insignifiantes.
Concepts élitistes des XIXe-XXe siècles.
En science politique, le terme français « élite » s'est répandu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle et est associé aux noms de scientifiques tels que Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto et Robert Michels.
Examinons brièvement les principales positions de leurs concepts élitistes.
Gaetano Mosca (1858-1941), sociologue et politologue italien, dans son ouvrage « Fondements de la science politique », a tenté de prouver l'inévitable division de la société en deux groupes inégaux en termes de statut et de rôle social. Il a divisé la société entre la classe gouvernante (classe dirigeante) et la classe gouvernée. Mosca a exprimé l'idée qu'une certaine stabilité de la classe dirigeante était nécessaire et que la pénétration de nouveaux éléments dans celle-ci ne devait pas se produire trop rapidement ni être trop importante. Le concept de classe dirigeante de G. Mosca avait grande influence sur le développement ultérieur de théories élitistes. Cependant, il a été critiqué pour avoir absolutisé le facteur politique et sous-estimé le rôle de l’économie. Cette théorie a trouvé l’approbation dans les États totalitaires. La direction qu'il a développée est dite organisationnelle.
Vilfredo Pareto (1848-1923) - dans son ouvrage « Traité de sociologie générale » a écrit que le monde a toujours été et doit être gouverné par une minorité sélectionnée - une élite dotée de qualités particulières : psychologiques (innées) et sociales (acquises dans le processus d’éducation et d’éducation). L'élite est divisée en l'élite dirigeante - qui participe directement ou indirectement à la gestion, et la contre-élite non dirigeante - ce sont des personnes qui possèdent les qualités caractéristiques de l'élite, mais n'ont pas accès au leadership en raison de leur statut ou autre. les raisons. V. Pareto a été le premier à introduire les concepts de « classe politique (dirigeante) » et de « circulation des élites » - c'est-à-dire un système « d'échange » de personnes entre l'élite et le reste de la population. La circulation des élites implique selon lui la circulation des idées.
Robert Michels (1876-1923), politologue allemand devenu l'un des idéologues du fascisme, dans son ouvrage « Interprétation des causes de l'élitisme », a examiné les mécanismes sociaux qui donnent naissance à l'élitisme et a conclu que l'organisation même de l'élitisme la société exige l’élitisme et le reproduit naturellement. Dans ses recherches, il a cherché à prouver l’impossibilité de mettre en œuvre les principes de la démocratie dans les pays occidentaux en raison des « tendances oligarchiques » des organisations politiques de masse.
L'école machiavélique (G. Mosca, V. Pareto et R. Michels) oriente ses adeptes sur le fait que l'élitisme est inhérent à toute société. Ceci est basé sur le fait des différences naturelles entre les personnes : psychologiques, mentales, morales. Selon les partisans de cette tendance, l'élite se caractérise par des qualités politiques et organisationnelles, et les masses reconnaissent son droit au pouvoir, c'est-à-dire sa légitimité. Le changement d’élites se produit lors de la lutte pour le pouvoir, puisque personne n’abandonne volontairement le pouvoir.
Actuellement, il existe diverses directions de théories de l'élite : théories des valeurs de l'élite, théories de l'élitisme démocratique, concepts du pluralisme des élites, théories libérales de gauche. Ils reflètent certains aspects de la réalité et justifient la légitimité de diviser la société en une minorité contrôlante et une majorité contrôlée.
Dans le cadre de la théorie de l'élitisme démocratique (R. Dahl, S. Lipset), la démocratie est comprise comme une lutte compétitive entre les candidats à la direction de la société lors des campagnes électorales. Et l’élite est considérée comme un champion des valeurs démocratiques – liberté, égalité, droit au travail, sécurité sociale, etc. Elle dirige les masses avec leur consentement volontaire, à travers des élections libres.
Dans les théories des valeurs (V. Ronke, J. Ortega y Gasset), l'élite est considérée comme une couche de la société dotée de hautes capacités de gestion. L’entrée dans l’élite n’est pas un processus arbitraire ou violent, mais une inclusion équitable de ceux qui sont les plus capables de contrôler les leviers de contrôle.
Les concepts de pluralisme des élites (ou théories fonctionnelles des élites) (S. Keller, O. Stammer, D. Riesman) prouvent que l'élite est plurielle. Aucun groupe en son sein n’est capable d’exercer une influence décisive sur tous les domaines de la vie en même temps. Dans une démocratie, le pouvoir est réparti entre diverses élites qui influencent la prise de décision pour défendre leurs intérêts. Les élites sont contrôlées par les masses à travers les élections, les référendums, les sondages, la presse et les groupes de pression. La concurrence entre les élites empêche la formation d’un groupe d’élite cohérent et rend possible le contrôle des masses. Les frontières entre les masses et les élites sont arbitraires. L'accès à l'élite est ouvert non seulement aux représentants du grand capital, mais également à ceux qui possèdent des capacités et des connaissances personnelles exceptionnelles.
Les concepts d'élites libéraux de gauche (R. Mills, R. Miliband, R.-J. Schwarzenberg) reposent sur la position selon laquelle la société est gouvernée exclusivement par une seule élite dirigeante. Dans la vraie vie, l'élite est là haut niveau pouvoir et ne permet pas aux masses de participer à la politique. Les possibilités des institutions démocratiques (élections, référendums, etc.) sont insignifiantes. L’élite dirigeante occupe des postes clés dans l’État et s’assure ainsi du pouvoir, de la richesse et de la renommée. Il existe une grande différence entre l’élite et les masses, qui est presque impossible à surmonter.
En science politique du XXe siècle. L'« élite » comprend :
* des personnes dotées de capacités intellectuelles exceptionnelles et d'un sens des responsabilités élevé (J. Ortega y Gasset) ;
* la minorité créative de la société, à l'opposé de la majorité non créative (A. Toynbee) ;
* une minorité qui a la plus grande influence dans la société et/ou y exerce les fonctions les plus importantes (S. Keller) ;
* dirigeants ou représentants éminents de tout groupes sociaux- professionnels, ethniques, locaux (pilotes « d'élite », joueurs d'échecs et même voleurs) (M. Boden) ;
* les personnes ayant reçu l'indice le plus élevé dans le domaine de leur activité (V. Pareto) ;
* les sujets politiquement actifs et orientés vers le pouvoir (G. Mosca) ;
* ceux qui possèdent les plus grandes fortunes ou ont le plus grand prestige (PLasswell) ;
* occupant des positions de premier plan dans la vie politique, économique et culturelle de la société (V. Gettsman) (6).
Selon Dreitzel. Élite - titulaires des postes les plus élevés dans un groupe, une organisation ou une institution, dont la sélection s'effectue sur le principe de la productivité des connaissances.
Selon Vaida. L'élite est un groupe de personnes situées au plus haut niveau de la hiérarchie et capables de créer des modèles de besoins et de comportements.
Selon Sultanov. Elite est un groupe structuré d'une certaine manière qui, en raison de son statut, des conditions pertinentes, perception générale, les traditions politiques et l’idéologie d’une société donnée peuvent potentiellement avoir une influence décisive sur la plupart des autres groupes et institutions d’une société donnée.
L'élite politique est un groupe intégré d'individus différenciés en interne qui possèdent des qualités de leadership et sont prêts à exercer des fonctions de direction, à occuper des postes de direction dans les institutions publiques et à influencer la prise de décision du gouvernement.
Théories élitistes modernes
Dans la théorie politique moderne, les approches proposées par ses fondateurs ont connu un nouveau développement. Ainsi, les adeptes de V. Pareto P. Blau, J. Sorel, E. Fromm, A. Adler, R. Stogdill et d'autres scientifiques ont compilé des descriptions impressionnantes des propriétés spécifiques des dirigeants politiques et des élites, révélant et clarifiant sur cette base le lien entre les propriétés individuelles de la classe dirigeante et les fondements de l’ordre politique dominant. Conformément à cette orientation, les concepts de valeur ont acquis des contours plus clairs. Ainsi, le scientifique américain G. Lasswell a avancé l'idée que seuls ceux qui possèdent des capacités particulières pour la production et la diffusion de certaines valeurs politiques (par exemple, assurer la sécurité individuelle d'une personne ou son respect public, la croissance des revenus, etc.) peut être classé comme une élite. ), pour mobiliser l'activité de la population et former un certain ordre politique.
Dans le cadre des théories des valeurs, une interprétation pluraliste des élites a également été développée, selon laquelle plusieurs groupes d'élite opèrent au pouvoir, et chacun d'eux a ses propres mécanismes et sa zone d'influence du pouvoir, exprime les intérêts spécifiques de divers groupes du population et n’a que sa propre autorité inhérente.
Les vues de Mosca ont également reçu un développement théorique unique. Ainsi, le chercheur français G. Dorso s'est tourné vers la doctrine de la « classe politique » et a proposé de la considérer comme un « instrument technique » de la « classe dirigeante », qui se décompose dans le processus politique en « gestion » et « opposition ». "segments. Pour cette raison, selon le scientifique français, le changement de pouvoir entre les couches dirigeantes et celles de l’opposition n’affecte en rien les intérêts et le statut de la classe dirigeante.
Le concept original a été proposé par R. Mills, qui a utilisé l'exemple de la société américaine pour étudier l'élite politique en tant qu'ensemble de représentants des « hiérarchies institutionnalisées » les plus importantes, c'est-à-dire des hauts fonctionnaires composés de chefs d'entreprise, d'administrateurs politiques et de dirigeants militaires. Dans le même temps, selon Mills, la plus grande influence dans ce triangle de pouvoir appartient aux individus (y compris une partie de l'élite bureaucratique non élue) qui entretiennent des relations informelles les uns avec les autres et ont la principale influence sur l'ensemble du processus décisionnel. .
J. Galbraith a également considéré les fondements fonctionnels des élites politiques d'une manière très originale, suggérant que l'influence la plus importante sur la prise de décision politique est exercée par ce qu'on appelle la technostructure, c'est-à-dire ce groupe anonyme de personnes qui contrôle le processus de circulation des informations officielles et prédétermine ainsi la nature des décisions prises au sommet. En ce sens, les hommes politiques publics n’expriment que les décisions préparées par leurs experts, analystes et autres assistants. Ainsi, le rôle des soi-disant cardinaux gris, qui se trouvent souvent dans les coulisses du pouvoir et déterminent ses décisions les plus importantes, a été théoriquement légalisé.
Les idées énoncées par Moskaya ont également été considérablement développées dans les travaux de représentants de la direction structurelle-fonctionnelle (D. Burnham, S. Keller), qui se sont concentrés sur l'analyse des caractéristiques institutionnelles et de rôle des cercles dirigeants. Les soi-disant néo-élitistes (H. Ziegler) ont également apporté leur contribution au développement de cette direction, en se concentrant sur les mécanismes politiques qui permettent aux couches d'élite d'exercer leur pouvoir réel quels que soient les résultats de la volonté de la société lors des élections, des plébiscites. et les référendums.
Conclusion
Le développement rapide des concepts élitistes à ce jour n'a pas conduit à l'approbation d'approches unifiées pour interpréter l'indépendance des élites, les caractéristiques de leurs relations avec les masses, pour déterminer la relation entre le statut et les propriétés personnelles des cercles d'élite lorsque leur composition change, ainsi que le rôle des managers dans le développement de la démocratie. En fait, chaque période historique a sérieusement modifié et actualisé ces types d’évaluations et d’idées. Par exemple, dans leurs versions originales, les théories élitistes étaient très négatives à l’égard de la démocratie. Par la suite, la situation a radicalement changé et l’élitisme a commencé à être considéré comme un élément de politique pleinement compatible avec les mécanismes de la démocratie représentative. Comme l’a soutenu un éminent penseur politique du XXe siècle. I. Schumpeter, les élites peuvent faire bien plus pour établir la démocratie que les couches les plus larges de la population intéressées par ces valeurs.
Dans le même temps, l'écrasante majorité des représentants de l'élitisme moderne considèrent les activités des structures de gestion supérieures isolées du social et facteurs économiques. Dans ce cas, les élites sont souvent interprétées comme des groupes autosuffisants contrôlant totalement tous les processus politiques. Dans une certaine mesure, cela prédétermine l'expansion par certains théoriciens (A. Stone) des rôles fonctionnels des groupes dirigeants, les considérant comme les seuls moteurs du processus historique, tandis que les masses se voient attribuer le rôle d'observateurs passifs.
Publié sur le site
Documents similaires
Condamnation du nationalisme, de l'impérialisme, du racisme, de l'antisémitisme dans le « Traité » de l'ingénieur, économiste et sociologue italien Vilfredo Pareto. Théorie comportement social. La théorie des élites par G. Mosca et V. Pareto. Caractéristiques caractéristiques des représentants de l'élite dirigeante.
présentation, ajouté le 14/11/2014
La doctrine de la « classe politique » G. Mosca. Théorie psychologique de l'élite par V. Pareto. Le concept d'oligarchie par R. Michels. Approche élitiste et théorie du management des élites. L'approche institutionnelle et la théorie de l'élite par R. Mills. Théories de la pluralité des élites (A. Bentley).
test, ajouté le 14/03/2011
La bibliosociologie comme discipline scientifique indépendante. Histoire du développement des fonctions sociales des bibliothèques dans un contexte temporaire. Etude des méthodes modernes de travail bibliosocial. Méthodes de recherche bibliosociologique et leurs caractéristiques.
travail de cours, ajouté le 06/02/2011
Sociologie des religions en tant que branche de la sociologie et discipline scientifique, le sujet et les méthodes de sa recherche, l'histoire de son origine et de son développement. Types de croyances religieuses. Fonctions de la religion dans la société. Caractéristiques et caractéristiques des méthodes, techniques d'études religieuses.
résumé, ajouté le 14/12/2010
Prérequis à la formation et caractéristiques du développement de la sociologie de l'entrepreneuriat. Un objet, Domaine et les tâches de la sociologie de l'entrepreneuriat. La sociologie de l'entrepreneuriat est une théorie sociologique particulière qui est extrêmement pertinente aujourd'hui.
résumé, ajouté le 29/12/2004
Les principales dispositions de la théorie du travail social, les conditions préalables à son émergence et à son développement en tant que discipline scientifique. Analyse de l'État et des problèmes de réforme du travail social dans les conditions de la Russie moderne. La relation entre la politique sociale et le travail social.
travail de cours, ajouté le 05/05/2010
Histoire de la formation de la méthodologie sociologique. Étude des relations interpersonnelles et des attitudes personnelles envers divers phénomènes sociaux. Théories modernes des élites politiques. Changements dans la structure sociale lors de la transition vers une société de l'information.
test, ajouté le 05/03/2010
Analyse comparative théories instrumentales, sémantiques, de genre et cratiques de l'origine de la société en tant que systèmes de connaissances scientifiques sur la genèse relations publiques. Le concept de progrès social, les théories évolutionnistes et cycliques du développement de la civilisation.
présentation, ajouté le 15/04/2017
Le concept de « jeunesse ». Voies de développement de la sociologie domestique de la jeunesse. Tendances du développement des jeunes. Besoins culturels des jeunes. Le système des besoins spirituels en tant que produit développement historique. Caractéristiques de la jeunesse de la société russe moderne.
travail de cours, ajouté le 11/04/2011
Orientations de la politique démographique dans la Fédération de Russie. Situation démographique en République du Daghestan. L'influence des modèles généraux et spécifiques de développement et de reproduction de la population sur développement social républiques jusqu'au dernier recensement général.