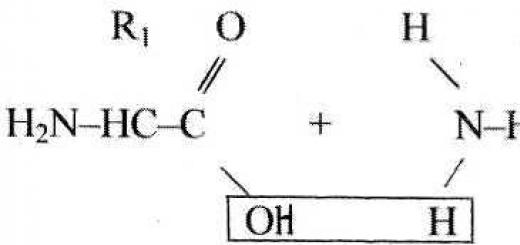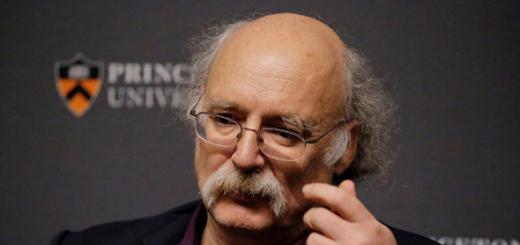Ivy Litvinova, épouse du futur commissaire du peuple aux Affaires étrangères M. Litvinov, peu après son arrivée en Russie dans des moments difficiles à la fin guerre civile fait une observation précieuse. Elle pensait, écrivit-elle à un ami en Angleterre, qu'en Russie révolutionnaire Les « idées » sont tout, et les « choses » ne sont rien, « parce que chacun aura tout ce dont il a besoin, sans excès ». Mais « en me promenant dans les rues de Moscou et en regardant par les fenêtres du premier étage, j'ai vu des objets de Moscou rangés au hasard dans tous les coins et j'ai réalisé qu'ils n'avaient jamais eu autant de signification »1. Cette idée est extrêmement importante pour comprendre la vie quotidienne en URSS dans les années 1930. Les choses étaient d’une grande importance dans les années 1930 en Union soviétique, ne serait-ce que parce qu’elles étaient très difficiles à obtenir.
Le rôle nouveau et extrêmement important des choses et leur répartition se reflétaient dans le discours quotidien. Dans les années 1930 les gens n’ont pas dit « acheter », ils ont dit « acheter ». L'expression « difficile à trouver » était constamment utilisée ; Un nouveau terme est devenu très populaire pour désigner toutes ces choses difficiles à obtenir : les « biens rares ». Au cas où ils trouveraient des biens rares, les gens se promenaient avec des filets, appelés « sacs à cordes », dans leurs poches. Voyant la file, ils la rejoignirent et, seulement après avoir pris leur place, demandèrent ce qu'elle se cachait derrière. D’ailleurs, ils formulent leur question ainsi : non pas « Que vendent-ils ? », mais « Que donnent-ils ? Cependant, l’approvisionnement en biens par les canaux normaux était si peu fiable qu’un vocabulaire entier a émergé pour décrire les options alternatives. Les marchandises pouvaient être vendues officieusement ou sous le comptoir (« à gauche ») si une personne avait « des connaissances et des relations » avec les bonnes personnes ou « blat »2.
années 1930 Ce fut une décennie de difficultés et d’épreuves énormes pour le peuple soviétique, bien pires que les années 1920. En 1932 - 1933 toutes les principales régions céréalières furent également frappées par la famine en 1936 et 1939. les mauvaises récoltes ont provoqué d’importantes perturbations dans l’approvisionnement alimentaire. Les villes étaient inondées de nouveaux arrivants en provenance des villages, il y avait une pénurie catastrophique de logements et le système de cartes menaçait de s'effondrer. Pour la majeure partie de la ville
La vie entière de la population tournait autour d'une lutte sans fin pour les nécessités de base - la nourriture, les vêtements, un toit au-dessus de sa tête.
Avec la fermeture du secteur privé urbain à la fin des années 20. et le début de la collectivisation est arrivé nouvelle ère. Un ingénieur américain revenu à Moscou en juin 1930 après plusieurs mois d'absence décrit les conséquences dramatiques de la nouvelle cours économique:
« On dirait que tous les magasins dans les rues ont disparu. Le marché libre a disparu. Les Nepmen ont disparu. Les magasins publics avaient de spectaculaires boîtes vides et autres décorations dans leurs vitrines. Mais il n’y avait aucune marchandise à l’intérieur. »3
Au début de la période stalinienne, le niveau de vie a fortement chuté tant en ville qu’à la campagne. Famine 1932-1933 Elle a fait au moins 3 à 4 millions de morts et a affecté le taux de natalité pendant plusieurs années. Même si la politique de l'État visait à protéger population urbaine Et tandis que les paysans devaient faire les frais, les citadins souffraient aussi : le taux de mortalité augmentait, le taux de natalité diminuait et la consommation de viande et de saindoux par personne en ville en 1932 était inférieure à un tiers de ce qu'elle était. en 19284.
En 1933, la pire année de toute la décennie, le travailleur marié moyen à Moscou consommait moins de la moitié de la quantité de pain et de farine consommée par le même travailleur à Saint-Pétersbourg au début du XXe siècle, et moins des deux tiers de la quantité correspondante de sucre. Son alimentation ne contenait pratiquement pas de matières grasses, très peu de lait et de fruits, ainsi que de viande et de poisson – seulement un cinquième de la norme au début du siècle5. En 1935, la situation s'améliore quelque peu, mais les mauvaises récoltes de 1936 font surgir de nouveaux problèmes : menace de famine dans certaines zones rurales, fuite des paysans des fermes collectives et longues files d'attente pour le pain dans les villes au printemps et en été. 1937. La meilleure récolte de la période d'avant-guerre, restée longtemps dans la mémoire des gens, a été récoltée à l'automne 1937. Cependant, les dernières années d'avant-guerre ont apporté avec elles une nouvelle série de pénuries et une pénurie encore plus grande. baisse du niveau de vie6.
Au cours de la même période, la population urbaine de l'URSS a augmenté à un rythme record, ce qui a provoqué une énorme pénurie de logements, une surcharge de tous les services publics et toutes sortes d'inconvénients. En 1926 - 1933 La population urbaine a augmenté de 15 millions de personnes. (de près de 60 %), et 16 millions supplémentaires s'y sont ajoutés avant 1939. Le nombre d'habitants de Moscou est passé de 2 à 3,6 millions de personnes, à Léningrad il a augmenté presque aussi fortement. La population de Sverdlovsk, une ville industrielle de l'Oural, est passée de moins de 150 000 habitants à près d'un demi-million d'habitants, et les taux de croissance démographique à Stalingrad, Novossibirsk et dans d'autres centres industriels ont été tout aussi impressionnants. Dans des villes comme Magnitogorsk et Karaganda, nouveau centre minier où le travail pénitentiaire était largement utilisé, la courbe de croissance démographique est passée de zéro en 1926 à plus de cent mille personnes. en 19397. Plans quinquennaux
années 30 a donné la priorité inconditionnelle à la construction industrielle sur le logement. La plupart des nouveaux citadins se sont retrouvés dans des dortoirs, des casernes et même des abris. Comparés à eux, même les fameux appartements communs, où toute la famille se blottissait dans une seule pièce et où il n'y avait aucune possibilité d'intimité, étaient considérés comme presque un luxe.
Avec le passage à la planification centrale à la fin des années 1920. les pénuries de marchandises sont devenues une caractéristique intégrante de l’économie soviétique. Avec le recul, nous pouvons le considérer en partie comme caractéristiques structurelles, produit d’un système économique à coercition budgétaire « douce », qui encourageait tous les producteurs à accumuler des réserves8. Mais dans les années 30. Peu de gens le pensaient ; la pénurie était considérée comme un problème temporaire, faisant partie d’une tactique générale de resserrement de la ceinture, l’un des sacrifices exigés par l’industrialisation. Les pénuries de ces années-là, contrairement à la période post-stalinienne, étaient en effet causées autant par une sous-production de biens de consommation que par des problèmes systémiques de distribution. Dans le premier plan quinquennal (1929-1932), la priorité était donnée à l'industrie lourde, la production de biens de consommation occupant la deuxième place, bien que secondaire. Les communistes attribuaient également la pénurie alimentaire au désir des koulaks de « cacher » les céréales, et lorsqu'il n'y avait plus de koulaks, ils l'expliquaient par un sabotage antisoviétique dans la chaîne de production et de distribution. Cependant, quelles que soient les explications rationnelles avancées pour justifier cette pénurie, il était impossible de l’ignorer. C’est déjà devenu un fait central de la vie économique et quotidienne.
Quand en 1929-1930. Pour la première fois, des pénuries alimentaires commencent et des files d'attente pour le pain apparaissent ; la population est alarmée et indignée. Voici une citation tirée d'une revue des lettres des lecteurs à la Pravda, préparées pour la direction du parti :
« Quelle est l’expression d’un mécontentement ? Premièrement, le travailleur a faim, ne consomme pas de graisse, le pain est un substitut qui ne peut pas être mangé... Il est courant que la femme d'un travailleur fasse la queue pendant des journées entières, que son mari rentre du travail, mais le déjeuner n'est pas prêt, et tout ici est une insulte au régime soviétique. Dans les files d'attente, il y a du bruit, des cris et des bagarres, des injures contre les autorités soviétiques. »9
La situation a vite empiré. Au cours de l’hiver 1931, le village ukrainien fut frappé par la famine. Malgré le silence des journaux, la nouvelle de lui se répandit instantanément ; à Kiev, Kharkov et dans d'autres villes, les signes de famine étaient évidents, malgré tous les efforts des autorités pour restreindre les déplacements. chemin de fer et l'accès aux villes. L’année suivante, la famine a ravagé les principales régions productrices de céréales du centre de la Russie, du Caucase du Nord et du Kazakhstan. Les informations le concernant étaient encore cachées et, en décembre 1932, les informations internes
renoncer à un passeport pour tenter de contrôler la fuite des paysans affamés vers les villes. Des pénuries de pain survenaient périodiquement, même après la fin de la crise de la faim. Même dans les bonnes années, les lignes de céréales dans certaines villes et régions prenaient des proportions suffisamment alarmantes pour que leur question soit portée aux réunions du Politburo.
La récidive la plus grave et à grande échelle des files d'attente pour le pain s'est produite au cours de l'hiver et du printemps 1936-1937, après la mauvaise récolte de 1936. Dès novembre, des pénuries de pain ont été signalées dans les villes. Région de Voronej, prétendument causé par un afflux de paysans venant en ville chercher du pain, car il n'y a pas un grain dans les villages. Cet hiver-là, en Sibérie occidentale, les gens allaient chercher du pain dès 2 heures du matin, un mémoriste local a décrit dans son journal d'énormes files d'attente dans une petite ville, avec des bousculades, des écrasements et des crises hystériques. Une femme de Vologda a écrit à son mari : « Ma mère et moi sommes restés debout depuis 4 heures du matin, et nous n'avons même pas eu de pain noir, car ils n'en ont pas apporté du tout, et c'était le cas presque tout le temps. Au dessus de la ville." De Penza, une mère a écrit à sa fille : « Nous vivons une terrible panique avec le pain. Des milliers de paysans passent la nuit dans des étals de pain, à 200 km de là. ils viennent à Penza pour acheter du pain, c'est juste une horreur indescriptible... Il faisait glacial et 7 personnes, rentrant chez elles avec du pain, se sont figées. Les vitres du magasin ont été brisées et la porte a été brisée. C'était encore pire dans le village. "Nous faisons la queue pour du pain depuis midi, mais ils ne nous donnent qu'un kilo, même si vous mourez de faim", a écrit à son mari une femme d'une ferme collective de Iaroslavl. « Cela fait deux jours que nous marchons affamés... Tous les kolkhoziens se lèvent pour acheter du pain et les scènes sont terribles : les gens s'étouffent, beaucoup ont été tués. Envoyez-nous quelque chose, sinon nous mourrons de faim. »10
Des pénuries de pain réapparurent dans tout le pays en 1939-1940. « Joseph Vissarionovitch », écrivait à Staline une femme au foyer de la Volga, « quelque chose de vraiment terrible a commencé. Du pain, et encore, il faut y aller à 2 heures du matin et rester debout jusqu'à 6 heures du matin, et on aura 2 kg de pain de seigle. Un ouvrier de l'Oural a écrit que dans sa ville, il faut faire la queue pour obtenir du pain à 1 ou 2 heures du matin, et parfois plus tôt, et rester debout pendant près de 12 heures. Depuis Alma-Ata, en 1940, on rapportait qu'« il y avait d'énormes files d'attente près des boulangeries et des étals toute la journée et même la nuit. Souvent, en passant ces lignes, on entend des cris, du bruit, des querelles, des larmes et parfois des bagarres. »11
La pénurie ne se limitait pas au pain. La situation n'était pas meilleure pour les autres denrées alimentaires de base, comme la viande, le lait, le beurre, les légumes, sans parler des choses aussi nécessaires que le sel, le savon, le kérosène et les allumettes. Le poisson a également disparu, même dans les zones où la pêche était développée. "Pourquoi n'y a-t-il pas de poisson, je n'arrive pas à le comprendre moi-même", écrivait en 1940 un citoyen indigné à A. Mikoyan, qui dirigeait le Commissariat du peuple à l'alimentation. "Nous avons des mers et elles restent les mêmes qu'avant, mais à l'époque il y en avait autant que vous vouliez et tout ce que vous vouliez, mais maintenant j'ai même perdu l'idée de à quoi cela ressemble."12
Même la vodka à la fin des années 30. c'était difficile à obtenir. C'était en partie le résultat d'une campagne de sobriété de courte durée, exprimée par l'adoption de la Prohibition dans certaines villes et cités ouvrières. Cependant, le mouvement de tempérance était voué à l’échec, car il y avait un besoin bien plus urgent d’injecter des fonds pour l’industrialisation. En septembre 1930, Staline, dans une note adressée à Molotov, souligna la nécessité d'augmenter la production de vodka pour financer l'augmentation des dépenses militaires due à la menace d'une attaque polonaise. En quelques années, la production publique de vodka a tellement augmenté qu'elle a fourni un cinquième de tous les revenus de l'État ; au milieu de la décennie, la vodka était devenue le principal produit commercial dans les magasins publics13.
La pénurie de vêtements, de chaussures et de divers biens de consommation, souvent totalement inabordables, a été encore plus grave que les denrées alimentaires de base. Cet état de fait reflétait à la fois les priorités de la production étatique, strictement orientée vers l’industrie lourde, et les conséquences désastreuses de la destruction de l’artisanat et de l’industrie artisanale au début de la décennie. Dans les années 1920 les artisans et artisans étaient soit les seuls, soit les principaux producteurs de nombreux articles ménagers : poteries, paniers, samovars, manteaux et chapeaux en peau de mouton - juste une petite partie de la longue liste. Tous ces produits sont devenus disponibles au début des années 1930. pratiquement inaccessible ; dans les cantines publiques, les cuillères, les fourchettes, les assiettes, les tasses étaient si rares que les ouvriers faisaient la queue pour les acheter, comme pour la nourriture ; Il n’y avait généralement pas de couteaux. Tout au long de la décennie, il était totalement impossible de se procurer des produits de première nécessité aussi simples que des auges, des lampes à pétrole et des casseroles, car l'utilisation de métaux non ferreux pour la production de biens de consommation était désormais interdite14.
Un thème de plainte récurrent était la mauvaise qualité des quelques produits disponibles. Les vêtements étaient coupés et cousus avec négligence, et de nombreux rapports faisaient état de défauts flagrants dans les vêtements vendus dans les magasins gouvernementaux, comme l'absence de manches. Les poignées des casseroles sont tombées, les allumettes ont refusé de s'allumer et des corps étrangers ont été trouvés dans du pain cuit à partir de farine contenant des impuretés. Impossible de réparer des vêtements, des chaussures, des ustensiles de ménage, de trouver un serrurier pour changer une serrure, ou un peintre pour peindre un mur. Pour couronner le tout, les citoyens ordinaires, même s'ils possédaient eux-mêmes les compétences nécessaires, ne parvenaient généralement pas à obtenir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la réparation de quelque chose. Il n’était plus possible d’acheter au détail de la peinture, des clous, des planches ou tout autre objet nécessaire aux réparations domiciliaires ; en cas de besoin urgent, tout cela devait être volé dans une entreprise d'État ou sur un chantier de construction.
Habituellement, il était même impossible d'acheter des fils, des aiguilles, des boutons, etc. Il était interdit de vendre du lin, du chanvre, de la toile et du fil à la population, toutes ces matières étant en grande pénurie15.
La loi du 27 mars 1936, qui légalise à nouveau l'exercice privé dans des domaines tels que la cordonnerie, la menuiserie et la charpenterie, la couture, la coiffure, la blanchisserie, la métallurgie, la photographie, la plomberie et le papier peint, n'améliore que légèrement la situation. Les commerçants privés étaient autorisés à embaucher des apprentis, mais ils ne pouvaient travailler que sur commande et non pour la vente. Le client devait venir avec son propre matériel (c'est-à-dire que pour coudre un costume chez un tailleur, il devait apporter son propre tissu, ses fils et ses boutons). Les autres métiers artisanaux, y compris presque tous ceux liés à la production alimentaire, restent interdits. La boulangerie, la production de saucisses et d'autres produits alimentaires étaient exclues de la sphère privée légale. activité de travail; cependant, les paysans étaient toujours autorisés à vendre des tartes faites maison dans des endroits spécialement désignés16.
L’un des problèmes les plus difficiles pour les consommateurs était celui des chaussures. En plus du désastre qui a frappé toute la production à petite échelle de biens de consommation, la production de chaussures a également été affectée par une grave pénurie de cuir - conséquence de l'abattage massif de bétail pendant la collectivisation. En conséquence, le gouvernement a interdit en 1931 toute production artisanale de chaussures, rendant le consommateur complètement dépendant de l'industrie d'État, qui produisait des chaussures en quantités insuffisantes et souvent Mauvaise qualité qu'il s'est effondré dès qu'il a été mis. Tout Russe qui a vécu dans les années 1930 a eu de nombreuses histoires d'horreur sur la façon dont il avait essayé d'acheter des chaussures ou de les faire réparer, comment il les avait réparées chez lui, comment il les avait perdues ou comment elles lui avaient été volées (voir, par exemple, ., la célèbre histoire de Zochtchenko « Galosh »), etc. C'était encore plus difficile avec les chaussures pour enfants qu'avec les adultes : lorsque la nouvelle année scolaire commença à Yaroslavl en 1935, il n'y avait pas une seule paire de chaussures pour enfants dans les magasins de la ville17.
Le Politburo a décidé à plusieurs reprises qu'il fallait faire quelque chose dans le domaine de l'approvisionnement et de la distribution des biens de consommation. Mais même l’intérêt personnel de Staline pour ce problème n’a produit aucun résultat18. À la fin des années 1930, comme au début, on parlait constamment d'une grave pénurie de vêtements, de chaussures et de produits textiles : à Leningrad, des files d'attente de 6 000 personnes se formaient ; selon le NKVD, de si longues files d'attente s'alignaient en même temps. magasin de chaussures au centre de Leningrad ont fait la queue, qu'ils ont gêné la circulation routière et que les vitrines des magasins ont été brisées lors de la bousculade. Les habitants de Kiev se sont plaints du fait que des milliers de personnes ont fait la queue toute la nuit devant les magasins de vêtements. Dans la matinée, la police a laissé entrer les clients dans le magasin par groupes de 5 à 10 personnes, qui marchaient « en prenant
se tenir la main (pour que personne ne fasse la queue)... comme des prisonniers"19.
S’il y avait pénurie, il fallait trouver des boucs émissaires. Commissaire du peuple à l'alimentation A. Mikoyan au début des années 1930. a écrit à l’OPTU qu’il soupçonnait un « sabotage » dans le système de distribution : « Nous envoyons beaucoup, mais les marchandises n’arrivent pas ». L’OGPU a utilement dressé une liste de « gangs contre-révolutionnaires » qui cuisaient des souris mortes dans du pain et jetaient des noix dans de la salade. À Moscou, en 1933, d’anciens koulaks « jetaient des ordures, des clous, du fil de fer et du verre brisé dans la nourriture », tentant de blesser les ouvriers. La recherche de boucs émissaires, de « nuisibles », a pris des proportions plus larges après les pénuries de pain en 1936-1937 : par exemple, à Smolensk et Boguchary, les dirigeants locaux ont été accusés d'avoir créé une pénurie artificielle de pain et de sucre ; à Ivanovo, ils ont empoisonné le pain des ouvriers ; à Kazan, les files d’attente pour le pain ont été déclarées comme le résultat de rumeurs répandues par les contre-révolutionnaires20. Lors de la prochaine série de pénuries aiguës, au cours de l'hiver 1939-1940, des accusations similaires ont commencé à tomber de la part du public, et non du gouvernement ; des citoyens inquiets ont commencé à écrire aux dirigeants politiques, exigeant de trouver et de punir les « saboteurs »21. .
Logement
Malgré l’énorme augmentation de la population urbaine en URSS dans les années 1930, la construction de logements est restée presque aussi négligée que la production de biens de consommation. Jusqu'au tout Période Khrouchtchev rien n'a été fait pour faire face d'une manière ou d'une autre à la monstrueuse surpopulation, qui est restée caractéristique des villes soviétiques pendant plus d'un quart de siècle. Pendant ce temps, les gens vivaient dans des appartements communs, où une famille occupait généralement une pièce, dans des dortoirs et des casernes. Seul un petit groupe bénéficiant de privilèges extrêmes disposait d’appartements séparés. Où plus grand nombre les gens s'installaient dans les couloirs et les « coins » des appartements des autres : ceux qui vivaient dans les couloirs et les couloirs avaient généralement des lits, et les habitants des coins dormaient par terre dans le coin de la cuisine ou dans un autre espace commun.
Après la révolution, la plupart des immeubles résidentiels de la ville sont devenus la propriété de l’État et les municipalités géraient ce parc de logements22. Les autorités en charge des questions de logement déterminaient l'espace à allouer à chaque résident d'un appartement, et ces normes d'espace de vie - les fameux « mètres carrés » - restaient gravées à jamais dans le cœur de chaque résident. grande ville. À Moscou, en 1930, le niveau de vie moyen était de 5,5 m2 par personne ; en 1940, il est tombé à près de 4 m2. Dans les villes nouvelles et en rapide industrialisation
La situation était encore pire : à Magnitogorsk et à Irkoutsk, la norme était légèrement inférieure à 4 m2, et à Krasnoïarsk en 1933, elle n'était que de 3,4 m2 23.
Les services municipaux du logement avaient le droit d'expulser les locataires - par exemple ceux considérés comme des « ennemis de classe » - et d'en emménager de nouveaux dans des appartements déjà occupés. Cette dernière coutume, appelée par euphémisme « densification », était l’un des pires cauchemars des citadins des années 1920 et du début des années 1930. Un appartement occupé par une famille pouvait soudainement, à la demande des autorités de la ville, se transformer en un appartement multifamilial ou communal, et les nouveaux résidents, en règle générale, venaient des classes inférieures, étaient complètement inconnus des anciens et étaient souvent incompatibles avec eux. Une fois la hache levée, il était presque impossible d’éviter le coup. La famille qui occupait à l’origine l’appartement n’a pas pu déménager nulle part, à la fois en raison de la pénurie de logements et de l’absence de marché locatif privé.
À partir de la fin de 1932, après la réintroduction des passeports intérieurs et de l'enregistrement municipal, les habitants des grandes villes furent tenus de disposer d'un permis de séjour délivré par les services des affaires intérieures. Dans les maisons avec appartements séparés, la responsabilité d'enregistrer les résidents était confiée aux gestionnaires d'immeubles et aux conseils d'administration des coopératives. Comme sous l'ancien régime, les gestionnaires d'immeubles et les concierges, dont la fonction principale était de maintenir l'ordre dans l'immeuble et la cour adjacente, étaient en communication constante avec les organes des affaires intérieures, surveillaient les résidents et travaillaient comme informateurs24.
À Moscou et ailleurs grandes villes Toutes sortes de fraudes au logement ont fleuri : mariages et divorces fictifs, enregistrement d'étrangers comme parents, location de « lits et coins » à des prix exorbitants (jusqu'à 50 % du salaire mensuel). Comme indiqué en 1933, « l’occupation [à des fins de logement] des chauffeurs, des guérites, des sous-sols et des cages d’escalier est devenue un phénomène de masse à Moscou ». La pénurie de logements a conduit au fait que les conjoints divorcés vivaient souvent dans le même appartement, incapables de le quitter. C'est ce qui est arrivé aux Lebedev, par exemple, dont l'attachement à un luxueux appartement de près de 22 m2 au centre de Moscou les a obligés à continuer de cohabiter (avec leur fils de 18 ans) pendant six ans après leur divorce, malgré leurs relations. à tel point qu'ils étaient constamment attirés devant les tribunaux pour s'être battus. Parfois, la violence physique allait bien plus loin. À Simferopol, les autorités ont découvert le cadavre en décomposition d’une femme dans l’appartement de la famille Dikhov. Il s’est avéré qu’il s’agissait de la tante des Dikhov, qu’ils ont tuées pour prendre possession de l’appartement25.
La crise du logement à Moscou et à Léningrad était si aiguë que même les meilleures connexions et statut social souvent, ils n'avaient pas encore la garantie de recevoir un appartement séparé. Les hommes politiques et les responsables gouvernementaux étaient noyés sous les demandes et les plaintes des citoyens.
en raison du manque de logements convenables. Un ouvrier de Léningrad de trente-six ans, qui vivait dans le couloir depuis cinq ans, a écrit à Molotov pour le prier de lui donner « une chambre ou un petit appartement à construire ». vie privée», dont il « a besoin d’air comme l’air ». Les enfants d’une famille moscovite de six personnes ont demandé à ne pas être installés dans un placard sous l’escalier, sans fenêtre, d’une superficie totale de 6 m2 (soit 1 m2 par personne)26.
Commun pour les villes russes L'ère Staline Le type de logement était des appartements collectifs, une pièce par famille.
« Il n'y avait pas d'eau courante dans la chambre ; les coins où dormaient et s'asseyaient deux ou trois générations étaient bloqués par des draps ou des rideaux ; En hiver, la nourriture était suspendue dans des sacs devant la fenêtre. Éviers, latrines, baignoires et équipements de cuisine partagés (généralement juste des cuisinières... brûleurs et robinets avec eau froide) étaient situés soit dans le no man’s land entre les pièces à vivre, soit en bas, dans des couloirs non chauffés recouverts de linge »27.
Le terme « communal » a une certaine connotation idéologique, évoquant l’image d’un foyer socialiste collectif. Cependant, la réalité était remarquablement différente de ce tableau, et même en théorie, il y a eu peu de tentatives pour fournir une base idéologique détaillée à ce concept. Certes, pendant les années de guerre civile, lorsque les conseils municipaux ont commencé à « densifier » les appartements, ils ont avancé comme l'un de leurs motifs le désir d'égaliser le niveau de vie des ouvriers et de la bourgeoisie ; Les communistes se plaisaient souvent à observer le désespoir de familles bourgeoises respectables contraintes de laisser entrer dans leurs appartements de sales prolétaires. Durant la courte période de la Révolution culturelle, à la fin des années 1920 et au début des années 1930. Les architectes radicaux ont favorisé les appartements collectifs pour des raisons idéologiques et ont construit de nouveaux logements pour les travailleurs avec des cuisines et des salles de bains communes. À Magnitogorsk, par exemple, les premiers bâtiments résidentiels permanents ont été construits selon une conception qui non seulement obligeait les familles à utiliser des salles de bains et des latrines communes, mais qui ne prévoyait pas non plus de cuisine au départ, car il était supposé que tout le monde mangerait dans les cantines publiques28. Cependant, à l'exception des nouvelles villes industrielles comme Magnitogorsk, la plupart des appartements collectifs des années 1930. n'ont pas été construits, mais convertis à partir d'anciens appartements séparés, et cette conversion s'explique principalement par des raisons très pratiques : le manque de logements.
En fait, à en juger par la plupart des histoires, les appartements communaux n'ont pas du tout contribué à la culture de l'esprit de collectivisme et des habitudes de vie communautaire parmi les résidents ; en fait, ils ont fait exactement le contraire. Chaque famille gardait jalousement ses biens personnels, tels que casseroles, poêles et assiettes, stockés dans la cuisine, un espace commun. Les lignes de démarcation étaient strictement tracées. Envie et
la cupidité a prospéré dans le monde fermé des appartements communaux, où souvent la taille des pièces et la taille des familles qui les occupaient ne correspondaient pas, et les familles vivant dans de grandes pièces provoquaient un profond ressentiment envers ceux qui vivaient dans de petites. Cette indignation fut à l'origine de nombreuses dénonciations et poursuites dont le but était d'augmenter l'espace de vie du dénonciateur ou du plaignant aux dépens du voisin.
Une querelle prolongée de ce genre est décrite dans la plainte d'un enseignant de Moscou, dont le mari a été condamné à 8 ans de prison pour agitation contre-révolutionnaire. Leur famille (parents et deux fils) a vécu pendant près de deux décennies dans une grande pièce de 42 m2 dans un appartement communal de Moscou. "Pendant toutes ces années, notre chambre a été une pomme de discorde pour tous les résidents de notre appartement", a écrit l'enseignant. Des voisins hostiles les ont tous pourchassés moyens possibles, notamment en écrivant des dénonciations à diverses autorités locales. En conséquence, la famille a d’abord été privée de ses droits, puis elle n’a pas reçu de passeport et enfin, après l’arrestation du chef de famille, elle a été expulsée29.
La vie dans un appartement commun, côte à côte avec des personnes d'origines différentes, aux biographies très différentes, étrangères les unes aux autres, mais obligées de partager les commodités de l'appartement et de les maintenir propres, sans droit à l'intimité, constamment devant les voisins, était extrêmement épuisant mentalement pour la plupart des résidents. Il n'est pas surprenant que le satiriste M. Zoshchenko, dans sa célèbre histoire sur la morale d'un appartement communal, ait appelé ses habitants « les gens nerveux" Une liste des aspects sombres de la vie dans un appartement communal était contenue dans un décret gouvernemental de 1935, condamnant les « comportements de hooligans » dans l'appartement, y compris « l'organisation... de beuveries systématiques, accompagnées de bruit, de bagarres et de jurons, coups (en particulier femmes et enfants), insultes, menaces de violence, abus de sa position officielle ou de parti, comportement dépravé, persécution nationale, moquerie envers une personne, commettre divers sales tours (jeter les affaires d'autrui de la cuisine et autres parties communes, gâchant la nourriture préparée par d'autres résidents, les choses et produits d'autrui, etc.)"30.
« Chaque appartement avait son fou, ainsi que son ou ses ivrognes, son ou ses fauteurs de troubles, son propre informateur, etc. », explique un vétéran des appartements communaux. La forme de folie la plus répandue était la manie de persécution : par exemple, « une voisine était persuadée que les autres mélangeaient du verre pilé à sa soupe, qu'ils voulaient l'empoisonner »31. Vivre dans un appartement commun a certainement aggravé la maladie mentale, créant des conditions cauchemardesques pour le patient et ses voisins. Une femme nommée Bogdanova, 52 ans, célibataire, vivant dans une pièce de 20 mètres de large dans un appartement communal à Leningrad, a mené une guerre contre ses voisins pendant de nombreuses années, en utilisant d'innombrables dénonciations et
poursuites. Elle affirmait que ses voisins étaient des koulaks, des détourneurs de fonds, des spéculateurs. Les voisins affirmaient qu'elle était folle, le NKVD s'occupait constamment de régler leurs querelles et les médecins étaient du même avis. Malgré cela, les autorités ont considéré qu'il était impossible d'expulser Bogdanova, car elle refusait de déménager dans un autre appartement et son « état extrêmement nerveux » ne permettait pas de la déplacer de force32.
A côté de toutes ces histoires terribles, on ne peut s'empêcher de citer les souvenirs de la minorité sur l'esprit d'entraide qui régnait entre leurs voisins de l'appartement commun, qui vivaient comme s'ils formaient une grande famille. Dans un appartement communal de Moscou, par exemple, tous les voisins étaient amis, s'entraidaient, ne fermaient pas les portes pendant la journée et fermaient les yeux sur la femme d'un « ennemi du peuple » qui s'était installé illégalement avec son petit-fils. dans la chambre de sa sœur33. La plupart des bons souvenirs de l'appartement communal, y compris celui évoqué ci-dessus, concernent les souvenirs d'enfance : les enfants dont les instincts de propriété privée étaient moins développés que ceux de leurs parents étaient souvent heureux que leurs pairs vivent avec eux et qu'ils aient quelqu'un avec qui jouer. , et aimait observer le comportement de nombreux adultes si différents les uns des autres.
Dans les nouvelles villes industrielles, un trait caractéristique de la situation du logement - et des services publics urbains en général - était que le logement et les autres services publics étaient fournis par les entreprises et non par les conseils locaux, comme c'était l'habitude ailleurs. Ainsi, les « villes départementales » sont devenues une partie intégrante de la vie en URSS, où l'usine non seulement fournissait du travail, mais contrôlait également conditions de vie. À Magnitogorsk, 82 % de la surface habitable appartenait à la principale installation industrielle de la ville – l'usine sidérurgique de Magnitogorsk. Même à Moscou, les logements départementaux ont été reçus dans les années 1930. répandu34.
Il s'agissait généralement de casernes ou de dortoirs. Dans un grand nouveau bâtiment industriel en Sibérie au début des années 1930. 95 % des ouvriers vivaient dans des casernes. À Magnitogorsk, en 1938, les casernes ne représentaient que 47 % des logements disponibles, mais à cela il faut ajouter 18 % de pirogues, recouvertes de tourbe, de paille et de ferraille, construites par les habitants eux-mêmes35. Les casernes à un étage, constituées de grandes pièces avec des rangées de lits en fer ou divisées en petites pièces, servaient généralement de logement aux ouvriers célibataires dans les nouvelles villes industrielles et étaient courantes à la périphérie des anciennes ; les travailleurs mariés ayant une famille devaient aussi parfois y vivre, malgré le manque d'intimité. Les étudiants, ainsi que les jeunes ouvriers qualifiés et employés célibataires, étaient généralement hébergés dans des dortoirs.
John Scott décrit une caserne relativement décente à Magnitogorsk – un bâtiment bas en bois blanchi à la chaux, « à doubles murs doublés de paille ». Toit recouvert de papier goudronné, au printemps
fuyait. La caserne comptait trente pièces. Dans chacune d'elles, les habitants installaient un petit poêle en brique ou en fer, afin que tant qu'il y avait du bois ou du charbon, les pièces puissent être chauffées. Le couloir au plafond bas était éclairé par une petite ampoule électrique. Dans une pièce pour deux personnes, « mesurant six pieds sur dix, il y avait une petite fenêtre recouverte de journaux pour empêcher les courants d’air. Il y avait une petite table, un petit poêle en brique et un tabouret à trois pieds. Les deux couchettes en fer étaient étroites et branlantes. Il n’y avait pas de treillis à ressorts dessus, seulement des planches épaisses posées sur un cadre en fer. Il n’y avait pas de toilettes dans la caserne et apparemment pas d’eau courante. « Il y avait une cuisine, mais une famille y vivait, donc chacun cuisinait sur ses propres fourneaux »36.
Scott, en tant qu'étranger, bien que travailleur, était hébergé dans une caserne meilleure que d'habitude. Tout Magnitogorsk était rempli de casernes, « des bâtiments d'un étage, s'étendant en rangées à perte de vue et ne présentant aucun trait distinctif caractéristique. "Tu rentres chez toi, tu cherches, tu cherches", dit confusément un riverain. "Toutes les casernes se ressemblent, tu ne trouves pas la tienne." Dans ces nouvelles villes, les casernes étaient généralement divisées en grandes chambres communes, où il y avait « des couchettes pour dormir, un poêle pour se chauffer, une table au milieu, souvent il n'y avait même pas assez de tables et de chaises », comme on disait à propos de la Kouznetsk sibérien. Les hommes et les femmes avaient tendance à vivre dans des casernes différentes, ou du moins dans des salles communes différentes. Dans la plus grande caserne, pour 100 personnes, 200 personnes ou plus vivaient souvent et dormaient sur des lits par équipes. Une telle surpopulation n’avait rien d’extraordinaire. Dans une caserne de Moscou, qui appartenait à une grande centrale électrique, vivaient en 1932 550 personnes, hommes et femmes : « Tout le monde avait 2 mètres carrés, il y avait si peu d'espace que 50 personnes dormaient par terre, et certains utilisaient des lits en paille. matelas un à la fois »37.
Les dortoirs des ouvriers et des étudiants étaient conçus comme des casernes : de grandes pièces (séparées pour les hommes et les femmes), peu meublées de couchettes en fer et de tables de chevet, avec une seule ampoule au milieu. Même dans une usine moscovite aussi prestigieuse que Hammer and Sickle, en 1937, 60 % des ouvriers vivaient dans des dortoirs d'une sorte ou d'une autre. Une enquête menée dans les dortoirs ouvriers de Novossibirsk en 1938 révéla l'état déplorable de certains d'entre eux. Les dortoirs des ouvriers du bâtiment en bois à deux étages n'avaient ni électricité ni aucun autre éclairage, et le service de construction ne leur fournissait ni combustible ni kérosène. Parmi les résidents se trouvaient des femmes célibataires, que le rapport recommandait de reloger immédiatement, car dans le dortoir « il y a une corruption quotidienne des ouvriers (ivresse, etc.) ». Cependant, les conditions étaient meilleures ailleurs. Les ouvrières, pour la plupart membres du Komsomol, vivaient dans un confort relatif dans un dortoir meublé de lits, tables et chaises, avec électricité, mais sans eau courante38.
Les conditions de vie misérables dans les casernes et les dortoirs provoquèrent le mécontentement, et ce dans la seconde moitié des années 1930. une campagne a été lancée pour les améliorer. Des militants sociaux y ont apporté des rideaux et d'autres petites choses sympas. Les entreprises ont reçu pour instruction de partager de grandes pièces dans les dortoirs et les casernes afin que les familles qui y vivent puissent avoir une certaine intimité. L'usine de construction mécanique de l'Oural à Sverdlovsk rapporta en 1935 qu'elle avait déjà converti presque toutes ses grandes casernes en petites pièces séparées ; un an plus tard, l'usine métallurgique de Staline annonçait que les 247 familles de travailleurs vivant dans des « salles communes » dans ses casernes recevraient bientôt des chambres séparées. À Magnitogorsk, ce processus était presque achevé en 1938. Mais l’ère des casernes ne s’est pas terminée si vite, même à Moscou, sans parler des nouvelles villes industrielles de l’Oural et de la Sibérie. Malgré la résolution de 1934 du Conseil de Moscou interdisant la poursuite de la construction de casernes dans la ville, 225 nouvelles casernes furent ajoutées aux 5 000 casernes existantes à Moscou en 193839.
LES TROUBLES DE LA VIE CITY
Dans la vie d’une ville soviétique dans les années 30. tout allait mal. Dans les vieilles villes, les services publics – transports publics, routes, électricité et eau – ont été submergés par une croissance démographique soudaine, une demande industrielle croissante et des budgets maigres. Les nouvelles villes industrielles ont connu une situation encore pire, puisque leurs services publics sont partis de zéro. « L’apparence physique des villes est terrible », écrivait un ingénieur américain qui travaillait en Union soviétique au début des années 1930. « La puanteur, la saleté et la dévastation émerveillent les sens à chaque pas. »40
Moscou était la vitrine de l’Union Soviétique. La construction des premières lignes du métro de Moscou, avec des escaliers mécaniques et des fresques sur les murs des stations souterraines du palais, fut la fierté du pays ; même Staline et ses amis les accompagnèrent la nuit qui suivit leur ouverture au début des années 1930.41. Il y avait des tramways, des trolleybus et des bus à Moscou. Plus des deux tiers de ses habitants utilisaient les égouts et l'eau courante au début de la décennie, et à la fin, près des trois quarts. Bien sûr, la plupart vivaient dans des maisons sans salle de bain et se lavaient environ une fois par semaine dans les bains publics – mais au moins la ville était relativement bien équipée en bains, contrairement à beaucoup d’autres42.
En dehors de Moscou, la vie a instantanément changé pour le pire. Même la région de Moscou était mal dotée en services publics : à Lioubertsy, le centre régional de la région de Moscou, avec une population de 65 000 habitants. il n'y avait pas un seul bain public ; à Orekhovo-Zuevo, un quartier ouvrier exemplaire avec une crèche, un club et une pharmacie, il n'y avait ni éclairage public ni eau courante. À Voronej
Jusqu'en 1937, de nouvelles maisons pour les ouvriers étaient construites sans eau courante ni égouts. Dans les villes de Sibérie, la majorité de la population vivait sans eau courante, sans égouts et sans chauffage central. Stalingrad, avec une population approchant le demi-million d'habitants, ne disposait pas encore de réseau d'égouts en 1938. À Novossibirsk, en 1929, il existait des réseaux d'égouts et d'adduction d'eau de taille limitée et destinés à plus de 150 000 personnes. population - seulement trois bains43.
Dnepropetrovsk, une ville industrielle ukrainienne en croissance rapide et bien planifiée avec une population de près de 400 000 habitants, située au centre d'une région agricole fertile, n'avait pas de système d'égouts en 1933 et ses quartiers ouvriers manquaient de rues pavées, de transports publics, électricité et eau courante. L'eau était rationnée et vendue dans les casernes pour un rouble par seau. La ville entière manquait d'électricité - en hiver, presque toutes les lumières de la rue principale devaient être éteintes - malgré la proximité de la grande centrale hydroélectrique du Dniepr. Le secrétaire de l'organisation du parti de la ville envoya un message désespéré au centre en 1933, dans lequel il demandait des fonds pour l'amélioration urbaine, soulignant une grave détérioration de la situation sanitaire : le paludisme sévissait dans la ville, avec 26 000 cas de maladie. enregistrés cet été-là, contre 1 000 044 l'année précédente.
Les nouvelles villes industrielles disposaient encore de moins de commodités. Le sommet du conseil municipal de Lénine en Sibérie, dans une lettre en larmes adressée à la haute direction, a dressé un sombre tableau de leur ville :
« Gor. Leninsk-Kuznetsky avec une population de 80 000 habitants. ...extrêmement en retard dans le domaine de la culture et du perfectionnement... Sur 80 km. Une seule rue de la ville est pavée, et elle n’est pas entièrement pavée. Au printemps et en automne, en raison du manque de routes, de passages à niveau et de trottoirs bien entretenus, la saleté atteint des proportions telles que les travailleurs ont de grandes difficultés à se rendre au travail et à rentrer chez eux, et les cours dans les écoles sont perturbés. La situation de l’éclairage public n’est pas dans les meilleures conditions. Seul le centre est éclairé sur seulement 3 kilomètres ; le reste de la ville, sans parler de la périphérie, est dans l’obscurité. »45
Magnitogorsk, une nouvelle ville industrielle exemplaire, qui à bien des égards est aussi une vitrine, ne possédait qu'une seule rue pavée de 15 km de long et un éclairage public très médiocre. « La majeure partie de la ville utilisait des puisards dont le contenu était vidé dans des citernes fixées sur des camions » ; même dans la région relativement élitiste de Kirov, il n’y a pas eu de système d’égouts décent pendant de nombreuses années. L'approvisionnement en eau de la ville était pollué par les déchets industriels. La plupart des ouvriers de Magnitogorsk vivaient dans des quartiers à la périphérie de la ville, constitués de « huttes temporaires alignées le long du seul chemin de terre... couvertes d'immenses flaques d'eau sale ».
de l’eau, des tas d’ordures et de nombreuses latrines ouvertes »46.
Les habitants et les invités de Moscou et de Léningrad ont laissé des descriptions vivantes des tramways et de l'incroyable cohue qui y régnait. Il y avait des règles strictes qui obligeaient les passagers à entrer par la porte arrière et à sortir par l'avant, obligeant ainsi les passagers à avancer constamment. Souvent, la foule ne permettait pas à une personne de descendre à son arrêt. Les horaires de circulation étaient très irréguliers : parfois les tramways ne circulaient tout simplement pas ; à Leningrad, on pouvait voir des « tramways sauvages » (c’est-à-dire imprévus, avec des conducteurs et des conducteurs autoproclamés) qui sillonnaient les rails, embarquaient illégalement des passagers et empochaient les billets47.
Dans les villes de province, où les rues pavées restaient relativement rares à la fin de la décennie, les transports publics, quels qu'ils soient, étaient minimes. À Stalingrad, en 1938, il y avait un parc de tramways avec 67 km de voies, mais il n'y avait pas de bus. Pskov, avec une population de 60 000 habitants, ne disposait en 1939 ni d'un parc de tramways ni de rues pavées : tous les transports urbains se composaient de deux bus. Penza ne disposait pas non plus de tramways avant la Seconde Guerre mondiale, même si leur lancement était prévu en 1912 ; Le transport urbain en 1940 comprenait 21 bus. Magnitogorsk a acquis une courte ligne de tramway en 1935, mais à la fin de la décennie, il n'y avait encore que 8 bus, que l'administration de l'usine utilisait pour « faire le tour de la ville et de ses environs et récupérer ses ouvriers là où ils habitaient ».48
Dans les rues de nombreuses villes soviétiques dans les années 1930. c'était dangereux de marcher. Les plus célèbres étaient les nouvelles villes industrielles et les colonies ouvrières des anciennes. Ici, l'ivresse, la concentration d'hommes célibataires agités, l'application insuffisante de la loi, les mauvaises conditions de vie, les rues non pavées et non éclairées, tout cela se conjuguait pour créer une atmosphère de sauvagerie et d'anarchie. Les vols, les meurtres, les bagarres ivres et les attaques contre les passants sans raison apparente étaient monnaie courante. Les conflits nationaux éclatent souvent sur les lieux de travail et dans les casernes dans un environnement multinational. Les autorités imputaient tous ces problèmes aux ouvriers paysans récemment arrivés du village, souvent au passé sombre ou étant des « éléments déclassés »49.
En URSS, les comportements destructeurs et antisociaux étaient appelés « hooliganisme ». Le terme a eu une histoire complexe et une signification changeante au cours des années 1920 et au début des années 1930. elle était associée à un comportement perturbateur, irrespectueux et antisocial, le plus souvent constaté chez les jeunes hommes. Toutes les nuances de ce concept ont été enregistrées dans la liste des actes de « hooligans » donnée en 1934 dans un journal juridique : insultes, bagarres, bris de vitres, fusillades dans les rues,
harceler les passants, perturber les événements culturels dans le club, casser les assiettes dans la salle à manger, perturber le sommeil des citoyens avec des bagarres et du bruit tard dans la nuit50.
Une flambée de hooliganisme dans la première moitié des années 1930. suscité l’inquiétude du public. A Orel, les hooligans ont tellement terrorisé la population que les ouvriers ont arrêté d'aller travailler ; À Omsk, « les travailleurs du soir devaient passer la nuit à l’usine pour ne pas courir le risque d’être battus et volés ». À Nadejdinsk, dans l’Oural, les citoyens « ont été littéralement terrorisés par le hooliganisme, non seulement la nuit, mais même le jour. Les actes de hooligans se traduisaient par du harcèlement sans but, des tirs dans les rues, des insultes, des coups, des bris de vitres, etc. Des bandes entières de hooligans sont entrées dans le club, ont perturbé tous les événements culturels organisés par le club, sont entrées dans les dortoirs des travailleurs, y ont provoqué un bruit inutile et parfois une bagarre, perturbant le repos normal des travailleurs. »51
Les parcs étaient souvent le théâtre d'activités hooliganes. Le parc et le club d'un village industriel de la Haute Volga, avec une population de 7 000 habitants, ont été décrits comme un véritable patrimoine de hooligans :
« A l'entrée du parc et dans le parc lui-même, vous pouvez acheter du vin de toutes sortes en n'importe quelle quantité. Il n’est pas surprenant que l’ivresse et le hooliganisme aient pris des proportions considérables dans le village. Les hooligans restent pour la plupart impunis et deviennent de plus en plus effrontés. Récemment, ils ont blessé le directeur de la production d'une usine chimique, le camarade Davydov, et ont tabassé le chauffeur Suvorev et d'autres citoyens.»
Des hooligans ont perturbé l'inauguration du parc culturel et récréatif de Khabarovsk. Le parc était mal éclairé à la tombée de la nuit, « les hooligans commencèrent leurs « tournées »… poussant sans ménagement les femmes dans le dos, arrachant leurs chapeaux, jurant, déclenchant des bagarres sur la piste de danse et dans les ruelles »52.
La criminalité a également prospéré dans les trains et dans les gares et gares. Des bandes de voleurs ont attaqué des passagers dans des trains de banlieue et longue distance à Région de Léningrad: Ils ont été traités de « bandits », un terme plus dur que « hooligan », et ont été condamnés à peine de mort. Les gares étaient toujours bondées de monde : des gens essayant d'acheter des billets, des visiteurs qui n'avaient nulle part où se loger, des spéculateurs, des pickpockets, etc. Ils ont écrit à propos d'une gare de la région de Léningrad qu'elle « ressemble plus à un hangar qu'à un carrefour ferroviaire confortable. Dans la zone passagers, des personnes suspectes vivent 3 à 4 jours, des ivrognes traînent souvent, des spéculateurs vendent des cigarettes et des personnages louches errent. Il y a une ivresse constante et une saleté inimaginable au buffet. À la gare de Novossibirsk, il n'y avait qu'un seul moyen d'obtenir un ticket - auprès d'une bande de revendeurs dirigée par un « professeur » : « de taille moyenne, surnommé « Ivan Ivanovitch », avec un chapeau de paille blanc, avec une pipe dans la bouche » 53.
L'ART DU SHOPPING
Annonce à la fin des années 20. l'entrepreneuriat privé a été interdit, l'État est devenu le principal, et souvent le seul, distributeur de divers avantages et biens. Toutes les prestations sociales de base, telles que le logement, les soins médicaux, l'enseignement supérieur et les bons d'accès aux maisons de vacances, étaient fournies par les services gouvernementaux54. Pour les recevoir, les citoyens devaient introduire une demande auprès de l'autorité compétente. Là, leurs revendications ont été évaluées sur la base de divers critères, parmi lesquels l'origine de classe du demandeur : les prolétaires appartenaient à la catégorie la plus élevée, les personnes dépossédées des « étrangers de classe » - à la catégorie la plus basse. Presque toujours compilé longues listes listes d'attente parce que les biens requis n'étaient pas suffisants. S'étant finalement retrouvé premier sur la liste, le citoyen aurait dû, en principe, recevoir un appartement de la taille requise ou un bon pour une maison de repos. Les appartements et les bons n'étaient pas obtenus gratuitement, mais les frais étaient faibles. Il n’existait pas de marché privé légal pour la plupart des biens sociaux.
Dans le domaine du commerce - c'est-à-dire distribution de nourriture, de vêtements et d'autres biens de consommation - la situation était un peu plus compliquée. L’État n’était pas le seul distributeur légal puisque les paysans étaient autorisés à vendre leurs produits sur les marchés des fermes collectives depuis 1932. En outre, l’existence de magasins « commerciaux » proposant des prix élevés, même s’ils appartenaient à l’État, introduisait également un certain élément quasi marchand. Néanmoins, dans ce domaine, l’État disposait d’un quasi-monopole.
Compte tenu de l'ampleur de la tâche à accomplir - remplacer le commerce privé - et du fait qu'elle a été résolue à la hâte, sans plan bien pensé, dans une période de crise générale et de tournant, il est difficile de s'étonner que le le nouveau système de distribution échouait constamment. Pourtant, l’ampleur des perturbations et leur impact sur la vie quotidienne des citoyens sont stupéfiants. Seule la collectivisation a surpassé cette catastrophe par son ampleur et ses conséquences considérables. Bien entendu, les citadins, en règle générale, ne sont pas morts de faim à cause du nouveau système commercial et n'ont pas non plus été arrêtés et déportés, comme les paysans lors de la collectivisation. Et pourtant, à la fin des années 1920. Les conditions de vie dans la ville se sont soudainement et fortement détériorées, causant d'énormes difficultés et désagréments à la population. Bien qu'au milieu des années 1930. La situation s'est quelque peu améliorée : la distribution des biens de consommation est restée le principal problème de l'économie soviétique pendant le demi-siècle suivant.
Ayant quelques idées sur le commerce, par exemple, selon lesquelles le marché capitaliste basé sur le profit est mauvais et que la revente de marchandises à un prix plus élevé est un crime (« spéculation »), les dirigeants politiques soviétiques ne pensaient guère à ce qu'était réellement le « commerce socialiste ». Ils ne le font pas
ils ne prévoyaient pas que leur système créerait des pénuries chroniques, comme l’a soutenu plus tard l’économiste hongrois János Kornai ; au contraire, ils s’attendaient à ce qu’elle génère l’abondance. De même, ils n’ont pas réalisé qu’en créant un monopole d’État sur la distribution, ils confiaient la fonction centrale de distribution à la bureaucratie d’État, ce qui avait un impact si profond sur la relation entre l’État et la société et sur la stratification sociale. En tant que marxistes, les dirigeants soviétiques pensaient que la production, et non la distribution, était primordiale. Beaucoup d’entre eux gardaient le sentiment que le commerce, même d’État, était une sale affaire – et les systèmes de distribution formels et informels apparus dans les années 1930 n’ont fait que confirmer ce point de vue.
Initialement, les principaux aspects du nouveau système commercial étaient le rationnement par cartes et ce qu'on appelle la « distribution fermée ». Lors du rationnement par cartes, une certaine quantité limitée de marchandises était libérée sur présentation, accompagnée du paiement, d'une carte spéciale. Avec la distribution fermée, les marchandises étaient distribuées sur le lieu de travail dans des magasins fermés, où seuls les employés d'une entreprise ou d'une institution donnée ou les personnes figurant sur une liste spéciale étaient autorisés. Par la suite, comme on peut le constater, cela a jeté les bases d’un système d’accès hiérarchiquement différencié aux biens de consommation, qui est devenu une caractéristique intégrante du commerce soviétique et une source de stratification dans la société soviétique.
Le rationnement et la distribution fermée étaient le résultat d’une improvisation face à la crise économique plutôt que de politiques réfléchies adoptées pour des raisons idéologiques. Il est vrai que certains théoriciens marxistes ardents ont mis en lumière de vieux arguments de la guerre civile selon lesquels le rationnement est précisément la forme de distribution qui convient au socialisme. Cependant, la direction du parti n’était pas très satisfaite d’un tel raisonnement. Ils estimaient que ces cartes étaient quelque chose de honteux, une preuve de la crise économique et de la pauvreté de l'État. Quand à la fin des années 1920. les cartes sont réapparues, cela s'est produit à l'initiative des localités, et non par décision du centre. L'abolition des cartes de pain au début de 1935 a été présentée au public comme un grand pas vers le socialisme et une vie meilleure, même si en fait elle a entraîné une baisse des revenus réels et de nombreux travailleurs à bas salaire ont été mécontents de ces changements. Lors des réunions à huis clos du Politburo, Staline a surtout insisté sur l'importance de l'abolition des cartes57.
Malgré le manque d'enthousiasme des cadres supérieurs pour les cartes, elles furent si souvent utilisées que cette mesure peut être considérée comme inévitable sous la distribution stalinienne. Le système de cartes a été introduit en Russie pendant la Première Guerre mondiale et a perduré tout au long de la guerre civile. Elle
à nouveau officiellement en vigueur de 1929 à 1935 et de 1941 à 1947 "- en général, près de la moitié de la période stalinienne. Même lorsque le système de cartes fut aboli, les autorités locales pouvaient l'introduire arbitrairement sans la sanction du centre dès que des problèmes d'approvisionnement Finalement, dans les années 1930, les cartes et la distribution fermée se sont progressivement répandues à nouveau dans tout le pays, grâce à des initiatives non autorisées des autorités locales. Lorsque les marchandises étaient vraiment rares, les cartes leur semblaient - et souvent à la population locale - le moyen le plus efficace. d'une manière simple traiter le problème. La distribution fermée attire les élites locales (mais pas la population) car elle leur garantit un accès privilégié à des biens rares.
Le système de rationnement était avant tout un phénomène urbain ; il s'est développé spontanément dans les villes de l'URSS en 1928-1929, à commencer par Odessa et d'autres villes ukrainiennes, en réponse aux ruptures d'approvisionnement provoquées par les difficultés d'approvisionnement en céréales. Au début, elle concernait tous les produits alimentaires de base, puis elle a commencé à couvrir les biens industriels les plus courants, tels que les vêtements d'extérieur et les chaussures58.
Comme pendant la guerre civile, le système de rationnement du premier plan quinquennal était caractérisé par une discrimination sociale pure et simple. La catégorie la plus élevée était constituée d'ouvriers industriels, la catégorie la plus basse - de commerçants, y compris d'anciens ayant changé de métier pour L'année dernière, prêtres, aubergistes et autres éléments étrangers à la classe qui n'ont reçu aucune carte du tout59. Le même principe de « priorité prolétarienne » était en vigueur ici, qui était appliqué dans d'autres domaines (admission dans les établissements d'enseignement supérieur, fourniture de logements) dans le cadre de la politique générale soviétique de promotion du prolétariat. Cependant, dans la pratique, la distribution des marchandises par cartes suivait un schéma plus complexe. Premièrement, le principe de la « priorité prolétarienne » a été violé lorsque diverses catégories de travailleurs intellectuels, comme les professeurs et les ingénieurs, ont acquis des droits égaux à ceux des travailleurs. Deuxièmement, le niveau de l'offre publique en général et le rationnement par cartes en particulier variaient sensiblement selon les régions, les départements, les industries ou les entreprises60.
Cependant, le facteur le plus important qui minait le principe de « priorité prolétarienne » était la distribution fermée. Cela signifiait la distribution de biens rationnés sur le lieu de travail dans des magasins et des cantines fermés, accessibles uniquement aux travailleurs inscrits dans une entreprise donnée61. La distribution fermée s'est développée simultanément avec le système de cartes, coexistant avec un réseau de « distribution ouverte » constitué de magasins d'État accessibles au public, et pendant la période du premier plan quinquennal, le système de distribution fermée couvrait les ouvriers de l'industrie, les cheminots, les forestiers. , le personnel des fermes d'État, les employés du gouvernement et bien d'autres.
catégories - début 1932 nombre total Les magasins fermés ont atteint 40 000, représentant près d'un tiers des points de vente de la ville. La concentration des approvisionnements sur le lieu de travail s'est accrue avec le développement d'un réseau de cantines d'usine, où les ouvriers recevaient des repas chauds pendant la journée. Au cours des années du premier plan quinquennal, leur nombre fut multiplié par cinq, pour atteindre 30 000. En juillet 1933, ils desservaient les deux tiers des habitants de Moscou et 58 % des habitants de Léningrad62.
La distribution fermée visait à protéger la population active des pires conséquences des pénuries et à lier le rationnement des marchandises à l'emploi. Mais il acquiert rapidement une autre fonction (décrite plus en détail au chapitre 4) : assurer des approvisionnements privilégiés à certaines catégories de privilégiés. Pour diverses catégories d'élite de fonctionnaires et de spécialistes, des distributeurs fermés spéciaux ont été créés, leur fournissant des produits de bien meilleure qualité que ceux disponibles dans les magasins fermés ordinaires et les cantines d'usine. Les étrangers travaillant en Union soviétique disposaient de leur propre système de distribution fermé appelé In-snab63.
En 1935, la distribution fermée est officiellement supprimée. Cependant, six mois plus tard, les inspecteurs du Commissariat du peuple au commerce extérieur ont noté que « certains magasins réservent des marchandises à certains groupes d'acheteurs, relançant ainsi diverses formes d'approvisionnement fermé ». Malgré le fait que le commissaire du peuple au commerce I. Weitzer ait interdit cette pratique, elle a continué d'exister, profitant à l'élite locale, qui bénéficiait d'un accès privilégié aux marchandises. Lorsque de graves pénuries sont réapparues à la fin de la décennie, le nombre de points de distribution fermés s’est immédiatement multiplié. Par exemple, avec l'apparition de grandes lignes de pain à Kustanai, Alma-Ata et dans d'autres villes de province à la fin de 1939, les autorités locales créèrent des magasins fermés où seuls les représentants de la « nomenklatura » étaient autorisés. Dans les institutions et les entreprises de tout le pays, des buffets fermés étaient organisés pour les employés64.
Pour les magasins d'État et coopératifs des années 1930. étaient typiques bas prix et de longues files d'attente, et ils manquaient constamment de marchandises. Mais si vous aviez de l’argent, vous pourriez trouver d’autres options. L’alternative légale était représentée par les marchés agricoles collectifs, les magasins Torgsin et les magasins « commerciaux » d’État.
Les marchés agricoles collectifs sont les successeurs des marchés paysans qui existaient à l'époque villes russesà travers les siècles. Durant la période de la NEP, elles furent tolérées, mais beaucoup d'entre elles, comme la Soukharevka de Moscou, acquitrent une très mauvaise réputation et furent fermées au cours du premier plan quinquennal. autorités locales. Cependant, en mai 1932, la légalité de leur existence fut reconnue dans un décret gouvernemental réglementant leurs activités. Ce décret a été motivé par la nécessité urgente de relancer les flux de produits en provenance de
villages dans une ville qui menaçait de s'assécher complètement. L'une de ses caractéristiques était qu'elle accordait à nouveau le droit de commercer aux paysans et aux artisans ruraux - mais à personne d'autre. Tout citadin qui se livrait au commerce était stigmatisé du surnom de « spéculateur », et les autorités locales étaient sévèrement punies « pour empêcher l'ouverture de magasins et de magasins par des commerçants privés et pour éradiquer par tous les moyens les revendeurs et les spéculateurs qui tentaient de gagner de l'argent sur le marché ». aux dépens des ouvriers et des paysans »65.
Dans la pratique, le gouvernement soviétique n’a jamais réussi à débarrasser les marchés agricoles collectifs des « revendeurs et spéculateurs », qui sont devenus le centre principal des activités du marché noir et de toutes sortes de transactions louches. Même si la lutte contre la « spéculation » n'a jamais pris fin, les autorités se sont montrées assez tolérantes à l'égard des citadins qui tentaient de vendre des vêtements ou des effets personnels d'occasion, voire de vendre une petite quantité de biens neufs (achetés ou fabriqués personnellement). Les marchés sont devenus de facto des oasis de commerce privé dans l’économie soviétique66.
Les prix sur le marché des fermes collectives, qui fluctuaient librement et n'étaient pas fixés par l'État, étaient toujours plus élevés que dans les magasins d'État ordinaires, et parfois même plus élevés que dans les magasins commerciaux, dont il sera question ci-dessous. En 1932, la viande sur les marchés de Moscou coûtait 10 à 11 roubles par kilogramme, tandis que dans les magasins ordinaires, elle coûtait 2 roubles ; pommes de terre - 1 kilogramme de rouble (en magasin - 18 kopecks)67. Au milieu des années 1930. l'écart de prix s'est quelque peu atténué, mais reste néanmoins important et toujours prêt à augmenter à la moindre interruption d'approvisionnement. La plupart des salariés ordinaires ne pouvaient pas se permettre le marché des fermes collectives et n'y allaient qu'à des occasions spéciales.
Pendant une très courte période, la même anomalie a été représentée par les magasins Torgsin, qui, de 1930 à 1936, vendaient des produits rares contre des devises étrangères, de l'or, de l'argent et d'autres objets de valeur. Précurseurs des magasins de devises ultérieurs en URSS, les magasins de Torgsin en différaient en ce qu'ils étaient ouverts à tout citoyen possédant la monnaie appropriée. Leur objectif était simple : reconstituer les réserves soviétiques de devises fortes pour permettre au pays d’importer davantage d’équipements destinés à son industrialisation. Les prix de Torgsin étaient bas (inférieurs aux prix « commerciaux » et aux prix du marché des fermes collectives), mais pour un citoyen soviétique, les achats à Torgsin étaient chers, car il devait sacrifier soit les restes de l'argent familial, soit l'or de son grand-père. montre, ou même sa propre alliance. Certains des magasins centraux de Torgsine, notamment le magasin de Moscou de la rue Gorki, né sur le site de la célèbre épicerie Eliseevsky, se distinguaient par un mobilier luxueux et une décoration luxuriante. Pendant les années de famine, comme l’écrivait un journaliste étranger choqué, « des groupes entiers de gens se tenaient devant les vitrines des magasins, regardant avec envie les pyramides de fruits qui s’y dressaient ».
Camarade; bottes et manteaux disposés et accrochés avec goût ; beurre, pain blanc et autres gourmandises qui leur sont inaccessibles »68.
« Commercial » désignait à l'origine les magasins publics qui vendaient des produits sans carte à des prix plus élevés. Elles sont devenues des institutions commerciales reconnues à la fin de 1929 ; Au début, ils y vendaient des vêtements, des tissus en coton et en laine, mais bientôt l'assortiment s'est élargi pour inclure à la fois des spécialités luxueuses comme le poisson fumé et le caviar, et des produits plus essentiels : vodka, cigarettes, produits alimentaires de base. À l'époque du système de cartes, les prix commerciaux étaient généralement deux à quatre fois plus élevés que les prix des produits vendus par carte. Ainsi, par exemple, en 1931, des chaussures coûtaient entre 11 et 12 roubles dans un magasin ordinaire. (si vous pouviez les trouver là-bas !), dans un magasin commercial, ils coûtent 30 à 40 roubles ; les pantalons dans un magasin ordinaire étaient vendus pour 9 roubles, dans un magasin commercial - pour 17 roubles. Le fromage dans un magasin commercial était deux fois plus cher, le sucre plus de huit fois plus cher. En 1932, les magasins commerciaux représentaient un dixième du chiffre d'affaires total du commerce de détail. En 1934, après une réduction significative de l’écart entre les prix commerciaux et réguliers, leur part était passée à un quart69.
Avec l'abolition du rationnement en 1935, le réseau de magasins commerciaux s'étend. Des magasins de mode et des magasins spécialisés ont ouvert dans de nombreuses villes, vendant des produits manufacturés de meilleure qualité et à des prix plus élevés que les magasins gouvernementaux classiques. Le nouveau commissaire du peuple au commerce, I. Weitzer, prêchait la philosophie du « libre-échange soviétique », qui impliquait l'orientation client et la concurrence entre les magasins au sein de la structure du commerce d'État. Au troisième quart des années 30. Il y a eu sans aucun doute des améliorations significatives dans le système commercial, principalement dues à une augmentation significative des investissements publics, dont le montant dans le deuxième plan quinquennal (1933-1937) était trois fois supérieur à celui du premier.
Toutefois, les fruits de ces améliorations ne pourraient, pour l’essentiel, profiter qu’aux segments les plus riches de la population. Une nouvelle réduction de la différence entre les prix commerciaux et les prix publics ordinaires s'est produite autant par une augmentation des prix ordinaires que par une diminution des prix commerciaux. Si au début des années 1930. Étant donné que les citoyens de tous les niveaux de la société soviétique étaient principalement confrontés à de graves pénuries, à partir du milieu de la décennie, les plaintes des groupes à faible revenu de la population n'étaient pas moins fréquentes, affirmant que leur revenu réel était trop faible et que les produits restaient donc inabordables. . « Je n’ai pas les moyens d’acheter de la nourriture dans les magasins, tout est très cher, on se promène comme une ombre et on ne fait que maigrir et s’affaiblir », écrivait un ouvrier de Léningrad aux autorités en 1935. Lorsque les prix de base du gouvernement pour les vêtements et autres produits manufacturés doublèrent en janvier 1939 (le plus grand prix unique au monde)
augmentation mentale des prix au cours de la décennie), le NKVD a noté les murmures les plus forts parmi la population urbaine et de nombreuses plaintes selon lesquelles l'élite privilégiée était indifférente à la souffrance des citoyens ordinaires, et Molotov, qui avait promis que les prix n'augmenteraient plus, a trompé le peuple71 .
Spéculation
Comme nous l’avons vu, il était extrêmement difficile d’obtenir des biens de toute sorte, depuis les chaussures jusqu’aux appartements, par les canaux de distribution officiels du gouvernement. Premièrement, il n’y avait tout simplement pas assez de marchandises. Deuxièmement, les départements qui les distribuaient le faisaient de manière extrêmement inefficace et étaient totalement corrompus. Les magasins gouvernementaux avaient de longues files d’attente et des étagères souvent vides. Les listes d'attente des autorités locales pour un logement sont devenues si longues et les méthodes informelles pour les contourner si répandues que pratiquement personne ne pouvait attendre son tour sans mesures supplémentaires.
En conséquence, la distribution informelle est devenue extrêmement importante - c'est-à-dire distribution contournant le système bureaucratique formel. Durant l’ère stalinienne en URSS, la « seconde économie » a prospéré (bien que ce terme lui-même soit d’origine plus récente) ; il a existé aussi longtemps que le « premier » et peut en fait être considéré comme le successeur du secteur privé des années 1920, malgré son passage d’une position légale, quoique à peine tolérée par l’État, à une position illégale. À l’instar du secteur privé de la NEP, la deuxième économie de l’ère stalinienne distribuait essentiellement des biens produits et détenus par l’État, les produits privés y jouant un rôle clairement secondaire. Les fuites de marchandises se produisaient à n’importe quel maillon du système de production et de distribution, à n’importe quelle étape du trajet depuis l’usine jusqu’au magasin coopératif rural. N'importe quel travailleur du système commercial, à n'importe quel niveau, pouvait être impliqué d'une manière ou d'une autre, c'est pourquoi cette profession, bien qu'elle offrait un niveau de vie supérieur à la moyenne, était considérée comme douteuse et n'offrait pas un statut social élevé.
Comme l'ont souligné J. Berliner et d'autres économistes, la première économie de Staline n'aurait pas pu fonctionner sans la seconde, puisque toute industrie reposait sur la pratique consistant à se procurer plus ou moins illégalement les matières premières et les équipements nécessaires, et que les entreprises industrielles entretenaient à cette fin tout un ensemble d'économies. armée d’agents expérimentés dans la seconde économie – les « pousseurs »72. Ce qui est vrai pour l’industrie l’est a fortiori pour les citoyens ordinaires. Il est arrivé à tout le monde d'acheter de la nourriture ou des vêtements à des spéculateurs ou d'acquérir un appartement, du fer à repasser.
un titre de transport, un bon pour une maison de vacances « via des correspondances », même si certains ont plus souvent recours aux services de la seconde économie et y parviennent mieux que d'autres.
Les dirigeants soviétiques ont qualifié sans discernement toute acquisition de biens destinés à la revente à un prix plus élevé de « spéculation » et ont considéré de tels actes comme un crime. Cet aspect de la mentalité soviétique peut s’expliquer par l’idéologie marxiste (même si très peu de marxistes en dehors de la Russie étaient aussi passionnément et catégoriquement opposés au commerce), mais il semble également avoir des racines nationales russes. Quoi qu’il en soit, la spéculation et sa condamnation morale étaient extrêmement fermement ancrées en Russie soviétique.
Qui étaient les « spéculateurs » ? Parmi eux, on pouvait rencontrer des hommes d'affaires prospères de la pègre, menant une vie luxueuse et ayant des relations dans de nombreuses villes, et des vieilles femmes opprimées par la pauvreté, achetant des saucisses ou des bas dans un magasin le matin, pour les revendre dans la rue quelques heures plus tard. plus tard avec un petit balisage. Certains spéculateurs se livraient autrefois à un commerce légal : par exemple, un homme nommé Jidovetsky, condamné à huit ans de prison pour spéculation en 1935, achetait des coupes de tissus de laine à Moscou et les transportait pour les revendre à Kiev. D’autres, comme Timofey Drobot, condamné à cinq ans de prison dans la région de la Volga pour profit en 1937, étaient d’anciens paysans arrachés à leur sol natal par la dépossession et contraints de survivre comme des renégats, arrivant à peine à joindre les deux bouts74. .
Parmi les cas de profit très médiatisés décrits dans les journaux, le plus important et le plus complexe concerne les activités d'un groupe de personnes qui auraient anciens koulaks et des commerçants privés, qui ont lancé un commerce à assez grande échelle de feuilles de laurier, de soda, de poivre, de thé et de café, en utilisant des connexions et des points dans un certain nombre de villes de la Volga et de l'Oural, ainsi qu'à Moscou et Léningrad. Au moment de l'arrestation, l'un des membres du groupe transportait 70 000 roubles, l'autre aurait gagné au total plus de 1,5 million de roubles grâce à cette affaire. Les artisans du Daghestan Nazhmudin Shamsudinov et Magomet Magomadov étaient à un niveau inférieur à celui du gang des commerçants, mais ils avaient également 18 000 roubles avec eux lorsqu'ils ont été arrêtés pour avoir troublé l'ordre public dans un restaurant de Grozny, la capitale de la Tchétchénie, et en plus, ils seulement qu'ils ont renvoyé chez eux 7 000 roubles supplémentaires.75.
De nombreux spéculateurs provinciaux, pour acheter des marchandises, prenaient simplement le train jusqu'à Moscou ou Léningrad, mieux approvisionnées, et les achetaient dans les magasins là-bas. Un groupe de 22 spéculateurs, comparu devant le tribunal de Voronej en 1936, a utilisé cette méthode, ouvrant un atelier de couture légale pour couvrir la revente des marchandises ainsi obtenues, qui, au moment de l'arrestation du groupe, comprenait 1677 m de tissu,
44 robes, ainsi que 2 vélos, de nombreuses paires de chaussures, des disques de gramophone et une sorte de colle à caoutchouc76.
Cependant, dans une entreprise à grande échelle et bien organisée, méthodes efficaces réception des marchandises, plutôt que leur achat habituel dans les magasins gouvernementaux parmi d'autres acheteurs. Les grands hommes d’affaires avaient souvent des « relations » avec des directeurs de magasins et des employés d’entrepôt (ou étaient eux-mêmes directeurs de magasins) et prenaient systématiquement les marchandises par la porte arrière. Le directeur du magasin et d'autres vendeurs pourraient être directement impliqués dans cette affaire, comme le directeur commercial d'un magasin de vêtements de Leningrad, jugé pour avoir dirigé une bande de spéculateurs qui recevaient des marchandises directement de l'entrepôt du magasin. Cependant, dans ce magasin, plus d'un directeur commercial était associé à des spéculateurs. L'un des vendeurs et le chef des pompiers, par exemple, informaient à l'avance les spéculateurs professionnels de l'heure d'arrivée des marchandises et leur permettaient d'éviter les files d'attente, gagnant à chaque fois 40 à 50 roubles.77.
Des cas similaires sont illustrés par une série de trois dessins animés sous le titre général « Le Magicien », publiés dans « Crocodile ». La première photo montre un stand ouvert rempli de marchandises, la deuxième montre le stand fermé pour la nuit, la troisième le montre le lendemain matin, ouvert et vide. «Sous vos yeux, j'ai fermé l'étal pour la nuit», raconte le magicien. - Le lendemain matin, je l'ouvre. Hello hop !.. Et le stand est complètement vide. Rien de fantastique : juste des tours de passe-passe et beaucoup de fraudes. »78
On pensait généralement que quiconque travaillait dans le commerce avait eu des liens avec la seconde économie ou avait au moins abusé de son accès préférentiel aux marchandises. Une opinion similaire se reflète dans de nombreuses blagues de Crocodile. Dans un dessin animé, par exemple, une mère dit à sa fille : « C’est pareil, chérie. Que vous soyez membre d’un parti ou non, du moment que vous servez dans le système de missiles de défense aérienne. Sur une autre, un employé d'un magasin coopératif regarde avec confusion le lot de chemises qui arrive : « Que dois-je faire ? Comment distribuer ? J’ai reçu 12 chemises, mais je n’ai que 8 membres de ma famille. »79 Il n’est pas surprenant que les ouvriers des magasins coopératifs aient souvent été jugés pour profitabilité.
Le travail de conducteur de chemin de fer était souvent associé à la spéculation. Par exemple, le conducteur du chemin de fer Staline. dans le Donbass, il a acheté des chaussures et divers produits industriels à Moscou, Kiev et Kharkov et les a revendus en chemin. Un autre guide « a pris du tissu auprès de personnes qui travaillaient dans des usines textiles de la région. Il s'est également rendu en train jusqu'à Shepetivka, située près de la frontière, et y a obtenu des marchandises passées en contrebande à travers la frontière russo-polonaise. Les spéculateurs potentiels étaient considérés comme les employés et les chauffeurs des bains publics (qui
pourraient utiliser les voitures de société pour se déplacer dans les fermes collectives et acheter leurs produits pour les vendre en ville). De petites spéculations étaient menées par de nombreuses femmes au foyer qui faisaient la queue dans les magasins gouvernementaux et achetaient des biens tels que des vêtements et des textiles pour les revendre au marché ou aux voisins. Par exemple, selon les journaux, la femme au foyer Ostroumova spéculait régulièrement sur les tissus. Elle n’en achetait que 3 à 4 m à la fois, mais lors de son arrestation dans son appartement, 400 m de tissu ont été retrouvés dans sa valise80.
L'appartement servait souvent de lieu de revente de marchandises81. Les voisins, sachant qu'une certaine personne (généralement une femme) possédait un certain produit ou pouvait l'obtenir, lui rendaient visite le soir pour voir ce qu'elle avait. De telles transactions, comme beaucoup d'autres opérations dans le domaine de la « seconde économie », étaient considérées sous des angles complètement opposés par leurs participants, qui les considéraient comme une faveur amicale, et par l'État, qui les considérait comme un crime. Les gares et les magasins étaient également appréciés des spéculateurs, devant lesquels les vendeurs ambulants vendaient des marchandises achetées auparavant à l'intérieur.
Mais le principal lieu de spéculation était apparemment le marché des fermes collectives. Toutes sortes de choses y étaient échangées illégalement ou semi-légalement : des produits agricoles achetés aux paysans par des intermédiaires, des biens industriels volés ou achetés dans les entrepôts des magasins, des vêtements de seconde main, voire des cartes et de faux passeports. La loi autorisait les paysans à vendre leurs propres produits au marché, mais interdisait aux autres de le faire à leur place, même si cela était souvent plus pratique pour les paysans que de traîner au marché toute la journée. Un rapport de Dnepropetrovsk décrit ce processus comme suit :
«Souvent sur la route du bazar, les kolkhoziens rencontrent un revendeur. - Qu'apportes-tu? - Concombres. Le prix est nommé et les concombres récoltés dans le jardin individuel du kolkhozien sont achetés en gros par le revendeur et vendus sur le marché à un prix majoré.
De nombreux revendeurs sont connus, mais ils sont souvent sous la protection des collecteurs des impôts du marché. »82
En principe, aucun particulier n'avait le droit de vendre des produits industriels sur le marché des fermes collectives, à l'exception des artisans ruraux vendant leurs produits. Cependant, cette règle était extrêmement difficile à appliquer, en partie parce que les producteurs d’État utilisaient les marchés pour vendre leurs produits aux paysans. Cette pratique visait à encourager les paysans à amener les produits agricoles sur le marché, mais en même temps elle donnait aux spéculateurs la possibilité d'acheter des produits manufacturés et de les revendre à un prix plus élevé. Selon les journaux, en 1936 à Moscou, sur les marchés de Iaroslavl et de Dubininsky, les spéculateurs, « aussi bien les Moscovites que les visiteurs », battaient leur plein en vendant des pantoufles en caoutchouc, des galoches, des chaussures, des vêtements de confection et des disques de gramophone83.
RENCONTRES ET CONNEXIONS
Un habitant inquiet de Novgorod, Piotr Gatsuk, écrivit en 1940 à A. Vychinski, vice-président du Conseil des commissaires du peuple, dénonçant un phénomène tel que le blat :
Un citoyen qui n'a pas de blat, affirme Gatsuk, est en réalité privé de ses droits :
« Ne pas avoir de copinage, c'est comme ne pas avoir de droits civiques, c'est comme être privé de tous droits... Si vous présentez une demande, tout le monde sera sourd, aveugle et muet. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose dans un magasin, vous avez besoin de blat. S'il est difficile, voire impossible, pour un passager d'obtenir un billet, grâce aux correspondances, c'est facile et simple. Si vous n’avez pas d’appartement, cela ne sert à rien d’aller au service du logement ou au parquet : un peu d’argent et vous aurez tout de suite un appartement. »84
Blat porte atteinte au principe de distribution planifiée dans une économie socialiste ; il est « étranger et hostile à notre société », a conclu Gatsuk. Malheureusement, dans ce moment il n'est pas puni par la loi. Gatsuk a proposé de le déclarer comme une infraction pénale entraînant des sanctions spéciales (Vychinski, avocat de formation, ou quelqu'un de son cabinet a souligné ce passage).
Gatsuk n’était pas le seul à croire que la vie en URSS était impossible sans copinage. « Le mot clé, le plus important dans la langue, était le mot « blat » », a écrit le journaliste britannique Edward Crankshaw à propos de la fin de la période stalinienne. - Sans le copinage approprié, il était impossible d'obtenir un billet de train de Kiev à Kharkov, de trouver un logement à Moscou ou à Leningrad, d'acheter des lampes pour la radio, de trouver un réparateur de toiture, d'interviewer un fonctionnaire du gouvernement... Pendant de nombreuses années, [blat ] était le seul moyen d'obtenir ce dont vous aviez besoin "85.
Gatsuk n’était pas le seul à considérer le blat comme quelque chose de pathologique, complètement inapproprié et étranger à la société russe. En 1935, un dictionnaire soviétique faisant autorité classait le mot « blat » comme « l’argot des voleurs » utilisé par les criminels, ajoutant que le nouveau vulgarisme familier « par blat » signifiait « par des moyens illégaux »86. Les personnes interrogées dans le cadre du Harvard Refugee Interview Project d’après-guerre, s’éloignant autant que possible du mot et de la pratique qu’il désigne, ont déclaré que « blat » est « une insulte soviétique ».
in », « un mot d'origine populaire, jamais trouvé dans la littérature », « un mot généré par un mode de vie anormal », et s'est excusé pour son utilisation (« Désolé, mais je vais devoir recourir au jargon soviétique... »). « Blat » est la même chose que la corruption, disaient certains ; « Blat » est le favoritisme ou le favoritisme. Il y avait une abondance d'euphémismes pour blat : « blat signifie connaissance » ; « blat... dans la société polie, on l'appelait « la lettre z » (du mot « familier ») » ; Blat était également appelé « zis », abréviation de « connaissance et connexion »87.
Blat peut être défini comme un système de relations associées à l’échange de biens et de faveurs, égales et non hiérarchiques, par opposition aux relations de patronage. Selon les participants à ces relations, elles étaient fondées sur l'amitié, même si l'argent changeait parfois de mains. Ainsi, de leur point de vue, le proverbe russe « une main se lave la main » était une parodie grossière du véritable respect personnel et des sentiments chaleureux qu’ils associaient aux actes des « voleurs ». Une bien meilleure idée du copinage a été donnée (comme le croyaient les participants à de telles relations) par un autre proverbe cité par l'un des répondants du projet Harvard : « Comme on dit en Union soviétique : « N'ayez pas 100 roubles, mais ayez 100 amis. »88.
Seule une petite partie des personnes interrogées dans le cadre du projet Harvard ont manifesté le désir de parler de leurs propres « affaires de voleurs »89 et, ce faisant, elles ont toujours parlé spécifiquement d’amitié et ont souligné le facteur humain des relations de « voleurs ». Les « amis » comptent beaucoup en Union soviétique, a déclaré une femme qui a manifestement beaucoup utilisé ses relations, car ils s’entraident. En réponse à une question hypothétique sur ce qu'elle ferait si elle avait des problèmes, elle a dressé le portrait d'une communauté solidaire composée de famille, d'amis et de voisins : « Ma famille... avait des amis qui pouvaient m'aider... Un... ... était à la tête d'un grand trust. Il nous aidait souvent et se tournait lui-même vers nous s'il avait besoin d'aide. C'était notre voisin... Un de mes proches était ingénieur en chef dans une usine. Il pouvait toujours aider si on le lui demandait. »90.
L’ancien ingénieur, devenu essentiellement un véritable spécialiste du copinage en tant que fournisseur du trust sucrier, utilisait constamment le mot « ami » : « Je me fais facilement des amis, mais en Russie, on ne peut rien faire sans amis. J'étais ami avec plusieurs communistes éminents. L'un d'eux m'a conseillé d'aller à Moscou, où il avait un ami qui venait d'être nommé responsable de la construction de nouvelles sucreries... Je suis allé lui parler et autour d'un tout puissant verre de vodka nous sommes devenus amis. Il se lie d'amitié non seulement avec ses supérieurs, mais aussi avec les responsables provinciaux de l'approvisionnement avec lesquels il traite : « J'ai invité le directeur à déjeuner avec moi, je lui ai donné de la vodka. Nous sommes devenus bons amis... Mon patron a vraiment apprécié ça
la capacité de se faire des amis et d’obtenir le matériel nécessaire »91.
La consommation d'alcool était un aspect important des relations de « voleurs » entre hommes. Pour le répondant cité ci-dessus, boire et se faire des amis étaient inextricablement liés ; en outre, boire, au moins parfois, facilitait clairement les conversations à cœur ouvert, comme par exemple lors de sa première rencontre avec son futur patron à la sucrerie, lorsqu'il essayait de savoir dans quelle mesure il comprenait son travail et admettait que « Il y a quelques années, je ne savais même pas de quoi on faisait le sucre. » Certes, cette personne interrogée parlait parfois de boire davantage comme moyen d'atteindre un objectif : « généralement, cela fonctionne », a-t-il noté avec désinvolture, décrivant une de ces réunions amicales avec de la vodka. D'autres répondants ont également déclaré que La meilleure façon pour réaliser quelque chose ou résoudre un problème, apportez une bouteille de vodka à quelqu'un qui peut vous aider. Cependant, la vodka n'était pas qu'une offrande, il fallait la boire ensemble avant que l'affaire soit réglée – d'où l'expression « copains de beuverie », caractéristique des relations de « voleurs »92.
Certaines personnes étaient expertes en copinage. Vous pouvez résoudre n’importe quel problème, a déclaré un répondant de Harvard, si vous connaissez des « voleurs professionnels », « des gens qui ont des relations au sommet et qui connaissent le système soviétique. Ils savent à qui ils peuvent soudoyer ou offrir un cadeau, et quel type de cadeau. Un autre type de professionnalisme « blat » est capturé dans le récit d'un voyage d'approvisionnement (basé sur l'expérience réelle d'un juif polonais exilé au Kazakhstan pendant la guerre), qui présente des croquis de portraits d'un certain nombre de professionnels « blat » du secteur. , des gens gentils et généreux, qui étaient, selon la définition de l’auteur, « les membres… d’une communauté souterraine invisible de ceux dont les positions leur donnent la possibilité d’échanger des services avec d’autres membres »93.
Les « voleurs » professionnels ont servi de thème à un poème humoristique du poète populaire V. Lebedev-Kumach, publié en 1933 dans « Krokodil » et intitulé avec le jeu de mots « Blat-not » - faisant référence à un cahier spécial où les numéros de téléphone et les adresses des connaissances des « voleurs » sont en outre inscrites avec de mystérieux enregistrements cryptés comme les suivants : « L'ami de Peter (sanatorium) », « Sergey (disques, gramophone) », « Nick.Nick. (à propos de la bouffe). Le "code secret" indiquait au propriétaire du "blat-note" où il est préférable d'obtenir une aide qualifiée dans un cas particulier ("Appelez simplement - et dans une minute, il y aura "Nick.Nick" en ligne. " Il vous procurera tout ce dont vous avez besoin »). Le seul problème, dit le poème à la fin, est que l'association avec ces personnages louches peut éventuellement vous conduire à un interrogatoire par le parquet94.
Le fournisseur du trust sucrier, dont les propos ont été cités à plusieurs reprises ci-dessus, appartenait précisément à la catégorie des « voleurs » professionnels. Comme beaucoup d’autres, il aimait son travail : « J’adorais mon travail. C'était bien payé, j'avais beaucoup de relations, j'ai voyagé dans toute l'Union soviétique - les indemnités journalières et les attestations de voyage étaient très utiles - et en plus, j'étais satisfait de ce que j'avais accompli, car j'ai réussi là où d'autres ont échoué. Le plaisir de travailler était caractéristique des virtuoses du blat, des non-professionnels pour qui le blat était la vocation de l'âme. L'un de ces virtuoses était une personnalité très remarquable : exilé de Leningrad qui travaillait comme comptable dans une ferme collective, il était un touche-à-tout (il était un menuisier qualifié, fabriquant des caisses et des tonneaux), mais se considérait comme un représentant du intelligentsia. L'été, il louait des locataires et se liait surtout d'amitié avec le directeur d'un grand garage de Léningrad, avec qui il partait à la chasse et entretenait des relations régulières de « voleurs » (le bois de la forêt était échangé contre de la farine et du sucre de la ville). « Mon père était apprécié », se souvient son fils. - Il a bien travaillé, et en plus, il pouvait faire beaucoup de choses. Il aidait beaucoup de gens, aimait organiser les choses grâce à des relations et savait comment le faire. »95
Blat n'était pas du tout l'apanage des professionnels et des virtuoses. Certains des répondants au projet Harvard pensaient que les relations de « voleurs » ne sont possibles que pour les personnes plus ou moins riches : « Vous savez, personne n'aidera un pauvre. Il n'a rien à offrir en retour. Blat signifie généralement que vous, à votre tour, devez faire quelque chose pour quelqu'un. Cependant, ceux qui ont fait de telles déclarations, niant l'existence de liens avec des « voleurs » en eux-mêmes parce qu'ils étaient, disent-ils, des personnes trop insignifiantes pour cela, ont souvent raconté à un autre endroit de leurs entretiens certains épisodes de leur propre vie lorsqu'ils en substance, ils ont eu recours au copinage (obtenir un emploi ou obtenir une promotion grâce à leurs relations personnelles)96. De ces données et d’autres, il ressort apparemment que le principe de réciprocité pourrait être interprété de manière très large : si quelqu’un vous aimait simplement, cela pourrait déjà devenir la base d’une relation « criminelle ».
Les transactions par copinage dans la vie des personnes interrogées à Harvard, dont ils parlaient (généralement sans utiliser le mot « blat »), poursuivaient de nombreux objectifs : par exemple, obtenir un enregistrement ou de faux documents, un meilleur lieu de travail, des matériaux pour construire un appartement d'été. maison. Un grand nombre de ces transactions de « voleurs » étaient associées à l'acquisition de vêtements et de chaussures (« J'avais... une amie qui travaillait dans un grand magasin et j'achetais des vêtements par son intermédiaire », « Je connaissais une personne qui travaillait chez une usine de chaussures, un ami de ma femme ; j'ai donc réussi à me procurer mes chaussures bonne qualitéà bas prix »). Selon un répondant dont le père travaillait dans une coopérative
magasin, sa famille avait de si nombreux liens avec les « voleurs » que « nous avions toujours tout. Les costumes étaient très chers, même s'ils pouvaient être obtenus aux prix de l'État. Nous devions faire la queue pour acheter des chaussures uniquement parce que nous n’avions pas d’amis qui travaillaient dans des magasins de chaussures. »97
Le thème du copinage est apparu étonnamment souvent dans Krokodil, qui publiait sur ses pages des caricatures illustrant les procédures pour entrer dans une université, obtenir certificats médicaux, places dans de bonnes maisons de vacances et restaurants. « Pourquoi, mon pote, es-tu si souvent malade ? «Je connais le docteur», peut-on lire sous l'un des dessins animés. Une autre montre un vacancier et un médecin discutant sur le balcon d’une luxueuse maison de vacances. "Je suis ici depuis un mois et je n'ai pas encore vu le réalisateur", raconte le vacancier. « Quoi, tu ne le connais pas ? Alors, comment avez-vous obtenu cette chambre ? »98
L’une des caricatures de Krokodil illustre la tendance inhérente des mécanismes de distribution informels soviétiques à transformer toute relation bureaucratique formelle en relation personnelle. Il s'intitule « Good Mannering » et représente un gérant de magasin parlant poliment à un client. La caissière et une autre femme les regardent. « Notre directeur est une personne polie », explique le caissier. « Lors de la sortie du tissu, chaque acheteur est appelé par son nom et son patronyme. » - « Connaît-il vraiment tous les acheteurs ? » - "Certainement. Celui qu’il ne connaît pas, il ne le lâchera pas. »99
Les relations personnelles ont adouci les dures conditions de vie en URSS, du moins pour certains de ses citoyens. Ils ont également remis en question l'importance de la grande restructuration économique de Staline, créant une deuxième économie basée sur le clientélisme et les contacts personnels, parallèle à la première, socialiste, basée sur la propriété d'État et la planification centrale. En raison de la grave pénurie de biens, cette seconde économie était apparemment encore plus importante dans la vie des gens ordinaires que le secteur privé pendant la NEP, aussi paradoxal que cela puisse paraître.
Il est vrai que même pour les personnes ayant des relations, les désagréments sont devenus la norme inévitable La vie soviétique. Les citoyens ont passé de longues heures à faire la queue pour obtenir du pain et d’autres produits de première nécessité. Le trajet pour se rendre au travail et en revenir est devenu une torture : dans les grandes villes, les gens avec des sacs de courses essayaient de se faufiler dans les bus et les tramways bondés et tremblants, dans les petites villes, ils erraient dans des rues non pavées, couvertes de neige en hiver et couvertes de flaques d'eau au printemps et l'automne, qui rappelle davantage la mer. Beaucoup de petits plaisirs de la vie, comme les cafés et les magasins de quartier, ont disparu avec la fin de la NEP ; dans le cadre de la nouvelle centralisation
le système commercial d’État devait souvent se rendre au centre-ville pour faire réparer les chaussures. À la maison, dans les appartements collectifs et les casernes, la vie se passait dans un surpeuplement douloureux, sans confort et souvent empoisonnée par des querelles avec les voisins. Une source supplémentaire d'inconfort et d'irritation était la « semaine de travail continue », qui éliminait le repos le dimanche et conduisait souvent au fait que tous les membres de la famille avaient des jours de congé différents100.
Bien entendu, toutes ces difficultés, pénuries, inconvénients étaient des phénomènes période de transition- mais est-ce le cas ? Au fur et à mesure que les années 1930 avançaient, et notamment lorsque le niveau de vie baissait à nouveau à la fin de la décennie, beaucoup de gens ont dû se poser cette question. Il est vrai qu’au milieu des années 1930, la courbe a commencé à monter, et le déclin qui a suivi pourrait s’expliquer par la menace imminente de guerre. De plus, les privations du présent pourraient toujours être contrées par une vision d’un avenir socialiste abondant (ceci sera discuté dans le prochain chapitre). Selon un répondant de Harvard, il « pensait que toutes les difficultés étaient dues aux sacrifices nécessaires pour construire le socialisme, et qu’une fois qu’une société socialiste serait construite, la vie serait meilleure. »101
Mes 20 ans étaient un véritable cauchemar. En fait, tout aurait dû me rendre heureux : j'étais enfin libre - pas de parents, pas de professeurs. Je pouvais me déshabiller devant d'autres personnes, avec leur permission, bien sûr. Je pourrais trouver un travail, réaliser tous mes rêves. Mais rien n’a fonctionné, car à 20 ans, personne ne sait vraiment rien faire.
Trop tard, j’ai réalisé à quel point quatre années d’université étaient inutiles. Je suis même tombé dans le rouge : j’ai payé mes études, mais je n’ai rien gagné et je n’ai rien appris. De toute façon, les connaissances que j’ai acquises ne m’ont pas aidé à trouver un emploi. En plus, à 20 ans, j'étais pressé. Je voulais réussir le plus rapidement possible et trouver le travail de ma vie.
Quelqu’un m’a dit : « Le temps, c’est de l’argent ». Cela signifie que chaque opportunité manquée a son propre prix. Cette formule est souvent répétée dans les cours d’économie. Je les ai souvent sautés, mais je sais avec certitude que le temps n'est pas de l'argent. L'argent peut être dépensé et l'argent peut être gagné. Le temps ne peut être gagné ou acheté. Il n’existe pas de distributeur automatique de temps qui vous donnera quelques heures supplémentaires en échange de cinq dollars.
A 20 ans, je ne comprenais rien, mais je pensais tout savoir. Mais c'est normal. Quand j’avais 20 ans, j’ai choisi quelques cours et je les ai répétés jour après jour parce que je pensais que j’étais bon dans ce domaine. J'ai écrit et programmé. Je n'étais bon dans aucune de ces choses, mais petit à petit, j'ai commencé à m'améliorer parce que je les faisais tout le temps.
Conseils aux 20 ans. Choisissez trois à cinq activités et concentrez-vous sur elles. Choisissez uniquement ce que vous êtes prêt à faire chaque jour, encore et encore. N'attendez pas une révélation ou une percée. Fais-le c'est tout. J'aurais fait la même chose moi-même, mais il n'y avait personne pour me le dire.
30 ans
C'est aussi un cauchemar complet. L’idée d’acheter sa propre maison est autant un canular que l’université. Les deux sont des moyens légaux de vous endetter et de vous forcer à travailler. Le secteur du crédit regorge d’expressions telles que « L’immobilier est un investissement intelligent » ou « Il est temps de s’enraciner ». Une hypothèque vous lie à un seul endroit, prend tout votre argent et peut vous conduire au suicide.
À 30 ans, j’ai réalisé que je sous-estimais mon entourage. J'ai appris que les gens autour de moi sont aussi bons que moi
J'en ai marre de faire la même chose tous les jours. J'ai toujours senti que j'avais « presque réalisé quelque chose », « sur la bonne voie » et « je dois être encore un peu patient ». Et puis j'ai abandonné. A trente ans, j'ai appris à perdre. A 20 ans, je ne pouvais pas perdre. Tout le monde autour de moi était trop « idiot » et j’avais juste besoin d’un essai et d’un autre.
Mais à 30 ans, j’ai réalisé que je sous-estimais mon entourage. J’ai appris que les gens autour de moi sont aussi bons que moi et j’ai réalisé qu’on ne peut pas trouver une chose à faire tout au long de sa vie. Vous devrez poursuivre plusieurs objectifs à la fois, faire ce que non seulement vous, mais aussi ceux qui vous entourent.
Conseils aux 30 ans. Si vous communiquez avec les bonnes personnes et êtes engagé dans des projets intéressants, tôt ou tard l'un d'entre eux décollera. Ou, si vous avez de la chance, deux.

40 ans
C'est l'enfer absolu. Premièrement, vous ne pouvez plus manger ni être stressé. L’alimentation et le stress entraînent le vieillissement du corps. Mais bien sûr, vous devez manger, mais seulement la moitié de ce à quoi vous êtes habitué. Et vous ressentirez du stress. Mais vous devrez vous en occuper, sinon il vous tuera.
Pour manger moins et moins vous inquiéter, vous devez faire ce que vous aimez. Vous n’aurez alors plus à manger du stress. Une autre façon de moins s’inquiéter est d’arrêter d’accumuler des choses inutiles autour de soi.
À 20 ans, vous pensez savoir ce que vous faites. A 30 ans tu veux gagner plus d'argent
Dans la vingtaine et la trentaine, j'ai constamment commis des erreurs dans mes relations, en élevant des enfants, en dirigeant une entreprise, à peu près tout. Et j'étais terriblement inquiet à ce sujet. Mais maintenant, je m'en fiche, je ne m'inquiète plus. Il vaut mieux admettre ses erreurs que de s’en soucier constamment.
Conseils aux 40 ans.À 20 ans, vous pensez savoir ce que vous faites. À 30 ans, on veut juste gagner plus d’argent. A 40 ans, fais ce que tu aimes. Pour trouver une telle activité, souvenez-vous de ce que vous aimiez à 20 ans et consacrez-vous-y. N'en attendez pas trop.
50 ans
La femme a amené son fils à Gandhi et lui a demandé : « Gandhi, dis-lui d'arrêter de manger des sucreries. » Gandhi a répondu : « Revenez dans deux semaines. » La femme et son fils sont rentrés chez eux à des centaines de kilomètres. Deux semaines plus tard, ils revinrent à Gandhi. Et il dit au garçon : « Arrête de manger des sucreries. » La femme a demandé : « Gandhi, pourquoi nous as-tu fait aller et venir ? Pourquoi ne l’as-tu pas dit la première fois ?
Gandhi a répondu : « Avant de dire à votre fils d’arrêter de manger des sucreries, j’ai dû arrêter de manger des sucreries moi-même. »
Conseils aux 50 ans. Mais je ne sais encore rien de cet âge. Revenez dans quelques années.
A propos de l'auteur
Entrepreneur, a fondé plus de 20 entreprises, dont 17 ont été des échecs. Écrit des articles, des livres, des blogs et des podcasts. Son livre « J'étais aveugle, mais maintenant je vois » a été classé numéro un dans la section des livres de motivation d'Amazon.com en 2011.
Introduction
Une révolution radicale dans développement spirituel société, réalisée en URSS dans les années 20-30. XXe siècle, composant transformations socialistes. La théorie de la révolution culturelle a été développée par V.I. Lénine. La révolution culturelle et la construction d'un nouveau mode de vie socialiste visent à modifier la composition sociale de l'intelligentsia post-révolutionnaire et à rompre avec les traditions de l'intelligentsia pré-révolutionnaire. héritage culturelà travers l’idéologisation de la culture. La tâche de créer une soi-disant « culture prolétarienne » basée sur l’idéologie de classe marxiste, « l’éducation communiste » et la culture de masse est apparue au premier plan.
La construction d'un nouveau mode de vie socialiste comprenait l'élimination de l'analphabétisme et la création d'un système socialiste. éducation publique et l'éducation, la formation d'une nouvelle intelligentsia socialiste, la restructuration de la vie quotidienne, le développement de la science, de la littérature et de l'art sous le contrôle du parti. À la suite de la révolution culturelle de l'URSS, des succès significatifs ont été obtenus : selon le recensement de 1939, l'alphabétisation de la population a commencé à atteindre 70 % ; en URSS, une première classe école polyvalente, le nombre de l'intelligentsia soviétique a atteint 14 millions de personnes ; il y avait un épanouissement de la science et de l'art. En matière de développement culturel, l'URSS a atteint l'avant-garde mondiale.
Un trait distinctif de la période soviétique de l’histoire culturelle est le rôle énorme du parti et de l’État dans son développement. Le parti et l'État ont établi un contrôle total sur la vie spirituelle de la société.
Dans les années 20 et 30, un puissant changement culturel s’est sans aucun doute produit en URSS. Si la révolution sociale a détruit l'état semi-médiéval du pays, qui divisait la société en « peuple » et « sommets », alors les transformations culturelles au cours de deux décennies l'ont amené sur la voie d'une réduction du fossé civilisationnel dans la vie quotidienne de plusieurs dizaines d'habitants. des millions de personnes. En un laps de temps incroyablement court, les capacités matérielles des individus ont cessé de constituer une barrière significative entre eux et la culture au moins élémentaire ; l’inclusion dans celle-ci a commencé à dépendre beaucoup moins du statut socioprofessionnel des individus. Tant par leur ampleur que par leur rythme, ces changements peuvent en effet être considérés comme une « révolution culturelle » à l’échelle nationale.
Des changements importants se sont produits dans les années 20. dans la vie quotidienne de la population russe. La vie, en tant que mode de vie quotidien, ne peut être considérée pour l'ensemble de la population, car elle est différente selon les segments de la population. Les conditions de vie des couches supérieures de la société russe, qui, avant la révolution, occupaient les meilleurs appartements, consommaient une nourriture de haute qualité et bénéficiaient des avancées en matière d'éducation et de santé, se sont détériorées. Un principe strictement de classe de répartition des valeurs matérielles et spirituelles a été introduit, et les représentants des couches supérieures ont été privés de leurs privilèges. Certes, le gouvernement soviétique soutenait les représentants de la vieille intelligentsia dont il avait besoin à travers un système de rationnement, une commission chargée d'améliorer les conditions de vie des scientifiques, etc.
Au cours des années de la NEP, de nouvelles couches ont émergé et ont vécu prospèrement. Ce sont ceux qu'on appelle les Nepmen ou la nouvelle bourgeoisie, dont le mode de vie était déterminé par l'épaisseur de leur portefeuille. Ils ont eu le droit de dépenser de l’argent dans les restaurants et autres établissements de divertissement. Ces couches comprennent à la fois la nomenklatura du parti et celle de l’État, dont les revenus dépendaient de la manière dont ils exerçaient leurs fonctions. Le mode de vie de la classe ouvrière a sérieusement changé. C'était lui qui devait prendre une place de premier plan dans la société et bénéficier de tous les avantages. Du gouvernement soviétique, il a reçu les droits de Education gratuite et des soins médicaux, l'État a constamment augmenté ses salaires, lui a fourni une assurance sociale et des prestations de retraite et, par l'intermédiaire des écoles ouvrières, a soutenu son désir d'obtenir des études supérieures. Dans les années 20 l'État surveillait régulièrement les budgets des familles qui travaillaient et surveillait leur occupation. Cependant, les paroles différaient souvent des actes ; les difficultés matérielles frappaient principalement les travailleurs, dont les revenus dépendaient uniquement des salaires ; le chômage de masse pendant les années de la NEP et le faible niveau culturel ne permettaient pas aux travailleurs d'améliorer sérieusement leurs conditions de vie. En outre, de nombreuses expériences visant à inculquer des « valeurs socialistes », des communes de travail, des « chaudières communes » et des dortoirs ont affecté la vie des travailleurs.
La vie des paysans pendant les années de la NEP a légèrement changé. Les relations patriarcales au sein de la famille, le travail commun dans les champs de l'aube au crépuscule et le désir d'augmenter leur richesse caractérisaient le mode de vie de la majeure partie de la paysannerie russe. Elle est devenue plus prospère et un sentiment d’appartenance s’est développé. La paysannerie faible s'est unie en communes et en fermes collectives et a établi un travail collectif. La paysannerie était très préoccupée par la position de l’Église dans l’État soviétique, car elle y liait son avenir. La politique de l'État soviétique envers l'Église dans les années 20. n'était pas constant. Au début des années 20. La répression s'est abattue sur l'Église, les objets de valeur de l'Église ont été confisqués sous prétexte de la nécessité de lutter contre la faim. Puis une scission s'est produite au sein de l'Église orthodoxe elle-même sur la question de l'attitude envers le pouvoir soviétique et un groupe de prêtres a formé une « Église vivante », a aboli le patriarcat et a prôné le renouveau de l'Église. Sous le métropolite Serge, l'Église entra au service du pouvoir soviétique. L'État a encouragé ces nouveaux phénomènes dans la vie de l'Église et a continué à mener des répressions contre les partisans du maintien de l'ordre ancien dans l'Église. Dans le même temps, il menait une propagande antireligieuse active, créait un vaste réseau de sociétés et de périodiques antireligieux, introduisait des fêtes socialistes dans la vie du peuple soviétique par opposition aux fêtes religieuses et modifiait même la semaine de travail de sorte que les week-ends ne coïncidait pas avec les dimanches et les fêtes religieuses.
DneproGES, 1934.
Contrairement aux histoires d'horreur qui sont aujourd'hui écrites à cette époque, c'est dans les années d'avant-guerre qu'il existait une symphonie de pouvoir et de personnes que l'on ne rencontre pas souvent dans la vie. Le peuple, inspiré par la grande idée de construire la première société juste de l’histoire de l’humanité, sans oppresseurs ni opprimés, a fait des miracles d’héroïsme et d’altruisme. Et l’État de ces années-là, aujourd’hui décrit par nos historiens et publicistes libéraux comme une monstrueuse machine répressive, répondait au peuple en prenant soin de lui.
La médecine et l'éducation gratuites, les sanatoriums et les maisons de repos, les camps de pionniers, les jardins d'enfants, les bibliothèques, les clubs sont devenus un phénomène de masse et étaient accessibles à tous. Ce n'est pas un hasard si pendant la guerre, selon des témoins oculaires, les gens ne rêvaient que d'une seule chose : que tout redevienne comme avant la guerre.
C’est par exemple ce qu’écrivait l’ambassadeur des États-Unis à cette époque, en 1937-1938. Joseph E. Davis :
« Avec un groupe de journalistes américains, j'ai visité cinq villes, où j'ai inspecté les plus grandes entreprises :
usine de tracteurs (12 000 travailleurs), - usine de moteurs électriques (38 000 travailleurs), Dneproges, - usine d'aluminium (3 000 travailleurs), considérée comme la plus grande au monde, Zaporizhstal (35 000 travailleurs), hôpital (18 médecins et 120 infirmières), crèches et jardins d'enfants, l'usine de Rostselmash (16 000 ouvriers), le Palais des Pionniers (un bâtiment de 280 chambres pour 320 enseignants et 27 000 enfants).
Cette dernière de ces institutions représente l’un des phénomènes les plus intéressants de l’Union soviétique. Des palais similaires sont en construction dans toutes les grandes villes et sont destinés à donner vie au slogan stalinien selon lequel les enfants sont le bien le plus précieux du pays. Ici, les enfants découvrent et développent leurs talents... »
Et tout le monde était sûr que son talent ne se fanerait pas et ne serait pas gaspillé, qu'il avait toutes les chances de réaliser n'importe quel rêve dans tous les domaines de la vie.
Les portes du secondaire et lycée. Les ascenseurs sociaux ont fonctionné à pleine capacité, élevant les ouvriers et les paysans d'hier aux sommets du pouvoir, leur ouvrant les horizons de la science, la sagesse de la technologie et la scène de la scène.
"Dans la vie quotidienne des grands projets de construction", un nouveau pays, sans précédent au monde, naissait - "un pays de héros, un pays de rêveurs, un pays de scientifiques".
Et afin de détruire toute possibilité d'exploitation d'une personne - qu'il s'agisse d'un propriétaire privé ou de l'État - les tout premiers décrets de l'URSS ont introduit la journée de travail de huit heures.
En outre, une journée de travail de six heures a été instaurée pour les adolescents, le travail des enfants de moins de 14 ans a été interdit, une protection du travail a été instaurée et une formation professionnelle pour les jeunes a été introduite aux frais de l'État.
Alors que les États-Unis et les pays occidentaux étouffaient sous l'emprise de la Grande Dépression, en Union soviétique en 1936, 5 millions de travailleurs avaient une journée de travail réduite de six heures ou plus, près de 9 % des ouvriers industriels prenaient un jour de congé après quatre jours. du travail, 10% des travailleurs, Ceux employés dans la production continue ont reçu deux jours de congé après trois journées de travail de huit heures.
Les salaires des ouvriers et des employés de bureau, ainsi que les revenus personnels des kolkhoziens, ont plus que doublé. Les adultes ne s'en souviennent probablement plus, et les jeunes ne savent même pas que pendant la Grande Guerre patriotique, certains kolkhoziens ont fait don au front d'avions et de chars, construits avec leurs économies personnelles qu'ils ont réussi à accumuler en peu de temps. adoptée après la collectivisation « criminelle ». Comment ont-ils fait ça `?
Le fait est que le nombre de journées de travail obligatoires pour les « esclaves libres » dans les années trente était de 60 à 100 (selon les régions). Après cela, le kolkhozien pouvait travailler pour lui-même - sur sa parcelle ou dans une coopérative de production, qui comptait grande quantité dans toute l'URSS. Comme l'écrit le créateur du site Internet Russian Project, le publiciste Pavel Krasnov : « … Dans l'URSS stalinienne, ceux qui voulaient faire preuve d'initiative personnelle avaient toutes les chances de le faire dans le mouvement coopératif. Il était tout simplement impossible de recourir à la main-d'œuvre salariée, à la main-d'œuvre contractuelle et coopérative - autant que l'on voulait.
Il y avait un puissant mouvement coopératif dans le pays ; près de 2 millions de personnes travaillaient constamment dans des coopératives, produisant 6 % de la production industrielle brute de l'URSS : 40 % de tous les meubles, 70 % de tous les ustensiles métalliques, 35 % des vêtements d'extérieur, presque 100% de jouets.
En outre, le pays comptait 100 bureaux d'études coopératifs, 22 laboratoires expérimentaux et deux instituts de recherche. Cela n'inclut pas les artels ruraux coopératifs à temps partiel. Dans les années 1930, jusqu'à 30 millions de personnes y travaillaient.
Il était possible de s'engager dans un travail individuel - par exemple, avoir sa propre chambre noire, en payant des impôts, les médecins pouvaient avoir un cabinet privé, etc. Les coopératives regroupaient généralement des professionnels hautement qualifiés dans leur domaine, organisés en structures efficaces, ce qui explique leur forte contribution à la production de l'URSS.
Tout cela a été liquidé par Khrouchtchev à un rythme accéléré depuis 1956 - les biens des coopératives et des entrepreneurs privés ont été confisqués, même les fermes privées et le bétail privé.»
Ajoutons qu'à la même époque, en 1956, le nombre de journées de travail obligatoires fut porté à trois cents. Les résultats ne se sont pas fait attendre : les premiers problèmes avec les produits sont immédiatement apparus.
Dans les années trente, le salaire aux pièces était également largement utilisé. Des bonus supplémentaires ont été pratiqués pour la sécurité des mécanismes, les économies d'électricité, de carburant, de matières premières, de matériaux. Des primes ont été introduites pour le dépassement du plan, la réduction des coûts et la production de produits de qualité améliorée. Un système bien pensé de formation de travailleurs qualifiés dans l'industrie et l'agriculture a été mis en place. Rien qu'au cours des années du deuxième plan quinquennal, environ 6 millions de personnes ont été formées au lieu des 5 millions prévues par le plan.
Enfin, en URSS, pour la première fois au monde, le chômage a été éliminé - le plus difficile et le plus insoluble dans les conditions du capitalisme de marché. problème social. Le droit au travail, inscrit dans la Constitution de l’URSS, est devenu une réalité pour chacun. Déjà en 1930, lors du premier plan quinquennal, les bourses du travail cessèrent d'exister.
Parallèlement à l'industrialisation du pays, avec la construction de nouvelles usines et usines, la construction de logements a également été réalisée. Les entreprises et organisations d'État et coopératives, les fermes collectives et la population ont mis en activité 67,3 millions. mètres carrés superficie utile des habitations. Avec l'aide de l'État et des fermes collectives, les ouvriers ruraux ont construit 800 000 maisons.
Les investissements de l'État et des organisations coopératives dans la construction de logements, ainsi que dans les investissements individuels, ont augmenté de 1,8 fois par rapport au premier plan quinquennal. Les appartements, on s'en souvient, étaient fournis gratuitement au loyer le plus bas du monde. Et probablement, peu de gens savent qu’au cours du deuxième plan quinquennal, presque autant d’argent a été investi dans le logement, la construction communale et culturelle et dans les soins de santé dans une Union soviétique en développement rapide que dans l’industrie lourde.
En 1935, le meilleur métro du monde en termes d'équipement technique et de conception artistique entre en service. À l'été 1937, le canal Moscou-Volga est mis en service, résolvant le problème de l'approvisionnement en eau de la capitale et améliorant ses liaisons de transport.
Dans les années 1930, non seulement des dizaines de nouvelles villes se sont développées dans le pays, mais l'approvisionnement en eau a été construit dans 42 villes, des systèmes d'égouts ont été construits dans 38, le réseau de transport s'est développé, de nouvelles lignes de tramway ont été lancées, la flotte de bus s'est développée et les trolleybus ont été créés. a commencé à être introduit.
Au cours des plans quinquennaux d'avant-guerre dans le pays, pour la première fois dans la pratique mondiale, formes sociales de consommation populaire, qui, en plus des salaires, étaient utilisés par chaque famille soviétique. Leurs fonds ont été utilisés pour la construction et l'entretien de logements, d'institutions culturelles et sociales, l'éducation et les soins médicaux gratuits, pour diverses pensions et prestations. Les dépenses de sécurité sociale et d'assurance sociale ont triplé par rapport au premier plan quinquennal.
Le réseau de sanatoriums et de maisons de repos s'est rapidement développé, dont les bons, achetés avec les caisses d'assurance sociale, étaient distribués par les syndicats aux ouvriers et employés gratuitement ou à des conditions préférentielles. Au cours de la seule deuxième période quinquennale, 8,4 millions de personnes se sont reposées et ont été soignées dans des maisons de repos et des sanatoriums ; les dépenses pour l'entretien des enfants dans les crèches et les jardins d'enfants ont augmenté de 10,7 fois par rapport au premier plan quinquennal. L'espérance de vie moyenne a augmenté.
Un tel État ne pouvait qu'être perçu par le peuple comme le sien, national, cher, pour lequel il n'est pas dommage de donner sa vie, pour lequel on veut accomplir des exploits... Comme l'incarnation de ce rêve révolutionnaire de le pays promis, où la grande idée du bonheur des gens prenait vie visiblement, sous leurs yeux. Il était d’usage de se moquer des paroles de Staline « La vie est devenue meilleure, la vie est devenue plus amusante » pendant les années de perestroïka et post-perestroïka, mais elles reflétaient de réels changements dans la vie sociale et économique de la société soviétique.
Ces changements ne pouvaient passer inaperçus en Occident. Nous sommes déjà habitués au fait qu'on ne peut pas faire confiance à la propagande soviétique et que la vérité sur la situation dans notre pays n'est révélée qu'en Occident. Eh bien, voyons comment les capitalistes ont évalué les succès de l'État soviétique.
Ainsi, Gibbson Jarvie, président de la United Dominion Bank, déclarait en octobre 1932 :
"Je tiens à préciser que je ne suis ni communiste ni bolchevik, je suis un capitaliste et un individualiste convaincus... La Russie avance alors que trop de nos usines sont inactives et qu'environ 3 millions de nos citoyens recherchent désespérément travail. Le plan quinquennal a été ridiculisé et prédit son échec. Mais on peut considérer comme certain qu'aux termes du plan quinquennal, plus de choses ont été faites que prévu...
Dans toutes les villes industrielles que j'ai visitées, de nouveaux quartiers émergent, construits selon un plan précis, avec de larges rues, ornées d'arbres et de places, avec des maisons des plus modernes. type moderne, les écoles, les hôpitaux, les clubs ouvriers et les inévitables crèches et jardins d'enfants où sont gardés les enfants des mères qui travaillent...
N'essayez pas de sous-estimer les projets russes et ne commettez pas l'erreur d'espérer que le gouvernement soviétique puisse échouer... La Russie d'aujourd'hui est un pays avec une âme et un idéal. La Russie est un pays d’une activité étonnante. Je crois que les aspirations de la Russie sont saines...
Le plus important est peut-être que tous les jeunes et tous les travailleurs de Russie ont une chose qui, malheureusement, manque aujourd’hui aux pays capitalistes : l’espoir.».
Et voici ce que le magazine Forward (Angleterre) écrivait dans le même 1932 :
« L’énorme travail réalisé en URSS est frappant. Nouvelles usines, nouvelles écoles, nouveau cinéma, nouveaux clubs, nouvelles immenses maisons – de nouveaux bâtiments partout. Beaucoup d'entre eux sont déjà terminés, d'autres sont encore entourés de forêts. Il est difficile de dire au lecteur anglophone ce qui a été fait au cours des deux dernières années et ce qui sera fait ensuite. Il faut tout voir pour le croire.
Nos propres réalisations que nous avons accomplies pendant la guerre ne sont qu'une bagatelle comparées à ce qui se fait en URSS. Les Américains admettent que même pendant la période de fièvre créatrice la plus rapide dans les États occidentaux, il n'y avait rien de comparable à l'activité créatrice fébrile actuelle en URSS. Au cours des deux dernières années, tant de changements se sont produits en URSS qu’on refuse même d’imaginer ce qui se passera dans ce pays dans dix ans.
Jetez de votre tête les histoires d'horreur fantastiques racontées par les journaux anglais, qui mentent de manière si obstinée et absurde sur l'URSS. Jetez également hors de votre tête toute cette vérité sans enthousiasme et ces impressions fondées sur des malentendus, qui sont mises en pratique par des intellectuels amateurs qui regardent l'URSS avec condescendance à travers les yeux de la classe moyenne, mais n'ont pas la moindre idée de ce qui s'y passe : l'URSS construit une nouvelle société sur des bases saines
Pour atteindre cet objectif, il faut prendre des risques, il faut travailler avec un enthousiasme, avec une énergie que le monde n'a jamais connue auparavant, il faut lutter contre les énormes difficultés qui sont inévitables lorsqu'on essaie de construire le socialisme dans un vaste pays isolé du reste. du monde. Après avoir visité ce pays pour la deuxième fois en deux ans, j'ai eu l'impression qu'il avance sur la voie du progrès, de la planification et de la construction, et tout cela à une échelle qui constitue un défi évident au monde capitaliste hostile.
La « Nation » américaine a fait écho à cet avan- tage :
« Quatre années du Plan quinquennal ont apporté des réalisations vraiment remarquables. Union soviétique a travaillé avec l'intensité de la guerre sur la tâche créative de construire une vie de base. Le visage du pays change littéralement au point de devenir méconnaissable : c'est le cas de Moscou avec ses centaines de rues et de places nouvellement pavées, ses nouveaux bâtiments, ses nouvelles banlieues et son cordon de nouvelles usines à sa périphérie. Cela est également vrai pour les petites villes.
De nouvelles villes sont apparues dans les steppes et les déserts, au moins 50 villes avec une population allant de 50 000 à 250 000 habitants. Tous sont apparus au cours des quatre dernières années, chacun étant le centre d'une nouvelle entreprise ou d'une série d'entreprises créées pour exploiter les ressources nationales. Des centaines de nouvelles centrales électriques et un certain nombre de géants, comme Dneprostroy, incarnent constamment la formule de Lénine : « Le socialisme, c’est le pouvoir soviétique plus l’électrification ».
L'Union soviétique a organisé la production de masse nombre infini des articles que la Russie n'a jamais produits auparavant : tracteurs, moissonneuses-batteuses, aciers de haute qualité, caoutchouc synthétique, roulements à billes, moteurs diesel puissants, turbines de 50 000 kilowatts, équipements téléphoniques, machines électriques pour l'industrie minière, les avions, les voitures, les vélos et plusieurs centaines de nouveaux types de machines.
Pour la première fois dans l'histoire, la Russie extrait de l'aluminium, de la magnésite, de l'apatite, de l'iode, de la potasse et de nombreux autres produits précieux. Les points de repère des plaines soviétiques ne sont plus les croix et les coupoles d'églises, mais les silos à grains et les silos. Les fermes collectives construisent des maisons, des granges et des porcheries. L'électricité pénètre dans le village, la radio et les journaux l'ont conquis. Les travailleurs apprennent à utiliser les dernières machines. Les garçons de ferme produisent et entretiennent des machines agricoles plus grandes et plus complexes que tout ce que l’Amérique a jamais vu. La Russie commence à « penser avec des machines ». La Russie passe rapidement de l’ère du bois à l’ère du fer, de l’acier, du béton et des moteurs.»
C'est ainsi que les Britanniques et les Américains parlaient avec fierté de l'URSS dans les années 30, enviant au peuple soviétique- à nos parents.
Il est facile d’imaginer la vie en Union soviétique dans les années 1930 à partir des films et des souvenirs de ses proches. Il est clair qu’à cette époque, dans le pays, tout était pour la plupart très rare. Mais ensuite il y a eu une période de construction, d’enthousiasme, de reconstruction après la dévastation post-révolutionnaire…
Comment était la vie dans les années 30 dans les autres pays ? Était-ce si différent ?
1937, États-Unis. Une maison parmi les bidonvilles. Tout est très pauvre, mais les murs sont recouverts de papier peint en papier journal et même un rideau est fait d'un journal découpé au sens figuré.

1937, Tchécoslovaquie. Sans les vêtements, il serait difficile de nommer le pays sur la photo

1937, États-Unis. Femme devant une maison dans la région métropolitaine de Washington, D.C.

1933, Royaume-Uni. Une famille anglaise ordinaire, même nombreuse selon les normes modernes

1936, États-Unis. Mère avec enfants en Californie

1932, France. Un homme trie les déchets dans la « capitale du monde » Paris

1938, Pologne. Une cabane dans laquelle vit une grande famille polonaise

Un couple de personnes âgées dans une cabane. États-Unis, 1937

1937, États-Unis. Et voici l'autre pôle, un style, un niveau de vie complètement différent. Il s'agit d'un dîner de famille pour le maire de la ville de Mansi et son épouse