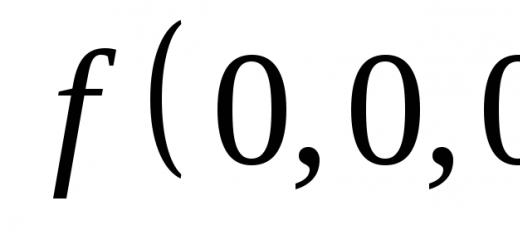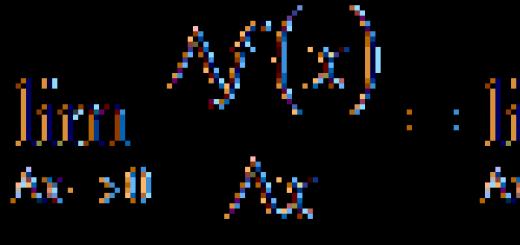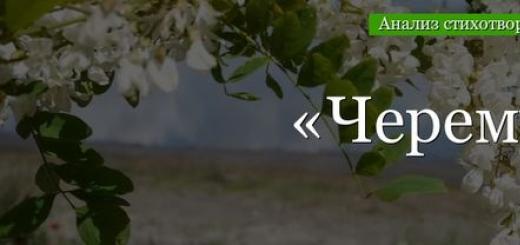Réflectance superficielle. Réflectance moyenne pondérée des surfaces intérieures d'une pièce. Transmission.
La propriété la plus importante de la surface d'un objet, qui détermine sa couleur et sa luminosité, est la réflectance de la surface à différentes fréquences : dans le domaine visible, infrarouge et radio. Réflectance superficielle(p) caractérise la capacité d'une surface à réfléchir le flux lumineux incident sur elle ; déterminé par le rapport entre le flux lumineux réfléchi par la surface et le flux lumineux incident sur celle-ci
Coefficient de réflexion moyen pondéré des surfaces internes de la pièce (p Épouser ) où S st, S sueur, S sol sont respectivement les surfaces des murs, du plafond et du sol, m 2 et P st, P sueur, P sol sont respectivement les coefficients de réflexion des murs, du plafond et du sol.
transmission,- le rapport du flux lumineux traversant la couche sur le flux lumineux incident sur la couche : τ = F/F. La transmittance est une mesure de la transparence d'une couche. En fonction de la nature du changement du faisceau lors du passage à travers la couche, la transmission est divisée en transmission directionnelle, diffusée, diffusée directionnellement et mixte. Il est bien évident que le coefficient de transmission est toujours inférieur à l'unité, puisque tous les corps absorbent plus ou moins la lumière qui les traverse et l'absorption est d'autant plus grande que la couche est épaisse.
3. Éclairage naturel keo
Qu'est-ce que le facteur de lumière du jour (DLC) ?
Il s'agit du rapport de l'éclairement naturel E B exprimé en pourcentage en tout point de la surface de travail à l'intérieur à la valeur simultanée de l'éclairement horizontal externe E n créé par la lumière diffuse d'un ciel complètement ouvert. e = E dans / E n *100 %
KEO montre quelle proportion de l'éclairage en un point donné de la pièce provient de l'éclairage simultané d'une surface horizontale dans un lieu ouvert avec une lumière du ciel diffuse
Quels facteurs influencent les valeurs du coefficient de lumière naturelle au point calculé de la pièce ?
Luminosité inégale du ciel
Effet du vitrage des ouvertures de fenêtres
Améliorer l'éclairage avec la lumière réfléchie
4. Normalisation du facteur de lumière naturelle.
De quels facteurs dépend la valeur standard du facteur de lumière naturelle ?
Outre la destination de la pièce (la nature du travail visuel effectué dans la pièce), lors de la normalisation de l'éclairage naturel, le climat lumineux de la zone de construction est également pris en compte (c'est-à-dire les conditions dominantes d'éclairage extérieur, la quantité de la lumière solaire, la stabilité du manteau neigeux) et l'orientation de la lumière s'ouvrant sur les côtés de l'horizon. Pour cette raison, la valeur normalisée de KEO est déterminée par la formule

Principes de normalisation du coefficient d'éclairement naturel.

5. Kéos géométriques

Le principe du calcul du KEO géométrique
Seule la lumière diffuse du ciel est prise en compte et les conditions réelles d'éclairement ne sont pas prises en compte : irrégularités, luminosité du ciel, influence des vitrages des ouvertures des fenêtres, lumière réfléchie. Déterminé à l'aide du groupe Danilyuk. Lors de la construction, le ciel est représenté sous la forme d'un hémisphère uniformément brillant avec un centre au point calculé ; la surface sphérique lumineuse du ciel est divisée en 10 4 sections dont les zones de projections sur la surface horizontale de la base sont identiques. Un rayon part de chaque section du ciel jusqu'au point calculé. Illumination en un point de l'horizon. presque le plan d'ouverture du firmament E n correspond à 10 4 rayons. A l'intérieur de la pièce, E in correspond au nombre de rayons N entrant par l'ouverture lumineuse.

Procédure de calcul (selon le Danilyuk gr.):
Dessiner un plan et une coupe à la même échelle
Déterminez la position du point de conception et du plan.
Sur la coupe, reliez le point calculé aux bords de l'ouverture lumineuse à travers laquelle la sphère céleste est visible
A l'aide du groupe 1, déterminez le nombre de rayons ; pour cela alignez le point calculé avec le pôle du graphique, le plan calculé avec l'axe horizontal du visage. À l’aide de rayons, comptez les distances entre les lignes pleines. Les lignes pointillées sur le graphique représentent les 1er au 10ème lobes du rayon.
Placez le point C en divisant la zone en deux.
À l'aide du groupe 1, déterminez le numéro du demi-cercle passant près du point C.
Sur le plan (2ème graphique) placer l'axe vertical du graphique coïncidant avec la section caractéristique calculée.
Le numéro de la ligne horizontale correspond au numéro du demi-cercle, aligné avec le bord extérieur.
Déterminer le nombre de rayons
Nous calculons le coefficient géométrique de l'éclairage naturel
Le graphique de Danilyuk est superposé à la section transversale du bâtiment, le centre du graphique est aligné avec le point. on compte le nombre de rayons n1, on note le numéro du demi-cercle qui passe par le point C qui est le milieu de l'ouverture lumineuse. L'annexe 2 est superposée au plan. Son axe coïncide avec l'horizon et passe par le point C. A l'aide du numéro du demi-cercle, on compte le nombre de rayons passant par l'ouverture lumineuse.
Calculé par gr. Danilyuk KEO coïncide avec celui calculé, si le ciel est uniformément lumineux, il n'y a pas de remplissage dans l'ouverture lumineuse (cadres, verre, etc.), la couche de sol sous-jacente et les surfaces de la pièce sont complètement noires.
Cartes Danilyuk
Chaque parcelle contient 100 rayons. Les rayons sont numérotés à partir de l’axe du graphique dans les deux sens. La poutre est l'espace entre les lignes pleines. Les lignes pointillées sur le graphique représentent le 1er au 10ème lobe du rayon (50). Chaque arc (demi-cercle) du graphique 1 correspond à une ligne horizontale (ligne horizontale) du graphique 2. Les arcs et les lignes horizontales des graphiques sont numérotés. Conçu sur la base de la loi de l'angle solide.
Coefficient de reflexion- grandeur physique sans dimension caractérisant la capacité d'un corps à réfléchir le rayonnement incident sur lui. Le grec est utilisé comme désignation de lettre ou latin .
Définitions
Quantitativement, le coefficient de réflexion est égal au rapport du flux de rayonnement réfléchi par le corps au flux incident sur le corps :
La somme du coefficient de réflexion et des coefficients d'absorption, de transmission et de diffusion est égale à l'unité. Cette affirmation découle de la loi de conservation de l’énergie.
Dans les cas où le spectre du rayonnement incident est si étroit qu'il peut être considéré comme monochromatique, on parle de monochromatique coefficient de reflexion. Si le spectre du rayonnement incident sur un corps est large, alors le coefficient de réflectance correspondant est parfois appelé intégral.
DANS cas général la valeur de la réflectance d'un corps dépend à la fois des propriétés du corps lui-même et de l'angle d'incidence, de la composition spectrale et de la polarisation du rayonnement. En raison de la dépendance de la réflectance de la surface d'un corps sur la longueur d'onde de la lumière qui l'arrive, le corps est visuellement perçu comme coloré d'une couleur ou d'une autre.
Coefficient de réflexion spéculaire
Caractérise la capacité des corps à refléter le rayonnement incident sur eux. Déterminé quantitativement par le rapport du flux de rayonnement réfléchi spéculairement au ruisseau qui tombe :
La réflexion spéculaire (directionnelle) se produit dans les cas où le rayonnement tombe sur une surface dont les irrégularités sont nettement inférieures à la longueur d'onde du rayonnement.
Réflexion diffuse
Caractérise la capacité des corps à réfléchir de manière diffuse les rayonnements qui les frappent. Déterminé quantitativement par le rapport du flux de rayonnement réfléchi de manière diffuse au ruisseau qui tombe :
Si les réflexions spéculaires et diffuses se produisent simultanément, alors la réflectance est la somme des coefficients miroir et diffuse réflexions :
voir également
Donnez votre avis sur l'article "Réflectance (optique)"
Remarques
Extrait caractérisant la Réflectance (optique)
- Oh, Natacha ! - dit-elle.- L'as-tu vu? L'as-tu vu? Qu'as-tu vu? – a crié Natasha en levant le miroir.
Sonya n'a rien vu, elle voulait juste cligner des yeux et se lever quand elle a entendu la voix de Natasha dire « définitivement »... Elle ne voulait tromper ni Dunyasha ni Natasha, et c'était difficile de s'asseoir. Elle-même ne savait pas comment ni pourquoi un cri lui échappait lorsqu'elle se cachait les yeux avec sa main.
- L'avez-vous vu? – a demandé Natasha en lui saisissant la main.
- Oui. Attends... je... l'ai vu », dit involontairement Sonya, ne sachant pas encore qui Natasha voulait dire par le mot « lui » : lui - Nikolai ou lui - Andrey.
« Mais pourquoi ne devrais-je pas dire ce que j’ai vu ? Après tout, les autres voient ! Et qui peut me convaincre de ce que j’ai vu ou n’ai pas vu ? a traversé la tête de Sonya.
«Oui, je l'ai vu», dit-elle.
- Comment? Comment? Est-il debout ou couché ?
- Non, j'ai vu... Puis il n'y a plus rien, tout d'un coup je vois qu'il ment.
– Andreï est allongé ? Il est malade? – a demandé Natasha en regardant son amie avec des yeux craintifs et arrêtés.
- Non, au contraire, - au contraire, un visage joyeux, et il s'est tourné vers moi - et à ce moment-là, pendant qu'elle parlait, il lui sembla voir ce qu'elle disait.
- Alors, Sonya ?...
– Je n'ai pas remarqué quelque chose de bleu et de rouge ici...
- Sonya ! quand reviendra-t-il ? Quand je le vois ! Mon Dieu, comme j'ai peur pour lui et pour moi, et pour tout ce que j'ai peur... » Natacha parla, et sans répondre un mot aux consolations de Sonya, elle se coucha et longtemps après que la bougie fut éteinte. , les yeux ouverts, elle s'allongeait immobile sur le lit et regardait le clair de lune glacial à travers les fenêtres gelées.
Peu de temps après Noël, Nikolai a annoncé à sa mère son amour pour Sonya et sa ferme décision de l'épouser. La comtesse, qui avait remarqué depuis longtemps ce qui se passait entre Sonya et Nikolai et attendait cette explication, écouta silencieusement ses paroles et dit à son fils qu'il pouvait épouser qui il voulait ; mais que ni elle ni son père ne lui donneraient sa bénédiction pour un tel mariage. Pour la première fois, Nikolaï sentit que sa mère n'était pas contente de lui, que malgré tout son amour pour lui, elle ne céderait pas à lui. Elle, froidement et sans regarder son fils, fit appeler son mari ; et quand il est arrivé, la comtesse a voulu lui dire brièvement et froidement ce qui se passait en présence de Nicolas, mais elle n'a pas pu résister : elle a pleuré des larmes de frustration et a quitté la pièce. Le vieux comte commença à réprimander Nicolas avec hésitation et à lui demander d'abandonner son intention. Nicolas répondit qu'il ne pouvait pas changer sa parole, et le père, soupirant et visiblement embarrassé, interrompit très vite son discours et se rendit chez la comtesse. Dans tous ses affrontements avec son fils, le comte n'a jamais été laissé avec la conscience de sa culpabilité envers lui pour la rupture des affaires, et il ne pouvait donc pas être en colère contre son fils pour avoir refusé d'épouser une riche épouse et pour avoir choisi Sonya sans dot. - ce n'est que dans ce cas qu'il se souvint plus clairement que, si les choses n'étaient pas bouleversées, il serait impossible de souhaiter pour Nikolaï une meilleure épouse que Sonya ; et que seuls lui, sa Mitenka et ses habitudes irrésistibles sont responsables du désordre des affaires.
GOST R 56709-2015
NORME NATIONALE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS
Méthodes de mesure des coefficients de réflexion lumineuse sur les surfaces des pièces et des façades
Bâtiments et structures. Méthodes de mesure de la réflectivité des pièces et des surfaces des façades
Date d'introduction 2016-05-01
Préface
1 DÉVELOPPÉ par le gouvernement fédéral institution budgétaire"Institut de Recherche en Physique du Bâtiment Académie russe architecture et sciences de la construction" ("NIISF RAASN") avec la participation de la Société à Responsabilité Limitée "CERES-EXPERT" (SARL "CERES-EXPERT")
2 INTRODUIT par le Comité Technique de Normalisation TC 465 « Construction »
3 APPROUVÉ ET ENTRÉ EN VIGUEUR par Arrêté de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie du 13 novembre 2015 N 1793-st
4 INTRODUIT POUR LA PREMIÈRE FOIS
Les règles d'application de cette norme sont établies dans GOST R 1.0-2012 (article 8). Les informations sur les modifications apportées à cette norme sont publiées dans l'index d'information annuel (au 1er janvier de l'année en cours) « Normes nationales », et le texte officiel des modifications et amendements est publié dans l'index d'information mensuel « Normes nationales ». En cas de révision (remplacement) ou d'annulation de cette norme, l'avis correspondant sera publié dans le prochain numéro de l'index mensuel d'information « Normes nationales ». Les informations, avis et textes pertinents sont également publiés dans Système d'Informationà usage général - sur le site officiel de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie sur Internet (www.gost.ru)
1 domaine d'utilisation
1 domaine d'utilisation
Cette norme établit des méthodes de mesure des coefficients intégral, diffus et spéculaire de réflexion lumineuse par les matériaux utilisés pour la finition des pièces et des façades des bâtiments et des structures.
Les coefficients de réflexion de la lumière sont utilisés dans les calculs de la composante réfléchie lors de la conception de l'éclairage naturel et artificiel des bâtiments et des structures (SP 52.13330.2011 et).
2 Références normatives
Cette norme contient des références aux normes suivantes :
GOST 8.023-2014 Système d'état assurer l’uniformité des mesures. Schéma de vérification de l'état des moyens de mesure des quantités lumineuses de rayonnement continu et pulsé
GOST 8.332-2013 Système d'État pour assurer l'uniformité des mesures. Mesures de lumière. Valeurs d'efficacité lumineuse spectrale relative du rayonnement monochromatique pour la vision diurne. Dispositions générales
GOST 26824-2010 Bâtiments et structures. Méthodes de mesure de la luminosité
SP 52.13330.2011 SNiP 23-05-95* "Éclairage naturel et artificiel"
Remarque - Lors de l'utilisation de cette norme, il est conseillé de vérifier la validité des normes de référence dans le système d'information public - sur le site officiel de l'Agence fédérale de réglementation technique et de métrologie sur Internet ou à l'aide de l'index d'information annuel « Normes nationales » , publié à compter du 1er janvier de l'année en cours, et sur les numéros de l'index d'information mensuel « Normes nationales » pour cette année. Si une norme de référence non datée est remplacée, il est recommandé d'utiliser la version actuelle de cette norme, en tenant compte de toute modification apportée à cette version. Si une norme de référence datée est remplacée, il est recommandé d'utiliser la version de cette norme avec l'année d'approbation (adoption) indiquée ci-dessus. Si, après l'approbation de la présente norme, une modification est apportée à la norme référencée à laquelle une référence datée est faite qui affecte la disposition mentionnée, il est recommandé que cette disposition soit appliquée sans tenir compte de cette modification. Si la norme de référence est annulée sans remplacement, il est alors recommandé d'appliquer la disposition dans laquelle une référence à celle-ci est donnée dans la partie qui n'affecte pas cette référence.
Lors de l'utilisation de cette norme, il est conseillé de vérifier la validité de l'ensemble de règles de référence du Fonds fédéral d'information sur les réglementations et normes techniques.
3 Termes et définitions
Cette norme utilise des termes selon GOST 26824, ainsi que les termes suivants avec les définitions correspondantes tenant compte de la pratique internationale existante * :
________________
* Voir la section Bibliographie. - Note du fabricant de la base de données.
3.1 réflexion de la lumière : Processus par lequel le rayonnement visible est renvoyé vers une surface ou un milieu sans modifier la fréquence de ses composants monochromatiques.
3.2 coefficient de réflexion de la lumière intégré , %:
Le rapport du flux lumineux réfléchi au flux lumineux incident, calculé par la formule
où est le flux lumineux total réfléchi par la surface de l'échantillon ;
- flux lumineux incident à la surface de l'échantillon ;
S- répartition spectrale relative de la puissance du rayonnement incident d'une source lumineuse étalon ;
- la réflectance spectrale globale de la surface de l'échantillon ;
V- efficacité lumineuse spectrale relative du rayonnement monochromatique V avec longueur d'onde.
3.3 coefficient de réflexion de la lumière diffuse , %:
La fraction de réflexion diffuse du flux lumineux de la surface de l'échantillon, calculée par la formule
où est la réflexion diffuse du flux lumineux.
3.4 coefficient de réflexion directionnelle (spéculaire) de la lumière , %:
Réflexion conforme aux lois reflet du miroir sans diffusion, exprimé comme le rapport de la réflexion régulière d'une partie du flux lumineux réfléchi au flux incident, calculé par la formule
où est le flux lumineux réfléchi spéculaire.
4 Exigences relatives aux instruments de mesure
4.1 Pour mesurer le flux lumineux, il convient d'utiliser des convertisseurs de rayonnement ayant une limite d'erreur relative admissible d'au plus 10 %, en tenant compte de l'erreur de correction spectrale, définie comme l'écart de la sensibilité spectrale relative du convertisseur de rayonnement de mesure par rapport à la efficacité lumineuse spectrale relative du rayonnement monochromatique pour la vision de jour V selon GOST 8.332, erreurs d'étalonnage sensibilité absolue et l'erreur causée par la non-linéarité de la caractéristique lumineuse.
4.2 Comme source de lumière pour les mesures, vous devez utiliser une source telle que UN.
La tension d'alimentation de la lampe doit être stabilisée à 1/1000 près.
4.3 Le photomètre, dont la conception doit être conforme aux schémas de mesure donnés dans les sections 6 à 8, doit satisfaire aux exigences suivantes :
4.3.1 Le système optique doit assurer le parallélisme du faisceau lumineux, l'angle de divergence (convergence) n'est pas supérieur à 1°.
4.3.2 Après avoir traversé le flux lumineux après réflexion sur l'échantillon de matériau, les rayons lumineux doivent tomber sur le photodétecteur avec un écart par rapport à la direction donnée de pas plus de 2°.
4.3.3 Lors de la détermination du coefficient de réflexion directionnelle de la lumière, l'angle d'incidence du faisceau lumineux est égal à l'angle de réflexion avec une erreur absolue de ± 1°.
4.3.4 L'angle d'incidence du faisceau lumineux sur la surface photosensible du photodétecteur doit être constant à toutes les étapes des mesures, à moins d'utiliser une sphère intégrante (Taylor ball).
4.3.5 Lors des tests d'échantillons, il est permis d'utiliser d'autres instruments qui fournissent des résultats de mesure de la réflexion de la lumière à l'aide d'échantillons de référence certifiés avec une erreur spécifiée.
Si un monochromateur ou un spectrophotomètre est utilisé comme instrument de mesure, le coefficient de réflexion est déterminé à l'aide des formules (1), (2) ou (3).
5 Exigences pour les échantillons
5.1 Les tests sont effectués sur des échantillons des matériaux utilisés. Les dimensions des échantillons sont établies conformément au mode d'emploi de l'instrument de mesure utilisé.
5.2 La surface des échantillons doit être plane.
5.3 La procédure de sélection et le nombre d'échantillons sont établis dans documents réglementaires pour un type de produit spécifique.
6 Mesure de la réflexion lumineuse intégrée
La réflectance de la lumière intégrée est mesurée à l'aide d'une sphère d'intégration, qui est une boule creuse avec un revêtement de surface interne présentant un coefficient de réflectance diffuse élevé. Il y a des trous dans la sphère.
Le diagramme schématique pour mesurer la réflectance de la lumière intégrale et diffuse, correspondant à *, est présenté à la figure 1.
________________
* Voir la section Bibliographie, ci-après. - Note du fabricant de la base de données.
1 - échantillon; 2 - port d'étalonnage standard ; 3 - port de lumière entrant ; 4 - photomètre ; 5 - écran; d- diamètre du trou pour placer l'échantillon à mesurer (0,1 D); d- diamètre du trou d'étalonnage ( d= d); d- diamètre du trou pour le flux lumineux entrant (0,1 D); d- diamètre du trou pour la sortie du faisceau réfléchi spéculairement ( d= 0,02D); D- diamètre interne de la sphère ; - angle d'incidence du faisceau entrant (10°)
Figure 1 - Diagramme schématique de mesure de la réflectance de la lumière intégrale et diffuse
Lors de la mesure du coefficient de réflexion intégral, le trou pour la sortie d'un faisceau réfléchi spéculairement d'un diamètre d manquant ou recouvert d'un bouchon.
7 Mesure de la réflexion diffuse de la lumière
La réflectance diffuse de la lumière est mesurée selon le schéma illustré à la figure 1.
Dans ce cas, la sphère doit avoir un trou pour la sortie d'un faisceau réfléchi spéculairement d'un diamètre d.
La taille standard de l'ouverture de sortie doit être de 0,02 D.
8 Mesure de la réflectance de la lumière directionnelle (spéculaire)
La réflectance directionnelle (spéculaire) de la lumière sur une surface est mesurée en éclairant la surface avec un faisceau de lumière parallèle ou collimaté incident sur la surface éclairée selon un angle. Le diagramme schématique de mesure du coefficient de réflexion spéculaire correspondant à est présenté à la figure 2.
9 Méthodes de mesure
9.1 Méthode absolue
9.1.1 L'essence de la méthode est de déterminer le rapport entre la valeur de l'intensité du courant du photodétecteur lorsqu'un flux lumineux réfléchi par l'échantillon d'essai le frappe, et la valeur de l'intensité du courant lorsque le flux lumineux le frappe directement. le photodétecteur.
9.1.2 Procédure d'essai
9.1.2.1 Le faisceau lumineux de la source lumineuse est dirigé vers le photodétecteur.
1 - lentille collimatrice ; 2 - une lentille collectrice dont le diaphragme est situé en biais ; 3 - Source de lumière; 4 - diaphragme collecteur du photodétecteur ; 5 - surface de l'échantillon mesuré ; 6 - photodétecteur ; - angle d'incidence du flux lumineux ; - angle des trous du diaphragme
Figure 2 - Diagramme schématique de la mesure du coefficient de réflexion spéculaire
9.1.2.2 Mesurer le courant du photodétecteur je.
9.1.2.3 Préciser le plan de mesure.
9.1.2.4 L'équipement est placé conformément au schéma optique illustré à la figure 1 ou 2, selon l'indicateur mesuré.
9.1.2.5 L'échantillon d'essai est placé dans le plan de mesure.
9.1.2.6 Mesurer le courant du photodétecteur je.
9.1.3 Traitement des résultats.
9.1.3.1 Le coefficient de réflexion de la lumière est déterminé par la formule
où est la force actuelle du photodétecteur avec l’échantillon étudié, A.
- intensité du courant du photodétecteur sans échantillon, A.
9.1.3.2 L'erreur de mesure relative est déterminée par la formule
- erreur absolue mesurer l'intensité du courant du photodétecteur (erreur absolue du photomètre) sans échantillon.
9.2 Méthode relative
9.2.1 L'essence de la méthode est de déterminer le rapport entre l'intensité du courant du photodétecteur lorsqu'un flux lumineux réfléchi par l'échantillon d'essai le frappe, et l'intensité du courant du photodétecteur lorsqu'il le frappe avec un flux lumineux réfléchi par un échantillon ayant une valeur certifiée du coefficient de réflexion lumineuse, tenant compte de ce coefficient.
9.2.2 Procédure d'essai
9.2.2.1 Préciser le plan de mesure.
9.2.2.2 L'équipement est placé conformément au schéma optique illustré à la figure 1 ou 2, selon l'indicateur mesuré.
9.2.2.3 Un échantillon avec une réflectance lumineuse certifiée (échantillon de référence) est placé dans le plan de mesure.
9.2.2.4 Mesurer le courant du photodétecteur je.
9.2.2.5 L'échantillon d'essai est placé dans le plan de mesure.
9.2.2.6 Mesurer le courant du photodétecteur je.
9.2.3 Résultats du traitement
9.2.3.1 Le coefficient de réflexion de la lumière est déterminé par la formule
où est le facteur de réflexion lumineuse certifié de l'échantillon de référence ;
- intensité du courant du photodétecteur avec l'échantillon étudié, A ;
- intensité du courant du photodétecteur avec l'échantillon de référence, A.
9.2.3.2 L'erreur de mesure relative est déterminée par la formule
où est l'erreur absolue dans la détermination du facteur de réflexion de la lumière ;
- erreur absolue dans la mesure de l'intensité du courant du photodétecteur (erreur absolue du photomètre) avec l'échantillon étudié ;
- erreur absolue dans la mesure de l'intensité du courant du photodétecteur (erreur absolue du photomètre) avec un échantillon de référence ;
- erreur absolue de la réflexion lumineuse certifiée de l'échantillon de référence.
Remarque - L'erreur établie du photomètre peut être considérée comme l'erreur de mesure relative (9.1.3.2 et 9.2.3.2).
Bibliographie
Ensemble de règles de conception et de construction « Éclairage naturel des bâtiments résidentiels et publics ». |
||
EN 12665:2011* | Lumière et éclairage. Termes et critères de base pour spécifier les exigences en matière d'éclairage (EN 12665:2011 Lumière et éclairage - Termes et critères de base pour spécifier les exigences en matière d'éclairage) |
|
________________ |
||
Propriétés des surfaces réfléchissantes des lampes. Méthodes de détermination (EN 16268:2013 Performance des surfaces réfléchissantes pour luminaires) |
||
CDU 721:535.241.46:006.354 | OK 91.040 | |
Mots clés : réflectance, éclairage, éclairage naturel, éclairage artificiel |
||
Texte du document électronique
préparé par Kodeks JSC et vérifié par rapport à :
publication officielle
M. : Standartinform, 2016
De l'hétérogénéité dans l'environnement de distribution. Des exemples d'hétérogénéité peuvent être une charge dans une ligne de transmission ou l'interface entre deux milieux homogènes avec des valeurs de paramètres électriques différentes.
- le rapport de l'amplitude de tension complexe de l'onde réfléchie à l'amplitude de tension complexe de l'onde incidente dans une section donnée de la ligne de transmission.
Coefficient de réflexion actuel- le rapport de l'amplitude complexe du courant de l'onde réfléchie à l'amplitude complexe du courant de l'onde incidente dans une section donnée de la ligne de transmission.
Coefficient de réflexion des ondes radio- le rapport entre la composante spécifiée de l'intensité du champ électrique dans l'onde radio réfléchie et la même composante dans l'onde radio incidente.
Coefficient de réflexion de tension
Coefficient de réflexion de tension(dans la méthode des amplitudes complexes) - une quantité complexe, égal au rapport amplitudes complexes des ondes réfléchies et incidentes :
K U = U négatif / U pad = |K U |e jφ Où |K U |- module coefficient de réflexion, φ - phase du coefficient de réflexion, qui détermine le retard de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente.Le coefficient de réflexion de tension dans la ligne de transmission est uniquement lié à son impédance caractéristique ρ et à son impédance de charge Z :
K U = (charge Z - ρ) / (charge Z + ρ).Coefficient de réflexion de puissance- une valeur égale au rapport de la puissance (flux de puissance, densité surfacique de puissance) transférée par l'onde réfléchie, puissance transférée par l'onde incidente :
K P = P négatif / P pad = |K U | 2Autres grandeurs caractérisant la réflexion dans une ligne de transmission
- Rapport d'onde stationnaire - K St = (1 + |K U |) / (1 - |K U |)
- Coefficient d'onde progressive - K bv = (1 - |K U |) / (1 + |K U |)
Aspects métrologiques
Des mesures
- Pour mesurer le coefficient de réflexion, des lignes de mesure, des impédancemètres, des compteurs panoramiques SWR (ils mesurent uniquement le module, sans phase), ainsi que des analyseurs de réseau vectoriel (peuvent mesurer à la fois le module et la phase) sont utilisés.
- Les mesures de réflexion sont diverses charges de mesure - actives, réactives à phase variable, etc.
Normes
- Norme d'état de l'unité de résistance aux ondes dans les guides d'ondes coaxiaux GET 75-2011 (lien indisponible)- situé à SNIIM (Novossibirsk)
- Réglage de la plus haute précision pour reproduire l'unité de réflectance complexe ondes électromagnétiques dans les trajets des guides d'ondes section rectangulaire dans la gamme de fréquences 2,59...37,5 GHz UVT 33-V-91 - situé à SNIIM (Novossibirsk)
- L'installation de la plus haute précision pour reproduire l'unité du coefficient de réflexion complexe (coefficient d'onde stationnaire de tension et de phase) des ondes électromagnétiques dans des trajets de guide d'ondes de section rectangulaire dans la gamme de fréquences 2,14 ... 37,5 GHz UVT 33-A-89 - est dans