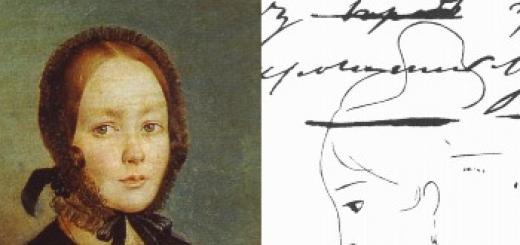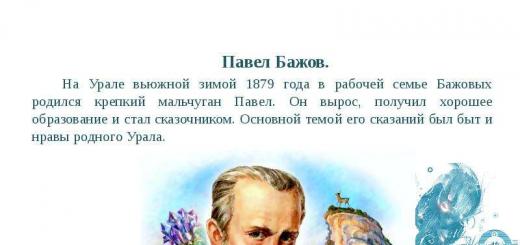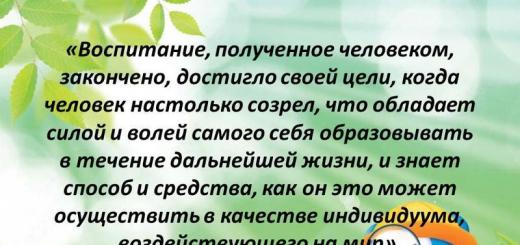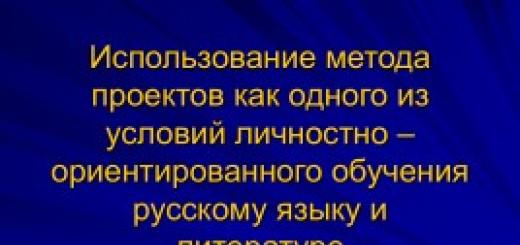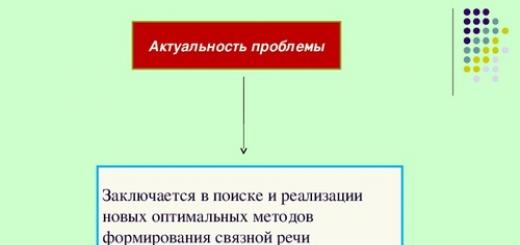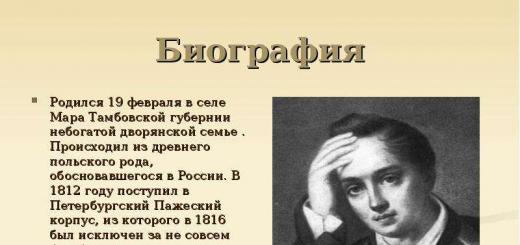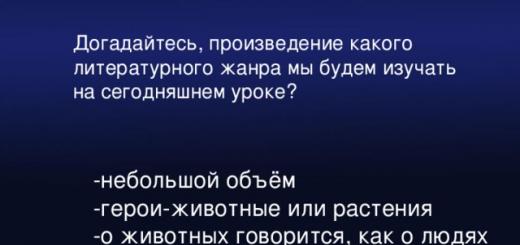Il existe quatre principaux types de liaisons chimiques :
1. Une liaison covalente réalisée par des paires d'électrons communes. Il est formé dans en raison de nuages d'électrons (orbitales) superposés d'atomes non métalliques. Plus le chevauchement des nuages d’électrons est important, plus liaison chimique. Les liaisons covalentes peuvent être polaires ou non polaires. Covalent non polaire connexion se produit entre des atomes du même type qui ont la même électronégativité. (L'électronégativité est la propriété des atomes d'attirer les électrons vers eux). Par exemple, la formation d'une molécule d'hydrogène peut être illustrée par le schéma :
H . + . H = H ( : ) H H 2
ou H . + . H = H – H
Les molécules O 2, Cl 2, N 2, F 2, etc. se forment de la même manière.
Une liaison covalente non polaire est symétrique. Un nuage électronique formé par une paire d’électrons commune (partagée) appartient également à deux atomes.
Covalent polaire connexion se produit entre des atomes dont l'électronégativité diffère, mais seulement légèrement. Dans ce cas, la paire d'électrons partagée est déplacée vers l'élément le plus électronégatif. Par exemple, lorsqu'une molécule de chlorure d'hydrogène est formée, le nuage électronique de la liaison est déplacé vers l'atome de chlore. En raison de ce déplacement, l'atome de chlore acquiert une charge partielle négative et l'atome d'hydrogène acquiert une charge partielle positive, et la molécule résultante est polaire.
H + Cl = H Cl H → Cl HCl
Les molécules de HBr, HI, HF, H 2 O, CH 4, etc. se forment de la même manière.
Des liaisons covalentes il y a célibataire(réalisé par une paire d'électrons commune), double(mis en œuvre par deux paires d'électrons communes), triples(mis en œuvre par trois paires d'électrons communes). Par exemple, dans l’éthane, toutes les liaisons sont simples, dans l’éthylène, il existe une double liaison et dans l’acétylène, il existe une triple liaison.
Éthane : CH 3 –CH 3 Éthylène : CH 2 = CH 2 Acétylène : CH ≡ CH
2. Liaison ionique se produit dans des composés formés d'atomes d'éléments qui diffèrent grandement par leur électronégativité, c'est-à-dire avec des propriétés nettement opposées (atomes de métaux et de non-métaux). Les ions sont des particules chargées dans lesquelles des atomes se transforment à la suite d'une perte ou d'un gain d'électrons.
Une liaison ionique se forme en raison de l’attraction électrostatique d’ions de charges opposées. Par exemple, un atome de sodium, abandonnant son électron, se transforme en un ion chargé positivement, et un atome de chlore, acceptant cet électron, se transforme en un ion chargé négativement. En raison de l'attraction électrostatique entre les ions sodium et chlore, liaison ionique:
Na + Cl Na + + Cl – Na + Cl –
Les molécules de chlorure de sodium n'existent qu'à l'état de vapeur. À l’état solide (cristallin), les composés ioniques sont constitués d’ions positifs et négatifs régulièrement disposés. Dans ce cas il n’y a pas de molécules.
La liaison ionique peut être considérée comme un cas extrême de liaison covalente.
3. Connexion métalliqueexiste dans les métaux et alliages. Elle est réalisée en raison de l'attraction entre les ions métalliques et les électrons partagés (ce sont des électrons de valence qui ont quitté leurs orbitales et se déplacent à travers le morceau de métal entre les ions - « gaz électronique »).
4. Liaison hydrogène est une sorte de liaison qui se produit entre un atome d'hydrogène d'une molécule, qui a une charge partielle positive, et un atome électronégatif d'une autre ou de la même molécule. La liaison hydrogène peut être intermoléculaire ou intramoléculaire. HF…HF…HF. Indiqué par des points. Plus faible que covalent.
Les données sur l'énergie d'ionisation (IE), le PEI et la composition des molécules stables - leurs valeurs réelles et comparaisons - tant des atomes libres que des atomes liés dans des molécules, nous permettent de comprendre comment les atomes forment des molécules par le mécanisme de liaison covalente.
UNE LIAISON COVALENTE- (du latin « co » ensemble et « vales » ayant une force) (liaison homéopolaire), liaison chimique entre deux atomes qui naît lorsque les électrons appartenant à ces atomes sont partagés. Les atomes des molécules de gaz simples sont reliés par des liaisons covalentes. Une liaison dans laquelle il y a une paire d’électrons partagée est appelée une liaison simple ; Il existe également des liaisons doubles et triples.
Examinons quelques exemples pour voir comment nous pouvons utiliser nos règles pour déterminer le nombre de liaisons chimiques covalentes qu'un atome peut former si nous connaissons le nombre d'électrons dans la coque externe d'un atome donné et la charge de son noyau. La charge du noyau et le nombre d'électrons dans la coque externe sont déterminés expérimentalement et sont inclus dans le tableau des éléments.
Calcul du nombre possible de liaisons covalentes
Par exemple, comptons le nombre de liaisons covalentes pouvant former du sodium ( N / A), aluminium (Al), phosphore (P), et du chlore ( cl). Sodium ( N / A) et l'aluminium ( Al) ont respectivement 1 et 3 électrons dans la coque externe et, selon la première règle (pour le mécanisme de formation de liaisons covalentes, un électron dans la coque externe est utilisé), ils peuvent former : du sodium (N / A)- 1 et aluminium ( Al)- 3 liaisons covalentes. Après la formation de la liaison, le nombre d'électrons dans les couches externes du sodium ( N / A) et l'aluminium ( Al)égal à 2 et 6, respectivement ; c'est-à-dire inférieur au nombre maximum (8) pour ces atomes. Phosphore ( P) et du chlore ( cl) ont respectivement 5 et 7 électrons sur la coque externe et, selon la deuxième des lois mentionnées ci-dessus, ils pourraient former 5 et 7 liaisons covalentes. Conformément à la quatrième loi, lors de la formation d'une liaison covalente, le nombre d'électrons sur la coque externe de ces atomes augmente de 1. Selon la sixième loi, lorsqu'une liaison covalente est formée, le nombre d'électrons sur la coque externe de ces atomes augmente des atomes liés ne peut pas être supérieur à 8. C'est-à-dire le phosphore ( P) ne peut former que 3 liaisons (8-5 = 3), tandis que le chlore ( cl) ne peut en former qu’un (8-7 = 1).
Exemple: Sur la base de l'analyse, nous avons découvert qu'une certaine substance est constituée d'atomes de sodium (N / A) et du chlore ( cl). Connaissant les régularités du mécanisme de formation des liaisons covalentes, on peut dire que le sodium ( N / A) ne peut former qu’une seule liaison covalente. Ainsi, on peut supposer que chaque atome de sodium ( N / A) lié à l'atome de chlore ( cl) par une liaison covalente dans cette substance, et que cette substance est composée de molécules d'un atome NaCl. La formule développée de cette molécule : Na-Cl. Ici, le tiret (-) désigne une liaison covalente. La formule électronique de cette molécule peut être représentée comme suit :
. .
Na:Cl:
. .
Conformément à la formule électronique, sur la coque externe de l'atome de sodium ( N / A) V NaCl il y a 2 électrons, et sur la coque externe de l'atome de chlore ( cl) il y a 8 électrons. Dans cette formule, les électrons (points) entre les atomes de sodium ( N / A) Et
chlore (Cl) sont des électrons de liaison. Depuis l'Î.-P.-É. du chlore ( cl) est égal à 13 eV, et pour le sodium (N / A) elle est égale à 5,14 eV, la paire d'électrons de liaison est beaucoup plus proche de l'atome Cl qu'à un atome N / A. Si les énergies d’ionisation des atomes formant la molécule sont très différentes, alors la liaison formée sera polaire une liaison covalente.
Considérons un autre cas. Sur la base de l'analyse, nous avons découvert qu'une certaine substance est constituée d'atomes d'aluminium ( Al) et les atomes de chlore ( cl). En aluminium ( Al) il y a 3 électrons dans la coque externe ; ainsi, il peut former 3 liaisons chimiques covalentes tout en chlore (Cl), comme dans le cas précédent, ne peut former qu'une seule liaison. Cette substance est présentée comme AlCl3, et sa formule électronique peut être illustrée comme suit :
Graphique 3.1. Formule électroniqueAlCl 3
dont la formule de structure est :
Cl - Al - Cl
Cl
Cette formule électronique montre que AlCl3 sur l'enveloppe externe des atomes de chlore ( Cl) il y a 8 électrons, tandis que la coque externe de l'atome d'aluminium ( Al) il y en a 6. Selon le mécanisme de formation d'une liaison covalente, les deux électrons de liaison (un de chaque atome) se dirigent vers les coques externes des atomes liés.
Liaisons covalentes multiples
Les atomes qui ont plus d’un électron dans leur enveloppe externe peuvent former non pas une, mais plusieurs liaisons covalentes entre eux. De telles connexions sont dites multiples (le plus souvent multiples) Connexions. Des exemples de telles liaisons sont les liaisons des molécules d'azote ( N= N) et l'oxygène ( O = O).
La liaison formée lorsque des atomes uniques se réunissent est appelée liaison covalente homoatomique, e Si les atomes sont différents, alors la liaison s'appelle liaison covalente hétéroatomique[Les préfixes grecs « homo » et « hétéro » signifient respectivement identique et différent].
Imaginons à quoi ressemble réellement une molécule avec des atomes appariés. Le plus molécule simple avec des atomes appariés est une molécule d'hydrogène.
Une liaison covalente(du latin « co » ensemble et « vales » ayant une force) est réalisé grâce à la paire d'électrons appartenant aux deux atomes. Formé entre des atomes non métalliques.
L'électronégativité des non-métaux est assez élevée, donc quand interaction chimique de deux atomes non métalliques, le transfert complet des électrons de l’un à l’autre (comme dans le cas) est impossible. Dans ce cas, la mise en commun des électrons est nécessaire.
À titre d'exemple, discutons de l'interaction des atomes d'hydrogène et de chlore :
H 1s 1 - un électron
Classe 1s 2 2s 2 2 page 6 3 s 2 3 p5 - sept électrons au niveau externe
Il manque à chacun des deux atomes un électron pour avoir un contact externe complet. couche électronique. Et chacun des atomes alloue un électron « pour un usage commun ». Ainsi, la règle de l'octet est satisfaite. Ceci est mieux représenté en utilisant les formules de Lewis :
Formation d'une liaison covalente
Les électrons partagés appartiennent désormais aux deux atomes. L'atome d'hydrogène a deux électrons (le sien et l'électron partagé de l'atome de chlore), et l'atome de chlore a huit électrons (le sien plus l'électron partagé de l'atome d'hydrogène). Ces deux électrons partagés forment une liaison covalente entre les atomes d’hydrogène et de chlore. La particule formée par la liaison de deux atomes est appelée molécule.
Liaison covalente non polaire
Une liaison covalente peut également se former entre deux identique atomes. Par exemple:

Ce diagramme explique pourquoi l'hydrogène et le chlore existent sous forme de molécules diatomiques. Grâce à l’appariement et au partage de deux électrons, il est possible de respecter la règle de l’octet pour les deux atomes.
En plus des liaisons simples, une liaison covalente double ou triple peut être formée, comme par exemple dans les molécules d'oxygène O 2 ou d'azote N 2. Les atomes d’azote ont cinq électrons de valence, il faut donc trois électrons supplémentaires pour compléter la couche. Ceci est réalisé en partageant trois paires d'électrons, comme indiqué ci-dessous :

Les composés covalents sont généralement des gaz, des liquides ou des solides à point de fusion relativement bas. L’une des rares exceptions est le diamant, qui fond au-dessus de 3 500 °C. Cela s'explique par la structure du diamant, qui est un réseau continu d'atomes de carbone liés de manière covalente, et non un ensemble de molécules individuelles. En fait, tout cristal de diamant, quelle que soit sa taille, est une énorme molécule.
Une liaison covalente se produit lorsque les électrons de deux atomes non métalliques se combinent. La structure résultante s’appelle une molécule.
Liaison covalente polaire
Dans la plupart des cas, deux atomes liés de manière covalente ont différent L'électronégativité et les électrons partagés n'appartiennent pas également à deux atomes. La plupart du temps, ils sont plus proches d’un atome que d’un autre. Dans une molécule de chlorure d’hydrogène, par exemple, les électrons qui forment une liaison covalente sont situés plus près de l’atome de chlore car son électronégativité est supérieure à celle de l’hydrogène. Cependant, la différence dans la capacité à attirer les électrons n’est pas suffisamment grande pour qu’un transfert complet d’électrons de l’atome d’hydrogène à l’atome de chlore se produise. Par conséquent, la liaison entre les atomes d’hydrogène et de chlore peut être considérée comme un croisement entre une liaison ionique (transfert complet d’électrons) et une liaison covalente non polaire (un arrangement symétrique d’une paire d’électrons entre deux atomes). La charge partielle des atomes est désignée par la lettre grecque δ. Cette connexion est appelée Covalent polaire liaison, et la molécule de chlorure d'hydrogène est dite polaire, c'est-à-dire qu'elle a une extrémité chargée positivement (atome d'hydrogène) et une extrémité chargée négativement (atome de chlore).

Le tableau ci-dessous répertorie les principaux types de liaisons et des exemples de substances :

Mécanisme d'échange et donneur-accepteur de formation de liaisons covalentes

1) Mécanisme d'échange. Chaque atome apporte un électron non apparié à une paire d'électrons commune.
2) Mécanisme donneur-accepteur. Un atome (donneur) fournit une paire d'électrons et l'autre atome (accepteur) fournit une orbitale vide pour cette paire.
7.11. La structure des substances avec des liaisons covalentes
Les substances dans lesquelles, parmi tous les types de liaisons chimiques, seule une liaison covalente est présente, sont divisées en deux groupes inégaux : moléculaires (très nombreuses) et non moléculaires (beaucoup moins).
Cristaux solides substances moléculaires sont constitués de molécules faiblement interconnectées par les forces d’interaction intermoléculaire. De tels cristaux n’ont pas une résistance et une dureté élevées (pensez à la glace ou au sucre). Leurs points de fusion et d'ébullition sont également bas (voir tableau 22).
Tableau 22. Points de fusion et d'ébullition de certaines substances moléculaires
Substance |
Substance |
||||
| H2 | – 259 | – 253 | BR 2 | – 7 | 58 |
| N 2 | – 210 | – 196 | H2O | 0 | 100 |
| HCl | – 112 | – 85 | P4 | 44 | 257 |
| NH3 | – 78 | – 33 | C 10 H 8 (naphtalène) | 80 | 218 |
| DONC 2 | – 75 | – 10 | S8 | 119 |
Contrairement à leurs homologues moléculaires, les substances non moléculaires possédant des liaisons covalentes forment des cristaux très durs. Les cristaux de diamant (la substance la plus dure) appartiennent à ce type.
Dans un cristal de diamant (Fig. 7.5), chaque atome de carbone est relié à quatre autres atomes de carbone par de simples liaisons covalentes (hybridation sp 3). Les atomes de carbone forment une structure tridimensionnelle. Essentiellement, le cristal de diamant dans son ensemble est une molécule énorme et très puissante.
Les cristaux de silicium, largement utilisés en radioélectronique et en ingénierie électronique, ont la même structure.
Si vous remplacez la moitié des atomes de carbone du diamant par des atomes de silicium sans perturber la structure du cristal, vous obtiendrez un cristal de carbure de silicium SiC - également une substance très dure utilisée comme matériau abrasif. Le sable de quartz ordinaire (dioxyde de silicium) appartient également à ce type de substance cristalline. Le quartz est très solide; Sous le nom d'« émeri », il est également utilisé comme matériau abrasif. La structure du quartz est facilement obtenue en insérant des atomes d’oxygène entre deux atomes de silicium dans un cristal de silicium. Dans ce cas, chaque atome de silicium sera associé à quatre atomes d'oxygène, et chaque atome d'oxygène à deux atomes de silicium.
Les cristaux de diamant, de silicium, de quartz et de structures similaires sont appelés cristaux atomiques.
Un cristal atomique est un cristal constitué d'atomes d'un ou plusieurs éléments liés par des liaisons chimiques.
Une liaison chimique dans un cristal atomique peut être covalente ou métallique.
Comme vous le savez déjà, tout cristal atomique, comme un cristal ionique, est une énorme « supermolécule ». La formule développée d'une telle « supermolécule » ne peut pas être écrite - vous ne pouvez montrer que son fragment, par exemple :

Contrairement aux substances moléculaires, les substances qui forment des cristaux atomiques sont parmi les plus réfractaires (voir tableau 23.).
Tableau 23. Points de fusion et d'ébullition de certaines substances non moléculaires Avec des liaisons covalentes
Des températures de fusion aussi élevées sont tout à fait compréhensibles si l’on considère que lorsque ces substances fondent, ce ne sont pas les liaisons intermoléculaires faibles qui sont rompues, mais les liaisons chimiques fortes. Pour la même raison, de nombreuses substances qui forment des cristaux atomiques ne fondent pas lorsqu'elles sont chauffées, mais se décomposent ou se transforment immédiatement en vapeur (sublimées), par exemple le graphite se sublime à 3 700 °C.
| Silicium – Si. Les cristaux de silicium très durs et cassants ressemblent à du métal, mais il s’agit néanmoins d’un non-métal. En fonction du type de conductivité électrique, cette substance est classée parmi les semi-conducteurs, ce qui détermine son énorme importance dans le monde moderne. Le silicium est le matériau semi-conducteur le plus important. Radios, téléviseurs, ordinateurs, téléphones modernes, montres électroniques, panneaux solaires et de nombreux autres appareils ménagers et industriels contiennent des transistors, des microcircuits et des photocellules fabriqués à partir de monocristaux de silicium de haute pureté comme éléments structurels les plus importants. Le silicium technique est utilisé dans la production d’acier et dans la métallurgie des non-ferreux. En termes de propriétés chimiques, le silicium est une substance assez inerte, il ne réagit qu'à haute température. Dioxyde de silicium – SiO 2 . Un autre nom pour cette substance est la silice. Le dioxyde de silicium se présente dans la nature sous deux formes : cristalline et amorphe. De nombreuses pierres semi-précieuses et ornementales sont des variétés de dioxyde de silicium cristallin (quartz) : cristal de roche, jaspe, calcédoine, agate. et l'opale est une forme amorphe de silice. Le quartz est très répandu dans la nature, car les dunes des déserts et les bancs de sable des rivières et des mers sont tous constitués de sable de quartz. Le quartz est une substance cristalline incolore, très dure et réfractaire. Sa dureté est inférieure à celle du diamant et du corindon, mais il est néanmoins largement utilisé comme matériau abrasif. Le sable de quartz est largement utilisé dans la construction et l’industrie des matériaux de construction. Le verre de quartz est utilisé pour fabriquer de la verrerie de laboratoire et des instruments scientifiques car il ne se fissure pas lorsqu'il est exposé à changement soudain température. Selon leur propre propriétés chimiques silice - oxyde d'acide, mais réagit avec les alcalis uniquement lors de la fusion. À haute température, le dioxyde de silicium et le graphite sont utilisés pour produire du carbure de silicium - carborundum. Le carborundum est la deuxième substance la plus dure après le diamant ; il est également utilisé pour fabriquer des meules et du « papier de verre ». |
7.12. Polarité d'une liaison covalente. Électronégativité
Rappelez-vous que les atomes isolés de différents éléments ont des propensions différentes à abandonner et à accepter des électrons. Ces différences persistent après la formation d'une liaison covalente. Autrement dit, les atomes de certains éléments ont tendance à attirer plus fortement vers eux la paire d’électrons d’une liaison covalente que les atomes d’autres éléments.
Considérons une molécule HCl.
À l'aide de cet exemple, voyons comment estimer le déplacement du nuage de communication électronique en utilisant les énergies et les moyens d'ionisation molaire de l'électron. 1 312 kJ/mol et 1 251 kJ/mol - la différence est insignifiante, environ 5 %. 73 kJ/mol et 349 kJ/mol - ici la différence est bien plus grande : l'énergie d'affinité électronique de l'atome de chlore est presque cinq fois supérieure à celle de l'atome d'hydrogène. Nous pouvons en conclure que la paire électronique de la liaison covalente dans la molécule de chlorure d'hydrogène est largement décalée vers l'atome de chlore. En d’autres termes, les électrons de liaison passent plus de temps à proximité de l’atome de chlore qu’à proximité de l’atome d’hydrogène. Cette répartition inégale de la densité électronique entraîne une redistribution des charges électriques à l'intérieur de la molécule : des charges partielles (excédentaires) apparaissent sur les atomes ; sur l’atome d’hydrogène, il est positif et sur l’atome de chlore, il est négatif.
Dans ce cas, la liaison est dite polarisée et la liaison elle-même est appelée liaison covalente polaire.
Si la paire d'électrons d'une liaison covalente n'est déplacée vers aucun des atomes liés, c'est-à-dire que les électrons de la liaison appartiennent également aux atomes liés, alors une telle liaison est appelée liaison covalente non polaire.
La notion de « charge formelle » dans le cas d'une liaison covalente est également applicable. Seulement dans la définition, nous ne devrions pas parler d’ions, mais d’atomes. DANS cas général la définition suivante peut être donnée.
Dans les molécules dans lesquelles les liaisons covalentes ne sont formées que par un mécanisme d'échange, les charges formelles des atomes sont égales à zéro. Ainsi, dans la molécule HCl, les charges formelles sur les atomes de chlore et d’hydrogène sont nulles. Par conséquent, dans cette molécule, les charges réelles (efficaces) sur les atomes de chlore et d'hydrogène sont égales aux charges partielles (excédentaires).
Il n'est pas toujours facile de déterminer le signe de la charge partielle sur un atome de l'un ou l'autre élément d'une molécule en fonction des énergies d'ionisation molaire et de l'affinité pour l'électrode, c'est-à-dire d'estimer dans quelle direction les paires de liaisons électroniques sont décalé. Habituellement, à ces fins, une autre caractéristique énergétique d'un atome est utilisée: l'électronégativité.
Actuellement, il n’existe pas de désignation unique et généralement acceptée pour l’électronégativité. Il peut être désigné par les lettres E/O. Il n’existe pas non plus de méthode unique et généralement acceptée pour calculer l’électronégativité. De manière simplifiée, il peut être représenté comme la moitié de la somme des énergies d'ionisation molaire et de l'affinité électronique - ce fut l'une des premières façons de le calculer.
Les valeurs absolues de l'électronégativité des atomes de divers éléments sont très rarement utilisées. La plus couramment utilisée est l’électronégativité relative, notée c. Initialement, cette valeur était définie comme le rapport de l'électronégativité d'un atome d'un élément donné à l'électronégativité d'un atome de lithium. Par la suite, les méthodes de calcul ont quelque peu changé.
L'électronégativité relative est une quantité sans dimension. Ses valeurs sont données en annexe 10.
Puisque l'électronégativité relative dépend principalement de l'énergie d'ionisation de l'atome (l'énergie d'affinité électronique est toujours beaucoup plus faible), alors dans le système éléments chimiques elle change à peu près de la même manière que l'énergie d'ionisation, c'est-à-dire qu'elle augmente en diagonale du césium (0,86) au fluor (4,10). Les valeurs de l'électronégativité relative de l'hélium et du néon données dans le tableau n'ont aucune signification pratique, car ces éléments ne forment pas de composés.
À l'aide du tableau d'électronégativité, vous pouvez facilement déterminer vers lequel des deux atomes les électrons reliant ces atomes sont déplacés et, par conséquent, les signes des charges partielles apparaissant sur ces atomes.
| H2O | La connexion est polaire | |||
| H2 | Les atomes sont les mêmes | H--H | La connexion est non polaire | |
| CO2 | La connexion est polaire | |||
| Cl2 | Les atomes sont les mêmes | Cl-Cl | La connexion est non polaire | |
| H2S | La connexion est polaire |
Ainsi, dans le cas de la formation d'une liaison covalente entre des atomes d'éléments différents, une telle liaison sera toujours polaire, et dans le cas de la formation d'une liaison covalente entre des atomes d'un même élément (dans des substances simples), la la liaison est dans la plupart des cas non polaire.
Plus la différence d'électronégativité des atomes liés est grande, plus la liaison covalente entre ces atomes s'avère polaire.
| Sulfure d'hydrogène H 2 S– un gaz incolore à l’odeur caractéristique d’œufs pourris ; toxique. Il est thermiquement instable et se décompose lorsqu'il est chauffé. Le sulfure d'hydrogène est légèrement soluble dans l'eau, il Solution aqueuse appelé acide sulfure d’hydrogène. Le sulfure d'hydrogène provoque (catalyse) la corrosion des métaux, c'est ce gaz qui est « responsable » du noircissement de l'argent. On le trouve naturellement dans certaines eaux minérales. Au cours de la vie, certaines bactéries le forment. Le sulfure d'hydrogène est destructeur pour tous les êtres vivants. Une couche de sulfure d'hydrogène a été découverte dans les profondeurs de la mer Noire et inquiète les scientifiques : la vie des habitants marins y est constamment menacée. |
LIAISON COVALENTE POLAIRE, LIAISON COVALENTE NON POLAIRE, ÉLECTRONÉGATIVITÉ ABSOLUE, ÉLECTRONÉGATIVITÉ RELATIVE.
1. Des expériences et des calculs ultérieurs ont montré que la charge effective du silicium dans le tétrafluorure de silicium est de +1,64 e et celle du xénon dans l'hexafluorure de xénon de +2,3 e. Déterminez les valeurs des charges partielles sur les atomes de fluor dans ces composés. 2. Composez les formules développées des substances suivantes et, à l'aide des notations " " et " ", caractérisez la polarité des liaisons covalentes dans les molécules de ces composés : a) CH 4, CCl 4, SiCl 4 ; b) H 2 O, H 2 S, H 2 Se, H 2 Te; c) NH 3, NF 3, NCl 3 ; d) SO 2, Cl 2 O, OF 2.
3.À l'aide du tableau d'électronégativité, indiquez dans lequel des composés la liaison est la plus polaire : a) CCl 4 ou SiCl 4 ; b) H 2 S ou H 2 O; c) NF 3 ou NCl 3; d) Cl 2 O ou OF 2.
7.13. Mécanisme donneur-accepteur de formation de liens
Dans les paragraphes précédents, vous avez découvert en détail deux types de liaisons : ioniques et covalentes. Rappelons qu'une liaison ionique se forme lorsqu'un électron est complètement transféré d'un atome à un autre. Covalent - lors du partage d'électrons non appariés d'atomes liés.
De plus, il existe un autre mécanisme de formation de liaisons. Considérons cela en utilisant l'exemple de l'interaction d'une molécule d'ammoniac avec une molécule de trifluorure de bore :


En conséquence, des liaisons covalentes et ioniques apparaissent entre les atomes d’azote et de bore. Dans ce cas, l’atome d’azote est donneur paire d'électrons ("le donne" pour la formation d'une liaison), et l'atome de bore - accepteur(« l’accepte » lors de l’établissement d’une connexion). D'où le nom du mécanisme pour la formation d'une telle connexion - " donneur-accepteur".
Lorsqu’une liaison est formée à l’aide du mécanisme donneur-accepteur, une liaison covalente et une liaison ionique se forment simultanément.
Bien sûr, après la formation d'une liaison, en raison de la différence d'électronégativité des atomes liés, la polarisation de la liaison se produit et des charges partielles apparaissent, réduisant les charges effectives (réelles) des atomes.

Regardons d'autres exemples.
S'il y a une molécule de chlorure d'hydrogène hautement polaire à côté de la molécule d'ammoniac, dans laquelle il y a une charge partielle importante sur l'atome d'hydrogène, alors dans ce cas, le rôle d'accepteur de paires d'électrons sera joué par l'atome d'hydrogène. C'est 1 s-AO, bien que pas complètement vide, comme l'atome de bore de l'exemple précédent, la densité électronique dans le nuage de cette orbitale est considérablement réduite.

La structure spatiale du cation résultant est ion ammonium NH 4 est similaire à la structure de la molécule de méthane, c'est-à-dire que les quatre liaisons N-H sont exactement les mêmes.
La formation de cristaux ioniques de chlorure d'ammonium NH 4 Cl peut être observée en mélangeant du gaz ammoniac avec du chlorure d'hydrogène gazeux :
NH 3 (g) + HCl (g) = NH 4 Cl (cr)
Non seulement l’atome d’azote peut être un donneur de paires d’électrons. Il peut s’agir par exemple de l’atome d’oxygène d’une molécule d’eau. Une molécule d’eau va interagir avec le même chlorure d’hydrogène comme suit :
Le cation H3O résultant est appelé ion oxonium et, comme vous l’apprendrez bientôt, est d’une grande importance en chimie.
En conclusion, considérons la structure électronique de la molécule monoxyde de carbone(monoxyde de carbone) CO :

En plus de trois liaisons covalentes (triple liaison), il contient également une liaison ionique.
Conditions de formation de liens selon le mécanisme donneur-accepteur :
1) la présence d'un doublet libre d'électrons de valence dans l'un des atomes ;
2) la présence d'une orbitale libre sur le sous-niveau de valence d'un autre atome.
Le mécanisme donneur-accepteur de formation de liens est assez répandu. Cela se produit particulièrement souvent lors de la formation de composés d-éléments. Les atomes de presque tout le monde d-les éléments ont de nombreuses orbitales de valence vides. Ce sont donc des accepteurs actifs de paires d’électrons.
MÉCANISME DONATEUR-ACCEPTEUR DE FORMATION DE LIEN, ION AMMONIUM, ION OXONIUM, CONDITIONS DE FORMATION DE LIEN PAR MÉCANISME DONATEUR-ACCEPTEUR.
1.Faire des équations de réaction et des schémas de formation
a) bromure d'ammonium NH 4 Br à partir d'ammoniac et de bromure d'hydrogène ;
b) sulfate d'ammonium (NH 4) 2 SO 4 à partir d'ammoniac et d'acide sulfurique.
2. Créer des équations de réaction et des schémas d'interaction pour a) l'eau avec le bromure d'hydrogène ; b) de l'eau avec de l'acide sulfurique.
3.Quels atomes dans les quatre réactions précédentes sont donneurs d’une paire d’électrons et lesquels sont accepteurs ? Pourquoi? Expliquez votre réponse avec des diagrammes de sous-niveaux de valence.
4. Formule développée de l'acide nitrique. Les angles entre les liaisons O – N – O sont proches de 120 o. Définir:
a) type d'hybridation de l'atome d'azote ;
b) quel AO de l'atome d'azote participe à la formation de la liaison - ;
c) quel AO de l'atome d'azote participe à la formation d'une liaison - selon le mécanisme donneur-accepteur.
À votre avis, à quoi est approximativement égal l’angle entre les liaisons H – O – N dans cette molécule ? 5.Créez la formule développée de l’ion cyanure CN (charge négative sur l’atome de carbone). On sait que les cyanures (composés contenant un tel ion) et le monoxyde de carbone CO sont des poisons puissants et que leur effet biologique est très similaire. Proposez votre explication sur la proximité de leur action biologique.
7.14. Connexion métallique. Les métaux
Une liaison covalente se forme entre des atomes dont la propension à abandonner et à gagner des électrons est similaire uniquement lorsque la taille des atomes liés est petite. Dans ce cas, la densité électronique dans la région des nuages d'électrons qui se chevauchent est importante et les atomes s'avèrent étroitement liés, comme par exemple dans la molécule HF. Si au moins un des atomes liés a un grand rayon, la formation d'une liaison covalente devient moins avantageuse, car la densité électronique dans la région des nuages d'électrons qui se chevauchent pour les gros atomes est bien inférieure à celle des petits. Un exemple d'une telle molécule avec une liaison plus faible est la molécule HI (en utilisant le tableau 21, comparez les énergies d'atomisation des molécules HF et HI).
Et pourtant entre les gros atomes ( r o > 1,1) une liaison chimique se produit, mais dans ce cas, elle est formée en raison du partage de tout (ou d'une partie) des électrons de valence de tous les atomes liés. Par exemple, dans le cas des atomes de sodium, les 3 s-électrons de ces atomes, et un seul nuage électronique se forme :

Les atomes forment un cristal avec métal communication
De cette façon, les atomes du même élément et les atomes d’éléments différents peuvent se lier les uns aux autres. Dans le premier cas, des substances simples appelées les métaux, et dans le second - des substances complexes appelées composés intermétalliques.
Parmi toutes les substances comportant des liaisons métalliques entre atomes, vous n’apprendrez les métaux qu’à l’école. Quelle est la structure spatiale des métaux ? Le cristal métallique est constitué de squelettes atomiques, restant après la socialisation des électrons de valence, et le nuage électronique d'électrons socialisés. Les noyaux atomiques forment généralement un empilement très serré et le nuage électronique occupe tout le volume libre restant du cristal.
Les principaux types d'emballages denses sont emballage cubique le plus proche(KPU) et emballage fermé hexagonal(GPU). Les noms de ces colis sont associés à la symétrie des cristaux dans lesquels ils sont réalisés. Certains métaux forment des cristaux peu compactés - cubique centré sur le corps(OTSK). Les modèles en volume et en boule et bâton de ces packages sont présentés à la figure 7.6.
L'emballage cubique serré est formé d'atomes de Cu, Al, Pb, Au et de quelques autres éléments. Emballage serré hexagonal - atomes de Be, Zn, Cd, Sc et plusieurs autres. Un emballage cubique d'atomes centré sur le corps est présent dans les cristaux métaux alcalins, éléments des groupes VB et VIB. Certains métaux peuvent avoir des structures différentes à différentes températures. Les raisons de ces différences et les caractéristiques structurelles des métaux ne sont pas encore entièrement comprises.
Une fois fondus, les cristaux métalliques se transforment en liquides métalliques. Le type de liaison chimique entre les atomes ne change pas.
La liaison métallique n'a ni directionnalité ni saturation. À cet égard, elle est similaire à une liaison ionique.
Dans le cas des composés intermétalliques, on peut également parler de polarisabilité de la liaison métallique.
Caractéristique propriétés physiques les métaux:
1) conductivité électrique élevée ;
2) conductivité thermique élevée ;
3) haute ductilité.

Les points de fusion des différents métaux sont très différents les uns des autres : le point de fusion le plus bas est celui du mercure (- 39 o C) et le plus élevé est celui du tungstène (3 410 o C).
| Béryllium Être- métal gris clair, léger, assez dur, mais généralement cassant. Point de fusion 1287 o C. Dans l'air, il se recouvre d'un film d'oxyde. Le béryllium est un métal assez rare, les organismes vivants en cours d'évolution n'ayant pratiquement aucun contact avec lui, il n'est donc pas surprenant qu'il soit toxique pour le monde animal. Il est utilisé dans la technologie nucléaire. Le zinc Zn est un métal mou blanc avec une teinte bleutée. Point de fusion 420 o C. Dans l'air et dans l'eau, il est recouvert d'un mince film dense oxyde de zinc, empêchant une oxydation ultérieure. En production, il est utilisé pour galvaniser des tôles, des tuyaux, des fils, protégeant le fer de la corrosion. Wolfram W. C'est le plus réfractaire de tous les métaux : le point de fusion du tungstène est de 3387°C. Typiquement, le tungstène est assez cassant, mais après un nettoyage soigneux, il devient ductile, ce qui permet d'en tirer un fil fin, à partir duquel les filaments de les ampoules sont fabriquées. Cependant, la majeure partie du tungstène produit est utilisée pour la production d'alliages durs et résistants à l'usure, capables de conserver ces propriétés lorsqu'ils sont chauffés même à 1 000 °C. |
MÉTAL, COMPOSÉ INTERMÉTALLIQUE, LIAISON MÉTALLIQUE, EMBALLAGE DENSE.
1. Pour caractériser divers emballages, la notion de « coefficient de remplissage de l'espace » est utilisée, c'est-à-dire le rapport entre le volume des atomes et le volume du cristal.
Où V un - volume d'un atome,
Z est le nombre d'atomes dans une maille unitaire,
VI- volume de la maille unitaire.
Les atomes dans ce cas sont représentés par des boules rigides de rayon R., se touchant. Volume de la balle V w = (4/3) R. 3 .
Déterminez le facteur de remplissage de l’espace pour les emballages en vrac et bcc.
2. À l'aide des valeurs des rayons métalliques (Annexe 9), calculez la taille de cellule unitaire de a) le cuivre (CPU), b) l'aluminium (CPU) et c) le césium (BCC).
Les trois principaux types de liaisons chimiques sont covalentes, ioniques et métalliques.
Apprenons-en davantage sur liaison chimique covalente. Considérons le mécanisme de son apparition. Prenons comme exemple la formation d'une molécule d'hydrogène :
Un nuage à symétrie sphérique formé par un électron 1s entoure le noyau d’un atome d’hydrogène libre. Lorsque les atomes s'approchent d'une certaine distance, leurs orbitales se chevauchent partiellement (voir figure),  en conséquence, un nuage moléculaire à deux électrons apparaît entre les centres des deux noyaux, qui a une densité électronique maximale dans l'espace entre les noyaux. Avec une augmentation de la densité de charge négative, il se produit une forte augmentation des forces d'attraction entre le nuage moléculaire et les noyaux.
en conséquence, un nuage moléculaire à deux électrons apparaît entre les centres des deux noyaux, qui a une densité électronique maximale dans l'espace entre les noyaux. Avec une augmentation de la densité de charge négative, il se produit une forte augmentation des forces d'attraction entre le nuage moléculaire et les noyaux.
Ainsi, nous voyons qu'une liaison covalente est formée par des nuages d'électrons d'atomes qui se chevauchent, ce qui s'accompagne d'une libération d'énergie. Si la distance entre les noyaux des atomes qui se rapprochent avant de se toucher est de 0,106 nm, alors après le chevauchement des nuages d'électrons, elle sera de 0,074 nm. Plus le chevauchement des orbitales électroniques est important, plus la liaison chimique est forte.
Covalent appelé liaison chimique réalisée par des paires d'électrons. Les composés avec des liaisons covalentes sont appelés homéopolaire ou atomique.
Exister deux types de liaisons covalentes: polaire Et non polaire.
Pour non polaire Dans une liaison covalente, le nuage électronique formé par une paire commune d’électrons est distribué symétriquement par rapport aux noyaux des deux atomes. Un exemple est celui des molécules diatomiques constituées d'un élément : Cl 2, N 2, H 2, F 2, O 2 et autres, dont la paire d'électrons appartient également aux deux atomes.
Chez polaire Dans une liaison covalente, le nuage électronique est déplacé vers l’atome ayant une électronégativité relative plus élevée. Par exemple, les molécules volatiles composés inorganiques tels que H 2 S, HCl, H 2 O et autres.
La formation d’une molécule HCl peut être représentée comme suit :
![]()
Parce que l'électronégativité relative de l'atome de chlore (2.83) est supérieure à celle de l'atome d'hydrogène (2.1), la paire d'électrons est décalée vers l'atome de chlore.
En plus du mécanisme d'échange de formation de liaisons covalentes - en raison du chevauchement, il existe également donneur-accepteur le mécanisme de sa formation. Il s'agit d'un mécanisme dans lequel la formation d'une liaison covalente se produit en raison du nuage à deux électrons d'un atome (donneur) et de l'orbitale libre d'un autre atome (accepteur). Regardons un exemple du mécanisme de formation de l'ammonium NH 4 +. Dans la molécule d'ammoniac, l'atome d'azote possède un nuage à deux électrons :
L'ion hydrogène a une orbitale libre de 1 s, notons-la .
Lors de la formation de l’ion ammonium, le nuage d’azote à deux électrons devient commun aux atomes d’azote et d’hydrogène, ce qui signifie qu’il est converti en un nuage d’électrons moléculaires. Par conséquent, une quatrième liaison covalente apparaît. Vous pouvez imaginer le processus de formation d’ammonium avec le schéma suivant : 
La charge de l’ion hydrogène est dispersée entre tous les atomes et le nuage à deux électrons appartenant à l’azote est partagé avec l’hydrogène.
Vous avez encore des questions ? Vous ne savez pas comment faire vos devoirs ?
Pour obtenir l'aide d'un tuteur -.
Le premier cours est gratuit !
blog.site, lors de la copie totale ou partielle du matériel, un lien vers la source originale est requis.