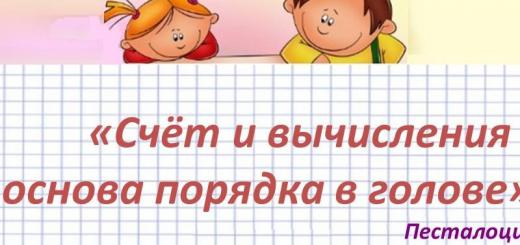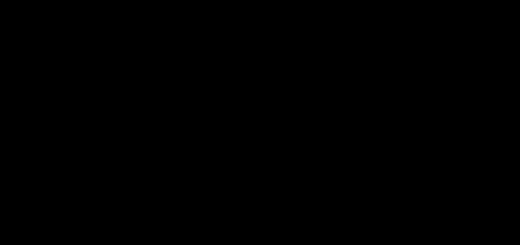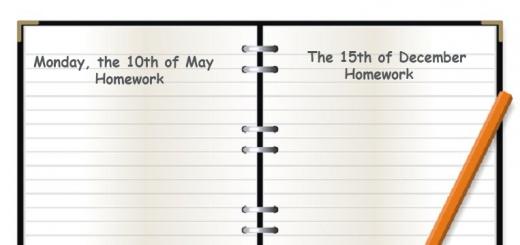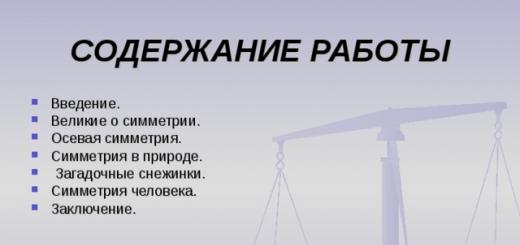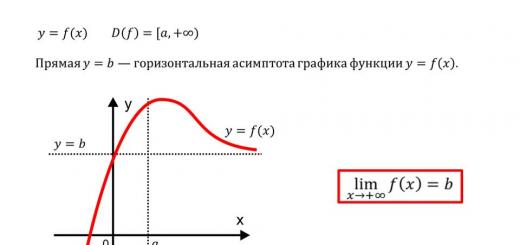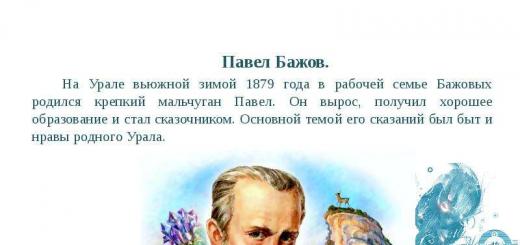Le syndicat allemand, qui a contrôlé pendant de nombreux siècles la plupart des transactions commerciales avec Londres, Veliky Novgorod, Riga, et a également signé des documents commerciaux au nom de l'empire marchand romain avec des conditions particulières pour chaque ville allemande - comme vous l'avez peut-être deviné, nous nous parlons de la Ligue hanséatique, dont l'histoire est décrite dans l'article.
Bref contexte historique
Il n’existe pas beaucoup d’exemples dans l’histoire de l’humanité qui démontrent des alliances volontaires et mutuellement bénéfiques conclues entre des pays ou des entreprises. Mais il convient de noter que bon nombre d’entre elles étaient fondées sur l’intérêt personnel et la cupidité de l’homme. Ces alliances furent donc de courte durée. Toute violation d’accords ou d’intérêts conduisait toujours à l’effondrement, mais l’histoire de la Ligue hanséatique n’est pas comme toutes les autres.
Cette union est une communauté de villes qui représentaient la force la plus importante de l'Europe du Nord et les partenaires égaux des pays souverains, mais il convient de noter que les intérêts des colonies qui faisaient partie de la Hanse étaient trop différents. Et la coopération économique n’est pas toujours devenue militaire ou politique. L'importance de la Ligue hanséatique ne peut être surestimée, car c'est ce phénomène de l'économie mondiale qui a jeté les bases du commerce international.

Comment est né le syndicat ?
Passons à l'étude de la question de l'émergence et de l'épanouissement d'une association professionnelle. La création de la Ligue Hanséatique remonte à 1267. C'était une réponse des marchands européens à la fragmentation des États européens au Moyen Âge. Ce phénomène politique était très risqué pour les entreprises. Les voleurs et les pirates opéraient le long des routes commerciales, et les princes, les églises et les dirigeants apanages imposaient des taxes élevées sur tous les biens conservés et apportés aux comptoirs commerciaux. Tout le monde voulait profiter du commerçant. Par conséquent, le vol qualifié a prospéré. Des règles commerciales absurdes permettaient d'imposer des amendes en cas de profondeur de pot ou de couleur de tissu inappropriée. Mais il convient de noter que l'Allemagne, utilisant les routes commerciales maritimes, a obtenu certains succès en matière de développement au début du XIe siècle. Le roi de Saxe offrait de bons avantages aux commerçants allemands à Londres.
En 1143, la ville de Lübeck fut fondée – le cœur de la future Ligue hanséatique. Bientôt le souverain céda Lübeck, qui devint ville impériale. Son pouvoir était reconnu par toutes les provinces du nord de l'Allemagne. Un peu plus tard, l'Union des marchands de Lübeck acquit des privilèges commerciaux dans de nombreux pays.
En 1158, la ville impériale prospéra rapidement alors qu'elle atteignait la mer Baltique avec le commerce, puis une société commerciale allemande fut fondée sur l'île de Gotland. Gotland jouissait d'une situation maritime favorable. Ainsi, les navires entraient dans ses ports pour que les équipages puissent se reposer et que le navire puisse être mis en ordre.
Cent ans plus tard, en 1241, les alliances commerciales de Lübeck et de Hambourg concluent un accord pour protéger les routes commerciales entre la Baltique et la mer du Nord. Ainsi, en 1256, le premier groupe commercial de villes côtières se forme.

Villes de la Ligue hanséatique
En 1267, une union unique de villes faisant partie de la Hanse est formée :
- Lübeck ;
- Hambourg;
- Brême ;
- Eau de Cologne;
- Gdansk ;
- Riga;
- Lunebourg ;
- Wismar ;
- Rostock et autres.
On sait que l’année de la création de la Ligue hanséatique, elle comprenait jusqu’à 70 villes. Les membres du syndicat ont décidé que toutes les affaires représentatives seraient menées par Lübeck, puisque ses sénateurs et bourgmestres étaient considérés comme plus capables de gérer les affaires commerciales. De plus, c’est cette ville qui assumait à son tour les coûts de protection des navires.

Avantages et inconvénients
Les dirigeants de la Ligue hanséatique ont très habilement utilisé les circonstances positives pour prendre le contrôle des affaires commerciales dans la mer du Nord et dans la mer Baltique. Ils en ont habilement fait un monopole. Ainsi, ils avaient la possibilité de fixer le prix des marchandises à leur propre discrétion et cherchaient également à gagner de l'influence dans les pays où ils présentaient un intérêt, ainsi qu'à divers privilèges. Par exemple, le droit d’organiser librement des colonies et du commerce ; le droit d'acheter des maisons et des cours avec représentation de juridiction.
Il y a eu des cas où des dirigeants du syndicat expérimentés, politiquement talentueux et prudents ont habilement profité des faiblesses et de la situation difficile des pays voisins. Ils placent indirectement ou directement l’État dans une position de dépendance pour atteindre les résultats souhaités.
Expansion de l'Union. Trois blocs principaux
Malgré toutes les manipulations effectuées par les bourgmestres et les sénateurs, la composition de la Ligue hanséatique ne cesse de s'élargir. Maintenant, d'autres villes ont commencé à être incluses :
- Amsterdam ;
- Berlin;
- Hambourg;
- Francfort ;
- Brême ;
- Eau de Cologne;
- Hanovre ;
- Kœnigsberg ;
- Dantzig ;
- Mémel;
- Yuriev ;
- Narva;
- Stockholm ;
- Volène ;
- Pomorie et d'autres villes.
Le syndicat est devenu grand. Les villes nouvellement annexées durent être divisées en groupes. Désormais, toutes les villes qui faisaient partie de la Hanse étaient conditionnellement divisées en trois districts :
- Est : terres de Lübeck, Hambourg, Stettin, etc.
- Ouest : territoires de Cologne, Dortmund, Groningue.
- Provinces baltes.

Expulsion du syndicat
Une autre technique efficace pour conserver les partenaires commerciaux dans l’alliance. Le fait est qu'il était extrêmement difficile de maintenir dans une seule union les villes côtières, ainsi que diverses villes dispersées du golfe de Finlande à l'Allemagne. Après tout, les intérêts des partenaires étaient très différents et seul un intérêt commun pouvait servir d’élément de liaison. La seule façon de garder un partenaire était de l'exclure. Cela impliquait l'interdiction pour les membres restants du syndicat d'avoir des relations avec la ville exilée, ce qui conduisait inévitablement à la rupture de diverses relations avec elle.
Cependant, aucune autorité au sein du syndicat ne pouvait contrôler la mise en œuvre de ces instructions. Diverses réclamations et plaintes n'étaient déposées que lors des congrès des villes alliées, qui se réunissaient de temps en temps. Des représentants de toutes les villes dont les intérêts le désiraient venaient à ces congrès. Avec les villes portuaires, la méthode d’exclusion s’est avérée très efficace. Par exemple, en 1355, la ville allemande de Brême annonce sa volonté de s’isoler. En conséquence, il a quitté le syndicat avec d'énormes pertes et, trois ans plus tard, a exprimé le désir d'y réintégrer.
Idées supplémentaires sur la Hansa
Les fondateurs du syndicat ont réagi avec souplesse aux défis de l’époque. Très rapidement et activement, ils ont étendu leur influence. Et plusieurs siècles après sa fondation, elle comprenait près de deux cents villes. Le développement de la Hanse a été facilité par un système monétaire unifié, l'égalité des langues autochtones, ainsi que l'égalité des droits pour les habitants des villes de cette union.
Il est à noter que les Hansiens diffusaient des idées sur un mode de vie sain. Ils ont activement mis en œuvre l’étiquette commerciale qu’ils représentaient. Des clubs ont été ouverts où les commerçants échangeaient leurs expériences et leurs idées commerciales, et diffusaient également diverses technologies pour la production de produits et de biens. Les écoles pour artisans débutants, ouvertes sur le territoire de la Ligue hanséatique, sont devenues populaires. On pense que pour L'Europe médiévale c'était une innovation. De nombreux chercheurs notent que la Hanse a formé l’image civilisée de l’Europe moderne que nous connaissons aujourd’hui.

Relations commerciales avec la Russie
Ce type de relation a commencé au 14ème siècle. La Ligue hanséatique et ses liens avec la Russie ont profité à tous. Les fourrures et la cire, le cuir, la soie, le lin et les peaux d'écureuil étaient exportés des terres russes, et les marchands russes achetaient principalement du sel et des tissus. Le plus souvent, ils achetaient du lin, du satin, du tissu et du velours.
Les bureaux hanséatiques étaient situés dans deux villes russes : Novgorod et Pskov. Les marchands étrangers étaient très intéressés par la cire. Le fait est que les Européens ne savaient pas comment le produire dans la quantité et la qualité requises. Il était également d'usage chez les catholiques de sculpter dans ce matériau la partie du corps touchée par la maladie. Le commerce des armes et des métaux non ferreux a toujours été considéré comme une pierre d’achoppement dans les relations commerciales. Il était rentable pour la Ligue hanséatique de vendre des armes aux terres russes, et l'Ordre de Livonie craignait la croissance du pouvoir des Slaves. En conséquence, il a interféré avec ce processus. Mais comme vous l’aurez deviné, les intérêts commerciaux prévalaient le plus souvent sur les intérêts de Levon. Par exemple, une transaction commerciale a eu lieu lorsqu'en 1396 des marchands de Revel ont importé des armes dans des barils de poisson à Pskov et Novgorod.

Conclusion
Le moment est certainement venu où la Ligue hanséatique a commencé à perdre sa domination sur les villes européennes. Cela a commencé au 16ème siècle. La Russie et l'Espagne ont quitté l'union. La Hanse a tenté à plusieurs reprises d'établir des relations avec ces États, mais toutes les tentatives ont été vaines et la guerre, qui a duré 30 ans, a ruiné les restes de la puissance allemande en mer. L’effondrement d’un syndicat est un long processus qui nécessite une réflexion distincte.
Dans l’histoire de l’humanité moderne, il existe une nouvelle Ligue hanséatique appelée Union européenne. L'expérience de la Ligue hanséatique est restée longtemps méconnue, mais la région baltique se développe aujourd'hui de manière très dynamique et est appréciée car ces terres possèdent tout ce qui est nécessaire à des relations mutuellement bénéfiques entre l'Union européenne et la Russie. Les experts et les économistes estiment que la Nouvelle Ligue Hanséatique contribue au développement des relations de la Russie avec les pays baltes.
Ligue hanséatique
« Avec un accord, les petites choses se transforment en grandes ;
en cas de désaccord, même les plus grands s’effondrent.(Salluste.)
Dmitri VOINOV
Dans l’histoire du monde, il n’existe pas beaucoup d’exemples d’alliances volontaires et mutuellement bénéfiques conclues entre des États ou des entreprises. En outre, l’écrasante majorité d’entre elles étaient fondées sur l’intérêt personnel et la cupidité. Et, par conséquent, ils se sont tous avérés de très courte durée. Tout déséquilibre des intérêts dans une telle alliance conduisait invariablement à son effondrement. De nos jours, les exemples rares de coalitions fortes et à long terme, où toutes les actions des partis étaient subordonnées aux idées de coopération et de développement, sont d'autant plus attrayants pour la compréhension et pour tirer des leçons instructives.
Dans l'histoire de l'Europe, la Ligue hanséatique, qui a existé avec succès pendant environ quatre siècles, peut pleinement devenir un tel modèle. Des États se sont effondrés, de nombreuses guerres ont commencé et se sont terminées, frontières politiquesÉtats du continent, mais l'union commerciale et économique des villes du nord-est de l'Europe a vécu et s'est développée.
Comment est né le nom " Hanse"On ne le sait pas exactement. Il existe au moins deux versions parmi les historiens. Certains pensent que Hanse est un nom gothique et signifie « une foule ou un groupe de camarades », d'autres pensent qu'il est basé sur un mot du moyen bas allemand traduit par « union ou partenariat ». Dans tous les cas, l’idée du nom impliquait une sorte d’« unité » au nom d’objectifs communs.
L'histoire de la Hanse remonte à la fondation en 1158 (ou, selon d'autres sources, en 1143) de la ville balte Lübeck. Par la suite, c'est lui qui deviendra la capitale de l'union et un symbole de la puissance des marchands allemands. Avant la fondation de la ville, ces terres furent pendant trois siècles la zone d'influence des pirates normands, qui contrôlaient toute la côte de cette partie de l'Europe. Pendant longtemps, les bateaux scandinaves légers sans pont, dont les marchands allemands ont adopté et adapté le design pour le transport de marchandises, ont rappelé leur force d'antan. Leur capacité était petite, mais la maniabilité et la vitesse étaient tout à fait adaptées aux marins marchands jusqu'au 14ème siècle, lorsqu'ils furent remplacés par des navires plus lourds à plusieurs ponts, capables de transporter beaucoup plus de marchandises.
L’Union des marchands hanséatiques ne prend pas forme tout de suite. Cela a été précédé par plusieurs décennies de compréhension de la nécessité de combiner leurs efforts pour le bien commun. La Ligue hanséatique fut la première association commerciale et économique de l’histoire européenne. Au moment de sa création, il y avait plus de trois mille centres commerciaux sur la côte des mers du Nord. Les faibles guildes marchandes de chaque ville ne pouvaient à elles seules créer les conditions d’un commerce sûr. Dans un pays fragmenté déchiré par des guerres intestines Allemagne, où les princes n'hésitaient pas à se livrer au vol ordinaire et au vol pour reconstituer leur trésor, la position du marchand n'était pas enviable. Dans la ville même, il était libre et respecté. Ses intérêts étaient protégés par la guilde marchande locale, où il pouvait toujours trouver le soutien de ses compatriotes. Mais après avoir dépassé le fossé défensif de la ville, le marchand se retrouva seul face aux nombreuses difficultés rencontrées en cours de route.
Même arrivé à destination, le commerçant prenait encore de gros risques. Chaque cité médiévale avait ses propres lois et des règles commerciales strictement réglementées. La violation d'un point parfois, même insignifiant, pourrait menacer de graves pertes. Le scrupule des législateurs locaux a atteint le point de l'absurdité. Ils déterminaient la largeur du tissu ou la profondeur des pots en argile, l'heure à laquelle le commerce pouvait commencer et quand il devait se terminer. Les corporations marchandes étaient jalouses de leurs concurrents et tendaient même des embuscades aux abords de la foire, détruisant leurs marchandises.
Avec le développement des villes, la croissance de leur indépendance et de leur pouvoir, le développement de l'artisanat et l'introduction de méthodes de production industrielles, le problème de la vente est devenu de plus en plus urgent. Par conséquent, les marchands ont de plus en plus eu recours à la conclusion d'accords personnels entre eux sur le soutien mutuel dans les pays étrangers. Certes, dans la plupart des cas, ils étaient temporaires. Les villes se disputaient souvent, se ruinaient, brûlaient, mais l'esprit d'entreprise et de liberté n'a jamais quitté leurs habitants.
Des facteurs externes ont également joué un rôle important dans l’unification des villes au sein de la Hanse. D’une part, les mers étaient pleines de pirates et il était presque impossible de leur résister seul. D’un autre côté, Lübeck, en tant que centre émergent de « camaraderie », avait des concurrents majeurs sous la forme de Eau de Cologne, Munster et d'autres villes allemandes. Ainsi, le marché anglais était pratiquement occupé par les marchands de Cologne. Avec la permission d'Henri III, ils fondèrent leur propre bureau à Londres en 1226. Les marchands de Lübeck ne restèrent pas endettés. L'année suivante, Lübeck cherche Empereur allemand le privilège d'être appelé impérial, ce qui signifie qu'elle est devenue propriétaire du statut de ville libre, ce qui lui a permis de mener de manière indépendante ses affaires commerciales. Peu à peu, il devient le principal port de transbordement de la Baltique. Pas un seul navire voyageant de la mer Baltique à la mer du Nord ne pouvait passer par son port. L'influence de Lübeck s'est encore accrue après que les commerçants locaux ont pris le contrôle des mines de sel de Lunebourg situées à proximité de la ville. À cette époque, le sel était considéré comme un produit presque stratégique, dont le monopole permettait à des principautés entières de dicter leur volonté.
Il a pris le parti de Lübeck lors de la confrontation avec Cologne Hambourg, mais il fallut de nombreuses années avant que, en 1241, ces villes ne concluent un accord entre elles pour protéger leur commerce. Le premier article de l'accord, signé à la mairie de Lübeck, disait : « Si des voleurs et d'autres personnes malveillantes se soulèvent contre nos habitants ou contre leurs habitants... alors nous devons, sur la même base, participer aux coûts et dépenses du destruction et éradication de ces voleurs. L’essentiel est le commerce, sans obstacles ni restrictions. Chaque ville était tenue de protéger la mer des pirates « au mieux de ses possibilités, afin d’exercer son commerce ». 15 ans plus tard, ils ont été rejoints Lunebourg Et Rostock.
En 1267, Lübeck avait déjà accumulé suffisamment de force et de ressources pour déclarer ouvertement ses prétentions sur une partie du marché anglais. La même année, usant de toute son influence à la cour royale, la Hanse ouvre une mission commerciale à Londres. Dès lors, les marchands scandinaves commencent à résister dans l’immensité de la mer du Nord. force puissante. Au fil des années, il deviendra plus fort et multipliera par mille. La Ligue hanséatique ne déterminera pas seulement les règles du commerce, mais influencera souvent aussi activement l'équilibre des forces politiques dans les pays frontaliers, du Nord à la mer Baltique. Il a acquis le pouvoir petit à petit - parfois à l'amiable, en concluant des accords commerciaux avec les monarques des États voisins, mais parfois par des actions violentes. Même une ville aussi grande selon les normes du Moyen Âge que Cologne, qui était monopole du commerce germano-anglais, fut contrainte de se rendre et de signer un accord pour rejoindre la Hanse. En 1293, 24 villes officialisent leur adhésion au partenariat.
UNION DES COMMERÇANTS HANSEA
Les marchands de Lübeck purent célébrer leur victoire totale. Une confirmation claire de leur force fut l'accord signé en 1299, dans lequel les représentants Rostock, Hambourg, Wismar, Lunebourg Et Stralsund a décidé que "à partir de maintenant, ils ne serviront plus le voilier d'un marchand qui n'est pas membre de la Hanse". C'était une sorte d'ultimatum adressé à ceux qui n'avaient pas encore adhéré au syndicat, mais en même temps un appel à la coopération. Dès le début du XIVe siècle, la Hanse devint un monopole collectif du commerce en Europe du Nord. La simple mention par un commerçant de son implication dans cette entreprise constituait la meilleure recommandation pour de nouveaux partenaires. En 1367, le nombre de villes participant à la Ligue hanséatique était passé à quatre-vingts. En plus Londres ses bureaux de vente étaient à Bergen Et Bruges, Pskov Et Venise, Novgorod Et Stockholm. Les marchands allemands étaient les seuls commerçants étrangers qui possédaient leur propre complexe commercial à Venise et pour lesquels les villes du nord de l'Italie reconnaissaient le droit de libre navigation dans la mer Méditerranée.
Les bureaux que la Hanse entretenait étaient des points fortifiés communs à tous les marchands hanséatiques. En pays étranger, ils étaient protégés par des privilèges accordés par les princes ou les municipalités locales. En tant qu'invités de ces comptoirs commerciaux, tous les Allemands étaient soumis à une discipline stricte. La Hanse gardait très sérieusement et jalousement ses possessions. Dans presque toutes les villes où faisaient du commerce les marchands de l'union, et plus encore dans les centres administratifs frontaliers qui n'en faisaient pas partie, un système d'espionnage s'est développé. Toute action des concurrents dirigée contre eux était connue presque immédiatement.
Parfois, ces comptoirs commerciaux dictaient leur volonté à des États entiers. Dès que les droits syndicaux ont été violés d'une manière ou d'une autre à Bergen, en Norvège, des restrictions sur l'approvisionnement en blé de ce pays sont immédiatement entrées en vigueur et les autorités n'ont eu d'autre choix que de reculer. Même à l’ouest, où la Hanse avait affaire à des partenaires plus puissants, elle a réussi à s’approprier d’importants privilèges. Par exemple, à Londres, la « Cour allemande » possédait ses propres quais et entrepôts et était exonérée de la plupart des taxes et frais. Ils avaient même leurs propres juges, et le fait que les Hanséatiques aient été chargés de garder l’une des portes de la ville témoigne non seulement de leur influence sur la couronne anglaise, mais aussi du respect incontestable dont ils jouissaient dans les îles britanniques.
C'est à cette époque que les marchands hanséatiques commencèrent à organiser leurs fameuses foires. Ils ont eu lieu à Dublin et Oslo, Francfort et Poznan, Plymouth et Prague, Amsterdam et Narva, Varsovie et Vitebsk. Des dizaines de villes européennes attendaient avec impatience leur ouverture. Parfois, c'était la seule possibilité pour les résidents locaux d'acheter ce qu'ils voulaient. Ici, on achetait des choses pour lesquelles les familles, se privant du nécessaire, économisaient de l'argent pendant plusieurs mois. Les galeries marchandes regorgeaient d'articles ménagers de luxe oriental, raffinés et exotiques. Là, le lin flamand rencontrait la laine anglaise, le cuir d'Aquitaine avec le miel russe, le cuivre chypriote avec l'ambre lituanien, le hareng islandais avec le fromage français et le verre vénitien avec les lames de Bagdad.
Les marchands comprenaient parfaitement que les bois, cires, fourrures, seigles et bois d'œuvre de l'Europe de l'Est et du Nord n'avaient de valeur que s'ils étaient réexportés vers l'ouest et le sud du continent. Dans la direction opposée, il y avait du sel, du tissu et du vin. Ce système, simple et robuste, rencontrait cependant de nombreuses difficultés. Ce sont ces difficultés à surmonter qui ont permis de fusionner l’ensemble des villes hanséatiques.
La force du syndicat a été mise à l’épreuve à de nombreuses reprises. Après tout, il y avait en lui une certaine fragilité. Les villes - et leur nombre à leur apogée atteignait 170 - étaient éloignées les unes des autres, et les rares réunions de leurs délégués aux ganzatags généraux (diètes) ne pouvaient pas résoudre toutes les contradictions qui surgissaient périodiquement entre elles. Derrière la Hanse ne se trouvaient ni l'État ni l'Église, seulement la population des villes, jalouse de ses prérogatives et fière d'elles.
La force naissait d’une communauté d’intérêts, de la nécessité de jouer le même jeu économique, de l’appartenance à une « civilisation » commune impliquée dans le commerce dans l’un des espaces maritimes les plus peuplés d’Europe. Un élément important de l'unité était une langue commune, basée sur le bas allemand, enrichie de latin, de polonais, d'italien et même de en mots ukrainiens. Des familles de marchands transformées en clans se trouvaient à Reval, Gdansk et Bruges. Tous ces liens ont donné naissance à la cohésion, à la solidarité, aux habitudes communes et à la fierté commune, aux restrictions communes à tous.
Dans les riches villes de la Méditerranée, chacun pouvait jouer son propre jeu et lutter farouchement avec ses semblables pour avoir une influence sur les routes maritimes et obtenir des privilèges exclusifs dans le commerce avec d'autres pays. Dans la Baltique et en mer du Nord, cela était beaucoup plus difficile à réaliser. Les revenus générés par les marchandises lourdes, volumineuses et bon marché sont restés modestes, tandis que les coûts et les risques étaient d’un niveau sans précédent. Contrairement aux grands centres commerciaux du sud de l’Europe, comme Venise ou Gênes, les commerçants du Nord disposaient d’une marge bénéficiaire de 5 % au mieux. Dans ces régions, plus qu'ailleurs, il fallait tout calculer clairement, tout économiser et tout prévoir.
DÉBUT DU COUCHER DU SOLEIL
L'apogée de Lübeck et de ses villes associées eut lieu assez tardivement, entre 1370 et 1388. En 1370, la Hanse maîtrisa le roi du Danemark et occupa les forteresses du détroit danois, et en 1388, dans un conflit avec Bruges, après un blocus efficace, elle força cette riche ville et le gouvernement hollandais à capituler. Cependant, déjà à cette époque, les premiers signes d’un déclin du pouvoir économique et politique de l’union sont apparus. Au fil des décennies, ils deviendront plus évidents. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, une grave crise économique a éclaté en Europe après qu'une épidémie de peste ait balayé le continent. Elle est entrée dans les annales de l’histoire sous le nom de Peste noire. Certes, malgré le déclin démographique, la demande de marchandises en provenance du bassin de la mer Baltique en Europe n'a pas diminué et a même augmenté aux Pays-Bas, qui n'ont pas été gravement touchés par la peste. Mais c’est l’évolution des prix qui a fait une cruelle plaisanterie à la Hanse. Après 1370, les prix des céréales ont commencé à baisser progressivement, puis, à partir de 1400, la demande de fourrures a également diminué fortement. Dans le même temps, le besoin en produits industriels, dans lesquels les Hanséatiques n'étaient pratiquement pas spécialisés, a considérablement augmenté. En termes modernes, la base de l'entreprise était constituée de matières premières et de produits semi-finis. A cela s'ajoute le début du déclin des mines d'or et d'argent lointaines, mais si nécessaires à l'économie hanséatique, en République tchèque et en Hongrie. Et enfin, la principale raison du début du déclin de la Hanse était le changement des conditions étatiques et politiques en Europe. Dans la zone d'intérêts commerciaux et économiques de la Hanse, des États nationaux territoriaux commencent à renaître : le Danemark, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Pologne et l'État de Moscou. Forts du soutien des dirigeants, les marchands de ces pays ont commencé à étendre la Hanse à travers les mers du Nord et la Baltique.
Certes, les attentats ne sont pas restés impunis. Certaines villes de la Ligue hanséatique se défendent obstinément, comme Lübeck qui prend le dessus sur l'Angleterre en 1470-1474. Mais il s’agissait de cas plutôt isolés : la plupart des autres villes de l’union préféraient s’entendre avec de nouveaux commerçants, redistribuer les sphères d’influence et élaborer de nouvelles règles d’interaction. L'Union a été obligée de s'adapter.
La Hanse subit sa première défaite face à l'État de Moscou, qui gagnait en force. Ses relations avec les marchands de Novgorod durent plus de trois siècles : les premiers accords commerciaux entre eux remontent au XIIe siècle. Pendant une si longue période, Veliky Novgorod est devenue une sorte d'avant-poste de la Hanse non seulement dans le nord-est de l'Europe, mais également sur les terres des peuples slaves. La politique d'Ivan III, qui cherchait à unir les principautés russes fragmentées, devait tôt ou tard entrer en conflit avec la position indépendante de Novgorod. Dans cette confrontation, les marchands hanséatiques ont adopté une position extérieurement attentiste, mais ont secrètement aidé activement l'opposition de Novgorod dans la lutte contre Moscou. Ici, la Hanse a mis au premier plan ses propres intérêts, principalement commerciaux. Il était beaucoup plus facile d'obtenir des privilèges des boyards de Novgorod que du puissant État de Moscou, qui ne voulait plus avoir d'intermédiaires commerciaux et perdre des bénéfices en exportant des marchandises vers l'Occident.
Avec la perte de l'indépendance de la République de Novgorod en 1478, Ivan III liquida la colonie hanséatique. Après cela, une partie importante des terres caréliennes, qui appartenaient aux boyards de Novgorod, sont devenues partie intégrante de l'État russe, avec Novgorod. Depuis lors, la Ligue hanséatique a pratiquement perdu le contrôle des exportations russes. Cependant, les Russes eux-mêmes n’ont pas pu profiter de tous les avantages d’un commerce indépendant avec les pays du nord-est de l’Europe. En termes de quantité et de qualité des navires, les marchands de Novgorod ne pouvaient rivaliser avec la Hanse. Par conséquent, les volumes d’exportation ont diminué et Veliky Novgorod elle-même a perdu une partie importante de ses revenus. Mais la Hanse n'a pas pu compenser la perte du marché russe et, surtout, de l'accès aux matières premières stratégiques - le bois, la cire et le miel.
Le prochain coup dur qu'elle reçut vint de l'Angleterre. Renforçant son pouvoir unique et aidant les marchands anglais à se libérer de leurs concurrents, la reine Elizabeth Ier ordonna la liquidation du tribunal de commerce hanséatique « Steelyard ». Dans le même temps, tous les privilèges dont disposaient les marchands allemands dans ce pays furent détruits.
Les historiens attribuent le déclin de la Hanse à l'infantilisme politique de l'Allemagne. Le pays fragmenté a d’abord joué un rôle positif dans le sort des villes hanséatiques : personne ne les a simplement empêchées de s’unir. Les villes, qui se réjouissaient au départ de leur liberté, sont restées livrées à elles-mêmes, mais dans des conditions complètement différentes, lorsque leurs rivales d'autres pays ont obtenu le soutien de leurs États. Une raison importante de ce déclin était le retard économique de l'Europe du Nord-Est par rapport à l'Europe occidentale, déjà évident au XVe siècle. Contrairement aux expériences économiques de Venise et de Bruges, la Hanse hésitait encore entre le troc en nature et en argent. Les villes recouraient rarement aux prêts, se concentrant principalement sur leurs fonds propres et leur solidité, avaient peu confiance dans les systèmes de paiement des factures et ne croyaient sincèrement qu'au pouvoir de la pièce d'argent.
Le conservatisme des marchands allemands leur a finalement joué une cruelle plaisanterie. N’ayant pas réussi à s’adapter aux nouvelles réalités, le « marché commun » médiéval a cédé la place à des associations de commerçants uniquement sur une base nationale. Depuis 1648, la Hanse a complètement perdu son influence sur l'équilibre des forces dans le domaine du commerce maritime. Le dernier Hansentag ne fut assemblé qu'en 1669. Après une discussion animée, sans résoudre les contradictions accumulées, la plupart des délégués ont quitté Lübeck avec la ferme conviction de ne plus jamais se revoir. Désormais, chaque ville souhaite mener ses affaires commerciales de manière indépendante. Le nom des villes hanséatiques n'a été retenu que par Lübeck, Hambourg et Brême pour rappeler l'ancienne gloire de l'union.
L’effondrement de la Hanse mûrissait objectivement au plus profond de l’Allemagne elle-même. Au XVe siècle, il devint évident que la fragmentation politique des terres allemandes, l'arbitraire des princes, leurs querelles et leurs trahisons devenaient un frein sur le chemin. développement économique. Certaines villes et régions du pays ont progressivement perdu les liens établis depuis des siècles. Il n'y avait pratiquement aucun échange de marchandises entre les terres de l'Est et de l'Ouest. Les régions du nord de l'Allemagne, où l'élevage ovin était principalement développé, avaient également peu de contacts avec les régions industrielles du sud, de plus en plus orientées vers les marchés des villes d'Italie et d'Espagne. La poursuite du développement des relations commerciales mondiales de la Hanse a été entravée par l'absence d'un marché intérieur unique. Il est progressivement devenu évident que le pouvoir de l’union reposait davantage sur les besoins du commerce extérieur que sur celui du commerce intérieur. Cette tendance a finalement « coulé » après que les pays voisins ont commencé à développer de plus en plus de relations capitalistes et à protéger activement leurs marchés intérieurs de leurs concurrents.
Formation et essor de la Ligue hanséatique
Cette période fut généralement extrêmement importante pour la navigation allemande. En 1158, la ville de Lübeck, qui atteignit rapidement une brillante prospérité grâce au développement accru du commerce dans la mer Baltique, fonda une société commerciale allemande à Visby, sur Gotland ; cette ville était située approximativement à mi-chemin entre la Trave et la Neva, le Sound et le golfe de Riga, la Vistule et le lac Mälar, et grâce à cette position, ainsi qu'au fait qu'à cette époque, en raison de l'imperfection de la navigation, les navires évitaient les longs passages, ils commencèrent à y entrer dans toutes les escales des navires, et cela acquit ainsi une grande importance.
La même année, des marchands de Brême débarquèrent dans le golfe de Riga, ce qui marqua le début de la colonisation de la région baltique, qui fut ensuite perdue par l'Allemagne lorsque sa puissance maritime déclina. Vingt ans plus tard, le moine augustin Meinhard y fut envoyé de Brême pour convertir les indigènes au christianisme, et vingt ans plus tard, les croisés de Basse-Allemagne arrivèrent en Livonie, conquirent ce pays et fondèrent Riga. Ainsi, au moment même où les Hohenstaufen menaient de nombreuses campagnes romaines avec d'immenses armées allemandes, où l'Allemagne alignait des armées pour les croisades successives en Terre Sainte, les navigateurs bas-allemands commençaient cette vaste entreprise et la menaient à son terme. La création de sociétés commerciales marqua le début de la Hanse. Le mot « Hansa » est d'origine gothique flamande et signifie « partenariat », c'est-à-dire « une union dans un but précis avec certaines contributions ». La première Hanse est née en Flandre, où en 1200 dans la ville de Bruges, qui était alors la première ville commerçante du nord, un partenariat de 17 villes fut formé, avec une certaine charte, qui effectuait le commerce de gros avec l'Angleterre et était appelé la Hanse flamande ; Ce partenariat n’a cependant pas acquis une indépendance politique.
Le premier élan pour la formation de la Hanse allemande est venu de Visby, où, en 1229, des marchands allemands, représentants de nombreuses villes commerciales allemandes, dont les villes portuaires de Lübeck, Brême, Riga et Groningen et certaines villes de l'intérieur des terres, comme Münster, Dortmund, Zesta, a conclu un accord avec le prince de Smolensk ; c'était la première représentation de la « société des marchands allemands » ; le mot « Hansa » est entré en usage bien plus tard.
Ainsi, Visby a acquis un avantage sur Villes allemandes, mais cet avantage passa bientôt à Lübeck, qui devint en 1226 une ville impériale libre et expulsa la garnison danoise. En 1234, la ville fut encerclée par les Danois sur terre et sur mer et commença à préparer ses « rouages » pour la bataille ; Ces navires ont brisé les chaînes qui bloquaient la rivière Trave, ont attaqué de manière inattendue la flotte de blocus et l'ont complètement détruite. Il s’agit d’ailleurs de la première victoire navale allemande remportée face à des forces supérieures. Ce succès majeur, par lequel on peut juger de la force et de la belligérance de la flotte de Lübeck, donne à la ville le droit de prendre une place de premier plan. Bientôt, en 1241, Lübeck conclut une alliance avec Hambourg pour entretenir une flotte aux frais communs afin de maintenir la liberté de communication par mer, c'est-à-dire d'exercer les fonctions de police maritime dans les eaux allemandes et danoises, la surveillance policière se référant principalement à les Danois eux-mêmes. Ainsi, ces deux villes assumèrent l'une des tâches principales de la marine.
Quelques années plus tard, pendant la guerre avec le Danemark, la flotte de Lübeck dévasta la côte danoise, incendia le château de Copenhague et détruisit Stralsund, qui appartenait alors au Danemark. Par la suite, cette flotte fut à son tour vaincue, mais la paix conclue en 1254 fut néanmoins bénéfique pour Lübeck. Ce fut le début de cette période difficile où l'Allemagne se retrouva sans empereur, l'époque du long interrègne qui accompagna la fin de la dynastie des Hohenstaufen, pendant laquelle régnait une horrible tyrannie en Allemagne. Jusqu'à cette époque, les villes allemandes, en cas de désaccords avec des États étrangers, comptaient toujours sur les princes allemands, qui devaient cependant payer cher pour l'aide qu'ils fournissaient ; à partir de ce moment, ces villes ne devaient plus compter que sur elles-mêmes.
L'art et la confiance acquis par la « société des marchands allemands » ont créé pour les Allemands, partout où ils faisaient du commerce, une position de leader et de larges privilèges : à Bruges en Flandre, à Londres, à Bergen en Norvège, en Suède, ainsi qu'à ainsi qu'en Russie, où A cette époque, un très grand centre commercial est apparu à Novgorod, relié par voie fluviale à la Neva. C'était le plus Grande ville en Russie, qui comptait environ 400 000 habitants (à la fin du XIXe siècle, il n'y en avait plus que 21 000). Dans chacune de ces villes, les Allemands avaient leur propre bureau, ils possédaient de grandes fermes et même des pâtés de maisons entiers bénéficiant de droits spéciaux, de refuges avec leur propre juridiction, etc. La mer Baltique jusqu'à Bruges et Londres était très étendue et rapportait de gros profits. Dans ces bureaux, de jeunes commerçants allemands vivaient et apprenaient auprès de vieux commerçants expérimentés, qui y acquéraient des compétences en matière commerciale et une expérience du monde, ainsi que des relations politiques et personnelles dont ils avaient besoin pour devenir plus tard chef d'une maison de commerce ou même ville natale et Hansa. De grands marchands et des renforçateurs venaient aussi souvent de leur pays d'origine, qui à cette époque effectuaient souvent personnellement des achats plus importants.
A cette époque, Lübeck, en tant que chef naturel de l'union, commença à conclure, sans autorisation particulière, au nom de « tous les marchands de l'Empire romain », des traités dans lesquels des avantages égaux étaient négociés pour toutes les villes allemandes. Contrairement au particularisme égoïste habituel des Allemands, une vision étatique large et noble de la cause et une conscience de la communauté des intérêts nationaux s'exprimaient ici. En tout cas, ce succès, où le sentiment national a triomphé des intérêts opposés des villes individuelles, doit s'expliquer par un long séjour dans des pays étrangers, dont la population a toujours considéré les Allemands, quelle que soit leur origine, comme des rivaux et même des ennemis. Car il n’y a pas de meilleur moyen d’éveiller et de renforcer le sentiment national d’une personne que de l’envoyer à l’étranger.
Dans le même temps, sous l'influence du pouvoir toujours croissant des chevaliers voleurs et en raison de l'absence totale de sécurité publique, l'union des villes rhénanes se forme, composée de 70 villes situées dans la zone allant des Pays-Bas à Bâle ; c'était une alliance de bourgeois contre l'anarchie régnante causée par la nécessité de se défendre. Cette union se mit énergiquement à l'œuvre et brisa l'entêtement de nombreux châteaux chevaleresques ; cependant, après l'élection de Rudolf Habsbourg au royaume, qui prit des mesures décisives contre les chevaliers voleurs, cette union cessa d'exister.
Concernant les négociations qui ont précédé une union plus étroite des villes, qui reçurent plus tard le nom de Hanséatique, aucune information ne nous est parvenue, sauf qu'en 1260 le premier congrès général des représentants de la Hanse eut lieu à Lübeck, et, cependant, même l'année de cet événement important en termes de précision n'est pas connu. Les informations concernant ce syndicat sont extrêmement rares. Le nombre de villes qui appartenaient à la Hanse est indiqué de manière très différente, et il y en a jusqu'à 90. Certaines villes du pays ont rejoint la Hanse pour les avantages commerciaux qui en découlaient, mais seulement nominalement et n'ont pratiquement aucune part à ses affaires.
Une particularité de cette communauté était qu'elle ne disposait pas d'une organisation permanente - ni gouvernement central, pas de forces armées communes, pas de marine, pas d'armée, pas même de finances communes ; les membres individuels du syndicat jouissaient tous des mêmes droits, et la représentation était confiée à la ville principale du syndicat - Lübeck, tout à fait volontairement, puisque ses bourgmestre et sénateurs étaient considérés comme les plus capables de diriger les affaires, et en même temps cette ville assumait les coûts associés à l'entretien des navires de guerre. Les villes qui faisaient partie de l'union étaient éloignées les unes des autres et séparées par celles qui n'appartenaient pas à l'union, et souvent même par des possessions hostiles. Certes, ces villes étaient pour la plupart des villes impériales libres, mais néanmoins, dans leurs décisions, elles dépendaient souvent des dirigeants du pays environnant, et ces dirigeants, bien qu'ils fussent des princes allemands, n'étaient pas toujours favorables à la Hanse. et, au contraire, ils la traitaient souvent avec méchanceté et même avec hostilité, bien sûr, sauf dans les cas où ils avaient besoin de son aide. L'indépendance, la richesse et la puissance des villes, qui étaient au centre de la vie religieuse, scientifique et artistique du pays et vers lesquelles gravitait sa population, constituaient comme une épine dans le pied de ces princes. Par conséquent, ils ont essayé de nuire aux villes autant que possible et l'ont souvent fait à la moindre provocation et même sans celle-ci.
Ainsi, les villes hanséatiques devaient se défendre non seulement contre les ennemis extérieurs, puisque toutes les puissances maritimes étaient leurs concurrentes et les détruiraient volontiers, mais aussi contre leurs propres princes. Par conséquent, la position du syndicat était extrêmement difficile et il devait mener une politique intelligente et prudente à l'égard de tous les dirigeants intéressés et utiliser habilement toutes les circonstances pour ne pas périr et ne pas permettre au syndicat de se désintégrer.
Il était très difficile de maintenir au sein de l'union les villes côtières et intérieures, dispersées dans l'espace allant du golfe de Finlande à l'Escaut et de la côte maritime jusqu'au centre de l'Allemagne, car les intérêts de ces villes étaient très différents, et pourtant le seul lien entre eux ne pourrait être précisément que des intérêts communs ; le syndicat ne disposait que d'un seul moyen coercitif : l'exclusion (Verhasung), qui impliquait l'interdiction à tous les membres du syndicat d'avoir des relations avec la ville exclue et aurait dû conduire à la cessation de toutes relations avec elle ; cependant, il n'existait aucun pouvoir de police pour superviser l'exécution de cette mesure. Les plaintes et les réclamations ne pouvaient être déposées qu'auprès des congrès des villes alliées, qui se réunissaient de temps en temps, auxquels étaient présents des représentants de toutes les villes dont les intérêts l'exigeaient. En tout cas, contre les villes portuaires, l’exclusion de l’union était un moyen très efficace ; ce fut le cas, par exemple, en 1355 de Brême, qui manifesta dès le début une volonté d'isolement et qui, en raison de pertes énormes, fut contrainte, trois ans plus tard, de demander à nouveau à être admise dans l'union.
Les villes de l'union étaient divisées en trois districts :
1) Région vendienne orientale, à laquelle appartenaient Lübeck, Hambourg, Rostock, Wismar et les villes de Poméranie - Stralsund, Greifswald, Anklam, Stettin, Kolberg, etc.
2) Région frisonne occidentale-néerlandaise, qui comprenait Cologne et les villes westphaliennes - Zest, Dortmund, Groningen, etc.
3) Et enfin, la troisième région comprenait Visby et les villes situées dans les provinces baltes, comme Riga et d'autres.
Du tout début à la fin de l'existence de la Hanse, Lübeck était sa ville principale ; ceci est prouvé par le fait que le tribunal local a été déclaré en 1349 cour d'appel pour toutes les villes, y compris Novgorod.
La Hanse était un produit de son époque et les circonstances lui étaient particulièrement favorables. Nous avons déjà évoqué l'habileté et la fiabilité des marchands allemands, ainsi que leur capacité d'adaptation aux circonstances. A cette époque, ces qualités étaient d'autant plus précieuses que les Normands qui habitaient l'Angleterre et la France traitaient le commerce avec mépris et n'en avaient aucune capacité ; Les habitants des États baltes non plus - les Polonais, les Livoniens, etc. Le commerce sur la mer Baltique, comme à l'heure actuelle, était très développé et encore plus étendu qu'aujourd'hui ; sur toute la côte de cette mer, il y avait partout des bureaux hanséatiques. Il faut ajouter à cela que les villes côtières allemandes, et Lübeck à leur tête, comprenaient parfaitement l'importance de la puissance maritime et n'avaient pas peur de dépenser de l'argent pour l'entretien des navires de guerre.
On sait très peu de choses sur les navires hanséatiques ; les « rouages » militaires ont déjà été évoqués plus haut ; c'étaient les plus grands navires de la mer Baltique, avec un déplacement allant jusqu'à 800 tonnes, une longueur de 120, une largeur de 30 et une profondeur de 14 pieds ; ils avaient trois mâts avec vergues et leur équipage était composé de 250 personnes, dont la moitié étaient des marins ; plus tard, ils furent équipés de 15 à 20 canons, dont la moitié étaient des canons de 9 à 12 livres. « Frede-koggen » était le nom donné aux navires qui effectuaient le service de police près de la côte et du port ; une certaine taxe était perçue pour leur entretien. Tous les navires marchands étaient armés, mais plus tard, la Hanse possédait également des navires de guerre spéciaux. Voici quelques chiffres qui datent cependant d'une époque ultérieure : le vaisseau amiral suédois, pris au combat par la flotte de Lübeck, mesurait 51,2 m de long et 13,1 m de large, l'armement était composé de 67 canons, sans compter les armes de poing ; le vaisseau amiral de Lübeck avait une quille de 37,7 m et sa plus grande longueur était de 62 mètres ; il y avait de hautes tours à la proue et à la poupe, il y avait 75 canons de calibre 40 à 2,5 livres, l'équipage comprenait 1 075 personnes.
Les dirigeants de la Hanse ont très habilement utilisé des circonstances favorables pour prendre en main le commerce de la Baltique et de la mer du Nord, en faire leur monopole, en éliminant tous les autres peuples et ainsi pouvoir fixer les prix des marchandises à leur propre discrétion ; en outre, ils s'efforçaient d'acquérir, dans les États où cela les intéressait, les plus grands privilèges possibles, comme, par exemple, le droit d'établir librement des colonies et de faire du commerce, l'exonération des impôts sur les marchandises, des impôts fonciers, la droit d'acquérir des maisons et des cours, en leur représentant l'extraterritorialité et leur propre juridiction. Ces efforts ont été pour la plupart couronnés de succès avant même la création du syndicat. Prudents, expérimentés et possédant des talents non seulement commerciaux, mais aussi politiques, les dirigeants commerciaux de l'union savaient parfaitement tirer parti des faiblesses ou des situations difficiles des États voisins ; En même temps, ils n'ont pas manqué l'occasion de mettre indirectement, en soutenant les ennemis de cet État, ou même directement, par la course ou la guerre ouverte, ces États dans une position difficile, afin de leur imposer certaines concessions. L'importance et l'existence même de la Hanse reposaient sur le fait qu'elle devenait nécessaire pour les États voisins, en partie grâce à sa médiation dans la livraison des biens nécessaires, la location de navires, les prêts d'argent, etc., afin que ces États trouvent des avantages. dans leurs relations avec les villes côtières allemandes, - en partie parce que la Hanse est devenue une grande force maritime.
Les conditions de l’époque étaient telles que lorsqu’il s’agissait d’acquérir ou de conserver des avantages, les deux parties n’agissaient pas particulièrement scrupuleusement ; La Hanse recourut avant tout aux cadeaux et aux pots-de-vin, mais recourut souvent directement à la violence, tant sur terre que sur mer, et ce, souvent même sans déclarer la guerre. Bien entendu, il est impossible de justifier la violence, qui s’accompagne souvent de cruauté, mais ceux qui veulent réussir doivent mener une politique énergique.
La situation politique dans les royaumes du Nord, en Russie, en Allemagne et aux Pays-Bas, c'est-à-dire au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, était si instable au Moyen Âge que nous ne pouvons en entrer ici dans une présentation plus détaillée ; les guerres et les alliances se succédèrent, les corsaires en mer, les vols sur les côtes, tantôt en alliance avec un État célèbre, tantôt en guerre avec lui, se succédèrent pendant quelques années, comme ce fut le cas par exemple entre le Danemark et la Suède. . Cependant, nous décrirons brièvement quelques événements marquants, notamment ceux qui se sont déroulés en mer.
En 1280, Lübeck et Visby prirent en charge la protection du commerce dans la mer Baltique, c'est-à-dire la surveillance de la police maritime ; trois ans plus tard, la Hanse forme une alliance avec les ducs de Mecklembourg et de Poméranie pour maintenir la paix contre les margraves de Brandebourg. Lorsque le roi danois Erik Glipping rejoignit cette alliance, le roi norvégien Erik « Pop Hater » s'empara soudain des navires marchands allemands et de tous les biens appartenant aux Allemands à terre. En conséquence, Lübeck, avec les villes de Wenden et Riga, équipa une flotte qui ruina le commerce norvégien, dévasta la côte et causa de telles pertes au pays que le roi fut contraint de conclure la paix à Kalmar le 31 octobre 1285. payer à la Hanse une récompense militaire et lui fournir des avantages commerciaux importants. Lorsque le roi Christophe II fut expulsé du Danemark, il se tourna vers Lübeck pour obtenir de l'aide, qui lui fut apportée ; il fut renvoyé au Danemark et rétabli sur le trône, pour lequel il dut accorder des privilèges presque illimités aux marchands allemands. La même histoire s'est produite avec le roi Magnus de Norvège, malgré le fait qu'il était hostile à la Hanse.
En raison des privilèges dont jouissait la Hanse, le commerce scandinave et russe a complètement disparu de la mer Baltique et le commerce anglais a pris une place secondaire - la Hanse a régné de la Neva aux Pays-Bas sur la mer et sur le commerce. Dans le même temps, la Hanse profite de la situation financière étroite d'Édouard III et lui prête de l'argent avec lequel il équipe une campagne en France qui se termine par la victoire à Crécy. Pour garantir le prêt, Edward a promis à la Hanse les droits sur la laine et les mines d'étain en Cornouailles. En 1362, les guerres de la Hanse éclatèrent contre Waldemar III, qui créa la grandeur et la puissance du Danemark. La même année, l'île de Gotland est occupée. Visby et la cour allemande qui s'y trouvait ont été pillées et beaucoup de sang a coulé. Puis la Hanse conclut une alliance avec la Suède et la Norvège ; début mai, la flotte hanséatique est apparue dans le Sound, mais les alliés hanséatiques ne sont pas apparus. Alors l'amiral hanséatique Wittenberg attaqua seul Copenhague, s'en empara, puis passa en Skonia, qui appartenait alors au Danemark, et assiégea Helsingborg. Ici, cependant, il fut surpris par la flotte danoise et perdit 12 gros « rouages » ; l'armée dut monter à bord des navires en toute hâte et retourner à Lübeck. Wittenberg fut jugé et exécuté.
Après cela, la paix s'ensuivit, qui dura plusieurs années, mais en novembre 1367, lors d'une assemblée générale de la Ligue hanséatique tenue à Cologne, 77 villes, de Narva à Zirik-Zee, décidèrent de toutes leurs forces de faire la guerre à Waldemar. . Était équipé grande flotte, qui commença par dévaster si complètement la côte norvégienne en avril 1368 que le roi commença à demander la paix ; Après cela, la flotte se dirigea vers le Sound et prit en mai Copenhague, puis Helsischer et força Waldemar à quitter son pays. Le 24 mai 1370, une paix fut conclue à Stralsund, selon laquelle, quelle que soit l'indemnité importante, la Hanse fut reconnue comme ayant le droit de confirmer les rois des États du Nord. Ce fut un énorme succès, notamment parce qu’il fut obtenu non pas par les forces d’un État puissant, mais par les forces d’une union de villes.
Après ce succès sans précédent, la Hanse commença apparemment à négliger le contrôle policier sur les mers ; le vol en mer s'est répandu à tel point que les villes de Wismar et de Rostock ont jugé nécessaire d'émettre des lettres de marque contre les navires des trois puissances du Nord. Cependant, cela a aggravé la situation, car cela a donné naissance dans ces villes à une grande et forte société de « Lickendelers », connue sous le nom de « Frères de Vitalii » ou « Vitaliers », qui ont donné leur confrérie des bandits le nom bruyant « amis de Dieu et ennemis du monde ». Les débuts de l'organisation Vitalier se cachent dans l'obscurité des siècles, cependant, compte tenu des relations qui prévalaient dans cette partie du monde au tournant des XIIIe-XIVe siècles, il n'est pas difficile de deviner les raisons de son émergence. Parmi les pirates Vitalier, on pouvait rencontrer des fugitifs des villes hanséatiques, principalement vendiennes, de toutes les régions d'Allemagne, des Néerlandais, des Frisons, des Danois, des Suédois, des Livoniens, des Slaves cachoubes, des Poméraniens, des Français et probablement aussi des Polonais. C'est à partir de ces têtes désespérées qu'est née une sorte d'organisation pirate de Vitaliers sur l'île baltique. Outre les marins hanséatiques, cette « confrérie », qui a choisi l'île de Gotland comme siège, comprenait des fugitifs persécutés par la loi, des individus qui se considéraient offensés et recherchaient la justice, l'argent facile, la possibilité de se venger de leurs ennemis. , ou simplement avide d'aventure.
Fidèles aux traditions de longue date des pirates baltes et des Vikings, les frères Vitalier maintenaient une discipline stricte au sein de leur organisation. Il n’y avait parmi eux aucune autre femme que des captives. Les capitaines pirates exigeaient de leurs marins une obéissance inconditionnelle ; la violation de leurs ordres était punissable. peine de mort. Sur l'île de Gotland, qui était sous la domination de la confrérie Vitalier, se trouvait le quartier général principal des pirates ; Ici, le butin était stocké, ici il était réparti entre les pirates qui se distinguaient lors des expéditions, et la base de toute la flottille de pirates s'y trouvait. La population locale de l'île était parfois contrainte de payer un tribut, mais le montant de ce dernier était relativement modéré, puisque les Vitalier obtenaient toutes les nécessités de base et toutes les richesses en pillant les navires en mer et en attaquant les colonies côtières. Cependant, les Vitalier, comme tous les pirates de cette époque, étaient aussi des marchands. Ils faisaient le commerce des biens pillés, les revendant parfois même là où leurs propriétaires légitimes étaient censés les livrer.
Les activités des Vitalier ont pris leur ampleur la plus large dans les années où le talentueux leader Klaus Störtebecker était à la tête de la confrérie des pirates. Avec son assistant Godecke Michels, il rejoint deux autres voleurs de mer - Moltke et Manteuffel. Störtebecker lui-même était issu d'une famille plébéienne de Rostock. Il a commencé sa carrière marchande et maritime dans sa jeunesse, travaillant dans les entrepôts des marchands de harengs en Scanie, sur les navires naviguant entre Reval et Bruges, et enfin pour les grands marchands de sa Rostock natale. Offensé par son patron, incapable de supporter le traitement inhumain, il s'organise, comme beaucoup d'autres à l'époque, à la fin du XIVe siècle. une émeute sur le navire sur lequel il servait, jeta le capitaine par-dessus bord et, prenant le commandement en main, partit en mer, voulant se venger des insultes qui lui étaient infligées. Pour avoir organisé une émeute et retiré le navire, Störtebecker a été interdit. La poursuite du nouveau pirate a été confiée au noble citadin Wulflam de Stralsund, qui, en 1385, s'est vu confier la tâche de lutter contre le vol maritime par la Ligue hanséatique.
Cependant, Störtebecker, qui se distinguait par ses remarquables capacités maritimes et militaires, non seulement ne fut pas capturé par les remorqueurs hanséatiques, mais commença bientôt à ennuyer complètement les navires marchands. Il était particulièrement cruel et impitoyable envers les représentants du patriciat dirigeant des villes vendiennes qu'il avait capturées, avec lesquels il avait des comptes personnels.
Mais Störtebecker est entré dans l'histoire non pas à cause de ses actes de piraterie, mais parce qu'il s'est impliqué dans des activités politiques. L'occasion s'en présenta en 1389, lorsqu'une lutte acharnée pour le trône éclata en Suède. Le roi Albrecht, qui y régnait, n'était pas populaire parmi les seigneurs féodaux suédois en Allemagne et fut capturé par la reine Marguerite du Danemark et de Norvège. Dans cette guerre, seule la garnison de Stockholm resta fidèle au roi, résistant aux Danois. La population de Stockholm à cette époque était majoritairement composée d'Allemands et, contrairement à Margaret, Albrecht soutenait les marchands allemands en Suède. Si les Danois s'emparaient de Stockholm, les privilèges des marchands allemands seraient abolis, ce qui, à son tour, bouleverserait l'équilibre des pouvoirs dans la Baltique et frapperait la Hanse. Les défenseurs de Stockholm, qui avaient du mal à retenir les forces ennemies supérieures, envoyèrent des lettres désespérées à la Hanse pour demander de l'aide.
Dans cette situation, Lübeck s'est tourné vers... les pirates de Gotland. Störtebecker a accepté de fournir une assistance aux Allemands de Stockholm et à la Ligue hanséatique. Avec sa flottille, il entame des opérations militaires contre les Danois. N'ayant que des navires petits et légers, Störtebecker ne put résister aux navires de guerre danois lourds et bien armés dans une bataille ouverte et décida d'aider les assiégés d'une autre manière.
L'assaut contre la ville n'a donné aucun résultat et les Danois ont procédé au siège, essayant de forcer les défenseurs à se rendre par la famine. Ayant coupé les routes d’approvisionnement alimentaire depuis la terre et la mer, ils étaient déjà proches de leur objectif. Il est devenu évident que seule une action rapide et décisive pourrait sauver les assiégés.
Un jour à l'aube, deux groupes de bateaux pirates apparurent soudain près de Stockholm. Tandis que le premier d'entre eux attaquait hardiment le cordon de navires danois, le second, profitant de la confusion provoquée par l'attaque inattendue, se glissa juste à côté des Danois et entra dans le port de Stockholm. Les pirates répétèrent cette manœuvre à plusieurs reprises et presque toujours avec succès, livrant à chaque fois de la nourriture aux défenseurs de la ville. C'est pourquoi les pirates de Gotland ont reçu le surnom de Vitaliers (« soutiens de famille ») et sont entrés dans l'histoire sous ce nom.
Les actions héroïques des Vitalier, leur origine plébéienne, la devise proclamant la justice sociale sous laquelle ils combattaient - tout cela a gagné la sympathie et la popularité de la fraternité parmi le peuple des villes hanséatiques. La meilleure preuve en est le résultat de l’attaque des pirates sur Wismar. Dans le but de libérer plusieurs camarades capturés et de s'approvisionner pour l'hiver, Störtebecker et Godecke Michels décidèrent de prendre ce qui semblait être une mesure désespérée en attaquant le port de Wismar.
Alors que le conseil municipal, surpris, parvient à faire appel à l'aide d'autres villes hanséatiques et à mobiliser la flotte qui leur est subordonnée, l'armée victorieuse des Vitalier a déjà navigué au large. Ils n'ont pu réaliser ce plan désespéré que parce que les gens ordinaires de Wismar, hostiles au patriciat de la ville, ont aidé les héros légendaires de Stockholm dans cette opération. L'aide du peuple a joué un rôle similaire lorsque les Vitalier ont capturé Bergen en 1392, alors centre commercial de la Norvège. Les pirates ont capturé le bureau hanséatique local et ont incendié la ville. Au cours de cette opération, ils capturèrent de nombreux nobles citoyens de Bergen, exigeant une énorme rançon pour leur libération.
Au tournant des XIVe et XVe siècles. La position politique des Vitalier devient assez ambiguë. D'une part, ils se sont activement opposés au système social en vigueur, combattant les cercles dirigeants des villes hanséatiques - le patriciat et les conseils municipaux, et d'autre part, ils sont entrés à plusieurs reprises, comme ce fut le cas à Stockholm, au service de ce ou cette ville, s'exprimant contre son ennemi, et souvent contre une autre ville hanséatique qui lui faisait concurrence. Ainsi, les Vitalier agissaient souvent comme condottieri rémunérés, servant au service du patriciat même, qu'ils considéraient comme leur principal ennemi.
Cette situation, à première vue paradoxale, se reflète notamment dans le texte de certains actes et règlements hanséatiques. Il arrivait souvent que le Congrès hanséatique décide de mener une sorte d'opération armée dans laquelle les pirates devaient être utilisés plus ou moins ouvertement du côté de la Hanse. Parallèlement, lors du même congrès, une autre décision est prise visant à éradiquer la piraterie dans la Baltique, et notamment la destruction des Vitaliers. Car les marchands hanséatiques, qui parfois eux-mêmes ne dédaignaient pas le vol, orientaient leur politique vers un commerce international à grande échelle et cherchaient donc à faire en sorte qu'il ne rencontre, si possible, aucun obstacle.
Malgré les décisions prises par la Hanse d'exterminer sans pitié les Vitalier, les activités des pirates se développèrent. Au fil du temps, les choses en sont arrivées au point qu'aucun navire ne pouvait traverser les détroits danois et se frayer un chemin de la Baltique à la mer du Nord ou revenir sans payer une rançon aux Vitalier. Après l'incendie de Bergen, les pirates ont commencé à voler même les pêcheurs pêchant du hareng dans la mer du Nord. En conséquence, non seulement la navigation commerciale s’y arrêtait, mais aussi la pêche.
Cette situation a commencé à menacer l’existence des États situés dans les bassins de la mer du Nord et de la mer Baltique. Puis ces derniers décidèrent de s’unir afin de mettre un terme au braquage maritime dans l’intérêt commun. Cependant, la première expédition contre les pirates, organisée par la reine Marguerite du Danemark et le roi anglais Richard II, échoua.
La Hanse commença également à être accablée par les pirates. Les pertes commerciales subies par les villes hanséatiques à cause des pillages maritimes n'étaient pas compensées par les services fournis par les pirates. La deuxième expédition, organisée cette fois par les villes hanséatiques en 1394, avec la participation de trente-cinq navires de guerre et trois mille chevaliers, ne produisit pas non plus les résultats escomptés.
Au fil du temps, l'équilibre des forces sur la scène politique dans les pays baltes a commencé à évoluer dans une direction très défavorable aux Vitalier. Incapable de faire face seule à la piraterie, la reine Margaret s'est tournée vers le Grand Maître de l'Ordre des Croisés, Conrad von Jungingen, pour obtenir de l'aide. A cette époque, cet ordre était au faîte de sa puissance et disposait d'une excellente armée et d'une marine forte.
Lorsque les croisés marchèrent sur Gotland en 1398, les Vitalier furent incapables de leur résister. Après avoir embarqué sur des navires, ils quittèrent définitivement la Baltique. Chassés de leur nid de voleurs, ils se réfugièrent dans la mer du Nord, où ils s'emparèrent de l'île d'Heligoland et la fortifièrent. Mais là, à l’embouchure de l’Elbe, ils se retrouvèrent face à face avec leur principal ennemi, la Hanse. Cette fois, il ne s'agissait plus seulement des villes du quartier vendien, mais de deux ports puissants, Hambourg et Brême, qui n'allaient d'ailleurs pas recourir aux services de pirates. Ces deux centre commercial ils ne voulaient pas supporter la présence de pirates presque à leur porte.
En 1401, un grand navire de commerce quitta l'embouchure de l'Elbe, comme s'il était rempli à ras bord de marchandises de valeur. Le navire s'est dirigé vers la mer du Nord, direction Helgoland. Les pirates qui se cachaient ont attaqué cette proie facile et apparemment sans défense, mais ils ont cruellement mal calculé. C'était un navire de guerre – un leurre déguisé en navire marchand. Son équipage nombreux et bien armé commença à combattre les pirates. Les Vitalier étaient tellement absorbés par la bataille qu'ils ne remarquèrent pas l'approche de la flottille de Hambourg.
Aucun des navires pirates impliqués dans la bataille n'en est sorti indemne ; Cent cinquante prisonniers ont été capturés et le nid Vitalier à Heligoland a été capturé et détruit. Störtebecker et Michels, également capturés, ont été publiquement décapités sur l'une des places de Hambourg. Tous les autres prisonniers, selon la coutume médiévale, étaient marqués au fer chaud et emprisonnés ou condamnés aux travaux forcés.
Selon la légende, les mâts du navire de Störtebecker ont été creusés et un alliage d'or pur a été coulé à l'intérieur. Les richesses capturées sur les bateaux pirates et à leur base à Helgoland suffisaient non seulement à couvrir entièrement les frais de l'expédition et à indemniser les marchands hanséatiques pour une partie importante des pertes subies, mais aussi à décorer les tours de l'église de Saint Nicolas à Hambourg avec une couronne d'or.
Les restes morts-vivants des Heligoland Vitaliers se sont dispersés dans toute l'Allemagne, obstinément poursuivis par les seigneurs féodaux et les autorités de la ville. Cependant, cette confrérie ne cessa finalement d'exister qu'après sa défaite par Simon d'Utrecht en 1432, combattant aux côtés des Frisons contre la Hanse, et avec la conquête d'Emden en 1433.
Il faut mentionner quelques autres héros navals allemands : le célèbre Bockelman de Dantzig avec six navires en 1455 battit 16 danois, qu'il attaqua l'un après l'autre, en détruisant 6 et en capturant 6 comme prise ; c'était un exploit glorieux qui justifiait le signe distinctif que Bockelman gardait sur la proue de son grand mât - un balai, signifiant qu'il balayait les ennemis de la mer Baltique. Dans cette bataille, il a fait preuve d'une grande capacité tactique.
Il faut ensuite citer Paul Benecke, de Dantzig, qui en 1437 captura des navires anglais de la Vistule, puis, déjà au service anglais, combattit avec grand succès contre la Bourgogne. Ses navires "Peter von Danzig" et "Mariendrache" inspiraient la peur à tous les marins. L'un de ses nombreux trophées est le célèbre tableau de Hans Memling sur l'autel de l'église Sainte-Marie de Dantzig, représentant le Jugement dernier.
Matériel de Wikipédia - l'encyclopédie gratuite
Ligue hanséatique, Ligue hanséatique, Aussi Hanséatique(Allemand) Deutsche Hanse ou Dudesche Hanse , ancien-allemand Hansa - littéralement "groupe", "union", lat. Hanse Teutonique) - une union politique et économique qui a uni près de 300 villes commerçantes du nord-ouest de l'Europe du milieu du XIIe siècle à milieu du XVIIe siècle des siècles. La date de l'origine de l'Empire hanséatique ne peut être déterminée avec précision car elle ne repose pas sur un document précis. La Ligue hanséatique s'est développée progressivement à mesure que le commerce s'étendait le long des côtes de la mer Baltique et de la mer du Nord.
La raison de la formation de la Ligue hanséatique était la croissance de la population des territoires au nord de l'Elbe en raison de la migration, l'émergence de nouvelles villes et de communes indépendantes et, par conséquent, une augmentation des besoins en biens et une augmentation des échanges commerciaux.
La Ligue hanséatique a commencé à prendre forme au XIIe siècle sous la forme d'une union de marchands, puis d'une union de corporations de marchands et, à la fin du XIIIe siècle, d'une union de villes.
La Ligue hanséatique comprenait des villes dotées d'autonomie gouvernement de la ville(« conseil municipal », mairie) et leurs propres lois.
Afin d'élaborer des règles et des lois générales pour la Ligue hanséatique, les représentants des villes se réunissaient régulièrement lors de congrès à Lübeck. Les marchands et entreprises hanséatiques bénéficiaient de certains droits et privilèges.
Dans les villes non hanséennes, il y avait des bureaux de représentation de la Ligue hanséatique. Ces bureaux hanséatiques étrangers étaient situés à Bergen, Londres et Bruges. À l'extrémité orientale du système commercial hanséatique, un bureau a été fondé à Novgorod (Peterhof), où les produits européens (vin, textiles) étaient vendus et où l'on achetait du chanvre, de la cire, du miel, du bois, des cuirs et des fourrures. En 1494, sur ordre du grand-duc Ivan III, ce bureau fut aboli, tous ses bâtiments (y compris l'église en pierre de Saint-Apôtre Pierre) furent complètement détruits.
Histoire
L'augmentation du commerce, des raids et de la piraterie dans la Baltique s'était déjà produite auparavant (voir Vikings) - par exemple, les marins de l'île de Gotland pénétraient dans les rivières et remontaient jusqu'à Novgorod - mais l'ampleur des relations économiques internationales dans la mer Baltique est restée insignifiante jusqu'à ce que l'ampleur des relations économiques internationales dans la mer Baltique soit restée insignifiante. montée de la Hanse.
Les villes allemandes ont rapidement acquis une position dominante dans le commerce de la mer Baltique au cours du siècle suivant, et Lübeck est devenue le centre de tout le commerce maritime reliant les pays riverains de la mer Baltique et de la mer du Nord.
Base
Avant la Hanse, le principal centre commercial de la Baltique était Visby. Pendant 100 ans, les navires allemands ont navigué vers Novgorod sous pavillon gotlandais. Les marchands de Visby ont établi un bureau à Novgorod. Les villes de Dantzig (Gdańsk), Elblag, Torun, Revel, Riga et Dorpat vivaient sous la loi de Lübeck. Pour les résidents locaux et les visiteurs professionnels, cela signifiait que les questions relatives à leur protection juridique relevaient de la compétence de Lübeck, en tant que tribunal d'appel final. Les communautés hanséatiques s'efforçaient d'obtenir des privilèges commerciaux spéciaux pour leurs membres. Par exemple, les marchands de la Hanse de Cologne ont réussi à convaincre le roi Henri II d'Angleterre de leur accorder (en 1157) des privilèges commerciaux spéciaux et des droits de marché, ce qui les a libérés de tous les droits de Londres et leur a permis de faire du commerce dans des foires dans toute l'Angleterre. Lübeck, la « reine de la Hanse », où les marchands transbordaient les marchandises entre la mer du Nord et la mer Baltique, reçut en 1227 le statut de ville libre impériale, la seule ville à bénéficier d'un tel statut à l'est de l'Elbe.
Lübeck, ayant accès aux zones de pêche de la Baltique et de la mer du Nord, a formé une alliance avec Hambourg en 1242, avec son accès aux routes commerciales du sel depuis Lunebourg. Les villes alliées prirent le contrôle d'une grande partie du commerce du poisson salé, notamment à la foire de Skåne ; par décision du congrès de 1261, Cologne les rejoignit. En 1266, le roi anglais Henri III accorda aux Hans de Lübeck et de Hambourg le droit de commercer en Angleterre, et en 1282 ils furent rejoints par les Hans de Cologne, formant ainsi la colonie hanséatique la plus puissante de Londres. Les raisons de cette coopération étaient la fragmentation féodale de l'Allemagne d'alors et l'incapacité des autorités à assurer la sécurité du commerce. Au cours des 50 années suivantes, la Hanse elle-même a établi des relations écrites de confédération et de coopération sur les routes commerciales de l'Est et de l'Ouest. En 1356, un congrès général eut lieu à Lübeck (allemand). Étiquette Hansetag), au cours de laquelle les documents fondateurs ont été adoptés et la structure de gestion de la Hanse a été créée.
Le renforcement de la Hanse fut facilité par l'adoption en 1299 d'un accord, selon lequel les représentants des villes portuaires de l'union - Rostock, Hambourg, Wismar, Lunebourg et Stralsund - décidèrent que « désormais elles ne serviront plus la navigation à voile ». navire d'un marchand qui n'est pas membre de la Hanse. Cela a stimulé l'afflux de nouveaux membres de la Hanse, dont le nombre est passé à 80 en 1367.
Extension
La situation de Lübeck sur la Baltique permettait d'accéder au commerce avec la Russie et la Scandinavie, créant une concurrence directe avec les Scandinaves, qui contrôlaient auparavant la plupart des routes commerciales de la Baltique. Un accord avec la Hanse de la ville de Visby a mis fin à la concurrence : selon cet accord, les commerçants de Lübeck ont également eu accès à port interne russe Novgorod (le centre de la République de Novgorod), où ils construisirent un comptoir commercial ou bureau .
La Hanse était une organisation à gouvernance décentralisée. Congrès des villes hanséatiques ( Étiquette Hansetag) se réunit de temps à autre à Lübeck à partir de 1356, mais de nombreuses villes refusèrent d'envoyer des représentants et les décisions des congrès ne liaient aucune ville à quoi que ce soit. Au fil du temps, le réseau des villes s'est développé jusqu'à liste mutable de 70 à 170 villes.
Le syndicat a réussi à établir des des bureauxà Bruges (en Flandre, aujourd'hui en Belgique), à Bergen (Norvège) et à Londres (Angleterre). Ces postes de traite sont devenus d’importantes enclaves. Le bureau de Londres, fondé en 1320, se trouvait à l'ouest du London Bridge, près d'Upper Thames Street. Elle s'est considérablement développée, devenant au fil du temps une communauté fortifiée avec ses propres entrepôts, sa maison, son église, ses bureaux et ses résidences, reflétant l'importance et l'ampleur des activités impliquées. Ce poste de traite s'appelait Chantier en acier(Anglais) Balance romaine, Allemand le Stahlhof), la première mention sous ce nom remonte à 1422.
Villes membres de la Hanse
Plus de 200 villes étaient membres de la Hanse à différentes époquesVilles qui commerçaient avec la Hanse
Les plus grands bureaux étaient situés à Bruges, Bergen, Londres et Novgorod.
Chaque année, dans l'une des villes de la Nouvelle Hanse, a lieu le festival international « Journées hanséennes du nouvel âge ».
Actuellement, les villes allemandes de Brême, Hambourg, Lübeck, Greifswald, Rostock, Stralsund, Wismar, Anklam, Demmin, Salzwedel conservent le titre " Hanséatique...."(par exemple, Hambourg s'appelle intégralement : "La Ville libre et hanséatique de Hambourg" - allemand. Ville libre et hanséatique de Hambourg, Brême - « la ville hanséatique de Brême - allemande. Ville hanséatique de Brême" etc.). En conséquence, les plaques d'immatriculation de l'État dans ces villes commencent par « supplémentaire » Lettre latine H… - HB(c'est-à-dire "Hansestadt Brême"), HH("Hansestadt Hambourg"), H.L.(Lübeck), H.G.W.(Greifswald), HRO(Rostock), TVH(Strasund), HWI(Wismar).
voir également
Bibliographie
- Berezhkov M.N.. - Saint-Pétersbourg. : Taper. V. Bezobrazov et Comp., 1879. - 281 p.
- Kazakova N.A. Relations russo-livoniennes et russo-hanséatiques. Fin XIVe – début XVIe siècles. - L. : Nauka, 1975. - 360 p.
- // Notes scientifiques de la ville de Moscou institut pédagogique eux. V.P. Potemkina. - 1948. - T. VIII. - P. 61-93.
- Nikouline T.S. Conseil et bourgeois de la ville hanséatique à l'époque de la Réforme (d'après des matériaux de Lübeck) // Moyen Âge. - 2002. - Numéro. 63. - pp. 210-217.
- Podalyak N.G. Puissante Hansa. Espace commercial, misère de la vie et diplomatie des XIIe-XVIIe siècles. - K. : Tempora, 2009. - 360 p.
- Podalyak N.G. Lutte sociale et politique dans les villes de la Hanse vendienne au XVe siècle. // Moyen-âge. - 1992. - Numéro. 55. - pp. 149-167.
- Rybina E.A. Novgorod et Hansa. - M. : Monuments manuscrits de la Rus antique, 2009. - 320 p.
- Sergueïeva L.P. Guerre navale anglo-hanséenne 1468-1473. // Bulletin de l'Université d'État de Léningrad. Histoire. - 1981. - N° 14. - P. 104-108.
- Khoroshkevitch A. L. Commerce de Veliky Novgorod avec les États baltes et l'Europe occidentale aux XIVe-XVe siècles. - M. : Académie des Sciences de l'URSS, 1963. - 366 p.
- Hanse. Dans : Lexikon des Mittelalters (dans 10 Bde.). Artemis-Verlag. Munich-Zurich, 1980-2000. Bd. IV, S. 1921-1926.
- Rolf Hammel-Kiesow : Die HANSE. Verlag C. H. Beck. Munich, 2000.
- Philippe Dollinger : Die Hanse. Stuttgart. 5. Aufl. 1997
- Volker Henn : Ligue hanséatique. Dans : Hindenbrand, Hans-J. (Ed.) : L'Encyclopédie d'Oxford de la Réforme, Vol 2 (Oxford University Press). New York/Oxford 1996, p. 210-211.
- Rolf Hammel-Kiesow : La Ligue hanséatique. Dans : L'Encyclopédie d'histoire économique d'Oxford, Vol. 2. Oxford 2003, p. 495-498.
- John D. Fudge : Cargaisons, embargos et émissaires. L'interaction commerciale et politique de l'Angleterre et d'Herman Hanse 1450-1510.
- Jörgen Brecker (Hg.) : Die Hanse. Lebenswirklichkeit und Mythos, Bd. 1 (enthalten sind ca. 150 Beiträge versch. Autoren), Hambourg 1989.
- Giuseppe D'Amato, Voyage dans la Hanse baltique, l'Union européenne et l'élargissement de l'Est ( Voyage dans la Hanse baltique, l'Union européenne et sonélargissement à l’Est). Greco&Greco, Milan, 2004. ISBN 88-7980-355-7
- Liah Greenfeld, L'esprit du capitalisme. Nationalisme et croissance économique. Presse universitaire de Harvard, 2001. P.34
- Lesnikov M., Lubeck als Handelsplatz für osteuropaische Waren im 15. Jahrhundert, « Hansische Geschichtsbiatter », 1960, Jg 78
- Hansische Studien. Heinrich Sproemberg zum 70. Geburtstag, B., 1961
- Neue Hansische Studien, B., 1969
- Dollinger Ph., La Hanse (Xlle - XVIIe siècles), P., 1964
- Bruns F., Weczerka H., Hansische Handelsstrasse, Weimar, 1967
- Samsonowicz H. , Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia z dziejów Hanzy nad Bałtykiem w XIV-XV w., Warsz., 1968
Donnez votre avis sur l'article "Hansa"
Remarques
Liens
- Hansa / Khoroshkevich A. L. // Grande Encyclopédie soviétique : [en 30 volumes] / ch. éd. A.M. Prokhorov. - 3e éd. -M. : Encyclopédie soviétique, 1969-1978.
- Dossier Deutsche Welle
- Sous-section de la bibliothèque des Annales.
- Forsten G.V.// Dictionnaire encyclopédique de Brockhaus et Efron : en 86 volumes (82 volumes et 4 supplémentaires). - Saint-Pétersbourg. , 1890-1907.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Extrait caractérisant Hansa
« Le comte n'est pas parti, il est là, et il y aura des ordres sur vous », dit le préfet de police. - Allons-y! - dit-il au cocher. La foule s'est arrêtée, se pressant autour de ceux qui avaient entendu ce que disaient les autorités et regardant le droshky s'éloigner.À ce moment-là, le chef de la police a regardé autour de lui avec peur et a dit quelque chose au cocher, et ses chevaux sont allés plus vite.
- Vous trichez, les gars ! Conduisez-y vous-même ! - a crié la voix d'un grand gars. - Ne me laissez pas partir, les gars ! Qu'il soumette le rapport ! Le tenir! - des voix criaient et les gens couraient après le droshky.
La foule derrière le chef de la police, parlant bruyamment, s'est dirigée vers la Loubianka.
- Eh bien, les messieurs et les commerçants sont partis, et c'est pour ça que nous sommes perdus ? Eh bien, nous sommes des chiens, ou quoi ! – a été entendu plus souvent dans la foule.
Le soir du 1er septembre, après sa rencontre avec Koutouzov, le comte Rastopchin, bouleversé et offensé par le fait qu'il n'ait pas été invité au conseil militaire, que Koutouzov n'a prêté aucune attention à sa proposition de participer à la défense de la capitale, et surpris par le nouveau regard qui s'ouvrait à lui dans le camp, dans lequel la question du calme de la capitale et de son humeur patriotique s'avérait non seulement secondaire, mais complètement inutile et insignifiante - bouleversée, offensée et surprise Grâce à tout cela, le comte Rostopchin revint à Moscou. Après le dîner, le comte, sans se déshabiller, s'allongea sur le canapé et fut réveillé à une heure par un courrier qui lui apporta une lettre de Koutouzov. La lettre indiquait que, puisque les troupes se retiraient sur la route de Riazan, à l'extérieur de Moscou, le comte souhaiterait-il envoyer des policiers pour conduire les troupes à travers la ville. Cette nouvelle n'était pas nouvelle pour Rostopchin. Non seulement de la rencontre d'hier avec Kutuzov sur la colline de Poklonnaya, mais aussi de la bataille de Borodino elle-même, lorsque tous les généraux venus à Moscou ont déclaré à l'unanimité qu'une autre bataille ne pourrait pas être menée, et lorsque, avec la permission du comte, chaque nuit propriété du gouvernement et les habitants s'éloignaient déjà jusqu'à la moitié, partons - le comte Rastopchin savait que Moscou serait abandonnée ; mais néanmoins, cette nouvelle, communiquée sous la forme d'une simple note avec un ordre de Koutouzov et reçue la nuit, lors de son premier sommeil, surprit et irrita le comte.
Par la suite, expliquant ses activités durant cette période, le comte Rastopchin écrivit à plusieurs reprises dans ses notes qu'il avait alors deux objectifs importants : De maintenir la tranquillité à Moscou et d "en faire partir les habitants. .] Si nous supposons ce double objectif, chaque action de Rostopchin s'avère impeccable. Pourquoi le sanctuaire de Moscou, les armes, les cartouches, la poudre à canon, les réserves de céréales n'ont-ils pas été retirés, pourquoi des milliers d'habitants ont-ils été trompés par le fait que Moscou ne le ferait pas. être rendu, et ruiné ? - Pour cela ", afin de maintenir le calme dans la capitale, répond l'explication du comte Rostopchin. Pourquoi les piles de papiers inutiles ont-elles été retirées des lieux publics ainsi que le bal de Leppich et d'autres objets ? - Afin de laisser la ville vide ", répond l'explication du comte Rostopchin. Il suffit de supposer que quelque chose menace la tranquillité nationale, et chaque action devient justifiée.
Toutes les horreurs de la terreur étaient fondées uniquement sur le souci de la paix publique.
Sur quoi reposait la crainte du comte Rastopchin concernant la paix publique à Moscou en 1812 ? Pourquoi supposer qu'il y avait une tendance à l'indignation dans la ville ? Les habitants sont partis, les troupes en retraite ont envahi Moscou. Pourquoi le peuple devrait-il se rebeller à cause de cela ?
Non seulement à Moscou, mais dans toute la Russie, dès l'entrée de l'ennemi, il ne se produisit rien qui ressemblait à de l'indignation. Les 1er et 2 septembre, plus de dix mille personnes restaient à Moscou et, à part la foule rassemblée dans la cour du commandant en chef et attirée par lui, il n'y avait rien. Évidemment, il était encore moins nécessaire de s'attendre à des troubles parmi la population si, après la bataille de Borodino, lorsque l'abandon de Moscou devenait évident, ou, du moins, probablement, si alors, au lieu d'agiter le peuple avec la distribution d'armes et d'affiches , Rostopchin prit des mesures pour retirer tous les objets sacrés, la poudre à canon, les charges et l'argent, et annonçait directement au peuple que la ville était en train d'être abandonnée.
Rastopchin, un homme ardent et optimiste qui a toujours évolué dans les plus hautes sphères de l'administration, bien qu'avec un sentiment patriotique, n'avait pas la moindre idée du peuple qu'il envisageait de gouverner. Dès le début de l’entrée de l’ennemi dans Smolensk, Rostopchin s’est imaginé le rôle de leader des sentiments du peuple, du cœur de la Russie. Non seulement il lui semblait (comme cela semble à tout administrateur) qu'il contrôlait les actions extérieures des habitants de Moscou, mais il lui semblait qu'il contrôlait leur humeur à travers ses proclamations et ses affiches, écrites dans ce langage ironique que le peuple au milieu d'eux le mépris et qu'ils ne comprennent pas quand il l'entend d'en haut. Rostopchin aimait tellement le beau rôle du leader du sentiment populaire, il s'y était tellement habitué que le besoin de sortir de ce rôle, le besoin de quitter Moscou sans aucun effet héroïque, l'a pris par surprise, et il a soudainement perdu de sous ses pieds le sol sur lequel il se tenait, il ne savait absolument pas que faire ? Même s'il le savait, il ne croyait de toute son âme à quitter Moscou qu'à la dernière minute et n'a rien fait dans ce but. Les résidents ont déménagé contre sa volonté. Si les lieux publics furent supprimés, ce ne fut qu'à la demande des fonctionnaires, avec lesquels le comte accepta à contrecœur. Lui-même n'était occupé que du rôle qu'il s'était fait. Comme cela arrive souvent chez les gens doués d'une imagination ardente, il savait depuis longtemps que Moscou serait abandonnée, mais il ne le savait que par le raisonnement, mais de toute son âme il n'y croyait pas et n'était pas transporté par son imagination vers cette nouvelle situation.
Toutes ses activités, assidues et énergiques (à quel point elles étaient utiles et reflétées sur le peuple est une autre question), toutes ses activités visaient uniquement à susciter chez les habitants le sentiment qu'il éprouvait lui-même - la haine patriotique des Français et la confiance en soi.
Mais lorsque l'événement a pris ses dimensions réelles et historiques, lorsqu'il s'est avéré insuffisant d'exprimer sa haine des Français par des mots seuls, lorsqu'il a été impossible même d'exprimer cette haine par le combat, lorsque la confiance en soi s'est révélée être inutile par rapport à une question de Moscou, lorsque la population entière, comme une seule personne, abandonnant ses biens, a quitté Moscou, montrant par cette action négative toute la force de son sentiment national - alors le rôle choisi par Rostopchin s'est soudainement révélé être dénué de sens. Il se sentit soudain seul, faible et ridicule, sans aucun sol sous ses pieds.
Ayant reçu, réveillé du sommeil, une note froide et autoritaire de Koutouzov, Rastopchin se sentit d'autant plus irrité, plus il se sentit coupable. A Moscou restait tout ce qui lui avait été confié, tout ce qui était propriété de l'État et qu'il était censé retirer. Il n'était pas possible de tout retirer.
« Qui est responsable de cela, qui a permis que cela se produise ? - il pensait. - Bien sûr, pas moi. J'avais tout préparé, j'ai tenu Moscou comme ça ! Et c’est à cela qu’ils l’ont amené ! Des scélérats, des traîtres ! - pensa-t-il, sans définir clairement qui étaient ces canailles et traîtres, mais ressentant le besoin de haïr ces traîtres qui étaient responsables de la situation fausse et ridicule dans laquelle il se trouvait.
Toute la nuit, le comte Rastopchin donna des ordres pour lesquels on vint le voir de tous les côtés de Moscou. Ses proches n'avaient jamais vu le comte aussi sombre et irrité.
« Votre Excellence, ils venaient du département patrimonial, du directeur des ordres... Du consistoire, du Sénat, de l'université, de l'orphelinat, le vicaire envoyé... demande... Qu'ordonnez-vous ? les pompiers ? Le directeur de la prison... le directeur de la maison jaune..." - ils rendirent compte au comte toute la nuit, sans s'arrêter.
A toutes ces questions, le comte donna des réponses brèves et colériques, montrant que ses ordres n'étaient plus nécessaires, que tout le travail qu'il avait soigneusement préparé avait maintenant été ruiné par quelqu'un, et que ce quelqu'un porterait l'entière responsabilité de tout ce qui se passerait maintenant. .
"Eh bien, dis à cet idiot", répondit-il à une demande du service du patrimoine, "pour qu'il continue de garder ses papiers". Pourquoi posez-vous des bêtises sur les pompiers ? S'il y a des chevaux, qu'ils aillent à Vladimir. Ne laissez pas cela aux Français.
- Votre Excellence, le directeur de l'asile d'aliénés est arrivé, comme vous l'ordonnez ?
- Comment vais-je commander ? Laissez tout le monde partir, c'est tout... Et laissez sortir les fous de la ville. Quand nos armées sont commandées par des fous, c’est ce que Dieu a ordonné.
Interrogé sur les condamnés qui étaient assis dans la fosse, le comte a crié avec colère au gardien :
- Eh bien, dois-je vous donner deux bataillons d'un convoi qui n'existe pas ? Laissez-les entrer, et c'est tout !
– Votre Excellence, il y en a des politiques : Meshkov, Vereshchagin.
- Vereshchaguine ! N'est-il pas encore pendu ? - a crié Rastopchin. - Amenez-le-moi.
A neuf heures du matin, alors que les troupes avaient déjà traversé Moscou, personne d'autre n'est venu demander les ordres du comte. Tous ceux qui pouvaient y aller le faisaient de leur propre gré ; ceux qui restaient décidèrent eux-mêmes de ce qu'ils devaient faire.
Le comte ordonna d'amener les chevaux pour se rendre à Sokolniki, et, fronçant les sourcils, jaune et silencieux, les mains jointes, il s'assit dans son bureau.
Dans des temps calmes et non orageux, il semble à chaque administrateur que ce n'est que par ses efforts que toute la population sous son contrôle se déplace, et dans cette conscience de sa nécessité, chaque administrateur ressent la principale récompense de son travail et de ses efforts. Il est clair que tant que la mer historique est calme, le souverain-administrateur, avec son bateau fragile appuyé de sa perche contre le navire du peuple et lui-même en mouvement, doit lui donner l'impression que, par ses efforts, le navire contre lequel il s'appuie est en mouvement. Mais dès qu’une tempête surgit, que la mer s’agite et que le navire lui-même bouge, alors l’illusion est impossible. Le navire se déplace avec sa vitesse énorme et indépendante, la perche n'atteint pas le navire en mouvement et le dirigeant passe soudainement de la position de dirigeant, source de force, à une personne insignifiante, inutile et faible.
Rastopchin le sentait et cela l'irritait. Le chef de la police, arrêté par la foule, ainsi que l'adjudant venu signaler que les chevaux étaient prêts, entrèrent dans le décompte. Tous deux étaient pâles et le chef de la police, rapportant l'exécution de sa mission, déclara que dans la cour du comte il y avait une foule immense de gens qui voulaient le voir.
Rastopchin, sans répondre à un mot, se leva et entra rapidement dans son salon luxueux et lumineux, se dirigea vers la porte du balcon, attrapa la poignée, la laissa et se dirigea vers la fenêtre, d'où toute la foule était plus clairement visible. Un homme de grande taille se tenait aux premiers rangs et, avec un visage sévère, agitant la main, dit quelque chose. Le foutu forgeron se tenait à côté de lui avec un air sombre. Le bourdonnement des voix pouvait être entendu à travers les fenêtres fermées.
- L'équipage est-il prêt ? - dit Rastopchin en s'éloignant de la fenêtre.
« Prêt, Votre Excellence », dit l'adjudant.
Rastopchin s'approcha de nouveau de la porte du balcon.
- Que veulent-ils? – il a demandé au chef de la police.
- Votre Excellence, ils disent qu'ils allaient affronter les Français sur vos ordres, ils ont crié quelque chose à propos de trahison. Mais une foule violente, Votre Excellence. Je suis parti de force. Votre Excellence, j'ose suggérer...
"S'il vous plaît, partez, je sais quoi faire sans vous", a crié Rostopchin avec colère. Il se tenait devant la porte du balcon et regardait la foule. « C’est ce qu’ils ont fait à la Russie ! C’est ce qu’ils m’ont fait ! - pensa Rostopchin, sentant monter dans son âme une colère incontrôlable contre quelqu'un qui pouvait être attribué à la cause de tout ce qui s'était passé. Comme cela arrive souvent chez les gens colériques, la colère l'envahissait déjà, mais il cherchait un autre sujet. « La voila la populace, la lie du peuple, pensa-t-il en regardant la foule, la plebe qu'ils ont soulevee par leur sottise. Il leur faut une victime. population, les plébéiens, qu'ils ont élevés avec leur stupidité ! Ils ont besoin d'une victime."] - lui vint-il à l'esprit en regardant le grand homme agitant la main. Et pour la même raison, il lui vint à l'esprit qu'il avait lui-même besoin de cette victime. , cet objet pour sa colère.
- L'équipage est-il prêt ? – il a demandé une autre fois.
- Prêt, Votre Excellence. Que commandez-vous à propos de Vereshchagin ? "Il attend sous le porche", répondit l'adjudant.
- UN! - Rostopchin a crié, comme frappé par un souvenir inattendu.
Et, ouvrant rapidement la porte, il sortit sur le balcon d'un pas décisif. La conversation s'arrêta brusquement, les chapeaux et les casquettes furent ôtés, et tous les regards se tournèrent vers le comte qui était sorti.
- Bonjour gars! - dit le comte rapidement et fort. - Merci d'être venu. Je vais vous le dire maintenant, mais avant tout, nous devons nous occuper du méchant. Nous devons punir le méchant qui a tué Moscou. Attendez-moi! « Et le comte rentra tout aussi vite dans ses appartements en claquant fermement la porte.
Un murmure de plaisir parcourut la foule. « Cela signifie qu'il contrôlera tous les méchants ! Et tu dis français... il te fera toute la distance ! - disaient les gens, comme pour se reprocher leur manque de foi.
Quelques minutes plus tard, un officier sortit précipitamment de la porte d'entrée, commanda quelque chose et les dragons se levèrent. La foule du balcon se dirigeait avec impatience vers le porche. Sortant sur le porche d'un pas rapide et furieux, Rostopchin regarda précipitamment autour de lui, comme s'il cherchait quelqu'un.
- Où est-il? - dit le comte, et au même moment qu'il disait cela, il aperçut du coin de la maison, sortant entre deux dragons, un jeune homme au cou long et maigre, avec la tête à moitié rasée et envahie par la végétation. Ce jeune homme était vêtu de ce qui avait été autrefois un manteau en peau de mouton de renard usé, recouvert de tissu bleu, et un sarouel sale de prisonnier, enfilé dans de fines bottes usées et sales. Des chaînes pendaient lourdement sur ses jambes maigres et faibles, ce qui rendait difficile au jeune homme de marcher de manière indécise.
- UN! - dit Rastopchin en détournant précipitamment son regard du jeune homme au manteau en peau de mouton de renard et en désignant la dernière marche du porche. - Mets-le ici! « Le jeune homme, faisant claquer ses chaînes, marcha lourdement sur la marche indiquée, tenant avec son doigt le col de son manteau en peau de mouton qui appuyait, tourna deux fois son long cou et, soupirant, croisa ses mains fines et non travaillantes devant son ventre avec un geste de soumission.
Le silence se poursuivit pendant plusieurs secondes tandis que le jeune homme se positionnait sur la marche. Ce n'est que dans les dernières rangées de personnes rassemblées au même endroit que des gémissements, des gémissements, des tremblements et le piétinement des pieds en mouvement ont été entendus.