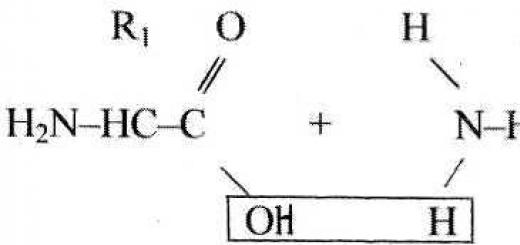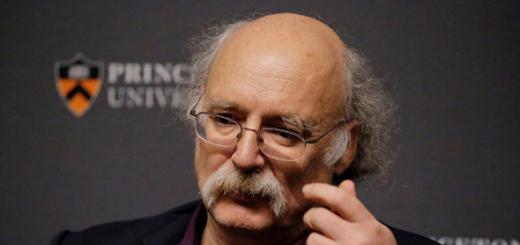Les idéaux de développement personnel présupposent la présence de la liberté, dont la poursuite et l'expérience constituent une caractéristique intégrale de la manière d'être personnelle.
Vous pouvez en nommer trois thèmes mondiaux, touchant lequel dans assistance psychologique peut épuiser presque toute la variété des problèmes et difficultés humains avec lesquels les gens se tournent vers les psychothérapeutes. C'est la liberté, l'amour et la finitude de notre vie. Nos expériences les plus profondes contiennent à la fois un énorme potentiel de vie et une source inépuisable d’anxiété et de tension. Nous nous concentrerons ici sur l'une des composantes de cette triade - le thème liberté.
La définition la plus positive de la liberté se trouve chez S. Kierkegaard, qui a compris la liberté est avant tout une opportunité(Anglais : rossibilité). Ce dernier concept vient du mot latin « posse » (pouvoir), qui est également la racine d'un autre mot important dans ce contexte : « force, puissance ». Cela signifie que si une personne est libre, elle est puissante et puissante, c'est-à-dire posséder de force. Comme l'écrit R. May (1981), lorsque nous parlons d'opportunité en relation avec la liberté, nous entendons d'abord la possibilité vouloir, choisir et agir. Tout cela signifie possibilité de changer, dont la mise en œuvre est le but de la psychothérapie. C’est la liberté qui fournit le pouvoir nécessaire au changement.
Dans l’assistance psychologique, le thème de la liberté peut être entendu sous au moins deux aspects principaux. Premièrement, comment composante de presque toutes les difficultés psychologiques, avec lesquels les clients viennent à nous, car la nature de nos relations avec les autres, la vision de notre place et les opportunités dans l'espace de vie dépendent d'une compréhension individuelle spécifique (pas du tout philosophique) de la liberté. La compréhension subjective de la liberté est particulièrement évidente dans les situations de la vie où nous sommes confrontés à la nécessité de choisir. Notre vie est tissée de choix - le choix des actions dans des situations élémentaires, le choix des mots pour répondre à l'autre, le choix des autres et la nature des relations avec eux, le choix des objectifs de vie à court et à long terme, et enfin, le choix des valeurs qui sont nos lignes directrices spirituelles dans la vie. À quel point nous nous sentons libres ou limités dans de telles situations quotidiennes - la qualité de notre vie en développement en dépend.
Les clients amènent à un psychologue non seulement propre compréhension la question de la liberté dans votre vie avec toutes les conséquences qui découlent de cette compréhension. La compréhension de la liberté des clients se reflète directement dans le processus de psychothérapie ; elle colore la relation thérapeutique entre le thérapeute et le client. On peut donc dire sur la liberté du client dans le contact thérapeutique, dont la nature de la construction de la part du client sert de modèle réduit de ses difficultés. D'autre part, en psychothérapie, la liberté du client entre en collision avec la liberté du thérapeute, qui a sa propre compréhension de la liberté et comment la gérer lors des réunions thérapeutiques. Dans une relation thérapeutique, le thérapeute représente la réalité de la vie, le monde extérieur, et en ce sens sert en quelque sorte de réservoir de liberté pour le client, offrant certaines opportunités et imposant certaines restrictions de contact. C’est pourquoi le thème de la liberté est également important composante du processus de formation et de développement des relations thérapeutiques.
La liberté, étant la principale valeur existentielle, est en même temps la source de nombreuses difficultés et problèmes de la vie. L'essence de nombre d'entre eux réside dans la diversité des idées subjectives sur la liberté.
Souvent, les gens, y compris certains de nos clients, ont tendance à penser que nous ne pouvons expérimenter la véritable liberté qu’en l’absence de toute restriction. Cette compréhension de la liberté comme "libre de"(V.Frankl) peut être appelé liberté négative. Probablement tout le monde a pu, à un moment ou à un autre, voir à partir de sa propre expérience ce que signifie choisir quelque chose qui lui est propre, sans tenir compte de la même liberté de choix des autres (y compris la liberté de s'identifier d'une manière ou d'une autre à ma liberté ), sans tenir compte des restrictions internes et externes. Il est difficilement possible de parler de liberté humaine réelle et concrète, et non de liberté philosophique abstraite, en dehors du monde des relations structurées et des obligations mutuelles. Vous pouvez imaginer ce qui se passerait dans les rues de la ville si tout le monde commençait soudainement à ignorer les règles. trafic. Le psychothérapeute a la possibilité d’être constamment convaincu des conséquences de la volonté personnelle et de l’attitude anarchiste du client à l’égard de ses propres droits et de ceux des autres, de sa propre liberté et de celle des autres.
La liberté négative conduit également à des expériences d’isolement et de solitude. Après tout, on sait que plus nous nous privons de liberté, sans tenir compte de l'interconnexion réelle avec les autres, moins il reste d'attachements et de dépendance saine à l'égard des autres, ce qui signifie plus de solitude et de vide.
Pour que la vraie liberté apparaisse dans la vie, il est nécessaire d'accepter le fait de l'existence destin. Dans ce cas, à la suite de R. May (1981), nous appelons destin l'intégrité des limitations : physiques, sociales, psychologiques, morales et éthiques, que l'on peut aussi appeler "données" de la vie. C'est pourquoi, en matière d'assistance psychologique, lorsque nous pensons et parlons de liberté, nous entendons liberté situationnelle, lorsque la liberté de chacun de nos choix est déterminée par les possibilités et les limites imposées par une situation de vie spécifique. J.-P. Sartre (1956) appelait cela la « factualité de la situation humaine », M. Heidegger (1962) - la condition de « l'abandon » d'une personne dans le monde. Ces concepts reflètent le fait que notre capacité à contrôler notre existence est limitée et que certaines choses dans nos vies sont prédéterminées.
Tout d’abord, l’existence elle-même en tant qu’espace de créativité vitale est limitée dans le temps. La vie est finie et il y a une limite de temps pour toute action et tout changement humain.
Selon les mots d'E. Gendlin (1965-1966), « ... il existe des faits, des situations et des conditions auxquels nous ne pouvons pas renoncer. Nous pouvons surmonter les situations en les interprétant et en agissant en conséquence, mais nous ne pouvons pas les choisir différentes. Il n’existe pas de liberté aussi magique que celle de simplement choisir d’être différent de ce que nous sommes. Sans mesures difficiles et exigeantes, nous ne pouvons pas nous libérer des restrictions qui nous sont imposées. »
En revanche, toute situation de vie comporte un certain nombre de degrés de liberté. La nature humaine est suffisamment flexible pour choisir librement ses propres méthodes d’action dans la vie, malgré toutes sortes de circonstances et conditions limitantes. Nous pouvons dire que la liberté signifie un choix constant entre des alternatives et, plus important encore, la création de nouvelles alternatives, ce qui est extrêmement important au sens psychothérapeutique. J.-P. Sartre (1948) s'exprimait de manière très catégorique : « Nous sommes condamnés à choisir... Ne pas choisir est aussi un choix : renoncer à la liberté et à la responsabilité. »
Les gens, y compris ceux qui se tournent vers un psychologue, confondent souvent possibilités ouvertes et nécessité limitante. Les clients insatisfaits de leur travail ou la vie de famille, leur situation est souvent considérée comme désespérée et irréparable, se plaçant dans la position de victime passive des circonstances. En réalité, ils évitent le choix, et donc la liberté.
À cet égard, l'un des principaux objectifs thérapie existentielle peut être considéré comme aidant le client à comprendre dans quelle mesure s'étend sa liberté de changer quelque chose dans une situation réelle, dans quelles difficultés ses difficultés ne peuvent pas être résolues à l'heure actuelle, dans quoi il se limite, interprétant sa situation comme insoluble et se mettant en la position d'une victime. R. May (1981) a appelé le but de toute psychothérapie le désir d'aider le client à se libérer des limitations et des conditionnements qu'il a lui-même créés, en l'aidant à voir des moyens de s'échapper de lui-même en bloquant ses opportunités dans la vie et en créant une dépendance extrême à l'égard des autres. circonstances et ses idées à leur sujet.
Ainsi, nous pouvons imaginer la liberté dans le contexte de la psychologie de la personnalité et de l'assistance psychologique comme une combinaison d'opportunités et de limitations dans une situation de vie spécifique pour une personne spécifique à l'heure actuelle. Comme le souligne E. van Deurzen-Smith (1988), nous pouvons parler de liberté dans la mesure où nous reconnaissons ou réalisons ce qui est impossible, ce qui est nécessaire et ce qui est possible. Cette compréhension vous aide à élargir votre vision de votre vie en analysant les possibilités et les limites – tant externes qu’internes – d’une situation de vie particulière.
La conscience de sa liberté s'accompagne de l'expérience anxiété. Comme l’écrit S. Kierkegaard (1980), « l’anxiété est la réalité de la liberté – en tant que virtualité qui précède la matérialisation de la liberté ». Souvent, les gens viennent chez un psychothérapeute avec un « esclave enchaîné à l’intérieur » et au cours du processus de psychothérapie, ils devront « grandir vers la liberté ». Cela provoque une anxiété sévère, tout comme l'apparition de sensations, d'expériences ou de situations nouvelles et inhabituelles, dont la rencontre entraîne des conséquences imprévisibles. Par conséquent, de nombreux clients en psychothérapie s'attardent longtemps avant le seuil des changements psychologiques et vitaux souhaités, n'osant pas le franchir. Il est difficile d’imaginer des changements sans une certaine émancipation et libération intérieure. D'où le paradoxe souvent rencontré dans la pratique psychologique : la coexistence chez une seule personne prise de conscience de la nécessité d'un changement Et le désir de ne rien changer à une vie souffrante mais établie. D’ailleurs, même après l’aide efficace d’un psychologue, les clients repartent souvent avec plus d’anxiété qu’ils ne l’étaient à leur arrivée, mais avec une anxiété qualitativement différente. Il devient source d’expérience aiguë du passage du temps, stimulant le renouvellement constant de la vie.
Selon K. Jaspers (1951), « … les limites donnent naissance à moi-même. Si ma liberté ne rencontre aucune frontière, je ne deviens rien. Grâce aux restrictions, je me sors de l’oubli et me fais exister. Le monde est plein de conflits et de violences que je dois accepter. Nous sommes entourés d’imperfections, d’échecs, d’erreurs. Nous n’avons souvent pas de chance, et si nous avons de la chance, ce n’est que partiellement. Même en faisant le bien, je crée indirectement le mal, car ce qui est bon pour l’un peut être mauvais pour un autre. Je ne peux accepter tout cela qu’en acceptant mes limites. Surmonter avec succès les obstacles qui nous empêchent de construire une vie libre et réaliste et faire face aux obstacles insurmontables nous donne un sentiment de force personnelle et de dignité humaine.
Le concept de « liberté » se retrouve souvent à côté des concepts de « résistance » et de « rébellion » – non pas dans le sens de destruction, mais dans le sens de préservation de l’esprit et de la dignité humaine. Cela peut aussi s’appeler apprendre à dire non et à respecter son non.
Le plus souvent, lorsque nous parlons de liberté, nous entendons la capacité de choisir des manières d'agir dans la vie, la « liberté de faire » (R. May). D’un point de vue psychothérapeutique, la liberté, que R. May (1981) qualifie d’« essentielle », est extrêmement importante. C'est la liberté de choisir votre attitude envers quelque chose ou quelqu'un. C'est la liberté essentielle qui constitue le fondement de la dignité humaine, puisqu'elle est préservée sous toutes restrictions et dépend moins des circonstances extérieures que de la disposition intérieure. (Exemple : la vieille femme cherche ses lunettes qui sont sur son nez).
Mais quelle que soit la liberté dont nous disposons, elle n’est jamais une garantie, mais seulement une chance de réaliser nos projets de vie. Cela doit être gardé à l'esprit non seulement dans la vie, mais aussi dans la pratique psychologique, afin qu'au lieu de certaines illusions, vous n'en créiez pas d'autres. Il est peu probable que nous et nos clients puissions un jour être totalement sûrs que nous utilisons la liberté de la meilleure façon possible. Vrai vie toujours plus riche et plus contradictoire que toutes les vérités généralisées, notamment celles obtenues à l'aide de manipulations psychothérapeutiques et techniques. Après tout, chacune de nos vérités n’est le plus souvent qu’une des interprétations possibles. situations de vie. Par conséquent, dans l'assistance psychologique, le client doit être aidé à accepter une certaine conditionnalité des choix qu'il fait - leur vérité conditionnelle par rapport à un moment précis et à des circonstances de vie spécifiques. C’est aussi la conditionnalité de notre liberté.
La subjectivité est la façon dont une personne expérimente sa liberté. Pourquoi donc?
Liberté et responsabilité, phénomène d'évasion de la liberté (selon E. Fromm).
Interprétation de la liberté personnelle dans diverses théories psychologiques.
1.5.3 Forces motrices du développement de la personnalité dans divers concepts.
Une analyse globale des théories de la personnalité doit bien entendu commencer par les concepts de l’homme développés par les grands classiques comme Hippocrate, Platon et Aristote. Une évaluation adéquate est impossible sans prendre en compte les contributions de dizaines de penseurs (par exemple Thomas d'Aquin, Bentham, Kant, Hobbes, Locke, Nietzsche, Machiavel, etc.) qui ont vécu à des époques intermédiaires et dont les idées peuvent être retracées dans l'époque moderne. des idées. Cependant notre objectif est de déterminer le mécanisme de formation et de développement de la personnalité, la formation des compétences professionnelles, civiles et qualités personnelles spécialiste, gestionnaire, leader. En conséquence, l’analyse des théories de la personnalité peut être personnage court, révélant les caractéristiques essentielles d'une théorie particulière.
En bref, les questions liées aux facteurs et aux forces motrices du développement de la personnalité peuvent être présentées comme suit.
Facteurs influençant le développement de la personnalité :
1. Biologique :
a) héréditaire - caractéristiques humaines inhérentes à l'espèce ;
b) congénital – conditions de vie intra-utérine.
2. Social – associé à l’homme en tant qu’être social :
a) indirect – environnement ;
b) direct – les personnes avec lesquelles une personne communique, un groupe social.
3. Propre activité - réaction à un stimulus, mouvements simples, imitation des adultes, activité indépendante, voie de maîtrise de soi, intériorisation - transition de l'action vers le plan interne.
forces motrices– résolution des contradictions, recherche de l’harmonie :
1. Entre besoins nouveaux et existants.
2. Entre les opportunités accrues et l’attitude des adultes à leur égard.
3. Entre les compétences existantes et les exigences des adultes.
4. Entre besoins croissants et opportunités réelles déterminées par l'équipement culturel et le niveau de maîtrise de l'activité.
Le développement de la personnalité est un processus de changement naturel de la personnalité en tant que qualité systémique d'un individu résultant de sa socialisation. Possédant des prérequis anatomiques et physiologiques pour le développement de la personnalité, dans le processus de socialisation, l'enfant interagit avec le monde extérieur, maîtrise les acquis de l'humanité (outils culturels, méthodes de leur utilisation), qui reconstruisent activités internes enfant, changer sa vie psychologique et ses expériences. La maîtrise de la réalité chez un enfant s'effectue par l'activité (contrôlée par un système de motivations inhérentes à un individu donné) avec l'aide des adultes.
Représentation dans les théories psychanalytiques(modèle homéostatique de Z. Freud, désir de surmonter le complexe d'infériorité en psychologie individuelle de A. Adler, idée des sources sociales du développement de la personnalité dans le néo-freudianisme de K. Horney, E. Fromm).
Représentation dans les théories cognitives(Théorie du champ psychologique Gestalt par K. Lewin sur le système de tension intrapersonnelle comme source de motivation, le concept de dissonance cognitive par L. Festinger).
L'idée d'une personnalité qui se réalise A. Maslow comme développement de la hiérarchie des besoins.
Présentation de la psychologie personnaliste G. Allport (homme comme système ouvert, la tendance à la réalisation de soi en tant que source interne de développement de la personnalité).
Représentation en psychologie archétypale K.G. Jung. Le développement de la personnalité comme processus d'individuation.
Le principe du développement personnel dans les théories domestiques. La théorie de l'activité de A. N. Leontiev, la théorie de l'activité de S. L. Rubinstein et l'approche sujet-activité de A. V. Brushlinsky, K. A. Abulkhanova, complexe et approche systémique B. G. Ananyeva et B. F. Lomova. Mécanismes volontaires et involontaires de développement de la personnalité.
6.1 Théorie psychanalytique de la personnalité de S. Freud.
Freud a été le premier à caractériser la psyché comme un champ de bataille entre les instincts irréconciliables, la raison et la conscience. Sa théorie psychanalytique illustre l'approche psychodynamique. Le concept de dynamique dans sa théorie implique que le comportement humain est complètement déterminé et que les processus mentaux inconscients ont grande importance dans la régulation du comportement humain.
Le terme « psychanalyse » a trois significations :
Théorie de la personnalité et psychopathologie ;
Méthode de thérapie pour les troubles de la personnalité ;
Une méthode d'étude des pensées et des sentiments inconscients d'un individu.
Ce lien entre la théorie, la thérapie et l'évaluation de la personnalité relie toutes les idées sur le comportement humain, mais derrière lui se cache un petit nombre de concepts et de principes originaux. Considérons d'abord les vues de Freud sur l'organisation de la psyché, sur ce qu'on appelle le « modèle topographique ».
Modèle topographique des niveaux de conscience.
Selon ce modèle, trois niveaux peuvent être distingués dans la vie mentale : la conscience, le préconscient et l'inconscient.
Le niveau de « conscience » est constitué de sensations et d’expériences dont nous sommes conscients dans ce moment temps. Selon Freud, la conscience ne contient qu'un petit pourcentage de toutes les informations stockées dans le cerveau et descend rapidement dans la région du préconscient et de l'inconscient lorsqu'une personne passe à d'autres signaux.
La zone du préconscient, la zone de la « mémoire accessible », comprend des expériences qui ne sont pas nécessaires pour le moment, mais qui peuvent revenir à la conscience spontanément ou avec un minimum d'effort. Le préconscient est un pont entre les zones conscientes et inconscientes du psychisme.
Le plus profond et zone importante l'esprit - l'inconscient. Il représente un référentiel de pulsions instinctives primitives ainsi que d'émotions et de souvenirs qui, pour diverses raisons, ont été refoulés de la conscience. Le domaine de l’inconscient détermine en grande partie notre fonctionnement quotidien.
Structure de la personnalité
Cependant, au début des années 20, Freud a révisé son modèle conceptuel de la vie mentale et a introduit trois structures principales dans l'anatomie de la personnalité : le ça, le moi et le surmoi. C'est ce qu'on appelait le modèle structurel de la personnalité, même si Freud lui-même était enclin à les considérer comme des processus plutôt que des structures.
Examinons de plus près les trois composants.
IDENTIFIANT.« La division du psychisme en conscient et inconscient est la prémisse principale de la psychanalyse, et elle seule lui donne l'opportunité de comprendre et d'introduire à la science les processus pathologiques fréquemment observés et très importants dans vie mentale. Freud attachait une grande importance à cette division : « ici commence la théorie psychanalytique ».
Le mot « ID » vient du latin « IT », dans la théorie de Freud, il fait référence aux aspects primitifs, instinctifs et innés de la personnalité tels que le sommeil, l'alimentation, la défécation, la copulation et dynamise notre comportement. Le ça a sa signification centrale pour l’individu tout au long de la vie, il n’a aucune restriction, il est chaotique. Étant la structure initiale de la psyché, le ça exprime le principe primordial de toute vie humaine - la décharge immédiate de l'énergie psychique produite par des impulsions biologiques primaires, dont la retenue conduit à des tensions dans le fonctionnement personnel. Cette décharge est appelée principe de plaisir. Soumis à ce principe et ignorant la peur ou l’anxiété, le ça, dans sa pure manifestation, peut constituer un danger pour l’individu et la société. Il joue également le rôle d'intermédiaire entre les processus somatiques et mentaux. Freud a également décrit deux processus par lesquels le ça soulage la personnalité des tensions : les actions réflexes et les processus primaires. Un exemple d’action réflexe est la toux en réponse à une irritation des voies respiratoires. Mais ces actions ne conduisent pas toujours à un soulagement du stress. Entrent alors en jeu des processus primaires qui forment des images mentales directement liées à la satisfaction du besoin fondamental.
Les processus primaires sont une forme illogique et irrationnelle des idées humaines. Elle se caractérise par une incapacité à supprimer les impulsions et à distinguer le réel de l’irréel. La manifestation d'un comportement en tant que processus primaire peut conduire à la mort de l'individu si sources externes satisfaction des besoins. Ainsi, selon Freud, les nourrissons ne peuvent retarder la satisfaction de leurs besoins primaires. Et seulement après avoir réalisé l'existence monde extérieur, la capacité de retarder la satisfaction de ces besoins apparaît. A partir du moment où cette connaissance apparaît, la structure suivante apparaît : l'ego.
EGO.(latin « ego » - « je ») Composant de l'appareil mental responsable de la prise de décision. L'ego, étant séparé du ça, puise une partie de son énergie pour transformer et réaliser des besoins dans un contexte socialement acceptable, assurant ainsi la sécurité et l'auto-préservation du corps. Il utilise des stratégies cognitives et perceptuelles dans ses efforts pour satisfaire les désirs et les besoins de la DI.
Le moi dans ses manifestations est guidé par le principe de réalité dont le but est de préserver l’intégrité de l’organisme en retardant la gratification jusqu’à trouver la possibilité de sa décharge et/ou des conditions environnementales appropriées. Le moi a été appelé par Freud un processus secondaire, « l’organe exécutif » de la personnalité, le domaine où se déroulent les processus intellectuels de résolution de problèmes. Libérer un peu d'énergie de l'ego pour résoudre davantage les problèmes haut niveau psychisme, est l’un des principaux objectifs de la thérapie psychanalytique.
Nous arrivons ainsi à la dernière composante de la personnalité.
SUR-MOI."Nous voulons faire du sujet de cette étude le Soi, notre Soi le plus propre. Mais est-ce possible ? " Après tout, le Soi est le sujet le plus authentique, comment peut-il devenir un objet ? Et pourtant, c’est sans doute possible. Je peux me prendre comme un objet, me traiter comme les autres objets, m'observer, critiquer et Dieu sait quoi faire d'autre de moi-même. En même temps, une partie du Soi s'oppose au reste du Soi, donc le Soi est démembré, il est démembré dans certaines de ses fonctions, au moins pour un temps... Je pourrais simplement dire que le spécial L'autorité que je commence à distinguer dans le Soi est la conscience, mais il serait plus prudent de considérer cette autorité comme indépendante et de supposer que la conscience est l'une de ses fonctions, et l'auto-observation, nécessaire comme condition préalable à l'activité judiciaire de la conscience, est son autre fonction. Et comme, reconnaissant l’existence indépendante d’une chose, il est nécessaire de lui donner un nom, j’appellerai désormais cette autorité dans le Moi « Sur-Moi ».
C'est ainsi que Freud a imaginé le Surmoi - la dernière composante de la personnalité en développement, signifiant fonctionnellement un système de valeurs, de normes et d'éthiques raisonnablement compatibles avec celles acceptées dans l'environnement de l'individu.
Étant la force morale et éthique de l’individu, le surmoi est la conséquence d’une dépendance prolongée à l’égard des parents. « Le rôle que le Surmoi endosse plus tard est d’abord rempli force externe, autorité parentale... Le surmoi, qui assume ainsi le pouvoir, le travail et même les méthodes de l'autorité parentale, n'est pas seulement son successeur, mais en réalité l'héritier direct légitime.
Ensuite, la fonction de développement est assumée par la société (école, pairs, etc.). On peut également considérer le Surmoi comme un reflet individuel de la « conscience collective » de la société, même si les valeurs de la société peuvent être déformées par la perception de l’enfant.
Le Surmoi est divisé en deux sous-systèmes : la conscience et l’idéal du moi. La conscience s'acquiert grâce à la discipline parentale. Cela inclut la capacité d'auto-évaluation critique, la présence d'interdits moraux et l'émergence de sentiments de culpabilité chez l'enfant. L’aspect gratifiant du Surmoi est l’idéal du Moi. Elle se forme à partir des évaluations positives des parents et amène l'individu à établir haute qualité. Le Surmoi est considéré comme pleinement formé lorsque le contrôle parental est remplacé par la maîtrise de soi. Cependant, le principe de maîtrise de soi ne sert pas le principe de réalité. Le Surmoi dirige une personne vers la perfection absolue dans ses pensées, ses paroles et ses actions. Il tente de convaincre l’ego de la supériorité des idées idéalistes sur les idées réalistes.
Mécanismes de défense psychologique
Protection psychologique– un système de stabilisation de la personnalité visant à éliminer ou minimiser le sentiment d'anxiété lié à la conscience du conflit.
S. Freud a identifié huit mécanismes de défense principaux.
1). La suppression (refoulement, refoulement) est l'élimination sélective de la conscience d'expériences douloureuses qui ont eu lieu dans le passé. Il s’agit d’une forme de censure qui bloque les expériences traumatisantes. La répression n'est jamais définitive ; elle est souvent à l'origine de maladies physiques de nature psychogène (maux de tête, arthrite, ulcères, asthme, maladies cardiaques, hypertension, etc.). L'énergie mentale des désirs refoulés existe dans le corps humain quelle que soit sa conscience et trouve son expression corporelle douloureuse.
2). Le déni est une tentative de ne pas accepter comme réalité les événements qui dérangent le « je » (un événement inacceptable ne s'est pas produit). C'est une évasion dans un fantasme qui semble absurde à l'observation objective. "Cela ne peut pas être" - une personne fait preuve d'indifférence à l'égard de la logique, ne remarque pas de contradictions dans ses jugements. Contrairement au refoulement, le déni opère à un niveau préconscient plutôt qu’inconscient.
3). La rationalisation est la construction d'une conclusion logiquement incorrecte, réalisée dans un but d'autojustification. ("Peu importe que je réussisse ou non cet examen, je serai de toute façon expulsé de l'université"); (« Pourquoi étudier assidûment, de toute façon, cette connaissance est en Travaux pratiques ne sera pas utile"). La rationalisation cache les véritables motivations et rend les actions moralement acceptables.
4). L'inversion (formation d'une réaction) est le remplacement d'une réaction inacceptable par une autre de sens opposé ; substitution de pensées, de sentiments qui correspondent à un désir authentique, par des comportements, des pensées, des sentiments diamétralement opposés (par exemple, un enfant veut d'abord recevoir l'amour et l'attention de la mère, mais, ne recevant pas cet amour, commence à éprouver exactement désir opposé d'ennuyer, de mettre en colère la mère, de provoquer une querelle et de la haine de la mère envers soi-même). Les options d'inversion les plus courantes : la culpabilité peut être remplacée par un sentiment d'indignation, la haine par le dévouement, le ressentiment par une surprotection.
5). La projection est l’attribution de ses propres qualités, pensées et sentiments à une autre personne. Quand quelque chose est condamné chez les autres, c'est précisément ce qu'une personne n'accepte pas en elle-même, mais ne peut pas l'admettre, ne veut pas comprendre que ces mêmes qualités lui sont inhérentes. Par exemple, une personne déclare que « certaines personnes sont des trompeurs », même si cela pourrait en réalité signifier « je trompe parfois ». Une personne, éprouvant un sentiment de colère, accuse une autre d'être en colère.
6). L'isolement est la séparation de la partie menaçante de la situation du reste de la sphère mentale, ce qui peut conduire à une séparation, une double personnalité. Une personne peut se retirer de plus en plus dans l’idéal, étant de moins en moins en contact avec ses propres sentiments. (Il n'y a pas de dialogue interne lorsque diverses positions internes de l'individu reçoivent le droit de vote).
7). La régression est un retour à une manière de répondre antérieure et primitive. S'éloigner de la pensée réaliste pour adopter un comportement qui atténue l'anxiété et la peur, comme dans l'enfance. La source de l’anxiété reste entière en raison du caractère primitif de la méthode. Tout écart par rapport à un comportement raisonnable et responsable peut être considéré comme une régression.
8). La sublimation est le processus de transformation de l'énergie sexuelle en formes d'activité socialement acceptables (créativité, contacts sociaux) (dans ses travaux sur la psychanalyse de L. da Vinci, Freud considère son travail comme une sublimation).
Développement personnel
L’une des prémisses de la théorie psychanalytique est qu’une personne naît avec une certaine quantité de libido, qui passe ensuite par plusieurs étapes dans son développement, appelées étapes de développement psychosexuel. Le développement psychosexuel est une séquence biologiquement déterminée qui se déroule dans un ordre invariable et est inhérente à tous, quel que soit le niveau culturel.
Freud a proposé une hypothèse autour de quatre étapes : orale, anale, phallique et génitale. Lors de l’examen de ces étapes, plusieurs autres facteurs introduits par Freud doivent être pris en compte.
Frustration. En cas de frustration, les besoins psychosexuels de l’enfant sont supprimés par les parents ou les éducateurs et ne trouvent donc pas de satisfaction optimale.
Surprotection. En cas de surprotection, l'enfant n'a pas la capacité de gérer ses propres fonctions internes.
Dans tous les cas, il y a une accumulation de libido qui, à l’âge adulte, peut conduire à des comportements « résiduels » liés au stade où s’est produite la frustration ou la régression.
Les concepts importants de la théorie psychanalytique sont également la régression et la fixation. Régression, c'est-à-dire un retour au stade le plus précoce et la manifestation d'un comportement enfantin caractéristique de cette période. Bien que la régression soit considérée comme un cas particulier de fixation - un retard ou un arrêt du développement à un certain stade. Les adeptes de Freud considèrent la régression et la fixation comme complémentaires.
STADE ORALE. La phase orale dure de la naissance jusqu'à environ 18 mois. Durant cette période, il est totalement dépendant de ses parents, et la zone buccale est associée à la concentration de sensations agréables et à la satisfaction des besoins biologiques. Selon Freud, la bouche reste une zone érogène importante tout au long de la vie d'une personne. La phase orale se termine à l’arrêt de l’allaitement. Freud a décrit deux types de personnalité lors de la fixation à ce stade : oral-passif et oral-agressif.
STADE ANAL. Le stade anal débute à l’âge de 18 mois et se poursuit jusqu’à la troisième année de vie. Pendant cette période, les jeunes enfants éprouvent un plaisir considérable à retarder l'expulsion des selles. Au cours de cette étape de l'apprentissage de la propreté, l'enfant apprend à faire la différence entre les exigences du ça (le plaisir de déféquer immédiatement) et les restrictions sociales émanant des parents (le contrôle indépendant des besoins). Freud pensait que toutes les formes futures de maîtrise de soi et d’autorégulation provenaient de cette étape.
STADE Phallique. Entre trois et six ans, les intérêts liés à la libido se déplacent vers la région génitale. Au cours de la phase phallique du développement psychosexuel, les enfants peuvent explorer leurs organes génitaux, se masturber et s'intéresser aux questions liées à la naissance et aux relations sexuelles. Les enfants, selon Freud, ont au moins une vague idée des relations sexuelles et, pour la plupart, comprennent les rapports sexuels comme des actions agressives du père envers la mère.
Le conflit dominant de cette étape chez les garçons s’appelle le complexe d’Œdipe, et le conflit similaire chez les filles est le complexe d’Électre.
L’essence de ces complexes réside dans le désir inconscient de chaque enfant d’avoir un parent du sexe opposé et dans l’élimination d’un parent du même sexe.
PERIODE DE LATENCE. Entre 6 et 7 ans et le début de l'adolescence, il y a une phase de calme sexuel, la période de latence.
Freud a prêté peu d'attention aux processus au cours de cette période, car à son avis, l'instinct sexuel était censé être en sommeil à cette époque.
STADE GÉNITALE. Phase initiale Le stade génital (la période qui s'étend de l'âge adulte jusqu'à la mort) est caractérisé par des changements biochimiques et physiologiques dans le corps. Le résultat de ces changements est une excitabilité accrue et une activité sexuelle accrue caractéristiques des adolescents.
En d’autres termes, l’entrée dans le stade génital est marquée par la satisfaction la plus complète de la pulsion sexuelle. Le développement conduit normalement au choix d'un partenaire de mariage et à la création d'une famille.
Le caractère génital est le type de personnalité idéal dans la théorie psychanalytique. La décharge de la libido lors des rapports sexuels offre la possibilité d'un contrôle physiologique des impulsions provenant des organes génitaux. Freud a dit que pour qu'un caractère génital normal se forme, une personne doit abandonner la passivité caractéristique de l'enfance, lorsque toutes les formes de satisfaction étaient faciles.
La théorie psychanalytique de Freud est un exemple d'approche psychodynamique de l'étude du comportement humain. La théorie considère le comportement humain comme étant entièrement déterminé et dépendant de conflits psychologiques internes. De plus, cette théorie considère la personne dans sa globalité, c'est-à-dire d'un point de vue holistique, puisqu'elle s'appuie sur la méthode clinique. D'une analyse de la théorie, il s'ensuit que Freud, plus que d'autres psychologues, était attaché à l'idée d'immuabilité. Il était convaincu que la personnalité d’un adulte se forme à partir des expériences de la petite enfance. De son point de vue, les changements survenant dans le comportement d'un adulte sont superficiels et n'affectent pas les changements dans la structure de la personnalité.
Estimant que la sensation et la perception du monde environnant par une personne sont purement individuelles et subjectives, Freud a suggéré que le comportement humain est régulé par le désir de réduire l'excitation désagréable qui survient au niveau du corps lorsqu'un stimulus externe se produit. La motivation humaine, selon Freud, repose sur l'homéostasie. Et comme il croyait que le comportement humain est entièrement déterminé, cela permet de l'étudier pleinement avec l'aide de la science.
La théorie de la personnalité de Freud a servi de base à la thérapie psychanalytique, utilisée aujourd'hui avec succès.
6.2 Psychologie analytique de C. G. Jung.
À la suite de la refonte de la psychanalyse par Jung, tout un ensemble d'idées complexes sont apparues à partir d'une telle différentes régions des connaissances telles que la psychologie, la philosophie, l'astrologie, l'archéologie, la mythologie, la théologie et la littérature.
Cette étendue d’exploration intellectuelle, associée au style d’écriture complexe et énigmatique de Jung, explique pourquoi sa théorie psychologique est l’une des plus difficiles à comprendre. Comprenant ces difficultés, nous espérons néanmoins que courte introduction avec les vues de Jung servira de point de départ pour une lecture plus approfondie de ses œuvres.
Structure de la personnalité
Jung soutenait que l'âme (un terme analogue à la personnalité dans la théorie de Jung) est composée de trois structures distinctes mais en interaction : la conscience, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif.
Le centre de la sphère de conscience est l’ego. C'est une composante de la psyché, qui comprend toutes ces pensées, sentiments, souvenirs et sensations à travers lesquels nous ressentons notre intégrité, notre constance et nous percevons en tant que personnes. L’ego sert de base à notre conscience de soi et grâce à lui nous sommes capables de voir les résultats de nos activités conscientes ordinaires.
L’inconscient personnel contient des conflits et des souvenirs qui étaient autrefois conscients mais qui sont désormais réprimés ou oubliés. Cela inclut également les impressions sensorielles qui ne sont pas assez brillantes pour être notées dans la conscience. Ainsi, le concept jungien de l’inconscient personnel est quelque peu similaire à celui de Freud.
Cependant, Jung est allé plus loin que Freud, en soulignant que l'inconscient personnel contient des complexes, ou des accumulations de pensées, de sentiments et de souvenirs chargés d'émotion, apportés par l'individu de son passé. expérience personnelle ou d'une expérience ancestrale et héréditaire.
Selon les idées de Jung, ces complexes, disposés autour des thèmes les plus courants, peuvent avoir une influence assez forte sur le comportement d'un individu. Par exemple, une personne ayant un complexe de pouvoir peut dépenser une quantité importante d’énergie mentale dans des activités directement ou symboliquement liées au thème du pouvoir. La même chose peut être vraie pour une personne fortement influencée par sa mère, son père, ou sous le pouvoir de l'argent, du sexe ou de tout autre type de complexe. Une fois formé, le complexe commence à influencer le comportement et l’attitude d’une personne. Jung soutenait que le matériel de l’inconscient personnel de chacun de nous est unique et, en règle générale, accessible à la conscience. En conséquence, des composantes du complexe, voire l’ensemble du complexe, peuvent devenir conscients et avoir une influence excessivement forte sur la vie de l’individu.
Enfin, Jung suggère l’existence d’une couche plus profonde dans la structure de la personnalité, qu’il appelle l’inconscient collectif. L’inconscient collectif est un dépositaire de traces mémorielles latentes de l’humanité et même de nos ancêtres anthropoïdes. Il reflète des pensées et des sentiments communs à tous les êtres humains et résultant de notre passé émotionnel commun. Comme le disait Jung lui-même, « l’inconscient collectif contient tout l’héritage spirituel de l’évolution humaine, renaissant dans la structure du cerveau de chaque individu ». Ainsi, le contenu de l'inconscient collectif se forme en raison de l'hérédité et est le même pour toute l'humanité. Il est important de noter que le concept d’inconscient collectif était la principale raison des différences entre Jung et Freud.
Archétypes.
Jung a émis l’hypothèse que l’inconscient collectif est constitué d’images mentales primaires puissantes, appelées archétypes (littéralement « modèles primaires »). Les archétypes sont des idées ou des souvenirs innés qui prédisposent les gens à percevoir, expérimenter et réagir aux événements d'une certaine manière.
En réalité, il ne s'agit pas de souvenirs ou d'images en tant que tels, mais plutôt de facteurs prédisposants sous l'influence desquels les gens mettent en œuvre des modèles universels de perception, de pensée et d'action dans leur comportement en réponse à tout objet ou événement. Ce qui est inné ici, c'est la tendance à réagir émotionnellement, cognitivement et comportementalement à des situations spécifiques, par exemple une rencontre inattendue avec un parent, un être cher, un étranger, un serpent ou la mort.
Parmi les nombreux archétypes décrits par Jung figurent la mère, l'enfant, le héros, le sage, la divinité solaire, le voyou, Dieu et la mort (tableau 4-2).
Jung croyait que chaque archétype est associé à une tendance à exprimer un certain type de sentiment et de pensée par rapport à un objet ou une situation correspondant. Par exemple, la perception qu'un enfant a de sa mère contient des aspects de ses caractéristiques réelles qui sont teintés par des idées inconscientes sur des attributs maternels archétypaux tels que l'éducation, la fertilité et la dépendance. En outre, Jung a suggéré que les images et les idées archétypales se reflètent souvent dans les rêves et se retrouvent également souvent dans la culture sous la forme de symboles utilisés dans la peinture, la littérature et la religion. Il a notamment souligné que les symboles caractéristiques des différentes cultures présentent souvent des similitudes frappantes car ils renvoient à des archétypes communs à toute l’humanité. Par exemple, dans de nombreuses cultures, il a rencontré des images de mandala, qui sont des incarnations symboliques de l'unité et de l'intégrité du « je ». Jung croyait que la compréhension des symboles archétypaux l'aidait à analyser les rêves d'un patient.
Le nombre d'archétypes dans l'inconscient collectif peut être illimité. Cependant, dans le système théorique de Jung, une attention particulière est accordée au personnage, à l'anime et à l'animus, à l'ombre et au soi.
Persona (du mot latin signifiant « masque ») est notre visage public, c'est-à-dire la façon dont nous nous montrons dans nos relations avec les autres. Persona désigne de nombreux rôles que nous jouons conformément aux exigences sociales. Selon Jung, un personnage a pour but d'impressionner les autres ou de cacher sa véritable identité aux autres. Le personnage en tant qu’archétype est nécessaire pour nous entendre avec les autres dans la vie de tous les jours.
Cependant, Jung a averti que si cet archétype devient trop important, une personne peut devenir superficielle, réduite à un rôle et éloignée de la véritable expérience émotionnelle.
Contrairement au rôle que joue le personnage dans notre adaptation au monde qui nous entoure, l’archétype de l’ombre représente le côté sombre, mauvais et animal refoulé de la personnalité. L’ombre contient nos pulsions sexuelles et agressives socialement inacceptables, nos pensées et nos passions immorales. Mais l’ombre a aussi des propriétés positives.
Jung considérait l'ombre comme la source de vitalité, de spontanéité et de créativité dans la vie d'un individu. Selon Jung, la fonction de l'ego est de canaliser l'énergie de l'ombre, de freiner le côté nocif de notre nature à tel point que nous pouvons vivre en harmonie avec les autres, mais en même temps exprimer ouvertement nos impulsions et profiter une vie saine et créative.
Les archétypes d'anima et d'animus expriment la reconnaissance par Jung de la nature androgyne innée des personnes. L'anima représente l'image intérieure d'une femme chez un homme, son côté féminin inconscient, tandis que l'animus est l'image intérieure d'un homme chez une femme, son côté masculin inconscient. Ces archétypes reposent, au moins en partie, sur le fait biologique que les hommes et les femmes produisent à la fois des hormones mâles et femelles. Selon Jung, cet archétype avait évolué au fil des siècles dans l’inconscient collectif à la suite d’expériences avec le sexe opposé. De nombreux hommes ont été « féminisés », au moins dans une certaine mesure, par des années de mariage avec des femmes, mais l'inverse est vrai pour les femmes. Jung a insisté sur le fait que l'anima et l'animus, comme tous les autres archétypes, doivent s'exprimer harmonieusement, sans perturber l'équilibre général, afin que le développement de l'individu vers la réalisation de soi ne soit pas entravé. En d’autres termes, un homme doit exprimer ses qualités féminines en même temps que ses qualités masculines, et une femme doit exprimer ses qualités masculines en même temps que ses qualités féminines. Si ces attributs nécessaires restent sous-développés, le résultat sera une croissance et un fonctionnement unilatéral de la personnalité.
Le Soi est l’archétype le plus important dans la théorie de Jung. Le Soi est le noyau de la personnalité autour duquel tous les autres éléments sont organisés et intégrés. Lorsque l’intégration de tous les aspects de l’âme est réalisée, une personne fait l’expérience de l’unité, de l’harmonie et de la plénitude. Ainsi, selon Jung, le développement de soi est l’objectif principal de la vie humaine. Nous reviendrons plus tard sur le processus de réalisation de soi, lorsque nous examinerons le concept d'individuation de Jung.
Orientation vers l'ego
La contribution la plus célèbre de Jung à la psychologie est considérée comme sa description de deux orientations ou attitudes principales : l'extraversion et l'introversion. Selon la théorie de Jung, les deux orientations coexistent chez une personne en même temps, mais l'une d'elles devient généralement dominante. L’attitude extravertie manifeste l’orientation de l’intérêt vers le monde extérieur – les autres personnes et les objets. Un extraverti est mobile, bavard, établit rapidement des relations et des attachements ; les facteurs externes sont pour lui le moteur. Un introverti, quant à lui, est immergé dans le monde intérieur de ses pensées, sentiments et expériences. Il est contemplatif, réservé, aspire à la solitude, a tendance à se retirer des objets, son intérêt est porté sur lui-même. Selon Jung, les attitudes extraverties et introverties n’existent pas isolément. Habituellement, ils sont tous deux présents et opposés l’un à l’autre : si l’un apparaît comme dirigeant et rationnel, l’autre agit comme auxiliaire et irrationnel. Le résultat de la combinaison des orientations du moi dirigeantes et auxiliaires donne des individus dont les modèles de comportement sont spécifiques et prévisibles.
Fonctions psychologiques
Peu de temps après que Jung ait formulé les concepts d'extraversion et d'introversion, il est arrivé à la conclusion que ces deux orientations opposées ne pouvaient pas expliquer suffisamment toutes les différences dans les attitudes des gens envers le monde. Il a donc élargi sa typologie pour inclure les fonctions psychologiques. Les quatre fonctions principales qu’il a identifiées sont la pensée, la sensation, le ressenti et l’intuition.
Jung a classé la pensée et le sentiment comme fonctions rationnelles, car ils nous permettent de former des jugements sur l’expérience de vie.
Le type pensant juge la valeur de certaines choses en utilisant la logique et des arguments. La fonction opposée à la pensée – le sentiment – nous renseigne sur la réalité dans le langage des émotions positives ou négatives.
Le type sentiment se concentre sur le côté émotionnel des expériences de vie et juge la valeur des choses en termes de « bon ou mauvais », « agréable ou désagréable », « motivant ou ennuyeux ». Selon Jung, lorsque la pensée agit comme fonction principale, la personnalité se concentre sur la construction de jugements rationnels dont le but est de déterminer si l'expérience évaluée est vraie ou fausse. Et lorsque la fonction principale est le ressenti, la personnalité se concentre sur le fait de juger si cette expérience est principalement agréable ou désagréable.
Jung a qualifié la deuxième paire de fonctions opposées - sensation et intuition - d'irrationnelles, car elles « saisissent » simplement passivement et enregistrent les événements du monde externe (sensation) ou interne (intuition), sans les évaluer ni expliquer leur signification. La sensation est une perception directe, sans jugement et réaliste du monde extérieur. Les types sensoriels sont particulièrement perspicaces en ce qui concerne le goût, l’odorat et d’autres sensations provenant des stimuli du monde qui les entoure. En revanche, l’intuition se caractérise par une perception subliminale et inconsciente de l’expérience actuelle. Le type intuitif s'appuie sur des prémonitions et des suppositions pour saisir l'essence des événements de la vie. Jung a soutenu que lorsque la sensation est la fonction principale, une personne perçoit la réalité dans le langage des phénomènes, comme si elle la photographiait. D'un autre côté, lorsque la fonction principale est l'intuition, une personne réagit aux images inconscientes, aux symboles et au sens caché de ce qui est vécu.
Chaque personne est dotée des quatre fonctions psychologiques.
Cependant, tout comme une orientation de la personnalité (extraversion ou introversion) est généralement dominante et consciente, de même, une seule fonction du couple rationnel ou irrationnel est généralement dominante et consciente. D’autres fonctions baignent dans l’inconscient et jouent un rôle de soutien dans la régulation du comportement humain. N’importe quelle fonction peut être leader. En conséquence, des types d’individus pensant, ressentant, ressentant et intuitifs sont observés. Selon la théorie de Jung, la personnalité intégrée ou « individualisée » utilise toutes les fonctions opposées pour faire face aux circonstances de la vie.
Deux orientations du moi et quatre fonctions psychologiques, en interaction, forment huit types de personnalité différents. Par exemple, un type de pensée extraverti se concentre sur des questions objectives importance pratique faits du monde environnant. Il apparaît généralement comme une personne froide et dogmatique qui vit selon des règles établies. Il est fort possible que le prototype du type de pensée extravertie soit Freud. Le type intuitif introverti, au contraire, est centré sur la réalité de soi. monde intérieur. Ce type est généralement excentrique, se tient à l’écart des autres et leur est indifférent. Dans ce cas, Jung pensait probablement à lui-même comme prototype.
Développement personnel
Contrairement à Freud, qui attachait une importance particulière aux premières années de la vie en tant qu'étape décisive dans la formation des comportements individuels, Jung considérait le développement de la personnalité comme un processus dynamique, comme une évolution tout au long de la vie. Il n'a presque rien dit sur la socialisation dans l'enfance et ne partageait pas l'opinion de Freud selon laquelle seuls les événements passés (en particulier les conflits psychosexuels) déterminent le comportement humain. Du point de vue de Jung, une personne acquiert constamment de nouvelles compétences, atteint de nouveaux objectifs et se réalise de plus en plus pleinement. Il attachait une grande importance à l’objectif de vie d’un individu tel que « acquérir l’individualité », qui est le résultat du désir d’unité de diverses composantes de la personnalité. Ce thème du désir d’intégration, d’harmonie et d’intégrité a ensuite été repris dans les théories existentielles et humanistes de la personnalité.
Selon Jung, l'ultime le but de la vie- c'est la réalisation complète du « Je », c'est-à-dire la formation d'un individu unique, unique et intégral.
Le développement de chaque personne dans cette direction est unique, il se poursuit tout au long de la vie et comprend un processus appelé individuation. En termes simples, l’individuation est un processus dynamique et évolutif d’intégration de nombreuses forces et tendances intrapersonnelles opposées. Dans son expression ultime, l'individuation présuppose la prise de conscience par une personne de sa réalité psychique unique, le plein développement et l'expression de tous les éléments de la personnalité. Ainsi, l’archétype du soi devient le centre de la personnalité et équilibre les nombreuses qualités opposées qui composent la personnalité comme un tout unique. Cela libère l’énergie nécessaire à une croissance personnelle continue. Le résultat de l'individuation, très difficile à atteindre, Jung l'appelle la réalisation de soi. Il pensait que cette dernière étape du développement de la personnalité n'était accessible qu'à des personnes capables et hautement instruites qui disposaient également de suffisamment de loisirs pour cela. En raison de ces limitations, la réalisation de soi n’est pas accessible à la grande majorité des gens.
Commentaires finaux
S'éloignant de la théorie de Freud, Jung a enrichi nos idées sur le contenu et la structure de la personnalité. Bien que ses concepts d’inconscient collectif et d’archétypes soient difficiles à comprendre et ne puissent être vérifiés empiriquement, ils continuent de captiver de nombreuses personnes. Sa compréhension de l’inconscient en tant que source riche et vitale de sagesse a suscité une nouvelle vague d’intérêt pour sa théorie parmi la génération moderne d’étudiants et de psychologues professionnels. De plus, Jung fut l’un des premiers à reconnaître la contribution positive de l’expérience religieuse, spirituelle et même mystique au développement personnel. C'est son rôle particulier en tant que prédécesseur du courant humaniste en personologie. Nous nous empressons d'ajouter cela dans dernières années Parmi la communauté intellectuelle des États-Unis, on constate une popularité croissante de la psychologie analytique et un accord avec bon nombre de ses dispositions. Les théologiens, philosophes, historiens et représentants de nombreuses autres disciplines trouvent les idées créatives de Jung extrêmement utiles dans leur travail.
6.3 Psychologie individuelle d'A. Adler.
administrateurLa liberté et le concept de « liberté » sont une question éternelle, d’actualité à tout moment. La liberté est un aspect très controversé de la vie, qui suscite beaucoup de jugements et de controverses, car les réalités de la vie sont telles que le concept de « liberté » est différent pour chacun.
Dans le même temps, la liberté personnelle est un concept à multiples facettes. La liberté s'exprime dans l'aspect économique, dans la liberté d'action. Il existe d'autres types de libertés : libertés politiques, spirituelles et autres.
Les penseurs et les philosophes ont tenté de comprendre la liberté, en donnant au concept différentes interprétations.
T. Hobbes croyait que le sens de la liberté est qu'une personne libre n'a aucun obstacle à l'action. I. Bentham croyait que les lois détruisaient la liberté. Les existentialistes affirmaient que l’homme était libre dès la naissance. N. Berdiaev - qu'une personne est initialement libre et qu'il est impossible de la retirer. J.P. Satre voyait le sens de la liberté dans la préservation de l'essence humaine.

Liberté ou responsabilité
Un autre aspect de la liberté personnelle est la nécessité et l'opportunité. Une personne n'est pas libre de choisir les conditions, mais en même temps, elle n'est pas libre de choisir les moyens de les mettre en œuvre.
La liberté est un attribut du développement personnel, mais si une personne n’a pas la responsabilité de la liberté de choix, cela s’appelle de l’arbitraire.
Une personne vit dans une société, sa liberté est comparée aux libertés des autres citoyens, ce qui signifie qu'elle caractérise un individu spécifique. Entre les concepts de « liberté » et le concept de « responsabilité », nous pouvons mettre en toute sécurité un signe égal. Plus une personne se sent libre dans la société, plus sa responsabilité de l'utiliser dans la société est élevée.
Théorie de base
La définition philologique de la liberté dit que ses origines remontent aux racines sanscrites, ce qui en traduction sonne comme « bien-aimé ». Ils parlent de liberté de la manière suivante : si une personne est capable de choisir, de penser et d’agir de manière indépendante à sa propre discrétion, elle est libre.
Pour comprendre la liberté, il faut se familiariser avec deux types de cette définition : le volontarisme et le fatalisme.
Les origines de la liberté volontariste disent qu’une personne est libre de la nécessité, du devoir. Le fatalisme définit la liberté comme un hommage. Une personne ne change rien, mais accepte tout comme un hommage.
Le fatalisme détermine que la liberté est involontaire et n'est pas permise à tout le monde, car les actions humaines sont limitées par des frontières - naturelles, culturelles, socio-historiques, politiques, le niveau de développement de l'individu ou le pays dans lequel il est né. Elle est limitée par les lois objectives du développement de la nature et de la société, lois que l’homme ne peut annuler.
Autres définitions - le concept juridique de liberté est qu'une personne se trouve au niveau législatif avec des justifications claires pour agir. Cela inclut la liberté d'expression, etc. Le concept juridique de liberté est interprété comme des actions humaines qui ne causent pas de préjudice à autrui lorsqu'une personne obéit à la loi et aux règles établies.
L’aspect économique de la liberté la définit comme s’engager dans tout type d’activité, assumer la responsabilité et le risque de son choix, de ses activités.

Existe-t-il une liberté inconditionnelle ?
Dès la naissance, une personne est libre et ce droit lui est inaliénable. Une personne grandit, se développe, entre en contact avec environnement, société. Le sentiment interne de liberté s'estompe progressivement et devient dépendant des circonstances et d'autres facteurs.
Malheureusement ou heureusement pour la personne elle-même, il n’existe pas de liberté absolue. Parce que même en vivant en ermite, une personne est obligée de prendre soin de son abri, de sa nourriture et de ses vêtements. Ceux qui vivent dans la civilisation obéissent d'autant plus aux normes adoptées par les lois.
Comment devenir une personne libre ?
La liberté personnelle commence par soi-même. Il n'est pas nécessaire de se libérer de ses proches, des choses, du cours des événements et des autres objets de la vie ; au contraire : il faut bien comprendre que la liberté vient en quelque sorte de l'intérieur d'une personne. Il est important de donner des conseils internes.
La libération interne commence par la suppression des restrictions, assurée par l'esprit et le subconscient. Le critère le plus important pour supprimer les restrictions est la rationalité des actions.
La libération de ses propres instincts et réflexes permet à une personne de les contrôler et de prendre le pouvoir sur eux. De plus, en contrôlant ses propres réflexes et instincts, une personne reçoit des « bonus » - contrôle et justesse de son propre comportement en société, prévention des actions ambiguës.
Une personne libre ne connaît pas de régime. Elle est sensible à son corps et à son écoute. Il n'est pas nécessaire de respecter un horaire de sommeil et de nutrition, de repos et autres. Il y a la liberté des réflexes secondaires, ainsi que leur contrôle. En occupant une telle position, l'individu reçoit plus d'énergie de la nourriture, son repos devient meilleur et sa productivité devient bien meilleure.
Il est important pour un individu d’être libre de complexes, notamment de. Après tout, c’est en fait la principale liberté que beaucoup de gens passent beaucoup de temps à acquérir. Un complexe d’infériorité est énergivore, il « dévore » l’individu de l’intérieur. Un complexe d'infériorité naît d'expériences négatives qu'une personne cache en elle-même.
La liberté personnelle se définit par l’élimination du pouvoir des émotions. La vraie liberté, c'est lorsqu'une personne agit sans l'influence de ses propres émotions. Après tout, tombant sous leur influence, une personne agit inconsciemment, parfois mal, regrettant souvent ce qui s'est passé en conséquence. Après quoi un autre complexe est certainement généré. Dans le cas de l’absence d’émotions, il est important de ne pas en faire trop. Les sentiments en eux-mêmes sont beaux, le principe irrationnel pousse une personne à créer. Mais si les émotions prennent le pas sur la raison, alors un danger surgit pour la personne elle-même et son environnement.
Le contrôle n’est pas facile, mais il est nécessaire, systématiquement et lentement. Pour commencer, comme dans le cas des complexes, il est important d’identifier le problème et de l’accepter. Pour mieux comprendre la nature de vos émotions, vous devez prendre du recul par rapport au problème et vous regarder de l'extérieur, comme de l'extérieur. L'observateur pourra alors voir ses actions, ainsi que la manifestation excessive de sentiments en tant que spectateur. Ils peuvent être raisonnés logiquement, une explication et une évaluation de ses propres actions peuvent être données. À un moment donné, vos propres actions deviendront ridicules et ridicules.
Une autre liberté est de s’affranchir du paradoxe logique d’être un adulte sans tuer l’enfant qui sommeille en soi. Après tout, par essence, les enfants ne sont pas limités, leur esprit n’est pas brouillé, ils n’ont aucun préjugé.

Comment comprendre votre propre liberté
Vous pouvez déterminer la liberté personnelle en répondant honnêtement à cinq questions :
Suis-je une personne indépendante ? Un individu peut-il se développer, apprendre et expérimenter de nouvelles choses de manière indépendante, s'arrête-t-il au résultat obtenu, avance-t-il.
Est-ce que je fais quelque chose qui deviendra une source de revenus permanents ? Une personne réussit lorsque tout dans la vie est rempli d’amour, en particulier le travail. Si une personne fait un travail qu’elle n’aime pas, elle n’est certainement pas heureuse. UN homme malchanceux ne gagne pas la liberté, parce qu’il est « lié » par la nécessité ou le besoin.
Ma pensée est-elle libre de toute influence extérieure ? Un individu peut-il penser de manière indépendante, quelles que soient les circonstances et les autres ?
Est-ce que je lis beaucoup de livres ? Les livres sont une excellente source de développement. Vous pouvez commencer par comprendre les biographies de personnes célèbres qui, au cours de leur vie. Cela n'ajoutera pas de liberté, mais cela vous indiquera dans quelle direction vous déplacer.
, pensées et sentiments? Une personne qui se sent et en même temps son propre maître est libre.
Une personne libre fait ce qu'elle veut, ce qu'elle veut. Une telle personne se démarque des autres, elle n'est pas comme les autres, car elle vit selon son propre programme spécifique, qui n'est pas imposé par des étrangers.
16 mars 2014, 14:38Le problème de la liberté en psychologie domestique
En Russie à la fin du XIXe – début du XXe siècle. la catégorie de liberté, comme indiqué ci-dessus, a été envisagée dans les travaux des philosophes russes - P. E. Astafiev, N. A. Berdyaev, N. O. Lossky, Vl. Soloviev et autres. Dans les pages de la revue « Questions de philosophie et de psychologie » (dont le rédacteur était N. Ya. Grot à partir de 1885), ainsi que dans « Actes de la société psychologique », des articles étaient constamment publiés, reflétant l'intensité des discussions sur la question. du libre arbitre et du déterminisme, les idées sur la liberté dans la littérature classique allemande ont été discutées. Avec développement sciences psychologiques, exigeant l'unité de la compréhension théorique et de la recherche empirique, la liberté s'affirmait dans le statut d'un phénomène mental - une qualité d'une personne ; Le sujet d'étude n'était plus tant la liberté elle-même, mais son porteur - la personne qui s'efforce de l'obtenir. La collaboration de philosophes et de psychologues a donné naissance à une culture particulière d'étude de la liberté dans la science psychologique nationale (manifestée le plus clairement dans les travaux de S. L. Rubinstein) et a conduit à l'émergence d'un espace sémantique unique pour comprendre et étudier la liberté, dans lequel les deux philosophiques et les vecteurs psychologiques de la connaissance sont énoncés.
Merci au premier ( philosophique), ses capacités d’analyse des diverses relations de l’homme avec le monde s’affirment et se révèlent base méthodologique compréhension de la liberté, principes du déterminisme, unité de la conscience et de l'activité, activité ; dans un raisonnement libre, non contraint par le cadre d'un école scientifique, une profonde connaissance existentielle à ce sujet est révélée.
Deuxième - psychologique un vecteur qui représente le sujet (cognitif, agissant, expérimentant, interagissant avec autrui) comme unité d'analyse de tous les phénomènes mentaux, et combinant donc les fondements ontologiques, épistémologiques et axiologiques pour comprendre la liberté dans sa dimension humaine, permet sur le la base de méthodes objectives confirme les idées philosophiques à ce sujet, révèle de nouveaux aspects et manifestations dans la vie humaine. Dans la psychologie domestique du XXe siècle. Les étapes suivantes peuvent être distinguées dans l’étude de la liberté.
Stade I : fin du X I X – milieu des années 30. XXe siècle Les idées de liberté se retrouvent dans les travaux des scientifiques suivants :
– M.I. Vladislavleva – sur la liberté en tant que capacité d’une personne à contrôler ses actions ;
– M. M. Troitsky à propos de la question de la dépendance personnelle et sociale ;
– N. Ya. Grot – sur la dépendance du libre arbitre à l'égard de la conscience de soi et de la condition humaine ;
– I.P. Pavlov, physiologiste russe qui a découvert les réflexes de liberté et de soumission, qu'il croyait caractéristiques non seulement des animaux, mais aussi des humains ;
– D. N. Uznadze – sur la conscience, la capacité de la personnalité à objectiver (libération de l'attitude) ;
– A.F. Lazursky – sur le type de personnes qui s'adaptent à leurs objectifs le monde;
– L. S. Vygotsky – sur le rôle de la conscience, de la fantaisie et de la capacité de former des concepts pour atteindre la liberté.
Stade II : milieu de la trentaine – début des années 90. XXe siècle(périodes de régime totalitaire, stagnation survenue après le court dégel de Khrouchtchev et ce qu'on appelle la perestroïka). Depuis le milieu des années 30. XXe siècle En raison du changement radical des circonstances sociopolitiques, le thème de la liberté humaine dans la psychologie russe était pratiquement clos. Cela n’est pas surprenant, car non seulement agir librement, mais aussi penser à la liberté était dangereux ; toute manifestation de libre pensée était punie ; le peuple devait se soumettre à l'obéissance servile, au travail servile, se réjouir devant le chef et le père de tous les temps et de tous les peuples, et se montrer fier des avantages du mode de vie soviétique. Le thème de la liberté en tant qu'indépendant de 1936 à 1990. n'a pas été développé en Russie. Nous devons rendre hommage au courage d'éminents scientifiques nationaux qui, non sans risque pour eux-mêmes, pendant une période difficile pour le pays et la science, marquée par une interdiction non seulement de l'étude de la liberté, mais aussi de la libre pensée, ont osé lever le problème de la liberté humaine dans leurs ouvrages consacrés à la physiologie des mouvements humains (N A. Bernstein), aux principes du déterminisme, à l'unité de la conscience et de l'activité (S. L. Rubinstein). De manière totalement infondée, ces éminents scientifiques ont été accusés de cosmopolitisme (S. L. Rubinstein - en 1947, N. A. Bernstein - en 1949), leurs travaux n'ont pas été acceptés pour publication ; ils ont ensuite été démis de leurs fonctions.
Lors de la session « Pavlovsk » (années 50 du XXe siècle) sur la science psychologique, qui n’avait pas encore repris ses esprits après la résolution dévastatrice du Comité central du Parti communiste des bolcheviks de toute l’Union de 1936. « Sur les perversions pédologiques dans le système du Commissariat du Peuple à l'Éducation », les scientifiques devaient adhérer aux enseignements de I. P. Pavlov sur réflexes conditionnés- conduire analyse scientifique activité humaine adaptative. M. G. Yaroshevsky dans le livre « La psychologie au 20e siècle » note la popularité de la version née après la séance « pavlovienne » parmi certains psychologues étrangers : « … comme si le soutien apporté par le parti et le gouvernement à I. P. Pavlov s'expliquait par une tentative de développer, sur la base de ses idées, un plan étatique de gestion des personnes basé sur des réflexes conditionnés. Cette version, inventée par Bauer, a malheureusement été soutenue par certains chercheurs sérieux, notamment Skinner. L'hypothèse de Bauer, bien sûr, est loin d'être vraie, même si certains phénomènes de la vie de notre pays étaient étonnamment similaires aux situations (façons de gérer les gens) décrites dans le roman de J. Orwell « 1984 » - cinq minutes et semaines de haine envers l'ennemi de Big Brother, une réaction défensive (trahison) face à la peur dans la salle 101 et autres. En effet, bien avant la séance « pavlovienne », se sont produits des phénomènes qui, à un examen superficiel, ressemblent à la manifestation d'une adaptation s'apparentant à un réflexe conditionné. Ainsi, la proclamation d’une autre victime comme ennemi du peuple s’est accompagnée d’une réaction immédiate et constante de condamnation acerbe et impitoyable de la part d’une immense masse de personnes. Tout ce qui était occidental, outre-mer (réalisations scientifiques, technologiques, artistiques) était qualifié de « bourgeois » (philosophie bourgeoise, psychologie bourgeoise, art bourgeois, etc.) et provoquait une réaction négative. Il existe de nombreux exemples, mais il ne s'agit pas des réflexes conditionnés pavloviens, mais de l'idéologie stalinienne (obéissance inconditionnelle, exécution des ordres, etc.), qui a été inculquée au cours de ces années. Le pire, c'est que la personne n'aurait pas dû y penser, se rendre compte de ce qui se passait. Ce n'est pas un hasard si dans la science psychologique, comme le note V.P. Zinchenko, les problèmes de l'activité étaient en avance sur le thème de la conscience. Quant au problème de la liberté, sans doute associé à la prise de conscience, au fil des années du régime totalitaire, dans de nombreux ouvrages, il a perdu de sa profondeur, se transformant en une liste de preuves de la liberté humaine sous le socialisme. Avec une réelle réduction de la liberté sous toutes ses formes, les mythes sur la liberté ont prospéré dans le pays, ce qui a ralenti les processus de compréhension et de réalisation pendant plus d'une décennie.
Dans le même temps, certains écrivains et personnalités publiques (A. Soljenitsyne, V. Tendryakov, A. Sakharov et d'autres) tentent encore de dissiper les illusions d'une liberté imaginaire. Beaucoup d’entre eux ont souffert pour leur courage, mais ont eu une influence inestimable sur la conscience de soi. grande quantité de personnes. Pendant la période du « Printemps de Prague », le physicien nucléaire alors peu connu A. Sakharov a commencé à travailler sur le livre « Réflexions sur le progrès, la coexistence pacifique et la liberté intellectuelle » (le livre a été publié au samizdat en 1986, dans la revue «Questions de philosophie», il a été publié pour la première fois en 1990. ). Il y écrit avec inquiétude quant à la menace qui pèse sur la liberté intellectuelle, c'est-à-dire interne, sur l'indépendance, les valeurs. personnalité humaine, le sens de la vie humaine dans notre pays. Les dangers de la perte de liberté incluent non seulement la guerre, la pauvreté, la terreur, mais aussi « l'abrutissement d'une personne... par la culture de masse avec une diminution intentionnelle ou commerciale du niveau intellectuel et de la résolution de problèmes, en mettant l'accent sur divertissement ou utilitarisme avec une censure soigneusement protectrice. Dans le système éducatif, il y a le danger d'un changement d'attrait, d'un certain rétrécissement du champ des discussions et de l'audace intellectuelle des conclusions à l'âge où se forment les croyances.
Stade III : début des années 90. XXe siècle - Jusqu'à maintenant. Au cours de cette période, évidemment, non sans l'influence de l'évolution de la situation sociopolitique et des processus de démocratisation amorcés en Russie, le problème de la liberté a été relancé dans la psychologie nationale, mais déjà au niveau de la pose du thème de la liberté comme un thème indépendant. un, nécessitant un travail théorique et expérimental approfondi. Le phénomène de la liberté a commencé à être abordé : V. P. Zinchenko dans ses travaux sur l'essence d'un mouvement vivant, K. A. Abulkhanova-Slavskaya - sur le choix d'une stratégie de vie. Au début des années 1990. Nous avons proposé une approche réflexive-activité pour comprendre le phénomène de la liberté et mené une étude empirique de ses manifestations individuelles (absence de frustration, liberté de créativité dans des conditions d'interaction démocratiques et autoritaires). Durant cette période, des travaux sur la liberté humaine du psychologue russo-américain V. Lefebvre ont été publiés en Russie, qui présentaient un modèle réflexif d'un sujet libre.
Sur scène moderne développement de la science psychologique nationale et le développement de la Russie, son autodétermination en tant que pays démocratique, il est important non seulement de généraliser les connaissances sur la liberté proposées par les penseurs - philosophes et psychologues de différentes époques et pays, mais aussi de ne pas perdre ce est précieux ce qui a été réalisé dans la compréhension de la liberté dans la psychologie de notre pays du XXe siècle. Les idées conceptuelles des psychologues nationaux sur la liberté sont pertinentes et ouvrent des perspectives pour d'autres réflexions théoriques et Recherche expérimentale le phénomène de la liberté.
Le problème de la liberté en psychologie domestique - concept et types. Classification et caractéristiques de la catégorie « Le problème de la liberté en psychologie domestique » 2017, 2018.